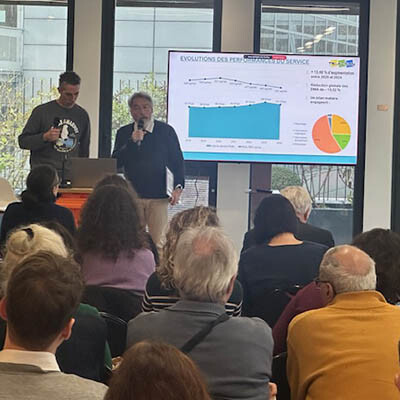- Speaker #0
Merci à toutes et à tous. Nous nous retrouvons cet après-midi pour plusieurs regards croisés, présentations et retours d'expérience. Les premiers sont autour, au nombre de trois, entre l'Institut Paris Région et la Région Île-de-France, et autour de la question de la modélisation des zones d'impact des projets et des équipements. J'ai l'honneur d'accueillir Séverine Albe Tersiguel qui est de l'Institut Paris Région, Stéphanie Lecellier également de l'Institut Paris Région et Christophe Libert de la région Île-de-France qui vont vous présenter Ma Région Près de Chez Moi, l'équipomètre et puis la logique toute à 20 minutes autour du SDRIF E. Et sans plus attendre, je te laisse la parole Christophe.
- Speaker #1
Donc on va parler de Ma Région Près de Chez Moi. Donc Ma région près de chez moi c'est une application qui vient de sortir, qui est accessible sur Ile-de-France.fr depuis quelques jours, semaines. Donc l'idée c'est que fait la région dans ma commune ou à proximité de la commune. Ce sont donc toutes les actions localisables, financées ou menées avec l'aide de la région depuis 2016. Donc là on parle d'actions territorialisées évidemment en Ile-de-France. Donc ça exclut de fait toutes les actions, l'action internationale plus un certain nombre d'actions qui ne sont pas localisables. Donc Ma Région Près de Chez Moi qui est accessible soit sur Ile-de-France, soit depuis l'adresse ma-région-près-de-chez-moi.fr. Donc ça permet soit de renseigner le nom d'une commune. et de voir après toutes les actions qui ont été menées sur la commune ou toutes les actions sur une thématique, si vous êtes intéressé par la ruralité, le patrimoine, la sécurité, la culture, toutes les thématiques, toutes les compétences, voire plus, de la région. Et donc, on arrive sur une fiche. Donc là, je vous ai pris, je ne sais pas s'il y a des cupressiens dans la salle, qui est le gentilet de couvrer, cupressien ou cupressienne. Donc les Couvray, la ville de Couvray de Seine-et-Marne, on voit qu'il y a 185 actions qui ont été menées par la région. Et quand on clique sur l'action, alors moi je suis un peu aveugle, je suis désolé, la réalisation d'un ensemble sportif à Couvray, on affiche donc une fiche détail sur l'action. Donc on s'est fait accompagner de mon ami Lya. donc de l'IA générative qui a généré, en fait, on va voir à partir de quel document, des éléments de cette fiche sont générés automatiquement par l'IA, à savoir le titre, la localisation partiellement, on va l'aborder, un résumé de l'action et la liste des actions similaires. Tout le reste, on va dire que c'est de l'habillage, de la communication. Donc là, si on prend notre exemple de la réalisation d'un ensemble sportif à Couvray, si on remonte un peu... Alors déjà, Couvray, si je fais cette recherche, on a un module des actes administratifs. Donc c'est tous les rapports qui sont votés par la région, en commission permanente, en conseil régional. Donc on a un légifrance, entre guillemets, régional, où on peut accéder à tous les textes votés. Si je rentre Couvray, j'ai 22 documents trouvés. Donc c'est un peu pour vous montrer la puissance de l'IA. C'est que grâce à l'IA, on voit que ce n'est pas que 22 documents, mais c'est 185 actions qui sont listées dans ma région près de chez moi. Alors comment est-ce possible ? Alors qu'a priori, on travaille sur les mêmes documents. En fait, le trésor de la région, la région cache son trésor, vraiment son précieux. Il est caché dans des annexes. C'est assez incroyable. Les rapports CP, les rapports en commission permanente, qui va être la politique générale régionale du sport, par exemple, eh bien en fait, tout ce qui est intéressant, entre guillemets, évidemment les politiques vont dire autre chose, mais les fiches projets concrètes sont en annexe des projets. Et ça ne fait pas partie, on va dire, du corpus de notre légifrance régionale. Nous, on va chercher simplement dans la délibération la décision politique. Mais en fait, on a des fiches qu'on voit à droite, où là, on retrouve notre fiche de couvret avec la construction d'un ensemble sportif. Et si je remonte encore un peu plus le chemin... Ça vient initialement d'un système d'information des subventions qu'on appelle IRIS. Alors pourquoi on utilise l'IA ? Vous allez me dire, parce que franchement, vous avez tous les éléments. En fait, dans IRIS, c'est un outil fait gérer par les métiers, par des gestionnaires. Ce ne sont pas des communicants. Donc parfois, les titres sont compréhensibles que par eux, on va dire. Il y a des sigles, il y a des abréviations. C'est un outil de fonctionnement, c'est un outil de travail. Donc là, on sort l'outil d'Iris de sa vocation de gestion en communication, ce qui est un peu compliqué parfois. Donc l'IA nous aide à traduire, on va dire, le langage administratif dans un langage compréhensible par un francilien moyen. Alors, on va passer assez rapidement, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais c'était pour vous montrer un peu où l'IA intervient. En fait, ce qu'on donne en entrée, c'est les données, les fiches iris, les fameuses fiches iris. On lui donne aussi des données complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on explique à l'IA, par exemple, les sigles. On utilise, alors à la région, on adore les sigles. Comme toutes les collectivités, on utilise plein de sigles. Mais en plus, parfois, on a des sigles qui, d'une direction à l'autre, ne signifient pas tout à fait la même chose, même pas du tout la même chose. Donc il faut bien qu'on explique à l'IA que dans tel cadre, dans le cadre culturel, Ce sigle signifie telle chose, alors que dans l'agriculture, ça signifie autre chose. Donc il faut qu'on lui apprenne toute cette taxonomie, tout cet environnement syntaxique et toutes nos spécificités. Il faut aussi qu'on lui apprenne les communes, les intercos, etc. Sachant que toutes les intercos dans les délibérations sont par sigle. Donc je vous souhaite bon courage, moi-même, je ne parle pas le sigle... Enfin voilà, c'est assez compliqué. Donc l'IA essaye de traduire ça. Et donc voilà, on traduit les titres et on utilise des langages. On a travaillé avec une société externe évidemment. Moi je ne suis pas développeur. Et donc pour travailler sur les titres, les résumés, les localisations, les similarités. Et on a aussi essayé de classifier les typologies d'action. Essayer de retirer le côté domaine et de classer construction d'un bâtiment. Après, si je construis d'un bâtiment plus lycée, on peut imaginer que c'est la construction d'un lycée, si on n'est pas trop bête. Et après, construction sport égale peut-être gymnase ou égale quelque chose, en tout cas un équipement sportif. Voilà, on a fait cette classification et après on a tout un travail de validation, d'anonymisation, de transformation de nom des communes. On travaille depuis 2016, donc on a le plaisir aussi... On va dire des événements sur les communes, puisqu'il y a des communes qui n'existent plus depuis 2016. Courcouronne a fusionné avec Évry, Évry-Courcouronne. Donc il faut aussi prendre en compte tous ces aspects. On enrichit les données et on publie ces données. Donc ces données seront publiées aussi en open data, car accessoirement je suis responsable open data à la région. Maintenant, on va parler un peu du problème de la ou des localisations. C'est un souci, mais qui est permanent à la région. C'est comment localiser une action. En fait, je vais casser un peu l'ambiance, je suis désolé. C'est le moment un peu lourd. On m'a dit, non, il faut un moment être un peu sérieux. Donc, on a commémoré les 80 ans de Auschwitz. On organise, depuis 2010, un partenariat avec le Mémorial de la Shoah, et on organise des voyages de mémoire avec les lycéens, on emmène certains lycéens à Auschwitz, avec un accompagnement évidemment avec des projets pédagogiques. Bon voilà, ça c'est le moment un peu dur de la... Désolé. Donc l'idée, c'est comment je localise cette action. En fait, le problème, c'est qu'on a un point de vue logistique qui va dire, c'est simple, c'est localisé à Auschwitz, puisque les gens vont à Auschwitz. Et on a des actions, en effet, qui sont, on a aussi un devoir de mémoire avec le camp d'internement de Drancy. Et dans le système, dans Iris, il y a parfois localisation Drancy. Mais on pourrait aussi se dire, et ça existe aussi, mais en fait, tout cohabite et rien n'est faux dans tout ça. C'est que le lieu du bénéficiaire de la subvention, celui qui organise, c'est le mémorial de la Shoah qui est à Paris 4ème. Donc j'ai quelques actions même à Drancy, certaines sont à Drancy et parfois d'autres sont à Paris 4e. Mais après on pourrait se dire aussi, et là c'est les métiers, c'est plutôt les lycées, le pôle lycée va dire « ouais non mais attendez, vous êtes bien gentil, mais moi en fait c'est les établissements qui comptent. Donc moi c'est l'établissement, c'est mon lycée de Provins. » Après qui a raison ? Le problème c'est que tout ça cohabite en fait. Donc il faut bien tenir compte, il peut y avoir dans ma région près de chez moi, parfois des petits soucis de localisation. Et on a essayé avec l'IA de récupérer, de redresser ces données, mais clairement on n'y est pas arrivé encore à 100%. Parce que les dossiers parfois ne mentionnent pas l'adresse par exemple des lycées. On va nous dire, mémorial de la Shoah, une aide avec différentes actions, mais on ne nous liste pas les lycées. Donc on n'a pas cette action. L'IA, on ne lui donne pas, elle ne fait pas des miracles. Si on ne lui donne pas la donnée, elle ne va pas la générer. Elle nous en a généré, elle nous fait des hallucinations parfois. Et justement, on veut essayer d'éviter ça. Après, on a vu la localisation, mais on peut se dire aussi que ces voyages ont peut-être un impact plus large que la simple localisation. En fait, quels sont les citoyens, des communes proches, qui sont impactés ? Proches par rapport à quoi ? On va faire un petit... Je vais faire une petite coupure, un petit focus sur les lycées, pour vous rappeler que, enfin pour vous apprendre peut-être, en fait il y a 470 lycées publics qui touchent une dotation par la région. Donc 470 lycées pour 1265 communes, si je compte les arrondissements, 1285 communes. Ça veut dire qu'il y a 1040 communes en Ile-de-France. qui n'ont pas de lycée. Est-ce que pour autant, quand je fais ma région près de chez moi, et que je fais une action qui est située au fin fond de la Seine-et-Marne, ou au fin fond de l'Essonne, ou au fin fond des Yvelines, ou à Paris, deuxième arrondissement, qui n'a pas de lycée, est-ce que pour autant, les habitants, les citoyens, les jeunes de ces villes-là ne vont pas au lycée ? J'en doute un peu. Évidemment. Donc on a bien un impact de ces lycées sur des communes avoisinantes. Ce qui est pratique avec les lycées, c'est qu'on peut visualiser... En fait, il y a des lycées de secteur. En fait, un lycée de secteur, c'est un lycée... Je vous le dis parce que je l'ai appris en même temps. Moi, j'apprends plein de choses. Je suis humble là-dessus parce que j'ai appris plein de choses. En fait, un lycée de secteur, c'est un lycée qui propose une seconde générale. Donc ça veut dire que dans les 470 lycées, il faut retirer au moins un tiers des lycées professionnels, qui ne sont pas des lycées de secteur. Il faut retirer les lycées qui ne préparent pas, qui ne proposent pas une seconde générale. Et donc si je reprends Provins, mon exemple de Provins tout à l'heure, donc qui a fait son voyage, en fait... Pourquoi j'ai pris Provins, ce lycée, le lycée Polyvalent-Hibaud de Champagne ? C'est le lycée qui est le lycée du secteur du maximum de communes en Ile-de-France. Il représente 78 communes. Les habitants de 78 communes vont dans ce lycée. Prioritairement, ils sont renvoyés. Évidemment, ça ne représente pas une population importante. On est sur 55 000 habitants. Mais ça veut dire que, typiquement, toutes les communes avoisinantes, même un peu plus qu'avoisinantes, vous le voyez. Et si je prends chaque lycée sectorisé le plus important dans la Grande Couronne, on est sur un sixième des communes franciliennes. Quatre lycées, un sixième des communes franciliennes. Plus de 200 communes franciliennes qui vont dans quatre lycées. Donc, on voit bien que l'impact, malgré tout, il fallait qu'on tienne compte de ces éléments. On peut prendre... Alors je vais quand même expliquer qu'on a pour Paris la petite couronne et les lycées non sectorisés. Un lycée professionnel, par exemple, ce n'est pas sectorisé. Parce qu'en effet, il y a certains lycées qui ne préparent qu'à un métier. Si le lycée est à Courbevoie, si j'habite à Étampes, j'ai le droit d'aller à Courbevoie, j'ai le droit de me déplacer, puisque c'est le seul lycée qui propose un métier. Donc il n'y a pas de sectorisation. À Paris, la sectorisation, il y a une sectorisation, mais elle est très spécifique. En fait, grosso modo, ils peuvent aller n'importe où, puisqu'il y a trois niveaux. C'est moins de 25 minutes en transport, moins de 40 minutes en transport. à Paris, donc moins de 40 minutes, déjà on l'a couvert pas mal. Et puis en fait, il y a même un troisième niveau qui est tous les autres lycées. Alors tous les autres, sauf le lycée Louis-le-Grand et le lycée Henri IV, et Pierre-Gilles de Gênes, qui sont hors secteur. Ça ne va pas être commentaire, mais donc ceux-là... Donc ceux-là, là c'était difficile de se dire, on va favoriser la sectorisation. Parce que, grosso modo, même le pôle lycée m'a dit, mais prends, quand tu es sur une commune pour la Petite-Coronne et Paris, tu mets tous les lycées. J'ai dit non, sur une fiche, on ne va pas mettre tous les lycées d'Île-de-France, enfin de quatre départements. Ça va devenir totalement invisible. Mais en réalité, c'est assez vrai. La zone d'impact, elle est très, très large. Mais là, pour cette version de ma région près de chez moi, on a favorisé la localisation de l'établissement. Dans une V2, on favorisera sûrement, puisqu'on a aussi une donnée sur le lieu de domicile des lycéens. Donc on a cette donnée qu'on pourra toujours utiliser dans un second temps. Parce qu'elle a ses limites, notamment pour le 94, le Val-de-Marne. En fait, là je rentre carrément, je vous fais un cours sur les lycées. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste des lycées, mais dans le 94, on peut dire qu'il y a une ville sur deux qui n'a pas de lycée. Donc ça commence à devenir un peu critique. Alors si je prends les transports, en fait, là encore, on est sur un peu la même histoire. Là, j'ai repris des données de IDFM, c'est les données sur les gares et stations du réseau ferré. Donc réseau ferré, RER, train, métro, tramway, je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, il y a encore un autre, enfin bon, peu importe, parce qu'après, de toute façon, ça... Ça ne va pas concerner la Grande Couronne. En fait, on a 925 communes quand même qui n'ont pas de gare. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne se déplacent pas ? Ce sont des gens qui ne se déplacent pas en transport. Parce qu'ils peuvent prendre leur voiture, ça c'est sûr. Ça, ils prennent leur voiture, j'en suis convaincu. Moi, j'habite dans la Grande Couronne, je prends ma voiture ou mon scooter. Mais ça, c'est évident. Mais par contre, de là à prendre les transports, on voit quand même qu'il y a des zones grises. Les zones grises, là, pour vous dire, ce sont les zones où il n'y a aucune ligne. Et après, du plus clair au plus sombre, reclère, c'est une gare, deux gares et trois et plus. Bon, Paris, évidemment, est hors sujet, parce que là, on n'avait pas la donnée par arrondissement. Mais bon, de toute façon, on est évidemment sur une densité impressionnante. Moi, je pars sur des questions, parce que moi, en fait, je n'ai pas de réponse à vous apporter. Mais moi, j'imagine, c'est qu'une supposition, on a sur la ligne P du train, on a deux gares, la gare de l'Est et Coulomiers. On peut imaginer, déjà que pour Coulomiers, qui est le terminus de cette tronçon de la ligne P, on peut imaginer que Coulomiers... vu l'offre de transport à l'est de Coulomiers, a une zone d'impact un poil plus large que sa commune. Un poil. Peut-être même très large. Mais c'est qu'une supposition. Moi, je n'ai pas d'élément factuel. La gare de l'Est, le problème, c'est que si je dis une zone d'impact d'une gare, c'est 10 km, un périmètre, ou 30 minutes. Le problème, c'est que si j'applique la même zone d'impact à la gare de l'Est, évidemment, ça va me poser un problème, parce que là, sinon, je vais englober... La gare de l'Est, elle va apparaître sur toutes les fiches de toutes les communes de la Petite-Coronne, quasiment. Et ça, ça pose un problème. Nous, on est sur la proximité. Tout le monde ne passe pas par la gare de l'Est tous les matins. Donc là, on a un... On a un souci, mais c'est une question. Moi, voilà, c'est comment on va pouvoir résoudre ce problème de l'impact des transports. Sachant que, évidemment, s'il y a des travaux dans la gare de l'Est, ça peut avoir un impact quasiment sur toute l'île de France, potentiellement. Mais après, on est sur ma ville, ma région, près de chez moi. Donc on va éviter tout ce qui concerne l'ensemble de l'île de France. Parce que je me vois mal mettre toutes les stations ou gares de Paris sur la commune qui est en bordure de la région en Seine-et-Marne. Pour cette version de ma région près de chez moi, on n'a pas travaillé sur de l'isochrone et du temps de parcours, mais on a travaillé... Ce n'est pas satisfaisant, mais on va l'améliorer. On a travaillé plutôt sur des rayons de villes limitrophes. Il y a les actions infracommunales, les actions qui sont proches, les villes limitrophes. Et après, on remonte comme ça le rayon jusqu'à 10 km. Et en fait, on va situer une action de 0 à 10 km par rapport au point central de la commune. Sachant que toutes les actions, on ne les a pas localisées forcément au POI. On les a à la commune, parfois on n'a pas l'adresse exacte aussi. Parce que parfois, on peut aussi avoir une action qui peut être en bordure de plusieurs communes. On a évidemment aussi l'intercommunalité qui est importante, parce qu'on a certaines thématiques, déchets, l'eau, etc. Où c'est plus, les actions sont souvent liées à l'interco. Donc c'est tout ça qu'on a mixé, en fait, ou que j'ai mixé. Et en fait, pour l'instant, on a adapté ça, j'ai adapté ça sur les dispositifs de la région. Alors depuis 2016, ça fait plus de 600 dispositifs. Et donc on a... appliquer une zone d'impact par dispositif, qui n'est pas toujours satisfaisant, puisqu'au sein d'un même dispositif, évidemment, il peut y avoir des actions plus ou moins importantes. C'est-à-dire que si je vous donne un exemple culturel... C'est un peu une tarte à la crème que je lance à chaque fois. Dans les actions d'événements, on peut organiser dans le même dispositif, Solidaze, et puis la rencontre avec l'écrivain local à la médiathèque de Melun. Je n'ai rien contre la médiathèque de Melun, ni contre l'écrivain local, mais on peut imaginer que la zone d'impact ne doit pas être totalement la même entre Solidaise et... même si elle est difficilement... même pour solidaires puisque ce qu'on pourrait presque dire que c'est national voir voir plus mais voilà on a beaucoup de difficultés avec les gros événements donc pour cette version en tout cas on a très mal on a travaillé comme ça mais tout en Sachant que, voilà, moi je suis convaincu que l'impact, en fait, c'est une combinaison forcément de plusieurs variables, ce qui va me permettre de passer la main après, juste derrière, à l'Institut. Donc, moi, de ce que je vois de mon petit niveau de gestionnaire Open Data, c'est donc que... clairement, et en fonction des 40 000 actions que j'ai pu croiser, je ne les connais pas toutes par cœur, évidemment, mais rentrent dans l'équation, donc la localisation de l'action, ça évidemment, clairement, sur quel type de commune je suis, est-ce que je suis dans l'hypercentre, quelles sont les communes environnantes, et le type de communes environnantes, la proximité de polarité, aussi de transport, de gros pôles transports qui génèrent sûrement une certaine densité. la densité de la population, mais qui va souvent avec la typologie de commune. La typologie de l'action, alors ça c'est une vraie question. Est-ce que construction de bâtiments, organisation d'un événement, création d'une œuvre, etc. Ce sont des typologies que nous avons définies grâce à l'IA. Est-ce que ça va pouvoir nous aider ? Pour l'instant, ça reste à prouver. Le domaine, évidemment, transport, culture, environnement, etc. La densité de l'offre dans la thématique. Après, il y a des sectorisations spécifiques, comme je vous l'ai montré avec les lycées. Là, clairement, il faut qu'on s'appuie sur la sectorisation lycée. Mais il y a également pour la sécurité, quand on aide un commissariat, on sait qu'un commissariat peut répondre à quelques communes, mais pas à toutes les communes avoisinantes. Le temps de trajet, plus que la distance, et le budget, qui peut être un élément, quand je parle de... La médiathèque de Melun versus Solidaze, clairement c'est le budget qui me permet de montrer que, dans un cas on nous demande 10 000 euros, dans l'autre on nous demande 700 000 euros. Je peux imaginer peut-être que ça a un impact, en tout cas ça modifie l'impact de l'action. Et un élément je pense que je n'ai pas vu beaucoup, c'est le problème de la date et de la temporalité. Moi je suis convaincu, alors d'abord la date, déjà même pour un équipement, en fait un équipement, son environnement. évolue avec le temps. C'est-à-dire qu'un équipement qui a été voté en 2016, peut-être que c'était une époque où il y avait peu d'offres, je sais pas moi, d'équipements sportifs par exemple, mais qu'entre temps il y a eu beaucoup de réalisations de nouveaux équipements qui modifient son impact. Et de la même façon, la région, on finance énormément d'événements. Un événement passé a moins d'impact. Enfin, me semble-t-il, moi je l'ai vu moi personnellement en regardant ma commune, la flamme n'est pas passée dans l'orge, enfin pas à côté de ma commune en tout cas, et en fait j'avais plein de... alors les actions quittaient à 5 ou je ne sais plus combien de kilomètres, et je voyais oui qu'elle était passée, mais quand c'était avant l'événement, le passage de la flamme avait un impact fort. Maintenant, ça devient plus un parasite, j'exagère, mais dans ma fiche commune, de voir que oui, ok, c'est passé à Viry-Châtillon, bon, so what, voilà. Et donc les événements, avec le temps, je pense, diminuent, la zone d'impact diminue, ce qui permet de prioriser aussi la future édition par rapport à une édition 2016. Voilà à peu près ce que je voulais aborder avec vous sur ma région près de chez moi. Je ne sais pas si vous avez des questions.
- Speaker #0
Oui, on peut prendre quelques questions et sur ce partage de plein de questions.
- Speaker #1
Oui, bonjour. J'avais une question sur à qui s'adressait cette application. Est-ce que c'était plutôt pour le grand public ou plutôt pour les agents internes ? Quels étaient les utilisateurs qui étaient ciblés par cette application ? Merci. Je pense que... La vocation, elle est double. Alors, clairement, la commande venait de la communication externe. Donc, c'est un outil qui est valorisé à l'occasion de la mi-mandat de la présidente. Donc, il s'appuie là-dessus pour montrer toute l'action de la région, plutôt vis-à-vis d'un grand public. C'est pour ça qu'on a demandé à l'IA de retraduire des titres ou des résumés, parce que sinon, pour un grand public... Il y a beaucoup de choses qui sont incompréhensibles. Maintenant, je pense qu'elles peuvent avoir un intérêt en interne, parce que, comme je l'ai montré, le module des actes administratifs, par exemple, ça peut être un moyen aussi de retrouver des actions, parce qu'aller chercher des données dans les actes administratifs, au fait, c'était dans quel rapport on avait voté le gymnase, machin, au moins, ça peut avoir peut-être cette vocation. Et la zone d'impact, je pense qu'elle est autant, ça peut être autant un élément interne qu'externe, me semble-t-il. Oui, comment vous avez géré les subventions qui sont multicommunes ? Des fois, c'est une action, un projet pour plusieurs communes en même temps. Et c'est difficile de localiser du coup. Très bonne question. On a mis toutes les communes qui sont concernées. En fait, dans la localisation, on peut avoir des actions sur lesquelles il y a 70 communes qui sont situées. Notamment, c'est un peu le parti qu'on a pris sur les PNR, les parcs naturels, qui concernent toutes les communes qui constituent. Alors parfois, il y a des actions localisées sur une ville du PNR, mais sinon, par défaut, c'est toutes les communes qui constituent le PNR. Et on a des actions itinérantes, on a des cas de festivals itinérants aussi qui peuvent se passer dans différentes villes. Et du coup, c'est chacune des communes qui est recensée. Donc sur chaque fiche commune, on retrouve l'action. Je lève la main et tout de suite,
- Speaker #0
on passe le micro. C'est bien, merci. J'avais une question sur la temporalité. J'ai regardé sur mon smartphone, selon ma commune, il y a 450 actions à peu près. La plus ancienne remonte à 2016. Question générale, jusqu'où vous êtes remonté, jusqu'à quelle temporalité vous êtes remonté ? 2016.
- Speaker #1
2016, de 2016 à maintenant, en fait à 2025, début 2025. Alors on pourra remonter, alors en fait il fallait mettre une barre, voilà. Clairement, il y a peut-être une élection, et qu'on a choisi cette date-là peut-être.
- Speaker #0
C'était ça un peu ma question.
- Speaker #1
Un peu fléchante. Non, mais on l'a fait aussi pour le module des actes administratifs. Clairement, au départ, la commande, c'était 2016. Enfin décembre 2015, si je veux être plus précis, puisqu'il y a une élection. Voilà. C'est sûrement un lien. Mais après, maintenant qu'on a vu que ça fonctionnait, il y a une volonté de remonter et de faire un peu de l'archéologie. Le problème, c'est que les dossiers sont en format image PDF et que ça complique un peu les choses et qu'ils ne sont pas forcément dans le système d'information Iris. Et c'est ça aussi notre limite. C'est qu'il y a un moment, sinon il va falloir aller scraper les données. Et là, ce n'est plus du tout le même boulot. Parce que là, c'est plus de l'archéologie que de l'analyse data analyst.
- Speaker #2
Même si c'est vrai que maintenant les modèles d'IA générative et l'OCR par l'ELM réouvrent des perspectives qui, il y a un an et demi, étaient très complexes. Là où c'était un coup, on fait le 80-20, c'est-à-dire comment on a le 80% de valeur pour l'ENAG avec le raisonnable d'investissement. Mais je pense que 2025, on peut rouvrir la récupération d'intériorité.
- Speaker #1
En fait, on a aussi une difficulté. Pour l'instant, avec l'IA, je le signale parce que si vous allez sur votre commune, vous allez peut-être être surpris. Parfois, il peut y avoir l'impression d'avoir des doublons. C'est-à-dire qu'une action peut être financée en plusieurs fois aussi. Il peut y avoir plusieurs étapes. Et pour l'instant, on a encore du mal. On n'a pas d'élément, en tout cas technique, qui nous permet de dire, en fait, ça a été trois dossiers différents dans IRIS. Mais il n'y a pas un identifiant qui nous dit, ça, c'est le projet global. du prolongement de la ligne 14. Et donc, dans un premier temps, ça a été d'abord ce tronçon-là, le deuxième temps, c'est ça. Non, on n'a pas cet élément. Donc, pour l'instant, il peut arriver sur une commune qu'on ait prolongement de la ligne 12, prolongement de la ligne 12, prolongement de la ligne 12. Les gars, vous surprendez votre truc, là. Mais non, en fait, il y a vraiment trois dossiers qui existent dans IRIS. Et ça, ça fait partie aussi des choses qu'il va falloir qu'on améliore et éventuellement de remonter le temps. Pourquoi pas ?
- Speaker #2
Merci Christophe pour cette présentation. Dans le temps, toutes les questions que Christophe vous expose dans la constitution 7.1 de ma région près de chez moi, nous sommes venus les poser à nos collègues de l'Institut en disant, est-ce que vous pouvez nous aider ? Quels sont l'état de vos réflexions, de vos études sur quel est l'impact d'un équipement ? Vous voulez vous mettre de ce côté slide ? Voilà. Et donc, quel est l'impact d'un équipement qui est posé sur le territoire en fonction de sa localité, etc. Et donc, je vous cède la parole.
- Speaker #0
Oui, le micro. Stéphanie et moi travaillons toutes les deux au sein du groupe équipement qui se trouve dans le département Habitat et Société. Et on va vous présenter aujourd'hui deux travaux, l'équipomètre qui est une carte interactive et tout à 20 minutes qui est plutôt une étude. Et ces deux travaux sont tous les deux fondés sur la base de données des équipements. qu'on a mise au point depuis plusieurs années. Du coup, je vais commencer par vous présenter, je vais essayer de ne pas être trop longue la base de données des équipements. Elle est tellement longue à mettre à jour que peut-être c'est un peu long, mais je vais mettre moins longtemps. Et ensuite, je vous montrerai rapidement l'équipomètre, mais vous le connaissez peut-être déjà. Et Stéphanie vous parlera du travail qu'elle a réalisé pour le compte de la région sur tout à 20 minutes. Ça bouge tout seul. Du coup, avant la base de données des équipements, à partir de 2008, plusieurs collègues qui travaillaient sur les équipements ont posé la question de ce qu'on sait, comment on veut le mettre en œuvre, ce qu'on ne sait pas et qu'on aimerait savoir. Et du coup, ça a donné lieu à un document qui s'appelle... Alors évidemment, je ne connais pas le texte par cœur et je l'ai noté, mais ce n'est pas la bonne feuille. démarche exploratoire pour une meilleure connaissance des équipements et services à la population. Un truc comme ça. Mais si vous tapez démarche exploratoire dans le site internet, vous le trouvez. Il n'y en a pas beaucoup qui s'appellent comme ça. Donc on a mis à plat toutes nos connaissances. On s'est dit, voilà, dans l'idéal, on aimerait faire une base de données avec tout ça. Et on a commencé à faire la base de données, mais pas avec tout ça, parce qu'on n'avait pas tout ça. Et donc aujourd'hui, on a commencé à la mettre en œuvre en ayant en tête l'échéance de la révision du drift de l'époque, 2013 je crois. Et on a fait des mises à jour depuis, on a un petit peu élargi. Aujourd'hui, ah oui, non je parle des principes. Donc il y a des équipements et des services à la population. Donc on essaie d'avoir une info sur les assistantes maternelles par exemple, des assistantes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et évidemment les crèches, les hautes garderies pour le secteur de la petite enfance. On souhaite avoir une info sur le service public et le service privé, le secteur public et le secteur privé. Et on travaille aussi avec la couche des espaces verts qui est réalisée par le département environnement chez nous. On couvre cinq thématiques. Donc la petite enfance qu'on inclut dans le thème éducation et formation. la santé, les commerces, la culture, les loisirs et les espaces verts et le sport. Depuis quelques temps on a ajouté des équipements comme les mairies, les préfectures et les gares. Les sources ce sont principalement des sources institutionnelles mais pas uniquement il y a aussi un travail de fourmis qui est réalisé par nos soins à la fois pour corriger mais aussi parfois juste pour trouver la donnée. et ça nous amène à une base de données de 270 000 points géolocalisés à l'adresse. Ça c'est hors espace vert parce que les espaces verts sont surfaciques. Et la richesse de cette base de données, c'est à la fois qu'on a envie d'avoir une vision la plus exhaustive possible sur les thématiques qui sont traitées. Je vais vous dire pourquoi, je vous le dis tout de suite. Par exemple... Moi je travaille principalement sur les équipements culturels et si on regarde les données de la direction régionale des affaires culturelles, par exemple pour la pratique amateur, on a les conservatoires labellisés par l'État. Il y en a je crois 170, mais en fait en Ile-de-France, c'est pas que dans ces lieux-là qu'on fait de la pratique amateur. Il y a aussi les écoles de musique intercommunales, municipales ou associatives. Il y a aussi les centres socio-culturels, les cours privés, les studios d'enregistrement, de répétition, etc. Nous, on essaie d'avoir tout ça et ce n'est pas simple. En tout cas, dans ce domaine-là, c'est particulièrement long et long. On essaie ensuite, pour chacun de ces points, d'indiquer un niveau d'hierarchisation, enfin même deux niveaux d'hierarchisation. Hierarchisation qui est liée à la création de l'équipe, au rayonnement et à la rareté de l'équipement. Par exemple, le Théâtre national de l'Odéon, il est niveau 5 parce qu'il rayonne au niveau régional et suprarégional. Et ça va de 1 à 5. Et on a aussi un autre niveau de hiérarchisation qui est plus structurel. C'est-à-dire que, par exemple, le Théâtre de l'Odéon... Lui, il n'est pas si gros et même s'il amène du public, il n'en amène pas autant qu'un stade de France. Donc au niveau de hiérarchisation pour le côté structurel, il sera moins élevé que le stade de France ou un hôpital ou une université. Donc ça donne des infos un peu pour les zones d'impact justement. Ouais, comment ? Non, je ne l'ai pas dit. Comment, en fait, on essaye aussi dans cette base de données d'ajouter, quand on les a, des infos de calibrage, le nombre de lits de l'hôpital, le nombre de les effectifs dans une université, les fauteuils du cinéma. Mais bon, globalement, les cinémas, ça va. Et les cinémas, c'est très facile de mettre à jour cette partie-là. Merci le CNC. Et du coup, c'est ça. Et c'est aussi un peu à dire d'expert. Enfin. Donc à dire d'expert en fonction de notre doc ou au doigt mouillé, c'est à dire d'expert. Et voilà, donc il y a une partie qui reste finalement un petit peu subjective, même si on essaye au maximum quand on peut de l'objectiver. Et donc ça, c'est une partie des sources qu'on utilise. Et comme je vous disais, vous voyez, sur la culture, quand même, il y en a beaucoup. Et après, le souci, c'est aussi que ces sources parfois disparaissent, notamment dans le domaine de la culture. Moi, je travaillais beaucoup avec des organismes associés de la région qui ont disparu depuis. Donc, je dois faire ça toute seule. Et voilà, il y a d'autres sources. Et on a créé une nomenclature pour s'y retrouver. En fait, ça marche mieux. Donc là il y a un extrait dessous où en fait on part de la partie la plus large et puis on détaille de plus en plus et on indique pour chaque équipement très détaillé. En fait je n'arrive pas à lire mais je ne sais pas moi par exemple école de musique intercommunale. Donc il y a une ligne et on voit que c'est niveau 3 de hiérarchisation pour la partie rayonnement. Il y a aussi un guide d'utilisation qu'on peut fournir dans lequel on détaille toutes les infos qu'on a sur chaque sous-thématique qu'on a rentrée. Donc avec le détail des champs, avec la date de mise à jour et avec d'éventuelles réserves qu'on peut avoir sur l'utilisation ou pas de cette donnée. Et voilà, et du coup on a mis en image, d'une certaine manière, en carte. cette base de données via l'équipomètre. Du coup, je vais vous montrer quelques écrans. On y accède via le site internet de l'Institut dans la partie cartes et données et cartographie interactive. C'est la rosace colorée qu'il y a là. Quand on arrive sur l'écran, on a à gauche une carte avec des symboles colorés et à droite un texte qui indique un peu comment ça marche. Si on zoome sur un territoire, là c'est Saint-Denis où on est aujourd'hui, on a différents symboles qui s'affichent et en fait plus on zoome, plus on a de détails sur la carte. C'est-à-dire que si on revient en arrière, on a les équipements les plus structurants de niveau 4 et 5 et plus on zoome, plus on voit les équipements de proximité avec des pictos qui sont plus ou moins précis en zoomant. Et on voit aussi, je ne sais pas si c'est réalisible, mais on a des espèces d'apps là un peu orangées. Et ça, ce sont les zones de polarité qui ont été calculées à l'Institut à partir de cette base de données toujours. Donc voilà, quand on zoome beaucoup, beaucoup, on a des pictos qui indiquent le type d'activité, le type d'équipement. Donc les petits sacs de course, ce sont des commerces, des grands commerces. Et voilà, je crois que... Pour le Stade de France, il y a à la fois sport et à la fois spectacle. Voilà, par exemple. Ensuite, on peut se déplacer en choisissant le nom d'une commune, si par exemple, on ne sait pas où elle est. Et comme on a préparé la réunion, c'est Milly-la-Forêt. Enfin, la réunion, n'importe quoi, la table ronde, la présentation. Donc là, on arrive sur Milly-la-Forêt. En cliquant sur une commune, le contour de la commune s'affiche en rouge. Et on voit en gris le contour de l'intercommunalité. Donc là, évidemment, on n'en voit qu'une partie. Et à droite, une rosace s'affiche qui montre en presque un coup d'œil la dotation en équipement de la commune par rapport à son interco. Donc là, on voit par exemple que Milly-la-Forêt est beaucoup plus dotée en espaces verts ouverts au public que l'interco des Deux-Vallées, par exemple. Ensuite, il y a un deuxième onglet qui s'appelle indicateur. et qui permet de choisir des indicateurs plus précis et affichés. J'ai choisi la culture et les loisirs parce que je suis un peu monomaniaque. Par exemple, pour les bibliothèques, c'est le nombre de mètres carrés de bibliothèques ou médiathèques rapportés aux habitants et ainsi de suite pour les lieux de pratique amateurs, les espaces verts, les spectacles, les musées, etc. Et les petites barres, là, montrent à la fois... L'indicateur pour Milly-la-Forêt en rouge, pour l'intercôte des deux vallées en noir, et pour l'île de France hors MGP en orange, orange-beige. Et donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble du territoire. Et juste pour préciser pour les établissements publics territoriaux pour la MGP, Du coup, la référence, c'est par exemple Saint-Denis, Pleine-Commune et la MGP. Ce n'est plus l'Île-de-France. Et enfin, le troisième onglet nous donne des informations sur l'accessibilité. Du coup, pour chaque commune, on indique quels sont les équipements structurants, donc niveau 4 ou 5, accessibles en moins de 45 minutes en transport en commun ou en moins de 30 minutes en voiture. Et donc, on peut faire défiler et on voit toute la liste. Si vous voulez avoir l'histoire des indicateurs, vous pouvez aller directement dans la version PDF. C'est juste en Ausha droite, la version PDF. Ça affiche tout. Vous avez la carte, la rosace, mais là on la voit juste à gauche, et tous les indicateurs les uns après les autres. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais passer la... Je ne sais pas si on prend des questions ou pas. Sinon, je passe la parole à Stéphanie. Merci Antoine. Juste une petite question au niveau des isochrones, donc des temps de parcours. Vous utilisez quelle ORS ? Tout à l'heure, j'ai vu Christophe qui a utilisé Smappen, il me semble, pour faire une illustration. Mais vous, à l'IPR,
- Speaker #2
vous passez par quoi ?
- Speaker #0
Moi, je ne sais pas. Parce que ça, je ne sais pas si Michel est là, mais c'est Michel qui était là ce matin, qui a fait les calculs pour l'accessibilité. Et du coup, c'est un modèle développé en interne. Mais après, comme Stéphanie a travaillé beaucoup, pour tout à 20 minutes forcément, il y a des isochrones aussi, à un moment, elle va vous parler des différents modèles qui existent en interne.
- Speaker #1
Une petite question, c'est sur la différence avec la base permanente des équipements.
- Speaker #0
La nôtre est mieux.
- Speaker #1
Oui, je l'en doutais. Non, mais je l'en doutais. Mais c'est quoi la différence ?
- Speaker #0
Par exemple, sur la pratique amateur, dans la base permanente des équipements, il y a les conservatoires labellisés. Voilà. Et puis à une époque, mais je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui, à une époque, c'était un nombre d'équipements par commune. Maintenant, c'est quasiment pour tous, si j'ai localisé. Mais non, c'est plus, en tout cas pour la culture, c'est plus le fait que nous, on veut avoir vraiment une notion des services existants.
- Speaker #3
Et puis, il y a tout ce travail de hiérarchisation des équipements qui est quand même énorme et qui permet d'avoir quand même cette plus-value par rapport à l'inventaire qui est déjà un boulot. énorme en soi, parce que 270 000 points, c'est quand même pas rien. Et en plus, il y a ce travail un peu quali, qui est fait sur chacun des équipements, et qui est, moi je trouve, particulièrement riche sur cette base de données.
- Speaker #0
Bonjour à tous,
- Speaker #4
j'avais une question sur comment vous avez challengé les sources de données ? Est-ce que vous les comparez régulièrement en cherchant à savoir si l'une est meilleure qu'une autre, plus exhaustive, les points mieux placés ?
- Speaker #0
On essaie de comparer des choses, mais en fait, il y a deux... Je ne sais pas trop comment dire, c'est toujours pareil, moi sur la culture, en fait à une époque j'avais ces données qui étaient assez fiables des organismes associés, notamment sur le spectacle vivant, sur le livre, et du coup eux ils étaient plus experts que moi d'une certaine manière, et du coup ils m'ont vachement aidée notamment pour la hiérarchisation, des salles de spectacle principalement, et donc moi j'ai toujours cette base là, et donc je pars de ça. Et je regarde avec d'autres bases, par exemple, Arsena pour les salles de spectacle. Je compare et je me cale quand même à ce que j'ai appris avec Arcadie pour ajouter des nouveaux points. Enfin, supprimer des points, ça, c'est facile, mais du coup, c'est comme ça. Après, je sais que pour la santé, ça a vachement bougé aussi.
- Speaker #4
Également pour les établissements d'enseignement du supérieur. Ma collègue est là avec qui je travaille sur ce volet. Pareil, on... On pense beaucoup en termes d'endroits où les gens, parce qu'on est sur les équipements, où les gens vont se déplacer pour leurs études, pour accéder à un musée, un cinéma, et non pas le siège social de l'université. Il y a beaucoup de bases de données où finalement on tombe sur ce type de données et nous ça ne nous intéresse pas, on veut savoir. où vont les gens, par exemple, et non pas avoir non plus 15 équipements à la même adresse, puisque c'est le cas pour l'enseignement supérieur, on réfléchit en termes d'UAI, d'unité administrative, et là on se retrouve parfois avec 20 points au même endroit, et nous ce qu'on recherche vraiment à faire, et c'est là qu'il y a tout le travail sur la base de données, c'est de regrouper ça en un point. De ne pas perdre d'informations sur ce point. Donc, on sait qu'à cet endroit-là, on a Paris 4, Paris 1. Qu'est-ce qu'on y fait ? On essaie de garder le maximum d'informations. Et rien que pour ce volet-là, ça nous prend pas mal de temps à deux. Donc, vous imaginez sur l'ensemble des données dont a parlé Séverine.
- Speaker #3
Je me permets de compléter aussi. Là où Séverine a présenté surtout cette thématique autour de la culture. Mais vous avez bien compris que sur cette base des équipements, il y a à la fois tout ce qui touche au commerce, au sport, à l'enseignement, à la santé, etc. Donc c'est vrai que l'avantage à l'Institut, c'est qu'on a un peu des départements ou des experts pour chacune de ces grandes thématiques qui nous permettent effectivement de s'assurer que les bases de données que l'on utilise sont effectivement les plus pertinentes. ou en tout cas celles qui sont plus fréquemment mises à jour pour pouvoir les intégrer dans cette base de données plus globale qui est celle des équipements. Et après, cette fameuse expertise que Séverine disait, le doigt mouillé, elle n'est pas si anodine que ça, puisqu'elle permet effectivement, comme vient de le préciser Stéphanie, c'est de faire en sorte que quand on veut avoir effectivement cette information la plus pertinente possible, de se dire, ben non, là, j'ai... pas besoin d'avoir cinq points, ce qu'il me faut c'est le point qui va être le plus significatif sur cet équipement. Là ça devient vachement intéressant d'avoir des experts sur les thématiques qui puissent effectivement nous aider à faire ce travail de tri et de hiérarchisation de l'information. Et donc pour revenir à votre question d'origine, savoir comment est-ce qu'on fait pour comparer, c'est là aussi où les experts interviennent puisque c'est leur quotidien de travailler avec ces bases de données. de, eux, au quotidien, de savoir quelle est la base qui est la plus pertinente et qu'au moment où on fait le rassemblement de l'ensemble de ces sources, on peut s'appuyer sur cette expertise.
- Speaker #4
C'était pour savoir quelle était la fréquence de mise à jour. des données et puis est-ce que ces données sont en open data chez vous ? Alors, comme c'est un énorme travail, on essaye pour chaque thématique d'avoir une fréquence de mise à jour d'environ 3 ans. C'est un peu plus long pour les commerces parce que c'est un très gros boulot. L'open data, pour l'instant, on transmet les données aux partenaires de l'Institut qui en ont besoin, mais la donnée n'est pas en open data. Parce que justement, il y a tout ce travail de... Mais, mais, mais...
- Speaker #3
Mais, on la transmet à l'IGN. On parlait ce matin des échanges entre nos différents organismes. Ça fait partie des bases de données qui sont transmises à l'IGN dans cette... cette démarche des géos communs avec l'IGN, on transmet la base des équipements pour qu'elle puisse éventuellement venir alimenter la baie des Topo. Bon après dans quelle proportion est-ce qu'ils l'utilisent ou pas ? Je n'ai pas de visibilité mais en tout cas on joue le jeu, on transmet quand même contrairement à ce qui était dit tout à l'heure, on transmet aussi des éléments à l'IGN, on alimente les choses de cette façon là. Alors elles ne sont pas accessibles directement, effectivement, c'est via les partenaires, mais en tout cas, ça permet d'alimenter quelque chose qui est d'un niveau plus haut.
- Speaker #4
Aussi, parfois, c'est transmis dans le cadre d'une étude, à des étudiants.
- Speaker #3
Oui, ça peut arriver que dans certaines conventions, on puisse faire des extraits de cette base de données, qu'elles puissent être transmises avec certains partenaires ou adhérents.
- Speaker #2
D'accord. Donc Assad qui est... Enfin, voilà. Donc en gros, si quelqu'un parmi vous en a besoin ou a connaissance d'un partenaire territorial qui en a besoin, il faut écrire à Assad Ali Sherif qui est pas loin ou en tout cas à des collègues. Enfin, on relèvera nous aussi. Voilà. Vous prenez l'adresse à la fin.
- Speaker #4
Alors moi je vais vous présenter une des utilisations que l'on a fait avec cette base de données que vous a présenté Séverine et pas des moindres d'utilisation puisque donc c'est la commande de la région tout à moins de 20 minutes. C'est un travail sur le long cours qu'on a commencé fin 2021 et qu'on a terminé en 2024 et qui se poursuit à... avec d'autres appellations maintenant, notamment le polycentrisme, et j'en reparlerai tout à l'heure. Au départ, cette étude, c'est une commande régionale. La région Île-de-France a sollicité l'Institut Paris Région pour l'accompagner dans la déclinaison de l'ambition tout à 20 minutes, formulée dans le rapport lutter contre les factures. Vous avez un extrait ici. Ce rapport a été adopté en 2021. Cette mesure vise à maintenir et à développer l'offre locale d'équipements et de services. pour les habitants du rural et du périurbain francilien. Dans un premier temps, on a d'abord été mobilisés pour identifier les zones blanches, c'est-à-dire les zones dans lesquelles la population aurait des difficultés d'accès aux équipements et services de proximité. Avant de lancer ce gros chantier et de lancer cette réflexion, Il a fallu définir des hypothèses de travail. On s'est posé pas mal de questions. Quel type d'équipement retenir pour l'étude ? Quel mode de déplacement prendre en compte ? Il n'était pas spécifié dans la commande tout à 20 minutes. Quel territoire du rural considérer ? Je vais commencer par ça. Concernant les territoires du rural, on s'est posé la question de savoir si on utilisait la définition de l'INSEE. pour les communes denses, peu denses, ou une définition plus régionale. Au final, on a statué aussi, pour faciliter le rendu cartographique, sur toutes les communes de Grande Couronne. On a regardé les habitants, pour la partie où j'habite, ce sont les habitants de Grande Couronne, mais bien entendu, on a considéré les équipements qui étaient aux franges, donc en petite couronne, sachant que quand on est en limite, on se déplace. pour accéder aux équipements qui sont de côté Petite Couronne. Alors, ça c'était pour la définition du rural. Quel type d'équipement retenir ? On le verra tout à l'heure. Et quel mode de déplacement choisir ? Là, c'est un graphique issu de l'EGT, de l'enquête transport de 2020, qui nous a pas mal aidé. Donc dans ce graphique, on voit que... Concernant les déplacements domicile-travail et les déplacements liés aux études, mais particulièrement les études supérieures, ici pour les plus de 18 ans, on est bien au-dessus du pas de temps de 20 minutes. Par contre, on voit de l'autre côté que pour la majeure partie des équipements de proximité, on se trouve là, au contraire, dans la... Dans la partie inférieure aux 20 minutes, le cercle de couleur, donc par type d'équipement, vous indique la moyenne des temps de déplacement et la médiane. Non, pardon, la moyenne, c'est en pointillés, excusez-moi, ici. Et le cercle rouge, c'est la médiane. Donc, on a 50% des habitants qui font le temps de déplacement qui est en dessous, qui est sur la barre avant ce point et 50%. ... des habitants qui font le déplacement de l'autre côté, qui mettent plus de temps sur la barre de l'autre côté. Alors, on voit... Quand on a vu ça, on s'est dit, comme on n'a pas le choix, c'est 20 minutes, on va, du coup, choisir de considérer une œuvre d'équipement vraiment globale. Et vous le verrez, on a regardé l'accès à chaque type d'équipement. individuellement mais aussi à des bouquets d'équipements. Ensuite on s'est posé la question aussi du type de déplacement à considérer. Là aussi ce sont des données issues de l'EGT. Et on voit que... Alors là c'est tout le temps... Je ne l'ai pas précisé mais les données sont uniquement pour les déplacements en grande couronne.
- Speaker #0
On voit quand même que la marche à pied prend une place importante, parfois notamment pour les loisirs visite, où on est à 41% contre 29% des déplacements en voiture, mais en tant que conducteur, puisqu'on voit que j'ai séparé les déplacements en voiture où on peut être n'être que passager et voiture conducteur. Et aussi les études, on voit bien que... Alors les études... C'est plutôt l'accessibilité à l'école, je pense, au collège qui se fait essentiellement à pied, même si on est en grande couronne. Donc on imagine que c'est pour les habitants qui se trouvent plus dans les pôles. Par contre, à côté de ça, pour tout ce qui est affaires perso, démarches administratives, santé, achats surtout, on n'hésite pas à prendre sa voiture. Là, 63% pour les achats de déplacement en voiture. On n'hésite pas à prendre sa voiture, mais là, attention, quelques éléments encore de contexte. En Grande-Couronne, on a quand même 40% des ménages, c'est le deuxième graphique, dont la personne de référence a moins de 25 ans, donc les ménages jeunes qui ne possèdent pas de voiture, et de même pour des ménages dont la personne de référence a 80 ans ou plus. Donc c'est quand même à garder en mémoire. On a aussi, on le voit dans le premier graphique, la deuxième barre, 28% des chômeurs qui n'ont pas accès à une voiture pour leur déplacement. Donc ça souligne quand même l'enjeu que peut représenter l'accessibilité aux équipements et services selon d'autres modes de transport que la voiture, même en grande couronne. Ensuite, concernant la partie quels équipements retenir ? Donc là, vous avez sur la gauche le tableau de tous les équipements qu'on a finalement décidé de retenir. Et puis, donc, je n'ai pas indiqué non plus, mais la commande ne spécifiait pas de mode de déplacement. Donc, on a choisi de retenir l'accessibilité piétonne, vélo et voiture pour cette étude. Donc, on a fait le travail pour tous les équipements individuellement et pour tous les types de transport. On a compilé ces données dans une grosse base de données, ce qui nous a permis après de facilement faire des bouquets d'accessibilité en mélangeant éventuellement les types de transport en fonction des types d'équipements et autres. Mais je vous montrerai tout à l'heure dans la carte, dans les résultats. Alors on a choisi de ne pas... On a écarté les déplacements en transport en commun, parce que même si l'offre existe dans le rural et dans le périurbain, 20 minutes, c'était trop court car la fréquence des temps de rabattement et les fréquences de passage et les temps de rabattement, on était déjà souvent au-dessus des 20 minutes. Donc on n'a pas considéré l'offre en transport en commun. Et concernant l'offre en vélo, au départ, on avait commencé par la voiture et l'accessibilité piétonne. Au DINUM, ma collègue a développé un modèle d'accessibilité en vélo dont on s'est servi parce qu'on s'est dit que ça pourrait être une opportunité et ça nous permettait aussi de voir un petit peu des temps d'accès intermédiaires entre la voiture et les déplacements piétons qui sont quand même parfois compliqués en Grande-Coronne. Alors concernant chaque équipement, je vous le disais, a fait l'objet d'un traitement spécifique pour savoir si tous les habitants avaient accès ou pas à ces équipements. Donc comment on a procédé ? On est parti, on s'est aidé du maillage de l'INSEE, donc on est parti de la couche de l'INSEE des carreaux de 200 mètres de côté. Et ce maillage finalement, on l'a utilisé jusqu'au bout. Donc il a été utilisé pour les calculs d'accessibilité, le comptage des équipements. Mais aussi le rendu cartographique. On a un petit exemple là en bas à droite. Donc rapidement, la méthode O, on a commencé par faire un état des lieux. Donc on a calculé pour chaque maille par équipement, le nombre d'équipements présents de chaque catégorie dans chacune des mailles de Grande Couronne. Ensuite, pour chaque maille habitée, là, on a utilisé des logiciels non pas SIG parce que... parce que ce n'était pas suffisamment puissant. Donc, on a utilisé SAS pour manipuler les matrices de données de maille à maille. Il y a environ 70 000 mailles habitées sur l'île de France. Donc, on a utilisé plutôt des logiciels statistiques. On a fait des programmes qui nous ont finalement, au final, donné le résultat par maille. On savait que pour chaque maille habitée... à combien d'équipements, dans n'importe quelle direction par contre, de chaque type j'avais accès ou pas. Pour terminer, la donnée est présente dans la couche des mailles de l'INSEE, des données de population. Nous aussi, à l'Institut, on a une couche qui s'appelle Dansy-Bati, où on estime aussi une population. J'ai complété aussi avec notre donnée. On estime une population dans ces mailles de 200 mètres par 200 mètres. Ce que vous voyez ici, c'est qu'ensuite, on a compté la population présente dans chaque maille habitée. qui n'étaient pas desservies pour chaque type d'équipement. Ici, elles apparaissent en rose. Là, c'était l'exemple des boulangeries. Vous voyez les petits points jaunes, ce sont les boulangeries. Et en rose, ce sont les mailles habitées sans boulangerie, accessibles en moins de 20 minutes à pied. On l'a fait pour chaque mode de déplacement. Et puis, on a associé, je vous disais tout à l'heure, on s'est posé la question de savoir quel territoire on prenait, et enfin, qu'est... Qu'était le rural ? C'était quoi les territoires ruraux ? On s'est dit que nos résultats, on les diviserait en deux catégories. On regarde pour toute la Grande Couronne. On voit que un peu plus de 9% de la population de Grande Couronne n'a pas accès à une boulangerie en moins de 20 minutes à pied. Mais par contre, si on distingue à l'intérieur de la Grande Couronne les communes denses et les communes peu denses, là, le référentiel INSEE, c'est celui-ci qu'on a utilisé. On voit bien que quand on se trouve dans les bourgs, dans les polarités, il n'y a que 4,5% de la population des communes denses qui n'ont pas accès à une boulangerie, contre 53% des communes peu denses et très peu denses qui, elles, n'ont pas accès en moins de 20 minutes à une boulangerie. Donc ça, ces informations-là, on les a pour toutes, je ne vous les ai pas toutes mises parce qu'on a fait énormément de cartes, on les a pour tous les types d'équipements et tous les modes de déplacement. Alors là, la question a été posée tout à l'heure. Je ne vais pas non plus détailler, j'y reviendrai si vous avez des questions particulières. C'est ma collègue du DINUM qui m'a calculé toutes les matrices de temps d'accès de maille à maille, donc en vélo, en voiture et le modèle piéton. Donc notre modèle le plus ancien, c'est la voiture, mais on est en train de voir pour le mettre à jour. Ça vous indique... qu'est-ce qu'il prend en compte, densité de population, découpage morphologique, le trafic en heure de pointe, le vélo, on a rentré dans le modèle la pente, donc la vitesse s'adapte à la pente, il tient compte du revêtement, je ne vais pas vous passer tout en revue, mais voilà les modèles qu'on utilise en interne pour nos calculs de matrice. Donc, ces calculs se font de la maille origine vers les mailles destination, dans lesquelles on a des équipements, donc toutes les mailles accessibles en 20 minutes. L'algorithme qui est utilisé, c'est celui du chemin le plus court. Donc, il peut se calculer en fonction d'une distance. Ça nous arrive d'avoir des études où on demande plutôt la distance depuis une maille vers une autre, mais aussi en fonction d'un temps de déplacement. Et c'est... la commande toute à 20 minutes, j'avais pour cette étude besoin du temps de déplacement. Et puis, ma collègue a calculé les matrices pour les trois modes de transport. Alors ça, ça rejoint ce que Michel disait ce matin avec l'IA, mais on a le même problème avec les calculs de matrices. On a des calculs qui ont pris vraiment même plusieurs semaines. Héloïse avait mis une semaine, mais on a des calculs qui ont pris plusieurs semaines qu'elle laissait tourner la nuit. Elle faisait tourner les calculs sur plusieurs stations, parce que c'est des calculs très gourmands en ressources machines. Alors là, je vous ai mis un exemple de résultats cartographiques. Je ne vais pas tous les passer en revue parce que ce n'est peut-être pas l'objet. Je pourrais vous, pour ceux qui le souhaitent, vous envoyer éventuellement quelques résultats. Au départ, la modélisation. Elle a révélé que finalement, tous les équipements, c'est ce qu'on voit sur la carte du haut, étaient accessibles en moins de 20 minutes en voiture, quasiment pour tous les types d'équipements qu'on a retenus. Là, les trois cartes concernent l'accessibilité au lieu de pratique amateur. Donc, vous voyez qu'en voiture, tout est accessible. Je n'ai même pas mis le chiffre parce qu'on est à 100% quasiment d'accès. Sinon, ce sont des biais aussi des modèles. Et puis, par contre, on voit, pareil, je ne vois pas bien. Pour l'accessibilité vélo, on est à 6,3% de la population de Grande-Coronne qui n'a pas accès à un lieu de pratique amateur, donc c'est conservatoire, école de musique, etc. Et à pied, on a 36% de la population qui n'a pas accès à pied à ce type d'équipement. Vous le verrez sur toutes les cartes, ça revient un peu. Ce que vous avez ici en... Les gros ronds gris foncés, ce sont les polarités, les grandes polarités et les plus petites polarités que l'on voit ici. Et globalement, on voit quand même que dès qu'on se trouve dans une polarité, on a accès, on a plutôt pas mal accès aux équipements en question. Alors même si à pied, forcément, on a encore au sud de la Seine-et-Marne et puis dans d'autres zones, ici à l'ouest des Yvelines aussi, on n'a pas forcément accès, en tout cas pour ce type d'équipement, mais c'est un petit peu pareil pour les autres. Là vous avez un exemple de carte de synthèse pour la culture, parce qu'on a fait des cartes équipement par équipement, des cartes de synthèse par domaine et une carte de synthèse générale. Donc là c'est un exemple de carte de synthèse où on mélange ce dont je vous parlais tout à l'heure. L'avantage c'est vraiment d'avoir tout lancé et d'avoir eu toutes les données dans une grosse base de données qui nous permet d'ensuite finalement avoir des rendus différents et on peut jouer un peu avec ces rendus, c'est un peu plus simple d'utilisation. Donc là, on a regardé sur la même carte, c'est l'accessibilité à un bouquet d'offres. Donc on regarde finalement, dans ce bouquet, on a considéré l'accès à une bibliothèque et un lieu de pratique amateur en vélo et l'accessibilité en voiture pour le cinéma et la salle de spectacle. Donc qui n'a pas accès à ces quatre équipements en vélo ou en voiture en fonction de l'équipement. Donc on voit pareil ici que quand on est dans les polarités, on a plutôt pas mal accès. Un peu plus loin, ça pose problème. On a fait la même carte avec accessibilité bibliothèque, pratiquemateur piéton et salle de spectacle, cinéma, vélo. Enfin voilà, on peut adapter les cartes comme on le souhaite après par la suite. Là, une autre carte de synthèse, mais je vais passer aussi rapidement sur les commerces. Là, on a regardé aussi qui n'avait pas accès à l'offre. On a plusieurs critères. En fait, soit on a accès. qu'à une boulangerie ou une grande moyenne surface alimentaire. On a accès aux deux. On a accès au panel complet de commerce de proximité. Alors là, on a pris en compte la boulangerie, la grande surface ou moyenne surface, la poste, le coiffeur, la pharmacie, le tabac. On avait sélectionné quelques équipements comme ça de proximité. Et en rouge, on n'a accès à aucune offre commerciale alimentaire. Donc là, pareil, vous voyez, on a 6,5% de la population de Grande-Coronne qui n'a pas accès au bouquet. d'offres commerciales. Là, c'est la carte. Un autre exemple, parce qu'à chaque fois, la représentation change un petit peu. Là, c'est la carte du sport où on a mis sur la même carte ce à quoi on avait accès à pied, en vélo et en voiture. Donc, plus on est foncé. Donc, on voit qu'on a quelques petites tâches foncées ici où on a accès au panel d'équipements sportifs. Là aussi, pour les équipements qui ne sont pas interchangeables. Si on a décidé de faire du tennis, on ne va pas se mettre forcément à la natation. On a considéré un accès à huit équipements sportifs, cours de tennis, équipements extérieurs de petits jeux, équipements de grands jeux, salles multisports, boulodromes, piscines, équipements d'athlétisme et dojos. Là aussi, on a vu avec nos experts sport pour savoir quels équipements il fallait qu'on retienne. Et donc là, pour être dans le vert, il faut avoir accès à des équipements de petits jeux. à ces huit équipements sportifs. C'est encore une autre réflexion pour les équipements sportifs. Je vous en parlais tout à l'heure. Là, il s'agit de la synthèse globale, d'accessibilité aux six catégories d'équipements, éducation, culture, commerce, espace vert, sport et santé. Là, c'est plutôt un score, une note, pour chaque maille habitée. Est-ce que j'ai accès... à combien de types d'équipements j'ai accès depuis chez moi. Alors, on voit qu'il y a très peu finalement d'équipements qui sont dans le vert foncé. Ça, c'est parce qu'on a mis l'indicateur ici de la santé, qui n'est pas bon du tout en Ile-de-France et qui plombe un peu les résultats, puisqu'on voit que finalement, là où on a l'indicateur santé qu'on a pris, c'est celui qui existait à l'Institut. qui est l'accessibilité potentielle localisée, qui était à peu près aussi sur un rayon de 20 minutes, donc ça nous allait très bien, où on regarde si on a accès à au moins trois consultations de médecins par an, parce que c'est la moyenne en Ile-de-France, et si on n'a pas accès à cette moyenne, du coup on est sous-doté en accessibilité à la santé, ce qui fait que ça va très vite, donc les bons scores sont... Là où la santé est bonne, c'est là où finalement on va être en vert foncé sur la carte. Et puis, on voit quand même que la majorité de la population a accès à cinq domaines sur six. Donc, si on met un petit peu la santé de côté, on voit aussi que dès qu'on est dans l'agglomération, on a quand même... accès à tous types d'équipements et puis également dans les polarités mais ça on l'a déjà vu. Bon ça c'est pareil comme la petite data viz que vous avez vu sur les cartes précédentes on a fait la même chose là pour la synthèse globale mais je vais passer là sur ça. Alors cette étude, on s'est rendu compte qu'elle avait des limites en travaillant dessus pour plusieurs raisons. Dans la pratique, les temps de déplacement sont variables. C'est ce qu'on a vu avec le graphique de l'EGT. La commande était toute à 20 minutes, donc on n'a pas eu le choix sur ce pas de temps de 20 minutes. Mais si ça marche bien pour les pratiques sportives, puisqu'on voit que 20 minutes, c'est à peu près ce que les personnes mettent comme temps pour se rendre à leurs activités sportives, que ce soit à pied ou en voiture. Pour les achats, on est quand même en dessous des 20 minutes. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on va considérer plus d'équipements. Pour la culture, au contraire, on est prêt à faire plus de déplacements. Séverine pourrait nous le confirmer. Et puis, on a envie de voir ce spectacle-là. C'est pas parce qu'il y a un théâtre qui est dans notre commune qu'on va aller vers ce théâtre. On va peut-être décider de faire 45 minutes et d'aller plus loin pour vraiment aller voir quelque chose qui nous plaît. Donc voilà, ça c'est assez à garder en mémoire. On a une appréciation des temps de déplacement à affiner. Parce qu'en effet, nous, on a pris isolément les équipements à moins de 20 minutes, mais dans toutes les directions, en fait. On n'a pas regardé si, justement, les équipements étaient regroupés en pôle à ce stade. Donc, j'ai accès, OK, à mon cours de tennis, à mon commerce, mais peut-être dans des directions différentes et je ne peux pas grouper mes achats ou autre. On l'a gardé aussi en mémoire, c'est pour ça que je vous disais, c'était plutôt, on a regardé l'accessibilité en vélo, mais plutôt comme un potentiel à développer, parce qu'on sait très bien qu'en grande couronne, tous les aménagements ne sont pas forcément au point pour faire du vélo et même de la marche. Donc il faut aussi faire attention. On sait très bien que le vélo et la marche sont plus pratiqués en zone urbaine dense que dans d'autres secteurs. Et puis, Séverine l'a montré tout à l'heure, c'est une approche aussi qui est tributaire des limites des bases de données. On a peu d'informations sur la qualité des équipements, les horaires d'ouverture, la fréquentation, saturation. C'est vrai que nous, pour les bibliothèques, on a appris que la bibliothèque, que ce soit le sous-sol de l'Amérique qui est ouvert deux heures dans la semaine, et la grosse bibliothèque, on l'a comptée de la même façon, alors que ça mériterait d'être un peu pondéré. On a aussi des effets de frange, vous l'avez peut-être vu sur les cartes, qui peuvent être présents parce qu'on n'a pas les données en dehors des limites régionales. Et puis, on en parlait tout à l'heure, les dates de mise à jour qui sont variables, absence de certains types d'équipements. Et enfin, pour ouvrir un petit peu sur des pistes d'action. Donc là, premièrement, il faudrait accompagner les territoires dans l'identification de leurs besoins. Donc réaliser des diagnostics. sur les offres existantes, identifier les besoins des populations particulières, les populations notamment vulnérables. On va faire un travail sur le vieillissement, les territoires propices au vieillissement. On va aussi utiliser nos données d'équipement, mais d'une autre manière, pas avec la même sélection d'équipements, par exemple. Il faut affiner la connaissance des déplacements. En effet, quels sont les territoires qui sont plus propices, on le disait, au mode actif ? Est-ce que l'offre de TC est suffisamment développée ? Ensuite il faut également conforter l'armature urbaine. Alors là c'est justement la suite que l'on va donner à cette étude du tout à 20 minutes. C'est cette suite qu'on va donner dans l'étude qui s'appellera polycentrisme. Là on va regarder justement, on va essayer de qualifier les bourres, les polarités que je vous montrais tout à l'heure sur la carte, pour savoir si elles proposent les paniers d'équipement la totalité des équipements dont la population a besoin, ou si au contraire, il manque des équipements. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis. Compléter l'offre dans les bourgs structurants, en privilégiant les implantations dans les secteurs déjà desservis par les transports en public, et en accompagnant les collectivités dans leur politique de mobilité et d'aménagement propice aux modes actifs, donc développer des modes de transport vers ces bourgs, vers ces polarités. Et également pour les zones vraiment reculées, les gens qui ont des... qui ne peuvent pas se déplacer, c'est plutôt favoriser la mixité des usages et des services dans le peu même d'équipements qui restent encore sur place. Et bien entendu, soutenir les offres itinérantes. On en avait pas mal dans notre étude des exemples de même d'un camion-piscine. Ça m'avait marqué un camion-piscine qui se déplaçait dans les communes. Puis les commerces de bouche qui se déplacent, etc. Oui, voilà. Si vous avez des questions.
- Speaker #1
Merci beaucoup Stéphanie. Bravo pour tous ces projets. Est-ce que vous avez des questions ? J'imagine. Moi j'en ai une, deux. On va dire, tu as évoqué vieillissement, territoire propice au vieillissement. Est-ce que c'est une étude que vous avez programmée pour prochainement ? Et l'autre, c'est, tu évoquais polycentrisme. Est-ce que... Pardon, c'est par rapport à la précédente slide, mais du coup, sur l'étude polycentrisme, justement, qu'est-ce que tu vas... Oui, c'est dans les limitations de l'étude actuelle que tu vas renforcer ça.
- Speaker #0
Oui, c'est ça. Oui, on va maintenant regarder, prendre le problème à l'envers et regarder comment sont... Quels équipements sont présents déjà ? Là par contre on va plus s'intéresser uniquement aux équipements de proximité, mais comme on sera dans les polarités, on va regarder des équipements de rang supérieur, comme Séverine nous a montré. Parce que là c'est vrai qu'on n'a pas regardé, forcément on n'a pas pris les hôpitaux, on n'a pas pris les universités, on a fait le travail, parce qu'on sait que c'est la région qui gère les lycées, donc le tout à 20 minutes on a quand même fait le travail jusqu'au lycée pour voir l'accessibilité. Mais là, ça va être l'occasion de prendre, en plus des équipements structurants, voir catégoriser toutes les polarités, et voir après, pareil, le même travail, depuis les mailles habitées vers les polarités, en combien de temps. Là, on pourra regarder toutes les mailles habitées, et voir, peut-être, c'est des idées comme ça, qui viennent voir en combien de temps on peut accéder à ces polarités, les poids de population touchés, etc. Pour le vieillissement, c'est une cartographie pour l'instant, mais avec plein de collègues de l'Institut. Je crois qu'on va se baser sur une carte qui avait été faite par le DMT sur les territoires propices à la marche. On va partir de ce modèle-là et on va essayer de l'adapter aux personnes âgées.
- Speaker #1
Merci à vous trois.