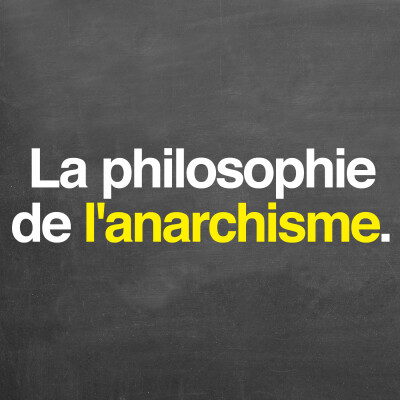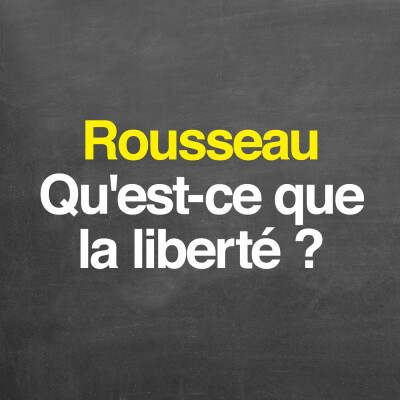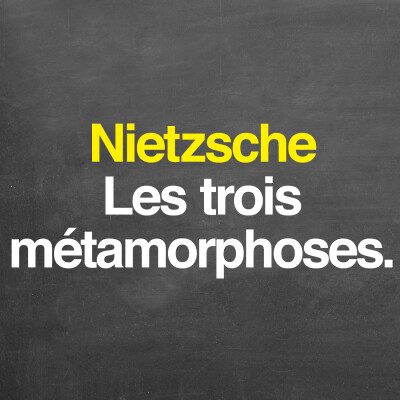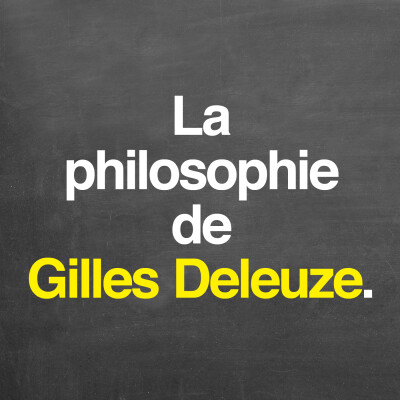SpeakerQu'est-ce que la condition humaine ? Si l'on devait condenser toute la philosophie d'Hannah Arendt en une seule question, ce serait celle-là. Et pourtant, c'est une question qui peut nous sembler très banale. Mais en 1958, au moment où Hannah Arendt publie son livre "Condition de l'homme moderne" cette question est redevenue absolument originale. C'est une question presque neuve. 13 années seulement se sont écoulées depuis les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki et la libération des camps d'extermination nazis. Mais il s'en est passé des choses entre 1945 et 1958. La structure de l'ADN a été découverte, les premiers ordinateurs ont été commercialisés et ce que l'on appelle déjà l'intelligence artificielle fait l'objet de recherches autonomes. Dans le même temps, l'Union Soviétique lance dans l'espace Spoutnik 1, le premier satellite artificiel. Autant de progrès techniques qui posent une question urgente. L'homme essaierait-il désormais d'échapper à sa condition ? Hannah Arendt écrit dans l'introduction de son livre, je cite : "Depuis quelque temps, un grand nombre de recherches scientifiques s'efforcent de rendre la vie artificielle elle aussi et de couper le dernier lien qui maintient encore l'homme parmi les enfants de la nature. C'est le même désir d'échapper à l'emprisonnement terrestre qui se manifeste dans les essais de création en éprouvette. Et je soupçonne que l'envie d'échapper à la condition humaine expliquerait aussi l'espoir de prolonger la durée de l'existence fort au-delà des limites jusqu'ici admises. Cet homme futur, que les savants produiront, nous disent-ils, en un siècle, pas davantage, paraît en proie à la révolte contre l'existence humaine telle qu'elle est donnée et qu'il veut, pour ainsi dire, échanger contre un ouvrage de ses propres mains." Fin de citation. Cette idée, Hannah Arendt la reprend au livre publié deux ans plus tôt par son ancien mari Günther Anders, "L'Obsolescence de l'homme", auquel j'ai déjà consacré une vidéo sur cette chaîne. Mais elle va lui donner un autre développement. Pour Hannah Arendt, cette volonté de l'homme moderne d'échapper aux limites de la condition humaine est en fait le symptôme d'un oubli de la condition politique de l'homme. C'est parce que l'homme veut oublier qu'il est avant tout un animal politique qu'il cherche à fuir son milieu naturel, la terre, et sa condition biologique, les limites de son corps. Alors, avant d'aller plus loin, il faut s'arrêter sur cette notion d'animal politique. C'est Aristote qui a défini l'homme comme "zoon politikon", animal politique. Pour Aristote, l'homme ne peut développer toutes ses capacités d'être humain qu'à l'intérieur de la cité, c'est-à-dire au sein d'une communauté politique. Mais attention, l'homme n'est pas un animal politique uniquement parce qu'il vit en société. D'autres animaux vivent en société, comme les fourmis par exemple. Mais ce qui distingue l'homme en tant qu'animal politique, c'est sa capacité unique à raisonner, à discuter, à délibérer et à élaborer des lois qui régissent sa vie en société. La cité n'est donc pas simplement un cadre de vie, mais elle est le moyen par lequel les individus réalisent pleinement leur humanité. Hannah Arendt reprend et développe la notion d'animal politique et en fait en quelque sorte le poumon de sa propre philosophie, la notion par laquelle toute sa philosophie peut se comprendre. Elle va donc pousser cette notion jusque dans ses ultimes conséquences. En un mot, pour Anna Arendt, exister humainement, c'est exister politiquement. L'action politique ne se limite donc plus au fait de délibérer et d'élaborer des lois, mais elle conditionne l'essence même de la liberté humaine. Or, bien qu'on ait souvent tendance à l'oublier aujourd'hui, l'action politique ne se limite pas à choisir entre telle ou telle idéologie, tel ou tel parti, tel ou tel bulletin de vote, comme on choisirait une marchandise dans un catalogue. On ne consomme pas de la politique, on fait de la politique. La liberté humaine ne consiste donc pas à choisir entre différentes options politiques préexistantes, mais au contraire à commencer quelque chose de politiquement nouveau, à créer une réalité politique, à créer ce qu'elle appelle un monde commun. Pour définir ce monde commun, Hannah Arendt écrit, je cite : "Il est ce que nous avons en commun aussi bien avec nos contemporains, mais aussi avec ceux qui sont passés et avec ceux qui viendront après nous. Ce monde commun, il est notre œuvre." Hannah Arendt utilise le concept d'œuvre pour désigner toutes les créations humaines qui dépassent le rang de la production et de la consommation. Ce que nous produisons et ce que nous consommons grâce à notre travail est toujours quelque chose d'éphémère, qui doit être renouvelé régulièrement, par exemple la nourriture, les vêtements, mais aussi tous les produits périssables comme les voitures, les ordinateurs, etc. La fabrication et la consommation de ces produits constituent l'activité économique des êtres humains, alors que l'œuvre, au contraire, est l'activité par laquelle les hommes créent une culture commune qui dépasse leurs simples besoins vitaux. L'œuvre humaine, qui est constituée aussi bien par les créations artistiques, les monuments que les institutions politiques, façonne donc le monde commun, que nous héritons des générations passées et que nous transmettons aux générations futures. Ainsi, alors que le travail nous permet avant tout de produire le monde tel que nous le consommons, l'œuvre, au contraire, c'est le monde tel que nous l'habitons. C'est donc un monde qui dépasse nos besoins individuels et qui répond aux besoins communs de l'humanité tout entière. Or, si l'homme est un animal politique, c'est parce que sa vocation consiste précisément à construire ce monde commun. C'est la création de ce monde commun qui fait de nous des êtres humains à part entière. Hannah Arendt écrit, je cite, : "Le devoir des mortels réside dans leur capacité de créer des œuvres immortelles, de sorte que par l'intermédiaire de ces œuvres, les mortels puissent trouver place dans un cosmos, un ordre, où tout est immortel sauf eux." Or, que constate Anna Arendt au moment où elle écrit la "Condition de l'homme moderne" ? Que les hommes se sont transformés en masse d'individus isolés, simples producteurs et consommateurs, déresponsabilisés politiquement. Que l'humanité tend de plus en plus à se réduire en une société où l'être travailleur l'emporte sur l'être politique. Selon Hannah Arendt, cette transformation s'est opérée à travers deux phénomènes majeurs. L'avènement de la société de consommation et l'expansion du domaine du travail. Deux phénomènes qui sont en fait les deux versants d'un seul processus. La démission du politique face aux impératifs économiques. Ainsi, la société de consommation a conduit à une valorisation excessive du travail comme moyen d'acquérir des biens matériels. Et l'homme a cessé d'être un animal politique pour devenir un animal travaillant et consommant. Cette obsession pour la consommation a eu pour effet de détourner l'homme de sa participation à la vie politique. Et en parallèle, l'expansion du domaine du travail a envahi tous les aspects de la vie humaine. Le travail n'est plus seulement un moyen de subvenir à nos besoins, il est devenu une fin en soi. Le moyen est devenu une fin. Or, une fin devrait toujours être associée à des activités plus nobles, moins utiles que le travail, comme la réflexion, la contemplation, l'art ou la politique. Si nous travaillons, c'est pour pouvoir assurer les conditions d'existence qui nous permettent de mener ensuite une vie libre. Et non l'inverse, nous travaillons pour devenir libres, mais nous ne devenons pas libres pour travailler. Mais en outre, que se passerait-il si demain, l'automatisation des tâches, la robotisation, voire désormais l'intelligence artificielle, venait à rendre inutile le travail humain, si l'on n'avait plus besoin des humains pour faire le travail ? Eh bien, nous serions confrontés à un vertige tel que nous n'en avons encore jamais connu. Un vertige qu'Hannah Arendt décrit ainsi, je cite : "Ce que nous avons devant nous, c'est la perspective d'une société de travailleurs sans travail, c'est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire." Fin de citation. Pourquoi écrit-elle que l'on ne peut rien imaginer de pire ? Tout simplement parce que lorsque le travail est à la fois notre moyen de subsistance et notre raison même de vivre, alors la vie en dehors du travail perd nécessairement tout son sens. Elle se résume à une vie de loisirs, d'entertainment, de divertissement, qui ne sont eux-mêmes rien de plus que des activités économiques. Alors, entendons-nous bien, ce n'est pas le travail qui est un problème, c'est le fait que tout se transforme en travail. Parce que lorsque tout se transforme en travail, tout se transforme aussi en produit. Et dès lors, l'être humain n'a plus d'autre choix que de chercher un sens à sa vie dans le cycle infernal de la production et de la consommation. Mais la production et la consommation de marchandises représentent les activités les moins politiques qui soient, car elles ont pour seule fin notre confort et notre bien-être individuel. Autrement dit, elles n'affectent que la sphère privée de notre existence. Bref, si l'on devait résumer la mentalité de nos sociétés modernes, on pourrait dire que nous confondons deux sphères : la sphère privée et la sphère publique. La sphère privée est structurée par l'ordre économique de la production. Par exemple, quand j'achète une maison pour y vivre, ou bien quand je fais mes courses, ou encore quand je pars en vacances, je peux faire tout ça parce que je gagne de l'argent. Et donc, la sphère privée dans laquelle j'évolue est entièrement conditionnée par l'activité économique dans laquelle je m'insère. Mais lorsque la vie économique, comme nous l'avons dit, remplace complètement la vie politique, alors la sphère publique est condamnée à disparaître. Certes, nous vivons encore en société, mais dans une société atomisée, une société dans laquelle la sphère publique n'est plus un lieu d'action politique, mais uniquement un lieu de travail et de consommation. Et dans une telle société, il est normal que nous en venions à glorifier ce que l'on appelle la valeur travail, que nous la mettions au-dessus de tout, car c'est la seule valeur qui nous reste et que nous sommes devenus incapables de penser à des activités plus élevées que le travail. Et cela, même dans le cas des productions artistiques. D'ailleurs, vous remarquerez que la plupart des artistes aujourd'hui ne disent plus "mon œuvre" mais "mon travail". Ouvrez n'importe quel catalogue d'exposition ou n'importe quelle revue d'art, on y parle toujours du travail de tel ou tel artiste. Mais l'on n'utilise quasiment plus le terme d'œuvre. Et quoi de plus normal ? Puisque dans une société de travailleurs, personne ne peut être autre chose qu'un travailleur. Et dans une société de consommation, aucune œuvre ne peut dépasser le stade d'une marchandise. Et c'est pourquoi une société entièrement tournée vers le travail est en réalité la société la plus antipolitique qui soit. Car lorsque le travail représente tout, quand il devient l'alpha et l'oméga de toute la vie personnelle et sociale, alors les êtres humains se retrouvent nécessairement isolés les uns des autres. isolés par leur absence totale d'activité politique. Et d'ailleurs, l'activité politique elle-même est réduite à un travail. Un travail comme un autre. Est-ce qu'on ne mesure pas aujourd'hui la valeur d'un responsable politique au fait qu'il fait le job ou bien qu'il ne fait pas le job ? Et cette manière de parler, qui est assez récente, montre combien les analyses d'Hannah Arendt étaient prémonitoires. Et d'ailleurs, à quoi se résume désormais la politique ? Eh bien à assurer, du moins en principe, le bien-être de chacun dans sa sphère privée. Et c'est le comble des paradoxes. La politique qui devait être garante de la sphère publique se fixe désormais pour mission de gérer les sphères privées de chacun. Nous sommes donc doublement dépossédés. Notre vie privée ne nous appartient plus, puisqu'elle est désormais gérée par le pouvoir politique, et dans le même temps, il n'existe plus de sphère politique publique, commune, à laquelle nous pourrions prendre part activement. Bien sûr, rien ne nous empêche de nous lancer dans la politique, mais avec pour seule perspective, si nous réussissons, de devenir de simples gestionnaires, de simples ingénieurs de la vie sociale. Puisque la politique n'est plus une action, mais une gestion. Puisque la politique n'est plus l'art de créer un monde commun, mais simplement un moyen de gérer les intérêts de chacun. Puisque la politique, en devenant une technique, n'a plus pour vocation de nous faire accéder à la liberté. Dès lors, il n'y a rien d'étonnant à ce que la politique soit abandonnée par la majorité des êtres humains, qui laissent le champ libre à des dirigeants, des partis, des gouvernements représentatifs et des bureaucraties. Mais ce pouvoir politique séparé de la population ne pourra jamais remplacer un espace de délibération commun. Et ce qui est encore plus grave, en monopolisant la légitimité de l'action politique, ce pouvoir séparé en vient fatalement à devenir un pouvoir violent qui n'incarne plus la souveraineté du peuple, mais au contraire qui usurpe cette souveraineté. Hannah Arendt en conclut qu'il est urgent de réhabiliter la politique comme un espace pluriel de discussion et de délibération. Car même si cet espace commun sera forcément perturbé par des désaccords profonds, il disposera d'une légitimité qui ne reposera pas sur la violence ni la contrainte, mais sur la participation et l'initiative de chacun, et surtout sur la discussion collective. D'ailleurs, nous n'avons pas vraiment le choix. Soit nous assumons notre condition d'animaux politiques et nous faisons de la politique notre affaire prioritaire, soit nous délégons la politique à un pouvoir séparé de nous et alors nous prenons fatalement le chemin du totalitarisme. Car finalement, qu'est-ce que le totalitarisme ? Ni plus ni moins que la négation totale de la politique. Pourquoi ? Parce que le totalitarisme prétend toujours agir au nom de lois qui dépassent l'initiative humaine. Dans le cas du nazisme, c'est au nom d'une prétendue loi de la nature qui supposerait l'existence d'une race supérieure, la race aryenne, qui serait censée dominer tous les autres peuples de la Terre. Dans le cas du stalinisme, c'est au nom d'une idéologie qui prétend que l'histoire humaine obéirait à des lois scientifiques inéluctables. Et dans le cas du capitalisme, c'est au nom d'une idéologie qui prétend que les lois de l'économie régissent naturellement les sociétés humaines, et donc qu'elles doivent primer sur les décisions politiques. Or, toutes ces idéologies, comme nous l'avons dit, ont un point commun. Elles ne se fondent pas sur des lois édictées par les êtres humains eux-mêmes, mais sur des lois qui sont au-delà des décisions humaines. Et c'est pourquoi ce sont des lois, à proprement parler, inhumaines. Le problème, c'est qu'à partir du moment où nous sommes convaincus que les lois qui régissent notre vie politique échappent totalement à nos discussions et à nos délibérations, nous sommes de fait condamnés à l'impuissance politique. Et c'est cela l'essence du totalitarisme, la désertion complète de la politique par l'humain. Une société totalitaire, c'est une société dans laquelle nous n'avons plus aucune raison d'agir, puisque nous sommes convaincus que l'organisation et l'orientation de la société ne dépendent pas de nous, mais de lois qui nous dépassent et sur lesquelles nous n'avons aucune prise. Le totalitarisme, selon Hannah Arendt, ce n'est donc pas l'excès du politique, mais c'est au contraire la négation absolue du politique. Alors, si nous devions utiliser, au présent, la grille de lecture que nous donne Hannah Arendt, quel totalitarisme nous menace-t-il aujourd'hui ? Eh bien, on pourrait dire que le plus grand danger qui pèse sur nous est sans aucun doute le techno-totalitarisme. Et quand je parle de techno-totalitarisme, je n'entends pas seulement l'envahissement de nos vies par toutes sortes d'objets connectés qui traquent et analysent en permanence nos moindres gestes. Et je ne parle pas seulement du contrôle des populations qui en découlent et qui est sans précédent dans l'histoire humaine. Mais j'emploie le terme de techno-totalitarisme dans le sens où Hannah Arendt aurait pu l'employer, c'est-à-dire dans le sens où le progrès technologique remplace l'action politique exactement comme elle le décrit dans la "Condition de l'homme moderne". Et pour bien comprendre en quoi le techno-totalitarisme menace notre condition d'animaux politiques, prenons un exemple très simple. Nous sommes tous, par nature, inégaux. Plus ou moins grands, plus ou moins beaux, plus ou moins forts, plus ou moins intelligents, plus ou moins valides, etc. Que faire pour dépasser ces inégalités ? Eh bien, deux possibilités s'offrent à nous. On peut soit recourir à la science et faire en sorte de réparer ces inégalités par la chirurgie, la manipulation génétique, donc par la technologie. Et dans ce cas, on fait le choix de s'affranchir des limites de notre condition humaine. Ou bien, deuxième possibilité, on peut décider que ces inégalités ne peuvent être dépassées que politiquement. Et dans ce cas, l'idéal à atteindre n'est plus un idéal technologique mais un idéal politique. Pour faire simple, imaginons une société dans laquelle les personnes de grande taille auraient plus de droits que les autres. Comment lutter pour abolir ces privilèges ? Première solution, en faisant appel à la science et à la technologie, pour trouver un moyen de faire grandir, par exemple à l'aide de traitements hormonaux, les personnes qui ne seraient pas assez grandes. Ou bien, deuxième solution, partir du principe que la lutte contre les inégalités entre les grands et les petits n'a rien d'un combat scientifique ou médical, mais qu'il s'agit uniquement d'un combat politique. Or, réfléchissons un instant. D'où nous vient le concept politique d'égalité ? Eh bien, il nous vient du fait que nous sommes tous différents. En effet, si tous les êtres humains étaient identiques, jamais nous n'aurions eu besoin d'inventer le concept politique d'égalité. Car s'il n'y avait aucune différence sexuelle, physique ou cognitive entre les êtres humains, nous n'aurions pas besoin de ce concept politique d'égalité. C'est justement parce que nous sommes tous différents que le concept d'égalité a un sens. Et justement, ce que Hannah Arendt comprend dès 1958, c'est que le refus des limites de la condition humaine trahit un oubli de la condition politique de l'homme. C'est parce que l'homme veut oublier qu'il est avant tout un animal politique, qu'il cherche à fuir sa condition biologique, c'est-à-dire les limites de son corps. Si nous avons aujourd'hui de plus en plus tendance à confondre l'égalité politique des individus avec l'uniformisation biologique des individus, c'est précisément parce que nous avons cessé de penser politiquement, et que désormais l'être humain ne pense plus son corps comme un donné biologique, mais comme une matière première que la technologie lui permet de remodeler selon son bon vouloir. Dès lors, la tentation est grande de préférer un être humain fabriqué en laboratoire à un être humain naturellement conçu. Et la volonté de produire une nouvelle version de l'homme, une version améliorée, augmentée, devient quasiment irrésistible. En 1958, Hannah Arendt écrivait déjà, je cite : "Il n'y a pas de raison de douter que nous soyons capables d'échanger notre vie naturelle contre une vie artificielle. La seule question est de savoir si nous souhaitons employer dans ce sens nos nouvelles connaissances scientifiques et techniques. C'est une question politique que l'on ne peut guère, par conséquent, abandonner aux professionnels de la science ni à ceux de la politique." Et Hannah Arendt ajoute que "nous devons reconsidérer la condition humaine du point de vue de nos expériences et de nos craintes les plus récentes. Ce que je propose est donc très simple. Rien de plus que de penser ce que nous faisons." Penser ce que nous faisons, c'est d'abord comprendre que ce n'est pas la technique qui nous rendra immortels, contrairement à ce que proclament aujourd'hui les transhumanistes. Mais au contraire, le fait d'œuvrer à un monde commun est de déterminer, par notre action politique, quel doit être ce monde commun. Ainsi, lorsque nous mourons, nous savons que le monde auquel nous avons activement œuvré nous survit. Et c'est la seule immortalité à laquelle notre condition humaine nous permet d'aspirer. Parole de philosophe.