Pourquoi parle-t-on rarement du handicap dans les recherches sur le genre ? Dans cet épisode, Mathéa Boudinet, sociologue post doctorante au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) affiliée au Centre de recherche sur les inégalités sociales de Sciences Po, revient sur les dialogues et les croisements entre les recherches sur le handicap et les recherches sur le genre. Elle présente un recueil de textes sur ce sujet traduits pour la toute première fois en français.
--
Lire la transcription écrite de l’épisode. (https://www.sciencespo.fr/gender-studies/sites/sciencespo.fr.gender-studies/files/Transcription-Genre-etc-theorie-feministe-handicap.pdf)
--
📚 Ressources
• L'anthologie La Théorie féministe au défi du handicap (https://www.cambourakis.com/tout/sorcieres/la-theorie-feministe-au-defi-du-handicap/) (Cambourakis, 2025) coordonnée par Célia Bouchet, Mathéa Boudinet, Maryam Koushyar et Gaëlle Larrieu, avec Les Dévalideuses (https://lesdevalideuses.org/). Recueil de textes de sept chercheuses : Michelle Fine, psychosociologue étasunienne, Adrienne Asch, chercheuse en bioéthique étasunienne, Susan Wendell, philosophe canadienne, Jenny Morris, chercheuse en politiques sociales britannique, Carol Thomas, sociologue britannique, Rosemarie Garland-Thomson, chercheuse en bioéthique étasunienne, et Eva Feder Kittay, philosophe étasunienne. Dans l'introduction du livre, les autrices reviennent sur la généalogie des différentes studies mentionnées au début du podcast.
• Un article de Dominique Masson : “Les théories féministes anglosaxonnes du handicap. Cartographie des Feminist Disability Studies” (https://shs.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2022-2-page-89?lang=fr) (2022)
• Un article Lucas Monteil et Alice Romerio : “Des disciplines aux « studies »” (https://shs.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2017-3-page-231?lang=fr) (2017)
🎧 Écouter d’autres épisodes
• Couples, genre et handicap (https://smartlink.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/couples-genre-et-handicap), avec Célia Bouchet
• L’intersectionnalité et le droit français (https://smartlink.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/l-intersectionnalite-et-le-droit-francais), avec Marie Mercat-Bruns
• Une éthique de l'expérience minoritaire (https://smartlink.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/une-ethique-de-l-experience-minoritaire-avec-bruno-perreau), avec Bruno Perreau
• Les mobilisations contemporaines contre les injustices : radicales et fluides (https://smartlink.ausha.co/sciencespo-presage-genre-etc/les-mobilisations-contemporaines-contre-les-injustices-radicales-et-fluides), avec Réjane Sénac
--
Genre etc. est le podcast du Programme d’études sur le genre (PRESAGE) de Sciences Po. (https://www.sciencespo.fr/gender-studies/fr/)
Musique originale : © Lune
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.



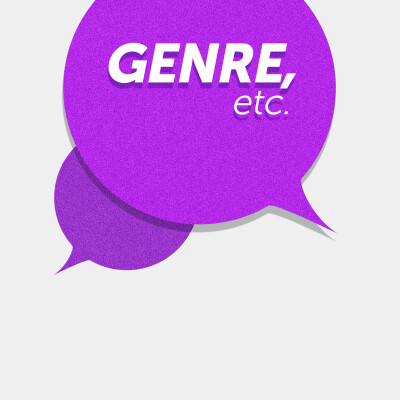

![[FOCUS] Mesurer les violences sexistes et sexuelles à l’université, avec Victor Coutolleau, Clara Le Gallic-Ach et Hélène Périvier cover](https://image.ausha.co/thaiRTemCq79HKSGFDk6esivWRZoUmvPmTh7wL6Y_400x400.jpeg)


![[FOCUS] Droit et sociologie face aux inégalités et aux discriminations, avec Émilie Biland-Curinier et Marie Mercat-Bruns cover](https://image.ausha.co/3MbaA9yuI0ZzE5zDt20jslIA1nZuXGyk8zFuMLGn_400x400.jpeg)

