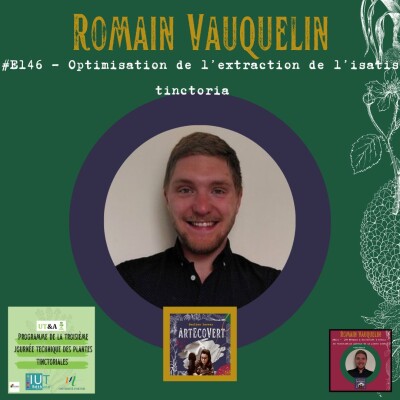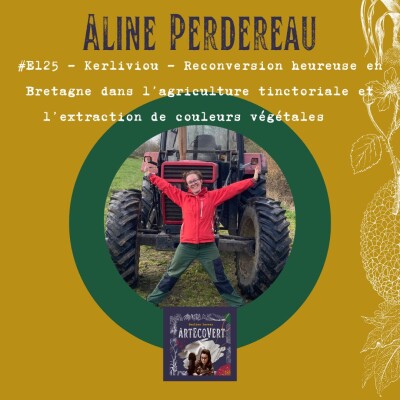Romain Vauquelin Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une partie de mes travaux de thèse. Cette thèse a été réalisée dans le laboratoire UTA, où on est ici. dans le laboratoire Bio-Eco-Agro, un laboratoire d'Aldo. J'ai travaillé sur l'optimisation d'un procédé d'extraction d'un pigment indigo à partir de la OED. On va revenir sur des choses qu'on a déjà vues, mais aujourd'hui il faut savoir que la majorité de l'indigo qui est produit est majoritairement d'origine synthétique. On produit au niveau mondial 80 000 tonnes par an. La moitié de cet indigo est destinée à l'industrie de la teinture. Donc il faut aujourd'hui trouver des voies de valorisation, notamment pour pallier à différents problèmes, notamment au fait qu'on utilise de l'aniline et du dithionine de sodium à la fois pour la synthèse organique et pour l'aspect teinture. Et donc également on a des problèmes d'émission de gaz à effet de serre. et aussi de la pollution des eaux. Donc on cherche des voies alternatives, à la fois sur le procédé et sur la teinture. Donc moi, dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé uniquement à l'aspect procédé de production notamment. Donc on est parti de ce qui se faisait de façon ancestrale, on est parti de l'isatiste intima qui est une plante bisannuelle, une brassica, et qui est actuellement non domestiquée. Et donc on s'est intéressé à récupérer les feuilles de cette plante. On a réalisé une extraction aqueuse et dans cette extraction, on a ajouté notamment de la chaux pour obtenir un indigo bot. L'objectif de ma thèse était à la fois d'optimiser ce procédé, mais également de définir des valorisations de différents coproduits issus de ce procédé pour trouver d'autres voies de valorisation. Donc on a utilisé notamment les activités antioxydantes pour évaluer s'il y avait un intérêt de garder ces extraits ou non, notamment aqueux et également hydroalcooliques. Dans cette présentation, je vais vraiment être maxé sur l'optimisation du procédé, mais vraiment même sur une petite partie de l'optimisation, notamment dans les contraintes de temps. Il est à savoir que dans l'indigo naturel, on retrouve généralement l'indigotine et l'indilurbine, qui sont généralement liés entre elles. Étant donné que c'est des isomères, on ne peut pas parler de l'indigotine pour moi sans parler de l'indirubine, étant donné qu'on les retrouve généralement dans l'extrait. Donc on a ces molécules, mais la grande majorité de l'indigo naturel est d'origine, et c'est une grande majorité notamment de composés inorganiques. Pour l'indigotine, on est plus sur des propriétés, comme on l'a vu, tectoriales, et également en santé, comme l'a dit Catherine, notamment pour la leucémie, qui est utilisée en santé. Là, je vais aller très vite sur cet aspect chimie. Dans la plante, on ne retrouve pas directement l'indigotine ou l'indirubine. Ça vient de précurseurs, et ces précurseurs et l'indoxyle. L'indoxyle va avoir une réaction avec l'oxygène de l'air pour former l'indigotine. Mais cet indoxyle provient de différents hétérosides. C'est ces hétérosides qui vont produire la molécule d'indigotine. Dans le cas notamment de l'isatis timtaria, on est dans grande majorité avec l'isatane B. Concernant l'indirubine, là on va avoir une addition entre l'isatine et l'indoxyle pour former l'indirubine. Cette isatine provient de l'oxydation de l'indoxyle et également de l'hydrolyse de différents hétérosines. Donc ça c'était vraiment l'aspect, ce qui se passe dans le procédé de manière chimique. Et là on l'a retranscrit, donc ça c'est les travaux qui ont été réalisés avec l'entreprise bleu d'Alien, notamment fait... notamment on est passé pour optimiser le procédé à observer ce qui se faisait notamment sur le procédé qu'on a adapté à l'échelle du laboratoire. Donc on a défini le procédé à l'échelle semi-pilote et qu'on a adapté à l'échelle laboratoire. Donc au niveau de l'échelle semi-pilote, ce qu'on a constaté c'est que les agriculteurs récoltés sur l'intégralité, ils faisaient une récolte le matin et cette récolte est traitée dans l'intégralité de la journée. Donc on va avoir dans un premier temps une étape d'infusion, donc c'est une extraction. où on va réaliser dans les tanks une infusion aqueuse pendant 30 minutes à 60°C. Ensuite, la phase de suicidation va être réalisée dans des cuves comme celle-ci, où on va ajouter de la chaux et on va effectuer une aération pendant 30 minutes. Là, c'est pour former l'indigotine à partir de l'indoxyle. Ensuite, il va y avoir des décantations successives, jusqu'à attendre sur une nuit et ajouter l'intégralité du procédé. de la veille dans ces bidons pour ensuite réaliser des étapes de lavage et former le pigment. Et ensuite, le pigment est destiné à des utilisateurs finaux. Donc là, on a vraiment mis en place ce qui se déroulait sur le procédé, mais à l'échelle laboratoire, pour réaliser l'optimisation de ce procédé, on était obligé d'avoir un contrôle qualité. Donc en fait, on a réalisé l'optimisation dans l'ordre inverse du procédé. Tout d'abord, on a mis en place le contrôle qualité par HPLC pour connaître la quantité en indigotine et en indirubine dans nos poudres. Ensuite, on a optimisé l'étape d'oxydation pour former à partir de l'indoxyle les molécules d'indirubine et d'indigotine. Et enfin, l'étape d'infusion pour maximiser durant cette étape d'extraction, pour récupérer le maximum de molécules. Donc là, dans cette présentation, je vais vous parler uniquement de l'étape d'infusion. pour la suite. Il est essentiel que je présente la manière dont j'ai exprimé mes résultats, et c'est en fait en lien avec ce qu'on avait mis en place pendant la thèse, et également par rapport à ce qu'on peut retrouver dans la littérature. A savoir qu'on parle d'une masse feuille, donc de feuilles fraîches, on obtient un indigo brut, et que dans cet indigo brut, on obtient une certaine quantité d'indigotine et une certaine quantité d'indirubine. Donc on peut définir On a pu définir trois types d'expressions, notamment le rendement. On retrouve généralement, quand on peut discuter entre personnes du monde de la teinture indigo, on va généralement parler en rendement. Les chiffres qu'on va obtenir, c'est souvent les rendements qui correspondent à la masse d'indigo brut sur la masse de feuille fraîche. Ensuite, la pureté qui correspond à la masse, donc la quantité d'indigotine et d'indirubine contenue dans l'indigo brut. Et enfin le ratio qui correspond à la masse d'indigo et d'indigotine, d'indigotine et d'indirubine, reportée à la masse de feuille fraîche. Nous, on s'est intéressé uniquement dans la présentation au ratio. Au niveau de la phase d'infusion, on a défini différents paramètres, notamment qui pourraient être importants, mais il peut y en avoir d'autres. On avait décidé d'utiliser des plans d'expérience, et pour cela on a réduit déjà certains paramètres. pour regarder uniquement la température, le ratio, qui correspond à la masse de biomasse sur la masse d'eau utilisée, le temps d'infusion et la qualité de l'eau utilisée. Au niveau, on a utilisé un plan d'expérience de type Kaguchi, avec au total 8 expériences, avec 4 répétitions, ce qui correspondait à 32 essais, avec différents niveaux pour ces facteurs. Au niveau des résultats, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a notamment... des résultats équivalents, notamment en termes de ratio en indigo, que ce soit à 50 ou à 60 degrés, pour un ratio de 1 g pour 3 ml, pour un temps de 45 minutes. Ce qui montre qu'on peut notamment réduire la température, ce qui est intéressant dans une dynamique d'économie d'énergie. Et le plus important, c'est surtout que le ratio est le facteur le plus intéressant sur la production d'indigo. Ce qui est étonnant, c'est qu'en réduisant la quantité d'eau, on augmente la concentration d'indigotine récupérée. C'est plutôt intéressant. Également dans une dynamique où on est comme une homisidore. Par contre, au niveau du temps, on voit qu'il est préférable de garder un temps plus long par rapport à 45 minutes au lieu des 15 minutes. Au niveau de l'indirubine, on trouve des résultats similaires. Seulement là, ce qui va être intéressant, le ratio est toujours le facteur prédominant, mais là on voit qu'il y a l'aspect du temps qui va rentrer en compte. Donc il serait intéressant de prendre... en considération ce facteur pour trouver des compromis, si on veut notamment réduire la quantité d'indirubines au profit de l'indigotine. Donc réduire peut-être cet aspect temps, peut-être à 30 minutes, pour observer notamment plus d'indigotine dans les extraits. Après, on avait réfléchi au ciel. Pourquoi pas proposer différents lots d'indigo, avec notamment, si on veut travailler plus sur de l'indirubine, prendre le facteur qui est plus intéressant et du coup l'adapter pour avoir cet indice. Donc au niveau des résultats que je vous ai présentés, on a mis en place, on a adapté ce qui était fait à l'échelle de ce pilote à l'échelle laboratoire et on a adapté en fait après chaque étape, on les a optimisés. Donc là ça n'a pas été présenté, mais il y avait une mise en place du contrôle qualité par HPLC, mais également on a tous eu une question sur la phase d'optimisation. qui a pris un certain temps, notamment parce qu'on a mis en place un test permettant d'oxyder et d'hydrolyser totalement l'extrait pour former l'indigo, l'indirubine et l'indigotine. Donc là, au niveau du procédé optimisé sur la phase d'infusion, on était donc, en tout cas pour l'indigotine, sur des facteurs. On utilise une eau de ville pendant 45 minutes à 50 degrés avec un ratio 1 g pour 3. à l'abri de la lumière et sans agitation. Les perspectives, ce serait notamment de comparer ces résultats à l'échelle semi-pilote pour voir si on trouve les mêmes similarités. Et il serait intéressant également d'avoir un focus spécifique sur la formation d'indirubines pour comprendre vraiment comment se forme cette indirubine dans l'extrait et voir s'il y a un lien entre ces deux molécules. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Romain.