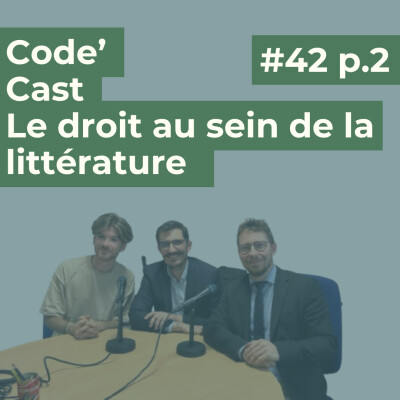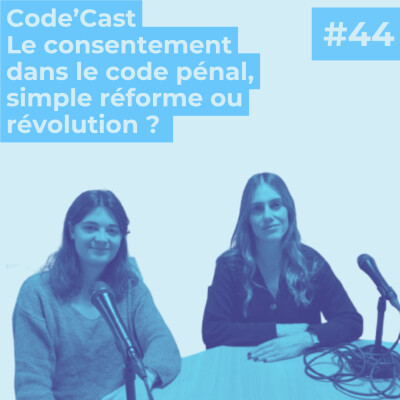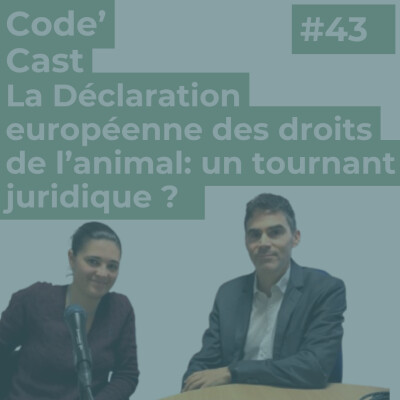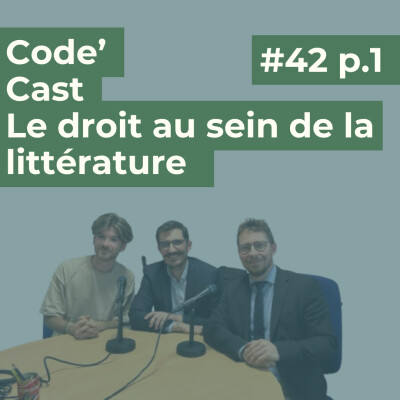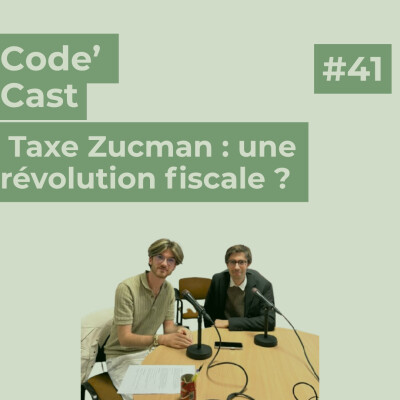- Speaker #0
Codcast, le podcast juridique de la Faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université.
- Speaker #1
Continuons dans la deuxième partie de cet épisode qui porte sur le droit et la littérature avec Marc Autreau et Alexandre Ferracci. Marc Autreau, vous dites que le mouvement droit et littérature pose la question de comment peut-on toucher le réel dans la littérature. Mais est-ce que finalement, la manière dont on rend la justice n'est pas influencée par des récits, des histoires, une culture, plus que par une logique purement rationnelle ? En fait, est-ce que la littérature peut presque toucher le réel ?
- Speaker #2
Effectivement, la place du récit est quelque chose d'extrêmement important. Alors certes, on a l'habitude de raisonner sous la forme de règles, de principes, sous forme de syllogismes, d'argumentations juridiques, d'applications. des textes, mais c'est tout l'intérêt notamment à la fois du projet herméneutique et du projet narrativiste, c'est de nous montrer que l'application, l'interprétation des textes laisse une grande marge de manœuvre, une certaine part de créativité qui est assez forte aux différents organes de concrétisation, notamment les juges. et le mouvement enfin Le projet narrativiste avait pour but de remettre sur le devant de la scène la question du récit, et en quoi le récit était un moyen déjà de conditionner, de fournir un cadre aux différentes options interprétatives. Je vais prendre un exemple peut-être assez parlant, mais si en tant que juge, on a cette petite musique, ce petit récit en arrière-plan de notre tête, qui nous dit qu'on est une démocratie libérale globalement juste, On aura tendance, effectivement, à choisir, même presque sans rendre compte, certaines options par rapport à d'autres dans l'interprétation des textes et dans la manière de les appliquer ensuite. Par contre, si on est au courant de certains contre-récits qui nous expliquent que non, on est certes une démocratie libérale, mais elle est plutôt défaillante, qu'il y a des injustices, une pauvreté, des exclus, des personnes marginalisées, on aura peut-être, effectivement... tendance, avec ce contre-récit en arrière-plan, à envisager des cadres nouveaux, des solutions nouvelles, des interprétations alternatives. Et donc je pense que le récit, qui est effectivement très lié à l'idée de culture en fonction de culture et de l'arrière-plan culturel que nous avons, conditionne en grande partie les options qui nous sont ouvertes en tant que juriste.
- Speaker #3
Alors je suis entièrement d'accord avec ça. La question de la créativité me semble absolument centrale, non seulement du point de vue de l'application du droit, mais aussi du point de vue de la formation des juristes. Parce qu'effectivement, et ça je m'en suis souvent aperçu, notamment au niveau du Master 2, auprès des étudiants de Master 2, nous formons à Aix-Marseille Université, à la Faculté de droit bien évidemment. d'excellents juristes et de très très bons techniciens et ça, cela ne fait aucun doute. Cependant, lorsqu'on demande à un étudiant de Master 2 de faire un pas de côté et de proposer, par exemple, une règle différente de la règle qui existe ou bien de lui poser une question toute simple, c'est-à-dire lui montrer que dans tel cas, par exemple, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de norme, il n'y a pas de... de texte écrit, et lorsqu'on lui demande de créer une règle lui-même, une règle de droit, souvent on s'aperçoit que les étudiants ont de grandes difficultés à faire cet effort de créativité, cet effort de remise en question qui... en réalité démontrent une difficulté liée à la possibilité d'interpréter des textes de manière peut-être un peu plus libre que ce qu'ils n'ont l'habitude de faire en raison de leur étude du droit positif existant. Et donc je pense qu'ici, la littérature peut être une ouverture extrêmement importante pour ces étudiants parce que les études littéraires visent à ces questions. herménotiques, ces questions d'interprétation démontrent comment effectivement le lecteur ou celui qui le spectateur d'un film d'une pièce de théâtre peut interpréter à divers niveaux une pièce et est libre en quelque sorte de son interprétation montrer également que le juriste est capable de cela s'inscrit dans une démarche d'interprétation des textes qui bénéficie d'un certain degré de liberté Merci. me semble tout à fait important. Et donc souvent, lorsqu'on met sous les yeux d'un étudiant, par exemple, un texte de Kafka ou autre, on voit que l'interprétation de ces textes donne lieu à une variété, à une créativité assez conséquente pour la détermination du sens. Et lorsqu'on le relie à une norme écrite, on s'aperçoit souvent que l'étudiant prend plus de liberté. avec cela et donc fait œuvre de créativité. Ce qu'il devra faire ensuite tout au long de sa carrière, à la fois comme juge, lorsqu'effectivement il se trouve confronté au silence des textes, à la fois comme juriste d'entreprise, lorsqu'il devra rédiger telle clause inédite dans tel contrat inédit. Toute cette créativité est extrêmement importante. Et donc, effectivement, en mettant la focale sur le phénomène herméneutique, en droit Comme en littérature, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté qui apparaît et qui fait un bien fou, je pense, dans les études juridiques.
- Speaker #1
Avant de continuer, pouvons-nous faire un petit point définition ? Pouvez-vous nous définir un petit peu en quelques mots ce qu'est le projet herméneutique ou juste l'herméneutisme en général ?
- Speaker #2
Alors, le projet herméneutique, il faut déjà, pour le comprendre, le réinscrire véritablement dans le contexte historique. On a une cour suprême. qui devient une cour conservatrice, c'est la cour Rehnquist. Et en fait, cette cour va promouvoir un originalisme interprétatif. C'est cette idée qu'on doit, la seule façon légitime de correctement interpréter la Constitution, c'est soit de se reporter aux conventions de langage au moment où on a rédigé la Constitution, donc pour les États-Unis, c'était deux siècles avant, soit il s'agissait de s'en remettre aux intentions des pères fondateurs. Donc dans tous les cas, il s'agit de... de se demander ce que l'auteur, ce que l'auteur de la Constitution, les pères fondateurs de la Constitution avaient en tête, d'une manière ou d'une autre. Très clairement, en faisant ce... en choisissant l'originalisme en termes de théorie interprétative, ça implique que les pères fondateurs n'avaient pas pensé à la fin des discriminations raciales, donc il ne faut pas les consacrer. Ça impliquait que les pères fondateurs n'avaient absolument pas pensé au droit à l'avortement, donc il ne faudrait pas le consacrer. Et tout le travail justement de ce tournant herménotique, c'est de contrecarrer la montée de l'originalisme et l'impact de la Cour suprême conservatrice aux États-Unis. Donc en gros, c'est presque une manière de mettre à distance le projet humaniste initialement promu par les promoteurs du mouvement droit et littérature qu'on trouvait un petit peu naïf. Et c'est comment, effectivement, réussir à s'opposer à la Cour suprême, mais d'une manière un petit peu plus moderne. Et pour ça, notamment, c'est de considérer l'interprétation juridique comme une interprétation littéraire. Et comme, à ce même moment, l'interprétation littéraire avait fait un peu son tournant en important les théories de la déconstruction de chez Derrida, c'était un peu la mort de l'auteur. Il ne s'agissait plus de savoir ce que l'auteur voulait nous dire. mais plutôt ce que le texte lui-même pouvait nous dire, à l'aune des conventions de langage d'aujourd'hui aussi. Donc c'était un moyen presque méthodologique, avec cette forme d'interdisciplinarité, de sensibiliser les juristes à une autre manière d'interpréter les textes qui était différente de l'originalisme promu par la Cour suprême américaine.
- Speaker #1
Pour faire le lien avec la suite, est-ce que cette manière de penser le droit à travers les récits Rejoint d'autres approches critiques du droit comme les Critical Legal Studies. Et est-ce que vous pourrez nous expliquer ce qu'est ce mouvement ?
- Speaker #2
Alors oui, le lien, il se fait essentiellement avec le troisième projet, le troisième objectif de ce mouvement. C'est le projet narrativiste. Ce projet narratif. On le voit apparaître dans les années 80, on a un article phare de Richard Delgado en 89 qui est effectivement de remettre sur le devant de la scène cette question du récit et notamment des contre-récits. Et c'est important parce que ce projet narrativiste, il va donner lieu à la fois aux théories critiques féministes dans l'approche du droit, mais va aussi donner lieu à la naissance des critical race studies, des études critiques de la race. où effectivement il s'agit de penser de manière critique comment les institutions vont accorder une certaine forme de privilège à des hommes blancs. Et comment culturellement, sans qu'on ait peut-être fait attention, on est venu cristalliser certaines règles, certaines institutions qui donnaient un certain avantage à certaines catégories de la population. Et comment, du coup ? d'autres catégories de la population étaient certainement désavantagées, les femmes et notamment les noirs, et alors encore plus effectivement les femmes noires aux Etats-Unis. Donc ce mouvement-là effectivement a donné naissance, enfin tout du moins a impulsé une réflexion de manière plus générale sur le poids des institutions et sur les inégalités qui étaient plus ou moins reproduites par les institutions aux Etats-Unis. Et je crois effectivement que le lien, tout du moins, entre les Critical Legal Studies ou droit et littérature, ce n'est jamais rarement les mêmes auteurs qu'on vient citer, mais le point de contact, il se fait, à mon sens, au travers de ce projet narrativiste.
- Speaker #1
Donc, une des idées centrales des Critical Legal Studies, c'est que le droit sert souvent les intérêts des plus puissants. Est-ce que vous, vous pensez que c'est encore vrai aujourd'hui ?
- Speaker #2
Initialement. Il s'agit de revenir sur le fait que le droit, ce sont des directives posées par le souverain. Pour la plupart des membres des Critical Legal Studies, le droit découle de la culture dominante. Et cette culture dominante va donc favoriser un certain segment de la population. Donc, est-ce qu'on peut dire effectivement qu'à vocation à privilégier les puissants, c'est une question qui n'est pas vraiment évidente. Tout dépend dans quel système dans lequel on se trouve et j'ai quand même l'impression que certes s'il y a des inégalités ou s'il y a effectivement des rapports de dominants et de dominés au sein de nos systèmes, c'est inévitable, tout du moins aujourd'hui tel que le système est structuré, j'ai l'impression malgré tout que lorsqu'on est puissant on peut effectivement être inquiété par le droit. Je crois que certains procès de ces dernières semaines ou derniers mois ont pu quand même nous le montrer.
- Speaker #3
Sans compter également tout un tas de règles de droit dont la vocation est précisément de protéger les plus faibles. Et donc ici, nécessairement, la chose doit être nécessairement relativisée. Sans compter ensuite les formes d'instrumentalisation du droit. Le droit peut être instrumentalisé par les puissants. Le droit peut aussi être instrumentalisé par les faibles, dès lors qu'ils se l'approprient et qu'ils arrivent, grâce à des procès divers et variés, à défendre leur droit face aux puissants également. Donc effectivement, la chose n'est pas toute blanche ou toute noire, mais là encore, c'est ce que nous montrent les Critical Legal Studies et c'est également... Ce que nous apporte le droit et littérature comme éclairage, en montrant que bien souvent, ce droit est instrumentalisé à la fois à la faveur des puissants, mais aussi parfois à la faveur des faibles.
- Speaker #1
Un grand merci Alexandre Ferracci et Marc Cottero pour cet éclairage très intéressant. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, code.cast.amu. Alors faites-nous part de vos retours sur nos réseaux. Nous serions aussi heureux de lire vos suggestions sur des thématiques futures. A très bientôt pour un nouvel épisode de CodeCast. Merci à toutes et à tous et à bientôt !