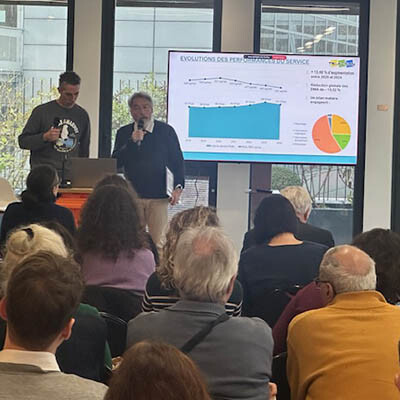Speaker #0Pierre Rioux, Pierre qui est directeur de programme pour le projet UrbaIA, un projet qui nous tient d'autant plus à cœur qu'on travaille avec vous et qu'on fait partie du projet. Et c'est un très beau projet, justement, où on va pouvoir allier IA et urbanisme. Je lance votre présentation et je vous laisse la parole. Merci, Laurie. Vous m'entendez bien. Merci, Laurie, pour cette invitation. très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Je m'appelle Pierre Rioux, je suis directeur du programme Urba IA, je suis également membre de la commission AFNOR de normalisation sur l'IA, membre expert, et en particulier sur les sujets d'IA frugal. J'ai également participé à la conception avec Ecolab et l'AFNOR du référentiel général pour l'IA frugal. Je fais aussi partie du Hub France IA, qui est une association qui peut promouvoir les startups françaises en intelligence artificielle. et du groupe de travail environnement de ce hub France IA avec entre autres la métropole du Grand Paris. Donc plein de réseaux qui communiquent. Aujourd'hui je vais vous parler du projet Irbaïa, un petit peu de sa genèse, d'où il vient aussi bien en termes de contexte global et de contexte spécifique de l'agglomération, quels sont les tenants et les aboutissants de ce projet, et puis un petit peu où on en est en termes d'avancement. En termes de genèse... Ça s'inscrit sur deux piliers. Il y a un premier pilier qui est plutôt national et international sur les grands projets France 2030 qui sont associés à la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et qui visent à prendre en compte, en tout cas dans le cadre de l'appel à projet de l'Ecolab et de la Banque des Territoires. sur les référentiels, sur les démonstrateurs de l'IAF Legal, les enjeux, d'associer les enjeux à la fois d'intelligence artificielle, d'environnement et de territoire. Donc l'objectif c'est d'appliquer les investissements d'intelligence artificielle pour promouvoir les enjeux environnementaux et la transformation environnementale en application des territoires. Une autre initiative qui est nationale et internationale concerne la partie IAF Legal. Alors pour répondre à une question antérieure qui a été posée, Il s'agit à la fois d'une volonté nationale de défendre la filière de l'intelligence artificielle embarquée et la filière industrielle qui est issue des filières aéronautiques et militaires, qui est une expertise française, et de défendre la capacité à développer des systèmes d'IA quand on arrivera à des environnements un peu contraints en termes de ressources et de bandes passantes. À partir du moment où on a des solutions... des solutions plus frugales, on est capable à la fois d'être plus compétitif commercialement, mais aussi de faire tourner ces systèmes avec moins de ressources. Et donc ce référentiel a été généré dans une dynamique franco-française, avec l'Ecolab et l'Afnor. Il a été poussé ensuite au niveau européen, au niveau de SensenElec, et fait partie des éléments qui ont été présentés dans le cadre du sommet pour l'IA au début du mois de février, avec la mise en place d'un consortium. international pour promouvoir l'IA frugale au niveau mondial et puis fédérer avec l'ISO, avec l'UNESCO, avec l'I3E, une harmonisation de l'ensemble des corpus de normes autour de l'IA frugale au niveau international. C'est une initiative qui part de là. Ces éléments-là ont conduit à un appel à projet de la Banque des Territoires et de l'Ecolab. qui a matérialisé, donc ça répond aussi à quelques questions précédentes, sur lesquelles il y a eu 25 lauréats, un petit peu partout en France, sur différents sujets, donc ça c'est spécifiquement la cartographie qui a été menée, qui a été, donc il y a eu trois vagues, et le projet Urbaïa fait partie de la troisième vague, et qui concerne tous les aspects de mobilité, de construction, traitement de l'eau, traitement des déchets, des aspects qualité de l'air. Et puis la partie urbanisme, c'est le petit logo jaune, c'est une coïncidence, c'est la couleur de l'agglomération. Donc il y a des démonstrateurs partout et toutes ces démarches ont vocation à la fois à concrètement déployer des solutions d'IA au service des territoires et pour des enjeux environnementaux. Au-delà de cette dynamique globale, il y a aussi une dynamique qui est liée au territoire et à l'agglomération de Paris-Saclay. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, je suis là. Et donc on a effectivement une image qui est extrêmement orientée laboratoire, centre d'innovation, centre d'expertise avec l'ensemble des chercheurs qui sont sur le territoire, l'ensemble des écoles, les 300 labs qui sont présents sur le territoire. Mais on a aussi une orientation qui est très orientée sur le territoire lui-même, puisqu'il y a 320 000 habitants, il y a 27 communes, on a 17 000 hectares de terres. non urbanisés de terres protégées et donc aujourd'hui une des spécificités de notre territoire est de faire en sorte de bénéficier de faire bénéficier notre territoire de toute la dynamique d'innovation et de recherche qui est disponible sur la zone et également de manière plus globale des initiatives nationales et internationales qui sont présentes je suis intervenu alors Rodolphe citait Hubert Béroche tout à l'heure sur la dynamique de ... de gouvernance de l'IA appliquée aux enjeux territoriaux. Je suis intervenu dans le cadre de l'IA Summit avec Hubert sur ces enjeux-là, puisque nous travaillons aussi avec lui sur la concertation territoriale autour de l'IA. Et un des éléments clés et différenciateurs de l'agglomération Paris-Saclay qui était relevé, c'était le fait que nous appliquions nos labos de recherche et nos systèmes d'IA sur l'utilisation pour les citoyens. Et pour le territoire, ce qui était souvent une lacune qui avait été identifiée à Boston, par exemple, ou dans d'autres études, le fait de la capacité à faire ruisseler les expertises technologiques et l'innovation sur les territoires. Cette autre spécificité de l'agglomération Paris-Saclay, on évoquait tout à l'heure au niveau de cette zone-ci, une forte mobilité et beaucoup de changements. dans l'aménagement, ça fait aussi partie des spécificités du territoire. Mais au-delà de ces éléments-là, nous avons trois piliers qui s'articulent à la fois autour de l'innovation, que j'évoquais tout à l'heure, au travers des laboratoires, centres de recherche et études, de la partie innovation technologique avec vocation de l'orienter vers l'action publique. Ce sont des projets qui sont initiés depuis plusieurs années, qui s'articulent sur des stratégies Green IT, sur des stratégies de... de réponse à la loi Rennes et de feuilles de route de la charte du numérique responsable. Et en fait, tous les éléments qu'on a mis en place par la suite sur la partie feuilles de route de l'intelligence artificielle se sont appuyés sur les enjeux qui avaient été identifiés, les feuilles de route qui avaient été identifiées au préalable sur les aspects numériques. Le troisième pilier est la culture de partenariat, sur lequel on va revenir tout à l'heure. qui est un des ADN de l'agglomération, puisqu'on travaille énormément avec nos partenaires, qu'ils soient locaux, régionaux, nationaux. On évoquait tout à l'heure le fait de travailler avec l'IGN sur le jumeau numérique national. On est tout à l'heure, en ce moment, aux Interconnecté ARN, où on a reçu une médaille d'argent pour un démonstrateur dans le cadre de la plateforme du PCAET, du plan climat de l'agglomération. Et donc on intervient dans ces instances-là. On a aussi une vision internationale, puisqu'on était en début de semaine à Bruxelles pour signer le local Green Deal dans le cadre de l'ICC. Et on a eu des interventions à Boston, à Montréal, à Singapour récemment sur ces sujets-là. Donc la logique est d'intervenir, d'avoir un ancrage territorial fort, d'avoir une... une portée nationale et une intégration dans les réseaux nationaux et aussi une vision qui soit au-delà et tendue à l'international. Alors concrètement, au-delà de ces aspects-là, ces éléments-là ont concouru à la genèse du projet Urbaïa. C'est-à-dire qu'on n'a pas construit le projet par rapport à l'appel à projet, mais on avait déjà ce projet qui était en ligne de mire et on a juste aligné les planètes pour pouvoir le matérialiser. Et l'objectif du projet Urbaïa, c'est de mettre l'intelligence artificielle au service de l'urbanisme et de l'urbanisme de demain, avec des contraintes réglementaires fortes autour de, par exemple, la Loisanne. problématiques techniques qui sont associées à des problématiques écologiques, donc de plus en plus de paramètres à prendre en compte dans les décisions, et une complexité croissante des règles d'urbanisme. La logique de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans ces sujets-là visait à construire des scénarios qui soient assistés par l'IA. L'IA ne va pas forcément être le promoteur ou l'instigateur de scénarios, mais sur leur description et leur mise en œuvre, l'IA va assister les métiers à la concrétisation des scénarios qui pourront être modélisés dans la plateforme. d'intégrer l'ensemble des paramètres écologiques clés et de les modéliser, puisqu'on a, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a un certain nombre de données, mais on ne les a pas forcément toutes. Donc l'idée, c'est de pouvoir étendre les données qu'on a aussi précisément que l'on peut sur les périmètres qui nous manquent, de proposer une vision claire des enjeux d'urbanisme à moyen terme. L'objectif, c'est une stratégie de jumeau numérique et donc de viser, non pas à constater à postériori, les impacts environnementaux des éléments qui ont été qui ont été décidées 5, 10, 20, 15 ans avant, mais d'anticiper, de prévoir et de prédire l'impact environnemental des décisions pour pouvoir orienter la décision en amont de l'exécution. De renforcer l'efficacité de l'analyse des équipes en charge des études, c'est un outil qui est au service des équipes, qui n'a pas vocation à les remplacer. On a vraiment besoin des experts métiers, et c'est aussi pour ça qu'on s'est associé à des experts de ce domaine-là, pour pouvoir, au-delà des expertises qu'on peut avoir nous en interne, pour pouvoir déployer des solutions qui soient adaptées. Et l'objectif, c'est aussi d'avoir un service, un outil qui soit au service des échanges du territoire, c'est-à-dire de faciliter les échanges aussi bien avec les élus, avec les services urbanistiques des différentes communes et avec les citoyens sur les évolutions du cadre de vie dans l'agglomération. Hop, un clic de trop. Rapidement, nous avons défini trois territoires pilotes dans l'agglomération qui ont vocation à couvrir différentes catégories de typologie urbanistique. D'un côté, une zone d'activité, un deuxième parti sur un territoire dense et un quartier de palaiso à croix de ville bois qui correspond à la fois à un tissu urbain traditionnel et une partie du plateau de Saclay. Un des enjeux du démonstrateur, enfin le démonstrateur a un certain nombre d'enjeux. Les raisons de ce choix sont liées à un des enjeux qui est la réplicabilité. L'objectif c'est de construire un démonstrateur qui puisse être réplicable non seulement au niveau de l'agglomération mais plus largement au niveau de l'ensemble des utilisateurs potentiels et des différentes communes qui sont amenées à faire évoluer leur PLU. Donc je crois qu'il y en a quelques unes. Et donc l'objectif est d'avoir des territoires représentatifs. Il y a d'autres enjeux qui sont l'explicabilité. Le démonstrateur est un objectif qui est très important. qui vise à garantir qu'on travaille sur des intelligences artificielles qui ne sont pas des boîtes noires et qui permettent de justifier les décisions qui sont prises. Puisqu'aujourd'hui, au niveau des PLU, il y a quand même des engagements qui sont pris par les élus par rapport à leur commune et par rapport à leurs citoyens. Et il faut être en capacité d'expliquer pourquoi telle ou telle décision a été prise. Et pas simplement aujourd'hui, mais quand des conséquences pourront arriver d'ici plusieurs années. d'être capable de faire du rétro-engineering et dit on a pris cette décision par rapport à cette hypothèse-là, dans ce contexte-là, et d'expliquer pourquoi cette décision a été prise. Donc il y a des notions d'explicabilité, il y a des notions d'égalité, on va y revenir aussi tout à l'heure, puisque l'objectif et l'enjeu c'est de limiter l'impact environnemental du système que l'on déploie, mais aussi de faire en sorte que l'usage de ce système ait le meilleur impact possible au niveau de l'environnement, pas le plus d'impact, mais le meilleur impact possible. Donc ça fait partie des enjeux qui sont mis en oeuvre dans ce projet. Pour illustrer la démarche de partenariat, nous travaillons donc avec l'Institut Paris Région, qui a l'amabilité de nous recevoir sur ces sujets, en particulier sur les éléments autour des métiers de l'urbanisme, et autour de la data et la fourniture des données. Nous avons intégré l'ensemble des communes, qui sont les parties prenantes qui sont concernées par les PLU et les zones pilotes. Nous travaillons avec les membres du consortium qui sont à la fois des entités publiques, des labos de recherche, donc Centrale Supélec, des startups comme Builders et Neimer, qui sont des experts à la pointe de la technologie sur leur domaine, et puis Dassault Systèmes qui est une petite PME française. qui a également une plateforme extrêmement poussée sur les éléments à la fois de visualisation et de modélisation de certains impacts environnementaux, en particulier de la partie qualité de l'air, pollution et propagation d'ondes. Ce consortium est piloté par l'agglomération Paris-Saclay et aujourd'hui nous sommes en train de finaliser tous les éléments contractuels et de poser les rails du projet qui doit durer sur les trois années qui viennent. Je reviendrai un peu plus sur la partie état des lieux tout plus tard. Qu'est-ce qu'Urbaïa ? plus concrètement. L'objectif, c'est d'intégrer tous les documents d'urbanisme littéraux, aussi bien les PLU, les OAP, les annexes, le ZRIFE, les différentes chartes, à partir de ces éléments d'information, de les modéliser dans le système Urbaïa, de manière à créer, à avoir un ensemble de choses qui sont compréhensibles par les outils d'IA, c'est-à-dire que de passer d'un mode, on va dire, littéral, compréhensible par l'humain, à un mode qui est compréhensible par les autres. par les différents systèmes d'IA, et de modéliser les formes urbaines possibles par rapport à l'ensemble de ces documents qui sont mis à disposition par rapport à la situation actuelle. Donc d'identifier ces formes urbaines et leurs simulations par rapport aux enjeux environnementaux. À ce jour, sont identifiés les éléments qui sont liés aux îlots de chaleur, les éléments qui sont liés à la pollution atmosphérique. Et donc, dans un premier temps... Et l'objectif, c'est que ça puisse être étendu par la suite. Ces éléments-là, donc, sur les documents existants, vont être analysés par les experts du domaine et validés par les experts du domaine. Et ensuite, ces experts vont proposer des scénarios d'études, d'évolution, à la fois de l'aménagement ou d'évolution du PLU. Et ces éléments, ces scénarios et ces recommandations seront décrits en tant que scénario, injectés à nouveau dans les documents et remodélisés. Et l'objectif, c'est que la solution... propose une visualisation 3D d'un certain nombre de paramètres sur lesquels les acteurs de l'urbanisme puissent faire varier ces paramètres pour regarder visuellement l'impact au niveau environnemental, mais aussi au niveau réglementaire, mais aussi au niveau artificialisation des sols, mais aussi au niveau de la stratégie d'évolution des élus par rapport à leur agglomération. de mesurer ces impacts-là, de les visualiser et d'ajuster les scénarios qu'ils ont identifiés. Donc on est vraiment dans une boucle et dans une notion de « on pose la photo aujourd'hui, on permet aux experts du domaine et du métier de construire les scénarios et on leur remet à disposition, en fonction de ces scénarios-là, les différents impacts sur un certain nombre de critères qui sont identifiés. » Un des éléments clés de démonstrateur, au-delà de... De ces éléments effectifs, c'est la partie innovation, que je n'ai pas forcément mentionné dans les enjeux tout à l'heure. L'objectif, c'est d'innover sur la manière de concevoir le PLU, donc c'est une innovation méthodologique. Il y a des innovations qui sont plus technologiques, dont on a évoqué aussi Michel tout à l'heure. Alors là, ce qu'on constate, c'est qu'on ne parle pas que d'IA générative, et même dans un certain nombre de cas, il n'y a pas d'IA générative du tout. L'IA, ce n'est pas que l'IA générative, il y a aussi d'autres éléments d'IA qui sont plus frugaux et plus optimisés. Et donc, l'objectif de ce projet, c'est à la fois d'articuler l'innovation sur cinq systèmes d'IA qui vont être interconnectés, mais qui vont aussi être consolidés par des couches de synchronisation de données et d'échange de données qui vont être intégrées par rapport aux données qui vont être mises à disposition sur le projet. et des interfaces qui vont permettre aux utilisateurs métiers d'exécuter leur processus métier par rapport non pas aux outils technologiques qui sont mis à disposition, mais par rapport à leurs besoins utilisateurs. Donc il y a aussi, au-delà de l'innovation sur les systèmes d'IA, il y a aussi de l'innovation sur les méthodologies qui sont mises en œuvre et l'apport méthodologique qui vient des experts de l'urbanisme qui vont nous apporter le déroulement de leur processus métier. Et puis de l'innovation d'intégration pour faire coexister l'ensemble de systèmes. pour produire un service auprès des utilisateurs métiers. De manière un peu plus détaillée, l'ensemble des données SIG vont être intégrées dans le système d'IA qui assure la modélisation et l'étude de densification possible par rapport aux éléments de PLU. Cela sera intégré aussi avec les documents d'Urbanism Littéraux. Cela permettra de construire... Les bâtiments en 3D avec les gabarits maximum disponibles par rapport aux règles qui sont en place et aux démarches qui intègrent aussi la notion de parking. On va reparler des parkings de Michel tout à l'heure. Et de ce qui est en pleine terre. A partir de ces éléments de bâtis 3D, Hop, on avait pas assez de place sur le slide. On fait des simulations, à la fois sur l'impact des îlots de chaleur, sur les impacts environnementaux, dispersion chimique et acoustique, et sur les métriques qui sont importantes par rapport à nos manctures ZAN, aux surfaces imperméabilisées, surfaces construites, aux longues de logement, etc. Donc tout ce qui concerne les éléments qui sont liés au PLU. Et à partir de ces éléments-là, on effectue des recommandations et on revient sur le slide précédent. Hop, ça marche. Ah non, ça ne marche pas. Je me trompe de flèche. Et hop, on revient ici, on réinjecte. Voilà la mécanique qui est envisagée. Sur la dimension frugalité... On parlait de savoir si c'était théorique ou pratique aujourd'hui. Donc ça fait un certain temps qu'on travaille sur les éléments de égalité. Dès l'origine du projet, c'était un postulat. Alors l'appel à projet est sorti avant le référentiel. Donc il y a un certain nombre de choses qui ont été faites dès le départ. Et donc dans les contraintes de l'appel à projet, il fallait déjà... prédéfinir le fait que l'objectif de l'outil devait être égal et donc devait consommer moins que ce qu'il apportait en fait en termes d'impact environnemental. Donc il y a toute une étude qui a été menée en amont pour identifier ou pour prévoir l'impact environnemental en particulier en termes d'énergie de carbone sur des différents systèmes d'IA qu'on utilisait et puis l'objectif de gain est un des éléments de gouvernance qui est mis en place. sur l'ensemble du projet vise à faire en sorte que la frugalité soit un suivi au fil de l'eau et à chacune des étapes du projet et soit pris en compte dans le développement de la solution et dans le développement des usages, des outils et dans la réflexion sur les données. Aujourd'hui on est à un stade où on a commencé à identifier l'ensemble des sources de données. On a vu tout à l'heure avec l'IGN et avec l'IPR que c'était un C'était un vrai challenge sur les projets d'IA et donc on a fait toute cette phase puisqu'on travaille à six sur le consortium, qu'on a tous des usages, des habitudes différentes, que ce soit en termes urbanistiques, en termes de start-up. Les grands groupes ont tous leurs sources de données qui sont potentiellement différentes, qui viennent parfois de la même origine, mais qui ont été retraitées, transformées de manière différente, éventuellement agrégées, éventuellement enrichies par des systèmes d'IA. Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu de cohérence globale du système de repartir sur les référentiels, de redéfinir clairement les référentiels sur lesquels on travaille et de s'assurer que les transformations qui sont faites par les différents acteurs sont à minima cohérentes. Elles peuvent être légèrement différentes, mais il faut qu'elles soient cohérentes parce que si chacun fait ses transformations avec des niveaux d'échelle différents, on va aboutir à un système qui ne va pas pouvoir être intégré. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on intègre dans cette réflexion aussi la dimension de frugalité, c'est-à-dire que la volonté de réduire et de faire en sorte que les données dont on se sert, on ne se sert que des données dont on a besoin. On préfère utiliser moins de données, mais qu'ils soient plus fiables parce que ça consomme moins et qu'on limite les transformations, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire trois transformations identiques ou légèrement différentes dans différents systèmes d'IA. Et donc, les enjeux de frugalité sont pris en compte à toutes les étapes du projet. Les enjeux d'explicabilité également. Parce que de la même manière, même sur les LLM, il faut qu'on soit en capacité de comprendre quelles sont les réponses qui sont apportées, pourquoi, et de vérifier que c'est bien cohérent. Et c'est à ce titre-là aussi que les utilisateurs sont complètement impliqués dans la démarche. Le premier comité qui va avoir lieu dans le cadre du projet, c'est le comité utilisateur, parce que c'est important d'avoir l'expertise, c'est important d'avoir l'expertise métier. L'outil n'a pas objet de remplacer les experts métiers. Et si certaines personnes se servent de l'outil sans avoir l'expertise, ou si tout le monde se sert de l'outil sans avoir l'expertise, on finira par ne plus avoir d'experts. Donc l'objectif, c'est de travailler avec les experts, de faire en sorte qu'on continue à construire ce chemin d'expertise et que l'outil puisse être juste un élément accélérateur ou une dimension supplémentaire de compréhension d'un certain nombre d'éléments. autour de l'urbanisme et non pas remplacer les experts puisqu'on a besoin d'eux et c'est pour ça qu'ils sont intégrés dans le projet aussi, pour valider que le résultat du fonctionnement de l'outil est bien conforme à la réglementation, est bien conforme à l'état de l'art, est bien conforme à ce qu'on attend d'un outil d'évolution du PLU. Donc la partie explicabilité est quelque chose qui a un fil rouge de toute la gouvernance. De la même manière, la notion de réplicabilité est quelque chose qui est un fil rouge de toute la gouvernance. Ce sont des choses qu'on a déjà identifiées au niveau de la data. Et justement, l'identification des référentiels de données prend en compte le fait qu'aujourd'hui, on l'applique en Ile-de-France, sur l'agglomération Paris-Saclay, mais qu'on a vocation à l'implémenter plus largement. Alors, on a déjà une perspective française, mais potentiellement une perspective internationale. Et l'idée, c'est qu'on structure aussi nos environnements données pour comprendre qu'est-ce qui est. du référentiel, qu'est-ce qui est de la donnée de structure, qu'est-ce qui est de la donnée... très localisées et de pouvoir dissocier ces différents ensembles de données pour pouvoir clairement et facilement passer d'un territoire à un autre et identifier, aujourd'hui, toutes ces données ont une portée nationale, toutes ces données ont une portée régionale, toutes ces données ont une portée locale et que le démonstrateur puisse simplement remplacer des domaines locaux d'une agglomération par les données locales d'une autre agglomération. sans que ça nécessite à nouveau de l'apprentissage et que le moteur soit capable de s'adapter à ces données locales, tout en gardant le même corpus régional ou le même corpus national. Je parlais des utilisateurs, j'ai un petit peu anticipé. Donc l'objectif, c'est qu'on est dans un programme qui n'a pas vocation à prendre les besoins utilisateurs, travailler pendant trois ans et puis sortir un résultat et attendre que les utilisateurs évaluent les résultats. Mais on travaille en permanence avec les utilisateurs. pour construire l'outil qui va leur permettre de réaliser leur travail, sachant qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément une bonne vision de tout ce que les outils et l'IA peuvent leur apporter. Et donc, les premiers travaux consistent à croiser les échanges avec les bons experts, entre les urbanistes, les data scientists et les gens qui connaissent les deux pour faire des passerelles et pour... faire en sorte que la solution qu'on va mettre en place va vraiment correspondre à leurs attentes. Et au quotidien, pas au quotidien, mais tout au long du projet, il y aura des évaluations avec une synthèse annuelle de ce qui est fait et de la manière dont les choses convergent. Au-delà de ce projet, donc au-delà de ce démonstrateur qui a une portée de 3 ans, l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça soit réplicable, qu'on puisse... Alors, il ne va pas être en tant que tel utilisable en... Plug and play sur tous les territoires, il y aura forcément une certaine adaptation, mais l'objectif c'est qu'il soit structuré pour que cette adaptation soit la moins coûteuse possible. C'est la partie des enjeux des démonstrateurs qui sont financés par la Banque des Territoires et par l'Ecolab, c'est qu'on puisse le plus simplement possible adapter la solution qui a été mise en œuvre sur de nouveaux territoires et sur de nouvelles communes. L'objectif c'est que ce soit un démonstrateur opérationnel, il ne s'agit pas de faire un POC et de le jeter. mais qu'on puisse s'en servir. Et donc ça fait partie aussi des choses qui ont été définies dès le départ pour dire, à l'issue de ces trois ans, ce qui va être créé, il va être utilisé concrètement sur le territoire de la gamme de la centre Paris-Saclay et il sera transposable sur l'ensemble des communes du territoire. Et puis l'objectif, c'est aussi que ça soit à vocation de transformation écologique et d'intégrer les différents éléments de transformation et de prendre en compte les critères environnementaux nativement dans la solution. Je ne sais pas si je suis en termes de timing, je suis à peu près bon. J'ai rattrapé Michel. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter rapidement. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. J'avais plusieurs questions. Une première question, plus de compréhension. Je voulais savoir si dans la boucle de l'outil que vous avez décrit, l'outil rédigeait des règles d'urbanisme. Parce que j'ai bien compris qu'il... produisait des recommandations, mais je n'ai pas compris s'il rédigeait le règlement derrière. Et puis, une question plutôt sur l'infrastructure. Je voulais savoir si la solution était hébergée chez vous ou chez un opérateur extérieur. Merci. Alors aujourd'hui, l'outil ne rédige pas de règles d'infrastructure. En revanche, il interprète des règles d'infrastructure qui sont rédigées par des urbanistes pour qu'ils puissent être intégrés dans le système de modélisation. Et donc, c'est prévu qu'on puisse rédiger des règles en langage naturel et que ces règles soient interprétées et rentrées dans le système de manière automatique, avec toujours le petit guillemet d'automatique, c'est-à-dire que ça puisse être de toute façon contrôlé. C'est-à-dire qu'on les intègre, mais qu'on peut contrôler que l'intégration s'est bien passée. Donc, il y a toujours le niveau d'expertise. L'urbaniste définit les règles et vérifie que l'interprétation est correcte. Et ce n'est pas juste de l'automatisme. Il y a des choses qui évoluent et c'est le principe aussi des intelligences artificielles dans ce sens où s'il y a des nouveaux concepts qui apparaissent en termes de normes, en termes de vocabulaire, etc. Comme l'intelligence artificielle apprend sur le passé, elle ne les intègre pas. Donc il faut effectivement périodiquement réentraîner les moteurs pour prendre en compte les nouvelles règles. Mais tant qu'ils ne sont pas entraînés... il faut que ça soit apporté par l'expert. Sur le deuxième point...
Speaker #0Tout à fait. Alors je n'ai pas la réponse absolue. Il y a des choses qui sont mises en œuvre, et comme j'évoquais tout à l'heure, sur les stratégies au niveau de l'agglomération Paris-Saclay, sur la feuille de route. de la charte numérique sur l'application de la loi Rennes sur la feuille de route de l'intelligence artificielle qui est faite au niveau de l'agglomération. Tous les collaborateurs de l'agglomération ont été acculturés, sensibilisés et on a fait des ateliers, des formations sur les enjeux d'intelligence artificielle, sur les enjeux du numérique responsable. Il y a aussi un comité de développement de l'agglomération qui embarque un certain nombre d'acteurs du territoire. Il y a eu aussi une concertation territoriale. On a fait venir des gens de la société civile, des élus, des membres d'associations pour discuter de ce qu'ils pensaient de l'IA, de ce qu'ils voulaient faire avec l'IA, de ce qui était possible, de quelles étaient leurs peurs, leurs angoisses, etc. Donc une instance de concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire pour évoquer ces sujets-là. Ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est que moi je viens plutôt du monde de l'IA, un petit peu moins du monde de l'urbanisme. Et j'ai eu l'impression inverse. C'est-à-dire qu'en fait, l'urbanisme, c'est un métier d'expert. J'ai aussi une casquette de citoyen. J'ai plein de casquettes, en fait. C'est pour ça que j'ai plus beaucoup de... J'ai aussi une casquette de citoyen. Et moi, en tant que citoyen, le PLU, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, était un petit peu abscond, abstrait, enfin compliqué. Et donc, moi, en venant de l'IA, je ne comprenais pas grand-chose, en fait, aux enjeux de l'urbanisme. Et le fait de faire travailler ensemble avec des gens de l'IA, des gens de l'urbanisme, et des gens qui comprennent les deux, ça permet de faire le lien. Et l'objectif de la solution qu'on développe, et c'est pour ça qu'on met les utilisateurs dans la boucle, les utilisateurs au sens urbanistique et au sens élu, parce que les élus doivent aussi être en capacité d'expliquer, c'est de sortir de cette notion de technologie. Le problème de l'IA aujourd'hui, c'est que quand on parle d'IA, on pense technologie, on pense innovation, on pense qu'on va refaire le monde, etc. Mais en gros, l'IA n'est pas le sujet. Le sujet c'est quel est le projet de l'agglomération, quel est le service qu'on veut rendre et après quel est le meilleur outil pour le rendre. Point barre. Et une fois qu'on a fait ça, dans certains cas, on n'a pas besoin d'IA. Dans certains cas, on n'a pas besoin de numérique. Il y a un peu de bon sens aussi. Et donc, l'objectif des solutions qui sont mises en œuvre, ce n'est pas un discours d'experts entre les experts de l'urbanisme et les experts de l'IA. Il faut qu'ils travaillent en chambre, ensemble, pour se comprendre. En revanche, le résultat, il a vocation à être compréhensible par les gens, par les élus. Les élus, ce n'est pas non plus des experts d'IA ou d'urbanisme. Vous connaissez un peu l'urbanisme aussi, ou l'IA. Mais ce n'est pas leur métier. Et les citoyens, ce n'est pas leur métier non plus. Et donc, l'objectif, c'est que c'est pour ça qu'il faut toujours repartir de quelle est la stratégie, quel est le besoin, quelle est la démarche et la vision qu'on veut développer, mais pas en termes de techno. Et après, on met les outils qui vont bien derrière. Et donc, c'est aussi la concertation territoriale fait partie de ces outils qui permettent de travailler sur le sujet. De la même manière que sur les aspects de transition écologique dans le cadre du plan climat. Il y a aussi de la concertation territoriale qui est mise en œuvre. Il y a aussi des notions qui sont autour des nouveaux récits, donc de travailler sur les nouveaux récits qui aident forcément à décrocher de cette notion technologique. Quand on fait contribuer les citoyens aux nouveaux récits et dire que vous attendez quoi en fait comme futur ? On décroche du côté technologique. On identifie des visions et des projets. Et après, une fois qu'on a des visions, des stratégies, on trouve les outils pour les mettre en œuvre.