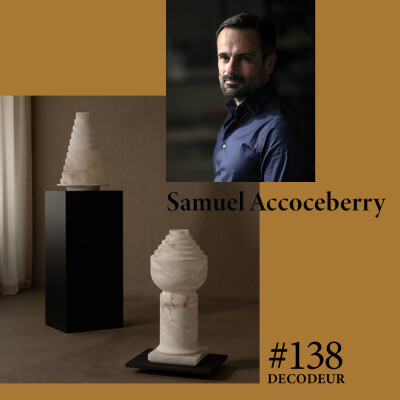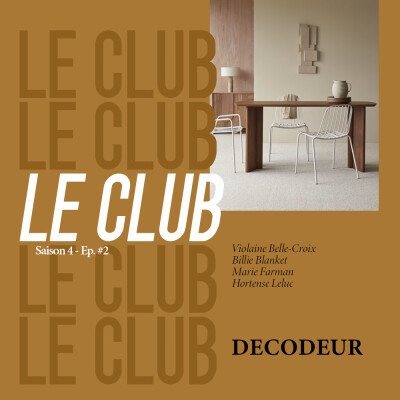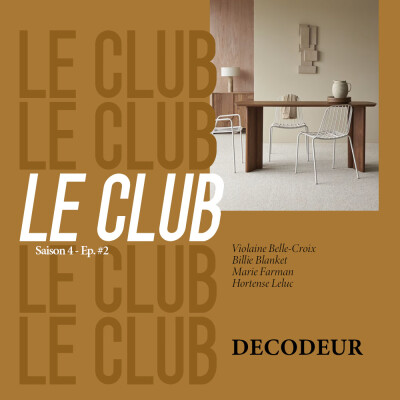- Speaker #0
Bonjour à tous, alors je dois vous dire que l'épisode qui va suivre est un épisode un peu spécial. C'est pas un épisode de Décodeur, mais un épisode d'Ezelle au talent, un podcast de la fondation Bétancourt-Schuller. Je sais pas si vous connaissez le prix Liliane Bétancourt pour l'intelligence de la main. C'est un prix qui est très prestigieux, qui récompense les professionnels des métiers d'art en France. Et à l'occasion des 25 ans de ce prix, ils ont créé un podcast qui met à l'honneur les lauréats de ces dernières années. des hommes et des femmes dont le talent et le parcours méritent d'être racontés. Alors quand ils m'ont proposé de diffuser quatre épisodes de ce podcast, j'ai accepté. On a choisi ensemble ceux qui pourraient le plus vous plaire, à vous mes auditeurs de Décodeur. Alors j'espère vraiment que vous allez aimer, c'est différent, vous allez voir. C'est une rencontre entre un talent donc et une plume, un écrivain qui va le raconter. Allez, je vous laisse, bonne écoute.
- Speaker #1
Des ailes au talent. Je vous propose de faire connaissance avec des artistes qui maîtrisent les techniques et savoir-faire des métiers d'art. Des ailes au talent, c'est une série de portraits de femmes et d'hommes dont le talent et le parcours méritent d'être racontés. Des portraits littéraires, car nous avons choisi de donner la parole à des écrivaines et à des écrivains. Chaque épisode de ce podcast est le fruit d'une rencontre entre un artisan d'art et une brume. L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Philippe Bordas. Il tire le portrait de l'héliograveuse Fanny Boucher. Vous écoutez la troisième saison des ailes au talent. Soyez les bienvenus.
- Speaker #2
Escalader la butte, faire le pèlerinage jusqu'à Meudon, une nouvelle fois. Je connais ce parcours, partir de Denfert à vélo, frôler la Seine, glisser de Venves vers ici, subir la pente extrême, celle de la route des Gardes, si ardue à gravir à force humaine. Quinze jours plus tôt, j'avais accompli mon entraînement cycliste, sur ce même tertre, secoué par les os et les ligaments, sprintant sur la route pavée de l'Observatoire. L'abrupte colline de Meudon met depuis toujours ce lieu sacré du dépassement. qu'il fut poétique ou musculaire. A 200 mètres de la coupole dédiée à la scrutation télescopique des astres, se dresse une haute bâtisse levée sur le parc, celui du potager du dauphin, acheté jadis par Louvois pour alimenter la table de Louis XIV. C'est là, à l'étage supérieur de ce bâtiment bourgeois, qu'officie Fanny Boucher, maître consacré de l'héliogravure française, l'une des douze au monde à savoir cet art.
- Speaker #3
Bonjour, je suis Fanny Boucher, je suis héliograveuse et j'ai été lauréate de la fondation Bettencourt-Schweller, le prix pour l'intelligence de la main en talent d'exception en 2020. Un beau jour, j'ai ouvert la porte de l'atelier de gravure et je n'en suis jamais ressortie. Et c'est ce choc de tous les sens parce que tu vois quand tu rentres dans l'atelier, tu as une odeur, tu as la présence des machines, tu as la présence de la matière, du cuivre, du papier, de tout ça. que je n'avais jamais expérimenté avant. Et c'est un univers qui m'a complètement envahi à ce moment-là.
- Speaker #2
C'est là, dans cet atelier polytechnique installé sous les combles, que je suis resté des heures à contempler, détailler, l'infinie suite des gestes et menus préparatifs nécessaires à la transfusion quasi-scientifique, quasi-magique d'un négatif photographique sur une plaque de cuivre jusqu'à son impression éternelle et pérenne. sur un papier chiffon insusceptible de vieillissement. Deux siècles après sa naissance, Fanny Boucher remet le geste photographique à son initial. Depuis toujours, les grands photographes, comme Alfred Stiglitz ou Édouard Curtis, ont privilégié les liaux gravures au grain pour son exceptionnel rendu et la conversion en surfines estampes de leur composition. Bien sûr, le transfert d'une image photographique sur une plaque de cuivre Par l'intermédiaire de gélatine photosensible, son impression en taille douce sur un papier pur chiffon, épais comme un cuir, toutes ces subtiles opérations nécessitent un savoir multiple considérable, un enchaînement de gestes répétitifs et serriés à la limite de la trance et de la mystique. La cime de cette colline dominant la scène serait-elle ce site dédié aux rituels intenses ? Mon saisissement à ces cérémoniaux de haute conservation a été d'autant plus fort que j'ai vécu dans cette même obsession de l'image parfaite. Longtemps, j'ai pratiqué la photographie, l'argentique, la vraie, aimer le mystère solaire et le jeu des chimies. Attirée très jeune à ses protocoles, Fanny Boucher vit depuis 30 années ce même rêve d'éterniser l'image argentique, la reporter sur le métal et la magnifier sur papier fibreux destiné à très longue durée. La technique, née à l'époque de Nicephore Niepce, au premier balbutiement de la photographie, était quasiment perdue. Après consultation des traités du siècle passé, un autodidacte passionné des techniques photomécaniques avait remis le procédé en vie. Dans son garage de Bièvre, il avait transmis à Fanny Boucher son unique élève. De fait, j'ai vécu un processus inverse du sien. En place d'une résurrection, j'ai assisté à l'effacement d'un savoir raffiné. Vécu son déclin industriel soudain. Les papiers photos, soumis à la rentabilité du monde libéral, se sont allégés à tel point de l'argent inclus à leur texture que mes images à fort noir ne libéraient plus que de pauvres gris. Au même moment, les pellicules couleur argentique les plus exceptionnelles de tous les temps, porteuses des teintes de bonheur et des noirs abyssaux de soulage, ces pellicules, telles la Kodachrome 25 professionnelle, ont été retirées du marché pour de simples raisons de rentabilité. Sous mise de réalité du capitalisme, la qualité artistique des images avait tout simplement baissé. La nature insubstantielle et frigide de la photographie numérique me laissait froid. Contraint d'œuvrer, Avec de misérables papiers, de faibles pellicules, j'ai préféré arrêter ma vie de photographe. La profondeur du regard, comme la durée, m'ayant été dérobée. Au lieu de s'effrayer des techniques récentes, la graveuse de la butte a opéré les fiançailles des airs numériques et argentiques. À travers portes et fenêtres, par l'escalier central et les fentes sur le ciel, elle a fait hisser de très lourdes machines, jusque sous les toits, des plus archaïques aux plus modernes. pour opérer le miracle égyptique d'un voyage de l'image à travers les âges. Près d'une presse centenaire et d'une imposante cisaille à contrepoids conçue pour la découpe des plaques de cuivre, brillent l'écran de l'ordinateur et les diodes de l'énorme scanner qui opère le passage du négatif originel à un film positif en demi-teinte subtile. Les claviers tactiles voisinent les machines à bras. C'est cette hybridation des techniques et des appareils. mal vu des rigoristes et des orthodoxes qui définit l'atmosphère intemporelle de cet atelier en surplomb des jardins du roi.
- Speaker #3
Il y a des films qui ont disparu. J'ai déjà rencontré ce problème-là au début.
- Speaker #2
Quand tu dis les films, c'était les premiers transparents.
- Speaker #3
Oui, les premiers transparents, tu vois, ils avaient disparu. Donc, il a fallu que je me remette en question, que je passe au numérique. C'était le bordel au début. Parce que j'avais calé ma technique sur des films argentiques. Guy Minot a fermé, Arista s'est abdé.
- Speaker #2
C'est-à-dire que là, tu prends le négatif qui est scanné numériquement et tu fais un report sur la machine numérique. Donc, tu n'as plus de matière, tu n'as plus de négatif.
- Speaker #3
Je n'ai plus la matière argentique. Là, j'ai réussi à sauver une étape. Ce qui est super intéressant parce que du coup, je démarre ma première étape, c'est par le numérique, par un truc très actuel. Et au fur et à mesure du process, on remonte dans le temps. Je trouve ça vachement...
- Speaker #2
Ah oui, c'est magnifique.
- Speaker #3
Vachement chouette.
- Speaker #2
À mon découragement, devant la fluctuation inévitable des techniques, la disparition des fournisseurs, s'oppose cet héroïsme d'orpailleurs dans la quête des matériaux, cette obstination d'alchimistes à glaner les optimales substances à travers le monde, les meilleurs papiers, encres, gélatines, métaux et acides, quel qu'en soit le prix.
- Speaker #3
C'est une crainte, je pense qu'on a tous dans l'artisanat, c'est qu'en effet on a des soucis. Moi je rencontre des soucis de... le cuivre, c'est devenu une matière extrêmement chère. J'ai des soucis de gélatine parce qu'il n'y a plus qu'un fabricant au monde qui fabrique la gélatine photosensible que j'utilise. C'est une dame, c'est Jennifer Page aux USA, qui a une boîte. Mais voilà, si elle arrête...
- Speaker #2
Elle a quel âge ?
- Speaker #3
Je pense qu'elle a dans mes âges, elle a 45-50 ans. Mais le souci, c'est que si elle arrête du jour au lendemain, elle avait changé son process de gélatine. Moi, ça me prend six mois pour caler.
- Speaker #2
Oui, c'est terrible.
- Speaker #3
Donc, c'est terrible. Donc, en fait, là, le travail que je fais, et je travaille dessus avec mon ancien élève, parce qu'on est toujours très proches, c'est d'essayer de trouver notre propre gélatine.
- Speaker #2
Au lieu de chercher une moderne technique de substitution, comme elle l'a fait en passant au numérique, Fanny Boucher imagine explorer les manières anciennes pour solutionner l'éventuelle pénurie.
- Speaker #3
Il y a possibilité, je pense, de trouver avec des gélatines liquides. Il y avait Niepce qui faisait ça avec une gélatine liquide. C'est le temps qui nous manque souvent.
- Speaker #2
Dans un atelier de la Renaissance, un travail égal, il y aurait eu cinq personnes qui devraient préparer les bains, vérifier les températures, vérifier le stockage, faire les commandes de cuivre et de gélatine. Le plus frappant, c'est cette manière de chorégraphie solitaire, ces allers et retours minutieux entre l'atelier et la chambre noire. Ces étapes successives, abstruses pour l'impétrant, mais toutes exécutées d'un geste sûr, sans précipitation ni lenteur. Après la numérisation du film transparent, un positif au gris léger, c'est le moment de la découpe de la plaque de cuivre. A la délicatesse des doigts succède la puissante pression des bras. Plus loin, dans la chambre obscure, sous le voile faible de la lumière inactinique, se déroulent les opérations complexes. de photosensibilisation de la gélatine, d'insolation du film, le transfert du papier gélatiné insolé sur la plaque de cuivre. Et ce ne sont plus que bains fastidieux, rinçage de la gélatine, séchage, passage de la coiteinte sur le cuivre, gage du grain final. Après de longues minutes à remuer l'eau acide noircie, advient l'épiphanie. La morsure de la plaque de cuivre s'amplifie et, sous les vaguelettes, apparaît l'image, ses reliefs hauts et bas dans la chair du métal, noir profond et haute lumière. À souffle coupé, l'artiste n'en finit pas de noter les durées et les températures, vérifier les dilutions, l'humidité de l'air, surveiller le moindre geste, même sa respiration.
- Speaker #3
On va être là, on a débarré une hélium, on a une image en épaisseur de gélatine différente. durcit. Cette gélatine, elle a pris l'humidité, elle a pris des conditions que je ne maîtrise pas forcément. Donc le seul truc qu'il ne faut pas, c'est souffler dessus, parce que si tu renvoies de la vapeur d'eau, ça va la gorger, ça va faire des traces noires, etc.
- Speaker #2
Si cet art d'estampe est de nature héliatique, lié par essence au soleil, hélios, il implique de son officiante une conscience aiguë des mouvances et fluences des matières en jeu. Même si le respect obsessionnel des paramètres étalonnés et chiffrés balise le processus, l'aboutissement final de la photographie sur le papier luxueux ne peut s'accomplir sans une préscience quasi instinctive des réactions chimiques et des délais après quoi rôde la catastrophe. Après une longue méditation des œuvres, une exploration des univers propres aux grands photographes et peintres pour lesquels elle se dévoue, quitte à aller de Meudon jusqu'au Guatemala. La graveuse s'en retourne seule dans le monde fragile des invisibles et des imprévisibles. Une partie de son cerveau est comme corrélée aux variations occultes du négatif, l'autre à la gravité froide du métal. Une partie protège les substances grasses et résineuses des vexations soudaines, l'autre pressant l'altération de l'air et la fatigue de l'acide, soumise à l'inlassable gymnique des mains. Son art se réclame de la substance dure et des éphémères, des phénomènes volatiles, et à queue les plus capricieux. Quand l'œil n'intervient plus, c'est la main qui obvie, étale l'encre épaisse sur la matrice de cuivre, ce carré génésique du netral imprimé. C'est la peau qui déchiffre l'épaisseur et le grain, tout à la fin apprécie la texture fibreuse et le léger renflement des noirs. C'est la pulpe de l'index qui certifie que l'épaisseur du monde a trouvé logement dans celle du papier.
- Speaker #1
C'était le portrait de l'héliograveuse Fanny Boucher, un texte écrit et lu par Philippe Bordas. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bétancourt-Schuller réalisé par le studio Radio France en collaboration avec les éditions Gallimard.