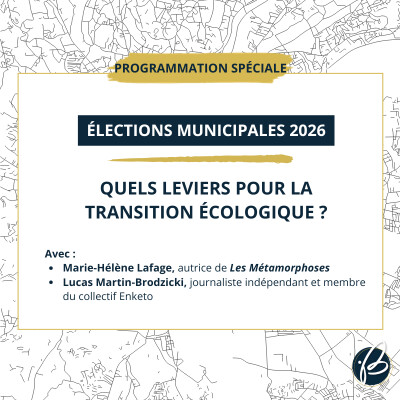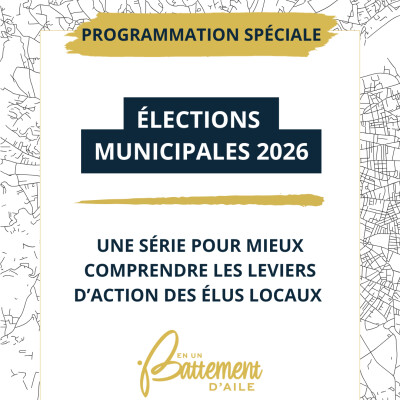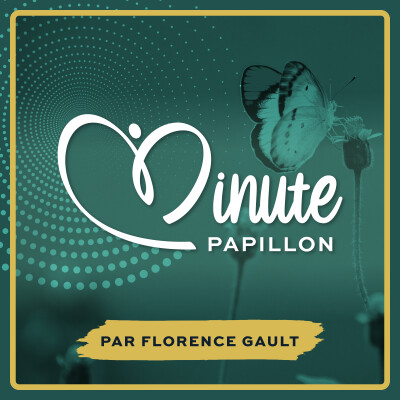- FG
Sommes-nous plus divisés que jamais ? Dans les débats, dans les médias, sur les réseaux sociaux, la polarisation semble s'être installée partout. Elle brouille nos échanges, bloque le dialogue et rend de plus en plus difficile Merci. le fait de simplement s'entendre ou de se comprendre. Dans ce climat, on nous pousse sans cesse à prendre position, à choisir un camp, à nous exprimer, souvent vite, souvent fort. Mais dans tout ce vacarme, une question se pose, à l'heure du dérèglement climatique, des crises sociales, de la nécessité de transformation profonde, comment réussir à faire société ? Comment créer un futur commun si nous ne parvenons plus à écouter l'autre ? D'où vient ce grand malentendu qui nous empêche de nous parler, et surtout, comment y remédier ? Autant de questions que pose la journaliste Nina Facio dans son livre « Malentendu » publié aux éditions Payot, un ouvrage qui ne se contente pas de pointer la défiance envers les médias mais qui explore des pistes concrètes pour renouer le lien entre ceux qui racontent le monde et ceux qui le vivent. Depuis 2016, Nina Fasciaux travaille pour le Solutions Journalism Network, une organisation internationale qui promeut une autre approche de l'information. le journalisme de solution. Elle forme des journalistes partout dans le monde à des pratiques plus constructives, plus ancrées dans le terrain, plus à l'écoute aussi, car pour elle, écouter les citoyennes et les citoyens n'est pas un supplément d'âme, c'est une nécessité démocratique. Un podcast d'une heure, enregistré en public à la Maison de l'Environnement. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Nina d'être avec nous ce soir.
- Nina Fasciaux
Bonsoir Florence, merci de l'accueil.
- Florence Gault
Donc merci d'être là, d'avoir pris ce temps ce soir pour écouter et peut-être aussi pour se laisser écouter. On va se tutoyer pour cet entretien, puisque on se connaît, même si c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. On a déjà largement échangé par les journalistes de Solutions. Puisque je le disais en introduction, tu es la directrice des partenariats au Solution Journalism Network, dont je suis moi-même formatrice certifiée. C'est comme ça qu'on se connaît. On va évidemment aborder tout ça. On va peut-être commencer par une impression très simple que beaucoup de gens se partagent aujourd'hui. On vit dans un monde où on n'arrive plus à s'écouter. Le débat semble constamment crispé. Plus personne n'écoute vraiment. Pourquoi ce longtemps on en est arrivé là ?
- Nina Fasciaux
Alors il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on en est arrivé là, mais je pense qu'il y a une chose que j'aimerais dire directement, c'est que je ne crois pas qu'on ait jamais été en capacité de savoir écouter. Je pense que l'écoute n'a jamais été considérée comme une compétence. Après, les canaux de communication et d'expression s'étant grandement multipliés ces dernières années, Il y a plus de bruit, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus d'injonctions à s'exprimer en permanence, à partager son ressenti, ses opinions. Et donc tout ça fait que ce bruit qui s'ajoute en permanence diminue encore plus nos capacités d'écoute.
- Florence Gault
Et qu'est-ce que ça dit de notre époque aujourd'hui, cette incapacité à bien écouter ?
- Nina Fasciaux
Ça dit que tout est déjà dans la spontanéité, l'immédiat. Donc, on doit toujours réagir tout de suite. Et ça, c'est beaucoup structuré par les réseaux sociaux qui nous... Vraiment, il y a une injonction, encore une fois, à s'exprimer. ça dit aussi un creusement du rejet de l'autre c'est à dire que dans notre incapacité à écouter on est en même temps dans une on va dire une aggravation du rejet de l'autre, de la pensée autre, parce qu'il n'y a plus cette curiosité pour une opinion opposée à la nôtre. Alors en plus, on n'est pas accompagné ni outillé à écouter, donc ça aggrave encore plus la situation.
- Florence Gault
Comment tu es arrivée à écrire et avoir envie justement de parler peut-être de cette fracture, de cette société polarisée et de ce manque d'écoute qui existe et particulièrement, on y reviendra ensuite, mais chez les journalistes dans la manière dont ils racontent le monde.
- Nina Fasciaux
Je pense en plusieurs temps, mais il y a eu trois temps forts dans cette réflexion. La première, et c'est comme ça que j'introduis le livre, c'est que moi j'ai été journaliste en Russie. Je n'ai pas d'origine russe, je suis française et je suis partie dans ce pays avec une vision du pays qui m'avait été entièrement donnée par les médias occidentaux et qui se résumait beaucoup à tous les problèmes qu'on peut entendre. Autour de la Russie, je fais un peu de provocation en disant que souvent ça se résume à Poutine, guerre, vodka et pute, mais c'est un peu ça. Et en fait, en exerçant le métier là-bas, je me suis rendue compte de la complexité du pays, de tout ce qui était passé sous silence. Tout ce qu'on entendait dans les médias occidentaux était vrai dans les faits, mais n'était pas vrai dans les faits. pas complet et du coup donner une perception du pays qui était complètement biaisée. Et je me suis dit, j'ai eu l'occasion, la chance de comprendre ça parce que j'ai vécu cinq ans en Russie, mais qu'en est-il des presque 200 autres pays dans lesquels je ne vivrais peut-être pas ? Donc ça, ça a été une première prise de conscience. Et en rentrant de Russie, j'ai eu cette démarche. d'essayer de comprendre comment certains autres journalistes faisaient différemment. J'ai découvert entre autres le Solutions Sur SM Network, avec une organisation qui est basée aux Etats-Unis, qui accompagne vraiment les journalistes à mieux traiter les sujets polarisants, mais dont le corps de métier est vraiment de soutenir, de promouvoir et de former au journalisme de solutions. Donc comment intégrer les... les réponses apportées aux problèmes à la couverture des problèmes. Et là, il y a eu un deuxième déclic, c'est qu'après l'élection de Donald Trump en 2016, donc la première élection, on a une journaliste de notre réseau, une journaliste très reconnue d'investigation qui s'appelle Amanda Ripley et qui a vécu cette élection comme un échec où elle s'est dit « Je n'ai pas voulu entendre, je n'ai pas voulu écouter ces millions d'électeurs qui se sont reconnus en Trump. » Et elle s'est dit, soit je trouve une solution pour faire mieux, soit je ne suis plus légitime d'exercer mon métier de journaliste. Et elle a écrit un essai qu'on a publié, c'était même une commande de David Bornstein, qui est le co-fondateur du Solutions Journalism Network, qui s'appelle Complicating the Narratives, donc complexifier nos récits, où elle a exploré pendant plusieurs mois comment les experts en médiation de conflits pouvaient apporter aux journalistes des outils pour justement mieux couvrir ces sujets qui nous divisent. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, moi ensuite, en fait cet essai qui a été publié dans notre réseau a eu une résonance énorme. C'est encore aujourd'hui, donc c'était en 2018, c'est encore aujourd'hui l'article le plus lu sur notre site internet. Et donc je revenais de congé maternité après la naissance d'Erin qui est là avec nous ce soir. Et j'ai eu la chance de participer à une semaine où l'équipe du Solutions Horizon Network, certains journalistes et des experts en médiation de conflit, on a bénéficié d'une formation, mais surtout on s'est posé en se demandant quels sont les outils que concrètement on pourrait transmettre aux journalistes. Donc ça, ça a été vraiment pour moi un grand moment d'épanouissement et ça m'a vraiment ouvert les yeux et je me suis aussi sentie... plus outillée pour mettre des mots sur ce que je ressentais moi-même en tant que journaliste. Et ensuite, vraiment plus au niveau de l'ancrage, on va dire, le livre s'ancre dans la société française. C'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes a été pour moi, tant professionnellement et personnellement, un moment où je me suis posé beaucoup de questions et où je me sentais euh... Je sentais qu'il fallait absolument faire quelque chose pour aider et les citoyens à être entendus, et les journalistes aussi à être entendus pour ce qu'ils faisaient comme métier, mais aussi comment remédier à cette fracture qui semblait vraiment se creuser entre les deux parties.
- Florence Gault
Et qui est encore bien là.
- Nina Fasciaux
Et qui est encore bien là, c'est vrai que c'était particulièrement épigrapé.
- Florence Gault
Exacerbé, oui.
- Nina Fasciaux
Exactement. Et donc, j'avais organisé, quelques jours avant le confinement, une rencontre à Paris entre Gilets jaunes et journalistes. Et je les ai formés à la technique de looping, on y reviendra je pense, mais une technique d'écoute qu'on utilise en formation. Et aussi, l'idée c'était vraiment de leur... de leur demander de se mettre à la place de l'autre et d'essayer de comprendre d'où chaque partie venait.
- Florence Gault
On va y revenir effectivement. Peut-être pour bien comprendre le contexte aussi du livre, tu t'es appuyée sur une étude réalisée en 2019 par Destin commun. Dans ce travail intitulé « La France enquête » , ce think tank a essayé d'éclairer les fractures qui travaillent la société en segmentant la population française. en fonction de leurs convictions profondes. L'ONG a identifié six types de familles de Français, les laissés pour compte par exemple, qui représentent avec 22% la plus grande famille, plus d'un Français sur cinq. Et vous avez organisé des groupes de parole pour que tu puisses interroger les Français sur leur rapport à l'autre, leur vision de l'écoute, leur rapport aux médias, aux journalistes, à l'information. Il y aurait plein de choses à dire, je pense, uniquement sur ce sujet-là, mais peut-être, toi, qu'est-ce que tu as retenu de ces échanges ? Et qu'est-ce qui les ressortit, justement, de leur perception, en fait, sur peut-être d'abord l'écoute et ensuite le monde médiatique ?
- Nina Fasciaux
Oui, mais c'est vrai que déjà, la raison pour laquelle j'ai voulu travailler avec Dessins communs, c'est que je trouvais que leur approche de vraiment sonder la société française en fonction des valeurs qui la constituent était pour moi plus intéressante que de sonder la société française en fonction de certaines catégories, on va dire, sociales. et du coup de questionner, comme je voulais documenter le déficit d'écoute. qui est à l'œuvre tant du côté des journalistes que du côté des citoyens, de vraiment poser cette question aux citoyens français de qu'est-ce que ça vous fait quand vous vous sentez entendu ? Quel est votre rapport aux médias ? Quel est votre rapport effectivement à l'autre, à l'inconnu, aux voisins, ou au contraire à vos amis ? Est-ce que vous, vous avez l'impression d'être plutôt en capacité d'être à l'écoute des gens ? Et si oui, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, c'était vraiment très intéressant. Et ce qui en est ressorti, c'est que les métiers d'écoute sont souvent, mais ça c'est un peu l'évidence, mais des métiers qui relèvent du métier du soin. Et les journalistes n'ont absolument pas été cités comme étant relevant du métier d'écoute, ce qui justement était à l'encontre du point que je voulais faire. et moi des témoignages qui m'ont vraiment interpellée c'est par exemple un homme de 67 ans qui s'identifiait plutôt comme identitaire, donc avec des idées qui se rapprochent quand même de l'extrême droite, qui disait « on a l'impression d'être utile quand on est écouté » . Et ce qui, pour moi, faisait le rapprochement avec le vote pour Trump, où en fait on a l'impression qu'une partie de la population qui sentait ne plus compter pour la société s'est exprimée dans un vote de colère. Et donc je trouvais ça... intéressant de capter cette volonté de vouloir être utile pour la société avec le sentiment de ne pas être entendu.
- Florence Gault
Et quand on regarde et quand on cherche un peu à analyser la deuxième élection de Trump, est-ce que tu l'analyses avec ces mêmes mécanismes ? Ou on peut se dire, à partir du moment où il y a un deuxième mandat qui arrive, est-ce que Ça vient toucher aux mêmes choses ? Est-ce que les causes sont les mêmes ?
- Nina Fasciaux
Je ne suis pas experte. Même si c'est vrai que j'ai des contacts quotidiens avec les États-Unis, je ne peux pas prétendre vraiment comprendre ce qui se passe en profondeur là-bas. Mais ce que j'entends aussi de mes collègues, ou lorsque je suis en voyage là-bas, c'est que oui, les causes profondes sont les mêmes. Mais il s'est passé beaucoup de choses entre les deux élections, notamment le mouvement Black Lives Matter. Et on a une partie de la population qui ne se sentait pas. C'est pas pas représenté, mais qui avait l'impression de ne plus compter. Et à cela s'est ajoutée une crise de l'appartenance. C'est-à-dire que les milieux, surtout dans les milieux ruraux, où on a des personnes, des Américains, qui ont l'impression de ne plus appartenir à ce pays, de ne plus se reconnaître. Tout ça, c'est vraiment ces crises de... d'appartenance ou remise en question de la dignité des gens tout ça c'est des allumes-feu c'est vraiment, on le voit dans l'histoire de l'humanité c'est que quand ça se passe ça nous envoie des signaux d'alerte très importants et on voit effectivement ce qui se passe après dans les urnes
- Florence Gault
T'as pu échanger avec Amanda Ripley tu nous parlais d'elle tout à l'heure justement à propos de la première élection de Trump t'as pu depuis échanger avec elle son regard doit être intéressant au vu du contexte là
- Nina Fasciaux
Oui, tout à fait. Après, elle continue de dire ce qu'elle disait déjà, c'est qu'on a quand même tendance à avoir une lecture, et ce n'est pas vrai que pour les États-Unis, mais très binaire en fait de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les pro-Trump, de l'autre les anti-Trump, d'un côté les démocrates, de l'autre les républicains. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. À l'intérieur des catégories, il y a d'infinies nuances. Et donc, ce qu'elle dit encore aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir cette lecture-là. On n'est pas obligé d'être dans le « us versus them » , donc le « eux contre nous » . Et également, elle dit plus que jamais que l'humiliation est un déclencheur de conflits extrêmement important. Et donc, voilà, il faut vraiment réussir à... À penser, moi c'est ce que je me suis dit aussi la dernière fois que je suis allée aux Etats-Unis, c'était en février, où en fait on a eu effectivement un mouvement pour l'équité, l'inclusion, la diversité, qui était évidemment nécessaire et très important. Comment faire que ce mouvement n'exclue pas les autres ? En fait c'est ça que ça dit, parce que l'exclusion provoque cette humiliation.
- Florence Gault
Alors on n'a pas encore pris le temps de définir le mot écoute. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot écouter ? Ce n'est pas la même chose qu'entendre.
- Nina Fasciaux
Dans l'écoute, il y a une volonté vraiment affichée d'accueillir la parole de l'autre sans jugement, sans approbation non plus. Vraiment juste accueillir et réceptionner la parole de l'autre. Et il faut que ça se voit. C'est-à-dire qu'une personne se sent entendue quand vraiment on lui a signifié. Et donc il y a plusieurs techniques pour le faire, mais on lui a signifié qu'effectivement on avait entendu ce qu'elle avait à dire.
- Florence Gault
Alors dans tout ça, évidemment, les médias ont un rôle majeur. D'un côté, on attend beaucoup des journalistes. On le voit notamment avec le baromètre des Français dans la confiance dans les médias, qui au moment des grands événements comme l'élection présidentielle ou au moment d'événements plus dramatiques comme les attentats, etc. Vraiment, on a une attente très forte à l'égard des médias d'informer et de transmettre. Et en même temps, on adore nous critiquer. On ne nous aime pas franchement. Il suffit d'aller interroger les gens pour que régulièrement les critiques remontent assez vite. Les journaux sont souvent accusés de déformer la vérité, de ne montrer finalement qu'une vision parcellaire. est-ce que Et notamment là, peut-être en s'appuyant sur ce que tu as pu entendre dans les groupes de parole, est-ce que tu trouves que cette critique, elle est justifiée ? Et puis, finalement, comment on se remet en question ? Tu l'as fait toi-même dans le cadre de ton métier. Comment repenser, par conséquence, notre métier ?
- Nina Fasciaux
Alors oui, dans les groupes de parole qu'on a menés, ce qui était intéressant, c'est que quand on parlait, par exemple, des fake news ou de... de ces vérités qui n'en sont pas, les gens qu'on a interrogés, et notamment ceux qui sont les plus défiants à l'égard de l'information et des journalistes, disaient « mais c'est pas tant que c'est pas la vérité, c'est que c'est une certaine perception, une certaine partie de la vérité, et du coup ça ne reflète pas la complexité de ce qu'ils vivent ou de ce qu'ils ressentent. » Et donc oui, effectivement, je pense que ça c'est vrai. en fait, qu'est-ce qui se passe quand... Une personne, je ne sais pas si vous avez déjà été dans le public interrogé par un journaliste, mais ce qui se passe, et on l'entend beaucoup, c'est qu'on a l'impression d'avoir été un peu trahi parce qu'on ne nous garde qu'une ou deux phrases et que c'est bien loin de la complexité de ce qu'on voulait exprimer. Donc on se sent trahi. Qu'est-ce qui arrive ? Ce n'est pas que la phrase qui a été gardée n'est pas celle que vous avez dite. C'est celle que vous avez dite, donc c'est la vérité, mais ce n'est pas votre vérité dans toute sa complexité. Donc c'est ça qu'il faut réussir à honorer. Et en plus, on se rend compte que... Quand on y arrive, ça a vraiment pour effet d'apaiser le débat public. Aux Etats-Unis, ils ont aussi mené des laboratoires des conversations difficiles, où ils ont mené 500 conversations sur des sujets hyper épidermiques, l'avortement, le conflit israélo-palestinien. Et ils faisaient l'expérience en donnant, dans une première version... Un article assez simple, traditionnel sur un sujet avec vraiment cette opposition binaire, donc un sujet construit avec deux opinions opposées, et un autre article où il y avait beaucoup plus de nuances dans l'expression de ces deux opinions opposées. Et on se rendait compte que les émotions qui traversaient les gens après avoir lu les deux articles et dans la conversation avec les gens avec qui ils n'étaient pas d'accord, étaient beaucoup plus complexes. que celles où l'article était vraiment traditionnel et binaire, où là, ils restaient bloqués sur des émotions bien identifiées. Et l'idée n'était pas de les faire changer d'avis, ce n'est pas du tout l'idée, mais par contre, ils avaient une ouverture, une tolérance accrue pour une opinion opposée. C'était un peu, je ne trouve toujours pas qu'il a raison, mais il a ses raisons. Et ça, c'est aussi un témoignage qu'il y a eu après l'opération Faut qu'on parle qui a été lancée en France, où on fait aussi se rencontrer deux personnes avec des opinions opposées. Et en fait, c'est ça qu'on veut créer pour que le débat public soit moins conflictuel.
- Florence Gault
Oui, et puis je crois qu'il y a aussi le fait peut-être de devoir réexpliquer en tant que médias ce que c'est qu'une ligne éditoriale, qu'il peut y avoir... effectivement aussi des valeurs portées par un média. Hier, j'étais dans un atelier d'éducation aux médias et un des participants, justement, on abordait ce sujet-là. Et à un moment, un des participants a dit, voilà, pour moi, vraiment, le média le plus objectif, vraiment, qui est neutre au possible, c'est Mediapart. Alors là, je lui dis, pas complètement. Il y a quand même un certain engagement de Mediapart. Elle me dit, non, non, non, non, mais vraiment, je lui dis, alors, j'explique, il en est tombé de sa chaise, en fait. Et c'était intéressant de pouvoir juste remettre en perspective chaque média. Après, il peut y avoir effectivement une différence d'opinion sur le traitement du sujet. Mais en fait, il y a aussi cet engagement éditorial qui est présent et qu'il faut peut-être accompagner aussi auprès du grand public. Oui,
- Nina Fasciaux
ça dit plusieurs choses que tu soulèves. c'est que d'une, il faut... Que les médias fassent l'effort de la transparence, donc vraiment expliquer comment est construite l'information, comment elle est choisie. L'information est subjective parce qu'elle est traitée par un être humain et c'est peut-être même ça qui fait sa beauté en fait. Mais il faut être clair avec ça, expliquer quelle est notre relation personnelle au sujet, comment on a choisi les personnes interviewées, les sources, etc. après là où c'est C'est primordial ce que tu fais avec l'éducation aux médias, c'est qu'aussi, et c'est ce que je documente dans le livre, c'est que le déficit d'écoute est aussi du côté des citoyens. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas l'information pour ce qu'elle veut nous dire, on a tendance à allumer la télé à la radio et à l'écouter d'une oreille. Il y a plein d'expressions rigolotes quand on s'intéresse à l'écoute et vraiment essayer de valoriser pour ce qu'elle est et effectivement d'identifier. d'où elle vient, par qui elle est produite. Mais aussi, ça c'est intéressant parce qu'avec les groupes de parole qu'on a menés, il y avait énormément d'ambivalence qui ressortait chez les gens dans leur consommation d'informations. Notamment, on en fait trop sur les faits divers et en même temps, ils en redemandent. Ou alors, on adore les journalistes engagés, mais en même temps, le problème de l'information aujourd'hui, c'est que les journalistes expriment leur opinion. Donc voilà, il y avait toutes ces ambivalences. hyper important du coup de vraiment accompagner les consommateurs d'informations.
- Florence Gault
Et de se dire que cette ambivalence, elle est carrément ok.
- Nina Fasciaux
Elle est humaine. Et puis en fait, le tout, c'est de le savoir et puis de s'auto-challenger, je pense que c'est... En fait, de prendre conscience, je ne suis pas la seule à faire ça, mais on compare souvent avec la malbouffe, en fait. La malinformation ou la surconsommation d'informations. Un impact sur notre santé mentale, mais aussi sur nos opinions. On n'est pas toujours en capacité d'assimiler l'information, or maintenant elle est partout, tout le temps. Et donc c'est aussi, à titre individuel, très important d'en prendre conscience et de mettre une distance s'il le faut.
- Florence Gault
Mais bon, malgré tout, posons le constat que les médias ont quand même un problème avec l'écoute. Pour essayer un peu de décartiquer tout ça, c'est pas juste un angle mort, c'est presque effectivement une déformation professionnelle. Comment ça se fait que finalement ça ne soit pas enseigné ? On apprend à poser des questions, mais on n'apprend pas à écouter, ou alors sur des sujets qui vont s'avérer un peu touchy. tout ce qu'on a pu voir autour des victimes de violences sexuelles, par exemple, où là, on se dit, bon, a priori, si je vais interviewer quelqu'un qui a été victime comme ça, on ne va pas y aller comme un gros bourrin. On va prendre un peu de précaution et laisser la place à la parole. Donc, sur certains sujets, ça peut paraître, et encore pas pour tous, mais on va dire à peu près évident. Pourquoi pas sur les autres sujets, finalement ?
- Nina Fasciaux
C'est vraiment un impensé total. c'est... Difficile à dire comme ça, mais reconnu ensuite par la profession quand j'échange avec eux, mais c'est un impensé total. C'est-à-dire que les journalistes, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas écouter, c'est que déjà, ils n'ont pas conscience qu'ils ne savent pas faire. Et souvent, en formation, moi, j'ai les journalistes qui arrivent et qui me disent « oui, je passe ma journée à écouter, évidemment que je sais écouter » . En fait, quand on apprend quelques techniques, on échange, on teste et ils se rendent compte. Avec horreur, qu'ils ne savaient pas faire. Donc ils ne sont pas outillés. Et ensuite, les contraintes du métier font que même s'ils sont outillés, même s'ils veulent le faire, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas le temps. Les contraintes, que ce soit éditoriales, techniques, même économiques, puisque le manque de temps c'est ça, font qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc il faut à la fois les accompagner sur les questions de la compétence. et ensuite revoir un peu au niveau structurel comment on donne le temps aux journalistes d'écouter. Et moi c'est quelque chose que je dis beaucoup, mais à l'heure où il y a beaucoup de menaces sur le métier de journaliste, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, il y en a énormément, notre valeur ajoutée c'est justement d'être humain. C'est justement de pouvoir prendre le temps, établir une connexion avec les gens. C'est des qualités, les qualités qui sont celles des journalistes aujourd'hui face à l'intelligence artificielle, ce sont des qualités humaines. Et donc voilà, c'est vrai que c'est un impensé total, mais c'est pas un manque de volonté, c'est plus « ah ben mince, on n'y avait pas pensé quoi » .
- Florence Gault
Et finalement c'est un peu la même chose avec le journalisme de solution, ça nous oblige en fait à revoir complètement la manière de procéder. Mais le process actuel dans la plupart des médias aujourd'hui fait que c'est difficile parce qu'effectivement, ça prend un peu plus de temps et qu'aujourd'hui, on a moins de temps, moins de moyens et qu'il faut aller encore plus vite pour tenter, ce qui est selon moi carrément impossible, de rivaliser avec les réseaux sociaux où l'information va à une vitesse dingue.
- Nina Fasciaux
Oui, mais est-ce qu'il faut continuer à rivaliser avec les réseaux sociaux ? Non, je crois pas. Oui, voilà. En fait, il faut vraiment se poser des questions très profondes et qui vont devenir structurelles. C'est que, est-ce que le journalisme, s'il continue à justement prendre le pas des réseaux sociaux, jouer sur les émotions, rebondir, réagir en permanence pour une information qui, de toute façon, va circuler naturellement, sans l'aide des journalistes... évidemment qu'on signe notre propre mort. Donc, c'est soit on change et on réaffirme une valeur qui n'est pas celle des réseaux sociaux et qui n'est pas celle des robots. Soit, effectivement, on est dans de mauvais draps.
- Florence Gault
Et effectivement, en ayant à l'esprit, et tu le soulignes d'ailleurs dans le livre, que les récits, et notamment le récit médiatique, façonnent aussi notre rapport au monde, notre vision du monde. On a eu l'occasion et ici en octobre dernier, à l'occasion des 30 ans de la Maison de l'Environnement, d'aborder le sujet avec Alain Damasio, où on parlait de la manière dont justement les récits, on parlait à propos de la transition écologique et sociale, comment les récits peuvent façonner l'imaginaire, et donc cet imaginaire rendre possibles les choses dans la réalité. Je trouve qu'il y a un parallèle qui est intéressant à mettre en lumière, que nos récits journalistiques, Merci. influencent nécessairement la société. Et donc, je trouve une responsabilité encore plus grande aujourd'hui à sans doute mieux incarner notre métier.
- Nina Fasciaux
Oui, tout à fait. Je cite dans le livre Sigmund Freud qui disait « Les récits et non pas les faits sont ceux qui construisent les jugements. » Et donc évidemment qu'à l'échelle des médias, les récits ont une influence énorme sur la perception qu'on a de certaines populations, la perception qu'on a de l'état du monde, de certains sujets. Tout ça façonne les opinions et c'est là que les journalistes doivent se poser la question de leur impact. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça que je commence mes formations. C'est pourquoi vous avez voulu devenir journaliste ? dans la plupart du temps. C'était justement pour créer du lien entre les gens, pour changer le monde même, parce qu'en dénonçant certains scandales, etc. Ok, est-ce que c'est l'impact que vous avez sur le monde aujourd'hui ? Non, l'impact qu'ils ont sur le monde aujourd'hui, c'est ce qui est documenté recherche après recherche par différents instituts. C'est une crise de défiance, c'est des pressions noyades, des garments vis-à-vis de l'information. Voilà, donc c'est vraiment poser la question, est-ce que l'impact que vous avez... par votre travail et celui que vous vouliez avoir quand vous avez commencé ce travail. Et là, quand on pose cette question-là, évidemment que... le journalisme de solution mais aussi d'autres pratiques prennent toute leur place
- Florence Gault
Alors on a dressé l'état des lieux on a montré le problème, on va aborder les solutions on va suivre la méthodologie justement du journalisme de solution tu as d'ailleurs intitulé la troisième partie du livre Apaiser le récit j'aime beaucoup et tu invites en fait les journalistes à voir leur métier comme un métier du lien, un métier du soin et donc Là, évidemment, ça inverse complètement la manière de traiter nos sujets.
- Nina Fasciaux
Et c'est une partie du livre que je ne m'attendais pas du tout, mais qui a vraiment fait mouche, c'est-à-dire qu'on m'en parle beaucoup. Et les journalistes, surtout, me disent merci en disant « Mais oui, c'est exactement ça, ma vision du journalisme. » Ah ben, bon. Effectivement, qu'est-ce que le journalisme comme un métier du soin ? parce que c'est justement créer du lien entre... Entre les gens, par essence, le journaliste se situe au milieu. Il se situe entre les politiques et les citoyens, entre différents groupes de citoyens, entre différents groupes de populations. Il est un intermédiaire. Et donc la question c'est est-ce qu'en étant au milieu il va faire barrage ou il va faire pont ? Pour moi pour l'instant on fait plutôt barrage. Et donc comment est-ce qu'on peut faire pont ? Comment on peut créer du lien ? Mais aussi, et d'ailleurs c'est ce qui est ressorti des groupes de parole, c'est que quand on leur demandait aux personnes qu'on a interviewées, qu'est-ce que ça vous fait quand vous vous sentez entendues, il y avait vraiment cette notion du soin. Ils avaient l'impression qu'on prenait soin d'eux et même que ça pouvait les aider à guérir. À guérir une colère, guérir un sentiment de mépris, etc. Donc c'est vraiment dans cette idée-là d'apaiser une société qui se pense divisée, qui se raconte divisée. Je pense qu'il y a aussi beaucoup plus de divisions, on va dire, factices que réelles. Ça, on le voit aussi dans la ruralité. Moi, j'ai beaucoup de gens qui ont témoigné en me disant, oui, toutes les grosses divisions ou les conflits qu'on peut imaginer entre voisins sur des questions écologiques. On arrive dans un petit village et puis on discute, on boit un coup, on discute et en fait il y a du lien qui se crée avant de parler des choses qui fâchent et du coup elles fâchent un peu moins. Voilà, donc c'est comment aussi montrer aux gens ce qui les lie au-delà de ce qui les divise.
- Florence Gault
Alors concrètement, comment on fait pour mieux écouter ?
- Nina Fasciaux
Alors il y a beaucoup de choses à faire mais il y a des choses très simples dans l'énoncé, un peu plus difficiles à appliquer. La première chose à faire, c'est de demander à sa petite voix intérieure de se taire. Parce que là, vous êtes en train de m'écouter, tous, et il y a votre petite voix intérieure qui réagit intérieurement. Donc elle va être soit d'accord, soit pas du tout d'accord, soit essayer de se rappeler comment s'appelle cette journaliste américaine que j'ai citée tout à l'heure. Voilà ce qui se passe. Quand on est journaliste en plus, la Florence, elle se dit, est-ce que je suis bien en train d'enregistrer ? C'est quoi ma prochaine question ? Quelle heure il est ? Donc sa boîte intérieure est tout le temps en train de s'exprimer. Et c'est très important, alors pas tout le temps, parce qu'un échange c'est aussi d'avoir un dialogue, donc vraiment de faire en sorte que chacun s'exprime, mais lui demander de se taire pendant un petit temps. C'est ce qu'on appelle en fait l'indimission, c'est-à-dire vraiment être présent pour l'autre. Et ça c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. qui est un muscle un peu à développer, c'est pas facile à faire mais en vrai c'est accessible à tous. Ensuite sortir de ces bulles sociales, surtout quand on est journaliste. Moi ce qui m'avait profondément marqué justement pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'était Jean-Marie Charon qui était justement venue pendant cet événement que j'avais organisé. Jean-Marie Charon, sociologue des médias., qui a écrit un livre sur la couverture journalistique du mouvement des Gilets jaunes. Il avait interviewé 90 journalistes et parmi ces 90 journalistes, il y en avait peut-être un ou deux qui connaissaient personnellement un journaliste, un Gilet jaune pardon, et encore c'était une ancienne source. Et ça, ça m'avait profondément marquée. Donc oui, les journalistes opèrent dans leur bulle sociale. Ils ne sont pas forcément complètement homogènes non plus, mais quand même. Donc comment on a accès à des populations ou à des opinions qui ne sont pas celles qui sont en dehors de nos biais cognitifs ? Les biais cognitifs évidemment, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des choses qui sont déjà dans notre radar et qui vont confirmer aussi nos opinions ou alors qui vont confirmer l'idée qu'on se fait de ce que l'autre pense. Et ensuite, et ça je l'évoque aussi dans le livre, ce qui nous empêche d'écouter c'est avant tout et surtout nous-mêmes. Et c'est vrai que certains journalistes vedettes, notamment dans l'audiovisuel, ont un égo, on va dire...
- Florence Gault
Des noms !!!
- Nina Fasciaux
Pas de noms. Il faut lire le livre pour avoir des noms. Et c'est vrai que ça, c'est hyper important. Je pense que la peut-être première, deuxième qualité après la curiosité, mais ça va de pair en même temps, chez les journalistes, c'est l'humilité. C'est-à-dire que je pense que les journalistes prennent trop de place dans les récits qu'ils font. Donc vraiment une posture d'humilité. Et oui, l'inhibition. Et après, il y a cette technique du looping.
- Florence Gault
Effectivement, on va en parler. En fait, c'est se mettre à l'écoute, adopter une posture d'ouverture. Si tu pouvais nous présenter un peu la méthode dans les grandes lignes.
- Nina Fasciaux
Oui, bien sûr. Et après, moi, on me demande souvent, mais oui, mais alors le looping et pourquoi pas l'écoute active ou la communication non violente. Je n'ai pas une méthode préférée. Je sais que des fois, il y a des petites batailles entre... Entre les différentes techniques, c'est juste que moi, j'ai été formée par le Centre de médiation de conflit aux États-Unis, qui utilise cette méthode qui s'appelle « looping for understanding » , qui est en gros, pour la traduire, le circuit de la compréhension, et qui marche très bien, nous on l'a vu avec les journalistes. Donc c'est une méthode en quatre étapes. La première étape, ça va être d'écouter en... Comme je le disais tout à l'heure, en affichant vraiment cette volonté d'écouter. Donc, il y en a qui vont avoir besoin de le dire. J'ai vraiment envie de comprendre ce que tu dis. Ou alors, ça peut être le langage corporel. Il y a beaucoup de gens, justement, dans les groupes de parole qui nous ont dit, moi, pour me sentir entendue, j'ai besoin qu'on me capte. J'ai besoin qu'on me regarde dans les yeux. La deuxième étape va être de reformuler ce qu'on a compris de ce que la personne a dit. Et non pas répéter. Et ça, c'est très important parce que Notre cerveau va filtrer ce qu'il juge important ou pas important, va comprendre d'une certaine façon certains mots. Et comme il est construit différemment de l'autre et avec ses propres expériences, etc., c'est vraiment une étape de validation où on va demander « voilà ce que j'ai compris de ce que tu viens de dire, est-ce que c'est ça ? » En troisième étape, la personne va pouvoir valider, invalider, nuancer, se rendre compte aussi, parce que c'est stressant de parler à un journaliste. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est vrai qu'il y a un rapport de domination entre celui qui écoute et celui qui est écouté. Et donc, des fois, on ne dit pas exactement ce qu'on voulait dire, ou alors on simplifie, ou quand on se réécoute, on se trouve un peu bête. Donc, on va avoir cette opportunité aussi de développer, de nuancer. Et à la quatrième étape, et là souvent les journalistes, ils lèvent les yeux au ciel en disant « c'est pas bientôt fini » , mais c'est vraiment là qu'on a accès à l'information que personne n'a vue, le scoop en journalisme, et où on demande « est-ce qu'il y a autre chose ? » . Et en fait là, on ouvre vraiment une porte sur un champ de réflexion que souvent même la personne ne s'est pas autorisée elle-même, et on va avoir accès à... à la vraie raison derrière ce qui construit une opinion. En manifestation, par exemple, c'est très intéressant de poser cette question-là. Voilà, les quatre étapes du looping.
- Florence Gault
Est-ce que je tente ? Alors, on va tester. Je vais reformuler pour voir. Donc, une posture où on crée du lien avec la personne. Je vais reformuler après avoir écouté ce qui vient d'être dit. Comme ça, la personne peut préciser. Et puis, enfin, je laisse l'opportunité à la personne en face d'apporter autre chose.
- Nina Fasciaux
Oui, tout à fait. Et là, dans ce que tu as dit, alors ça me permet, moi, de rajouter quelque chose que je n'ai pas dit. Non pas que tu as mal compris, mais je n'ai pas dit. C'est que quand on écoute la personne qui s'exprime, souvent, alors là, on parle quand même de sujets lourds. Enfin, soit c'est des opinions très tranchées, c'est des sujets un peu conflictuels. Il y a ce qu'on appelle des red flags, des mots vraiment qui nous signalent quelque chose. Soit c'est des mots qui vont être répétés souvent, soit c'est des mots vraiment lourdement chargés de sens, émotionnels, etc. Et là, c'est intéressant du coup, quand on reformule, d'essayer d'en savoir un peu plus sur ça, parce que ça veut dire quelque chose.
- Florence Gault
Cette méthode du looping, elle peut peut-être apparaître... Un peu naïve, un peu bisounours, un truc qu'on reproche aussi beaucoup au journalisme de solution. Peut-être que de dire, effectivement, le journaliste qui lève les yeux au ciel en se disant « Est-ce qu'en fait, je suis vraiment obligée de passer par toutes ces étapes ? » Alors qu'on nous apprend qu'une question bien anglée avec des informations est plus intéressante qu'une question où on va juste dire « Vous avez quelque chose d'autre à ajouter ? » Et pourtant, c'est... C'est pas fait pour être bisounours.
- Nina Fasciaux
Non, mais alors déjà, c'est pas obligé d'être en opposition. Ah, on peut quand même avoir des questions un petit peu dérangeantes, qui vont aller un petit peu gratter là où ça fait mal. Ça n'empêche pas. Mais c'est vrai que nous, on a un témoignage d'une journaliste qu'on a formée avec le Solutions Charism Network, qui nous a vraiment dit, non mais quand vous m'avez appris ça, je me suis dit, mais pour moi, c'est un calvaire, va falloir que j'aille jusqu'à la quatrième étape, j'en peux déjà plus. Je ne me voyais pas du tout faire ça. Et qui, dès la première interview où elle l'a essayé, s'est dit, mais ça, je me suis rendue compte de tout ce que j'ai loupé dans ma carrière, comme information. C'est-à-dire qu'en étant tellement... Parce qu'on se prépare quand on a des interviews. On anticipe, on a nos questions. Et du coup, aussi, il y a le stress du journaliste. Mais évidemment, et même après, je ne sais pas, 20 ans de métier, peut-être, on est toujours stressé. Et donc, on est quand même concentré sur ce que nous, on a anticipé, de ce qui allait être dit. Et c'est vrai qu'avec cette technique du looping, qui peut être utilisée en préparation d'une interview aussi, si c'est vrai qu'on est sur un plateau de deux minutes et que du coup, il faut y aller, ce n'est pas possible. Mais on peut l'utiliser en amont. Et c'est vrai que c'est absolument extraordinaire. Les journalistes sont... globalement toujours assez sceptiques et globalement toujours assez complètement bluffés de voir à quel point ça leur apporte une information beaucoup plus nuancée, beaucoup plus authentique et beaucoup moins similaire à ce qu'on trouve déjà sur X, quoi, sur Twitter.
- Florence Gault
On arrive à un moment charnière avec la crise écologique, crise démocratique, crise sociale. Est-ce que tu penses que l'écoute peut être un levier finalement pour accompagner les transitions à venir ?
- Nina Fasciaux
Je pense que oui. Effectivement, comme il va falloir énormément s'adapter, il va falloir composer avec des systèmes ou des façons de faire ou il va falloir faire des sacrifices qui sont difficiles. Il va falloir faire des compromis. Donc effectivement... Ça me paraît de l'ordre de la survie et d'ailleurs j'en parle un petit peu dans le livre de comment on pourrait apprendre du monde végétal et animal pour qui l'écoute est une question de survie. C'est-à-dire que l'écoute leur permet, la captation des signaux que nous envoie la nature leur permet de rester en vie. Souvent c'est parce qu'il y a un danger qui s'annonce. Et nous on n'est tellement pas en capacité d'écoute qu'on n'entend pas, on ne voit pas le danger qui s'annonce. effectivement, je pense qu'on va devoir se serrer les coudes, mettre nos divisions de côté pour assurer notre propre survie. Et cela, effectivement.
- Florence Gault
Et ça veut dire quoi ? Créer des espaces de dialogue, de rencontres ?
- Nina Fasciaux
Oui, ça commence par ça, parce qu'on se rend compte aussi, alors il y a énormément d'opérations qui ont été menées partout dans le monde, comme ça, les médias s'y mettent à inviter des gens. à matcher des gens comme Tinder, mais avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord.
- Florence Gault
La Croix notamment qui a fait ça.
- Nina Fasciaux
La Croix et Brut qui ont fait ça en France, ça s'appelle Faut qu'on parle. Ça a été initié en Allemagne avec l'opération My Country Talks, où des gens qui ne sont pas d'accord sur des sujets très difficiles vont accepter de se rencontrer. Et dans la rencontre physique, il y a un lien qui se crée. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'échange virtuel n'est absolument pas propice à créer du lien et à être à l'écoute des opinions opposées. Donc c'est vrai que se rencontrer, avoir l'opportunité d'échanger sur ce qui nous lie avant de se battre, oui, c'est extrêmement important.
- Florence Gault
Tu vois des signes, des petites lueurs d'espoir, tu vois des signaux lumineux ? On a encore pas mal dans l'obscurité.
- Nina Fasciaux
Alors, je vois des signaux lumineux parce que mon propos, par exemple, est quand même bien réceptionné dans la profession. Il voit bien qu'il y a un problème, heureusement, j'ai envie de le dire. Mais, par contre, là où je reste encore un petit peu pessimiste, c'est que Je ne sais pas si les signaux d'espoir que je vois, que j'identifie vont assez vite. C'est-à-dire, je ne sais pas si on va assez vite par rapport à la vitesse avec laquelle on se divise, on se déchire.
- Florence Gault
Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on passe aux questions ?
- Nina Fasciaux
Je crois que ce que je pourrais ajouter, c'est que ce livre, c'est vraiment un appel à... À conscientiser ce besoin d'écoute, et pas que pour les journalistes d'ailleurs. Je pense que, moi je suis mère de trois enfants, et j'aimerais beaucoup qu'on apprenne ça à l'école. On est beaucoup accompagnés sur l'expression, sur l'écoute de soi aussi, et très peu sur l'écoute des autres, et je trouve ça hyper dangereux en fait.
- Florence Gault
C'est le moment si vous avez des questions. Maintenant, après avoir parlé, on écoute et on vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer ? La première question est souvent la plus difficile, mais après ça roule tout seul.
- Speaker #3
Moi, je voulais savoir quel est votre avis sur la question des nouveaux récits et de la communication avec le journalisme. Est-ce qu'il y a un pont qui est faisable ? Est-ce qu'il y a une complémentarité ou pas ?
- Nina Fasciaux
Voilà, donc j'ai bien compris la question. Est-ce qu'il y a des ponts possibles entre le monde des médias, des journalistes et du monde de la communication ? Oui, parce qu'il y a une défiance souvent qui vient des journalistes. En tout cas sur ces compétences d'écoute, très certainement. Moi j'ai quand même pas mal de gens du monde de la communication qui m'ont dit que ça leur parlait beaucoup. Donc je pense qu'il y a des compétences à partager. c'est très salutaire en fait de collaborer, de coopérer, de partager des compétences, quels que soient les milieux d'ailleurs. Je suis plutôt sur le décloisonnement des savoirs que l'inverse. Après je comprends tout à fait les journalistes qui veulent mettre des garde-fous entre... et d'autant plus en étant dans le journalisme de solution où c'est encore plus important. Donc voilà, je comprends pas la défiance mais une grande rigueur, ça c'est... Évidemment. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que vous avez des modèles de médias ou de journalistes qui, pour vous, vraiment font preuve de cette écoute et que vous aimez écouter ou lire ? Ah oui, j'ai mes petits chouchous. Alors, j'ai une personne que je cite dans le livre, notamment, qui a fait des films, qui s'appelle Diya Khan. Elle est d'origine afgano-pakistanaise, mais elle vit au... En Angleterre, et il me semble qu'elle a la nationalité norvégienne, enfin là je vous ai peut-être perdu du coup, mais bon, peu importe, elle a fait des films sur les plus grandes pourritures du monde. Donc elle a fait des films sur les suprémacistes blancs, les hommes qui battent et tuent leurs femmes, les djihadistes, et avec vraiment cette volonté de comprendre sans juger, pour comprendre au final ce qui est systémique dans l'apparition de ces comportements extrêmes. Et c'est absolument extraordinaire ce qui se produit quand on fait ça, et elle le montre très bien, c'est qu'en fait on crée des brèches dans ces convictions, dans ces engagements très extrêmes ou dans cette violence, en ressortant la dignité par l'écoute. Je recommande Diyarhan et beaucoup d'autres, pour ne citer qu'eux, parce qu'ils sont à Lyon, mais Mediacité m'avait demandé de faire cette formation sur l'écoute il y a quelques années. Ils ont vraiment cette volonté, c'est un média d'investigation local, ils ont vraiment cette volonté de faire mieux, avec les contraintes qui sont les leurs, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de la rédaction qui est vraiment louable.
- Speaker #3
Je voulais rebondir sur ce sujet-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a des formats journalistiques qui sont plus propices à l'écoute que d'autres ?
- Nina Fasciaux
C'est une très bonne question. Le temps long, c'est évident. Les formats longs. Après, des formats, si on parle de format radio, documentaire, presse écrite, non, je ne crois pas. Je pense que c'est vraiment une question de posture avant tout.
- Speaker #3
Du coup, deuxième question, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. La deuxième, c'était justement, parce que là, dans la méthodologie que vous évoquiez, celle de looping, hum hum Il y a la question de la revalidation par la personne qui est interviewée, ce qui pose la question de la relecture, qui est un sujet sensible chez les journalistes. Et du coup, comment est-ce que ça s'est perçu par la profession ?
- Nina Fasciaux
Très mal, je pense que vous connaissez la réponse. Oui, c'est pas très largement pratiqué de faire relire ou de faire valider les propos par la personne interviewée. mais en vrai les fois où Moi j'ai été témoin que ça a été fait, ou j'ai eu des journalistes qui m'ont rapporté l'avoir fait, et en fait ils en sortent vraiment grandis parce qu'il y a une opportunité de nuancer le propos et sans forcément polisser justement. On imagine que ça va être polissé et en fait pas forcément, c'est juste que ça permet d'honorer plus la complexité des propos. Moi je suis plutôt... pour, mais je sais aussi que c'est une contrainte supplémentaire dans le temps qui est donné aux journalistes pour rendre un papier, par exemple.
- Speaker #4
Comment on peut écouter et bien écouter, comme vous nous recommandez de le faire, sans tomber dans la complaisance par rapport à des histoires de post-vérité, parce qu'à la fin, si on écoute tout le monde et qu'on leur donne autant d'importance les uns qu'aux autres, quelqu'un qui lit des grosses bêtises aura autant de poids qu'un scientifique, ou des choses comme ça.
- Nina Fasciaux
Excellente question. C'est très important de rappeler et de s'en tenir aux faits. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est dans une posture d'écoute et qu'on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un complotiste, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un raciste, vraiment dans une démarche de compréhension encore une fois de ce qui est systémique, qu'on ne peut pas rappeler les faits. Après, je pense qu'il y a une façon de faire, c'est-à-dire qu'une manière très frontale, comme on peut avoir parfois en interview, va braquer non seulement la personne qui est interviewée, mais toutes les personnes qui, par exemple, à la radio, qui les écoutent et qui pensent comme elles. Donc, en fait, on braque beaucoup plus de personnes que juste la personne qu'on interview. Donc, il y a des façons de faire, très simplement de dire, alors vous dites que blablabla, mais pourtant, les experts disent... Que pouvez-vous me dire ? Qu'en pensez-vous ? Donc ça permet de ramener les faits au premier plan tout en étant dans le respect, le respect de la dignité de la personne et ça marche mieux. Après, ce qu'on recommande aussi, nous, en formation, c'est quand c'est possible, sur des faits qui sont polémiques, de plutôt montrer les données, donc avec des graphiques, ou vraiment les montrer en... je sais pas, en sous-titres, ou plutôt que de les énoncer. Parce que ça a plutôt tendance à accroître la confiance en ces faits que quand ils sont énoncés.
- Speaker #5
Alors, donc moi je suis pas du monde journalistique, mais par contre dans mon quotidien, je côtoie des personnes qui vont pas forcément avoir les mêmes opinions que moi, voire parfois avec des idées un peu complotistes, et je sais que j'ai énormément de mal à garder mon calme quand je discute avec ces personnes-là, même si ce sont des proches. Et je me demandais si vous aviez des conseils pour pouvoir discuter et garder justement cette ouverture et un certain calme. Parce que le fait de s'énerver, forcément, ça va braquer l'autre personne. Et du coup, le débat n'est pas du tout constructif. Donc voilà, je me demandais si vous aviez peut-être des conseils à donner par rapport à ça.
- Nina Fasciaux
Oui, peut-être que si vous, en plus, si ça vous énerve, peut-être que la première chose à faire, c'est d'exprimer votre désaccord. Justement, peut-être que ça va vous apaiser déjà. Je veux dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais j'ai envie de comprendre. Et quand vous le faites, vraiment poser des questions qui s'attachent au vécu personnel des gens, à leur motivation profonde, à ce qui, dans leur vie, les a amenés à penser ça. Et du coup, ça devient tout de suite très personnel. Mais c'est ça, en fait, qui construit une opinion. Ce n'est pas vraiment ce qu'on a lu ou entendu. Dans les médias, c'est notre expérience vécue, c'est nos relations personnelles, c'est nos peurs. Donc c'est intéressant de maintenir la conversation sur des aspects personnels pour comprendre pourquoi les gens sont arrivés là. Et en plus, en faisant ça, ils se sentiront entendus et donc ils seront à leur tour plus ouverts à ce que vous, ensuite, vous pourrez partager.
- Speaker #5
D'accord. Et j'ai une deuxième question un peu liée du coup. quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'il y a quand même un fort travail de presque de psychologue. Je me demande si vous avez des formations, peut-être justement avec des psychologues, sur ce sujet-là. Et, troisième question, comment vous, vous arrivez à gérer psychologiquement ce genre de débat ? Parce que je pense que ça impacte forcément. Je me demande, d'un point de vue psychologique, comment ça se passe ?
- Nina Fasciaux
Il y a plusieurs aspects, je pense à la question, c'est que, est-ce que nous, on travaille avec des psychologues pour vraiment sur l'aspect formation journalistique ? Plutôt non, plutôt des médiateurs qui sont vraiment sur des techniques d'écoute, mais qui ne sont pas forcément dans une démarche thérapeutique. parce que justement C'est peut-être là que s'arrête le rôle du journaliste dans ce métier du soin. C'est-à-dire que c'est de créer des liens, d'essayer de comprendre sans forcément guérir. Après, il y a des éléments, par exemple Destin commun, il travaille beaucoup sur des méthodologies qui sont issues de la psychologie sociale. Donc il y a quand même évidemment des outils, mais il y a aussi des outils à explorer. Avec les neurosciences, il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer pour mieux faire notre travail de journaliste. Et ensuite, je pense que ce que vous posez la question, c'est aussi le soutien psychologique. dont pourraient bénéficier les journalistes.
- Speaker #5
C'est ça. Et comment, en fait, vous arrivez à peut-être mettre une barrière ou faire en sorte, justement, que ce que vous, vous pouvez ressentir n'ait pas d'impact, ensuite, sur votre travail, en fait, pour rester le plus factuel possible ?
- Nina Fasciaux
Alors, je ne sais pas si c'est possible qu'il n'y ait pas d'impact. Je pense que c'est, justement, la première chose à faire, c'est de reconnaître qu'il y en a un. Au lieu de se dire, non, moi, je suis blindée. De toute façon, je suis là pour la neutralité. Non, en fait, évidemment que notre petit guicœur fond. Donc voilà, de prendre le temps aussi de l'assimiler, de éventuellement se faire aider, être soutenu. Mais là aussi, il y a la profession qui doit évoluer. C'est-à-dire que je pense que les journalistes doivent être soutenus parce que c'est difficile aussi d'être dans cette position-là où on absorbe beaucoup, beaucoup d'émotions. positions extrêmes qui sont difficiles.
- Florence Gault
Et ça, je pense qu'effectivement, en tout cas, les choses semblent évoluer quand même un peu, où on prend un peu plus en compte effectivement l'impact que peut avoir l'actualité. Moi, j'ai travaillé pendant 16 ans dans l'actu chaude. J'ai notamment couvert en 2015, c'est l'exemple que je donne très souvent, les attentats du 13 novembre 2015, les attentats contre Charlie Hebdo, etc. C'était aussi la... L'époque où on parlait beaucoup de la crise migratoire, etc. Moi, j'ai vraiment des collègues qui ont fait des burn-out à cause de l'actualité. Une de mes collègues a été obligée d'arrêter la profession parce que ça prenait trop de place. Et j'ai quand même la sensation que ça évolue un peu. Là, j'ai deux étudiants, parce que je suis aussi prof en école de journalisme, qui consacrent leur mémoire à la santé mentale des journalistes. Je trouve qu'il y a un petit truc qui apparaît. Pas dans toutes les rédactions où effectivement le journaliste il est supposé quand même être fort, gérer, encaisser comme si ça ne nous atteignait pas alors qu'en fait l'impact il est quand même pas anodin je trouve selon les sujets qu'on a traités.
- Nina Fasciaux
Oui puis on en revient aux questions un peu structurelles c'est-à-dire que ce qui pose problème aussi c'est d'aller d'une situation dramatique à l'autre sans transition en fait. de passer vraiment du drame du lundi au drame du mardi. Et en fait, on enchaîne, on enchaîne. Et donc le fait aussi de faire en sorte que ça, ça n'arrive plus et de prendre le temps de ralentir va permettre aussi de digérer ce qu'on couvre.
- Speaker #5
Et est-ce que... Je suis désolée, je monopole. Après, j'arrête. Est-ce que justement, le fait de ne pas réussir à traiter... ces informations émotionnellement je veux dire ça réduit pas aussi peut-être un peu le niveau d'empathie et quand on a moins d'empathie on est aussi moins à l'écoute et ça pourrait expliquer en partie pourquoi dans le journalisme il peut y avoir parfois un manque d'écoute
- Nina Fasciaux
Oui je pense que en partie vous avez raison, quand on se blinde pour se faire croire à soi-même et aux autres que...
- Florence Gault
Eh bien, merci beaucoup. Merci Nina pour cet échange.
- Nina Fasciaux
Merci Florence.
Donc,
- Florence Gault
malentendu aux éditions Payot, pour ceux qui souhaitent, il y a possibilité d'acheter l'ouvrage de Nina juste après, de se le faire dédicacer, profitez-en. Merci en tout cas pour cet échange en public. Merci à la Maison de l'Environnement et à Clémence Bruggemann de nous avoir accueillis aujourd'hui. Merci.