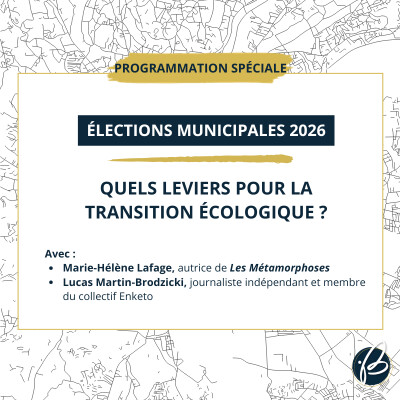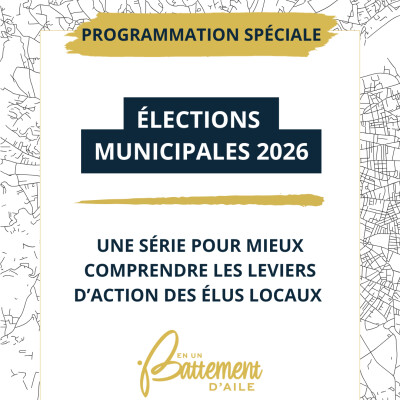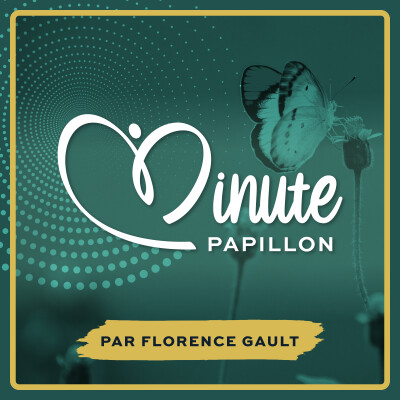- Florence Gault
Pourquoi, malgré la multiplication des rapports alarmants et des signaux tangibles du dérèglement climatique, nos comportements peinent-ils à évoluer à la hauteur des enjeux ? Qu'est-ce qui nous pousse ? ou nous freine à changer ? Ces questions sont au cœur des travaux de Stéphane Labranche, sociologue du climat et coordinateur du GIECO, le groupe interdisciplinaire pour l'évolution des comportements face à la crise climatique. Depuis 20 ans, il analyse les forces sociales, écologiques et politiques qui influencent nos modes de vie et Ausha en matière de transition écologique. À l'occasion du lancement du premier volume du rapport du GIECO consacré aux moteurs et aux freins des changements de comportement, Il nous éclaire sur les leviers d'action possibles, comment passer d'une prise de conscience individuelle à une transformation collective, quel rôle jouent nos institutions, nos villes, nos récits collectifs, et si au fond la question écologique était avant tout une question culturelle et politique. C'est à Grenoble, en Isère, que je retrouve Stéphane Labranche. Bonjour Stéphane Labranche. Bonjour. Alors les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais nous sommes installés dans votre dojo pour cette interview. Est-ce qu'il y a peut-être un lien à faire dans notre manière à être combatif dans la lutte contre le dérèglement climatique ?
- Stéphane La Branche
Oui, en partie oui. Parce qu'en fait, c'est un dojo de MMA, où on fait de la boxe, de la lutte, du seul avec et sans les coups. Et donc c'est très stratégique et très complexe comme sport. Ce qui veut dire que parfois, il faut s'abrandir, il faut... Boire. Il faut s'aider, des fois il faut rentrer dans le tas, des fois il faut attendre son moment, surtout quand on fait du sol, parce que sinon on se fait prendre en étranglement, des choses comme ça. Donc il y a toute une stratégie je trouve qui est applicable quand même sur choisir le bon moment pour faire la bonne chose quand on essaye de faire la transition. Ceci étant dit, un deuxième parallèle, faire la bonne chose au bon moment, ça veut dire qu'on comprend ce qu'il faut faire avec quel moment.
- Florence Gault
Être capable de lire la situation et de savoir à quel moment envoyer le bon coup.
- Stéphane La Branche
C'est ça. Et là, à un contre un, c'est simple. Quand on parle de transition, on parle d'une population mondiale, en fait, avec des cultures différentes, des systèmes politiques différents, des valeurs de représentation. Et puis même à une petite échelle, même une seule personne, toi et moi, on n'a pas toujours les mêmes envies, à des phases différentes de nos vies, de faire la même chose en matière de transition. Puis il y a des moments où on se sent trop fatigué, on se dit « Merde, je vais me prendre un hamburger » .
- Florence Gault
Mais le but, c'est de ne pas être KO dans les deux cas.
- Stéphane La Branche
C'est ça, c'est ça. Oui, parce que le KO, il va être civilisationnel si on va jusque-là. Donc là, il faut tenter de l'éviter. Une partie, je dois dire, de mes motivations personnelles à ça, c'est d'éviter le KO ou même une dérive fasciste quelconque. On a eu tendance en France, mais c'est vrai dans les autres pays. pays aussi à faire au début de la politique publique coercitive, obligatoire, même quand ce n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est complètement contre-productif. Mais parce qu'on se limitait trop à ça, on ne savait pas comment faire d'incitation ou de l'encouragement, alors que ça pouvait être suffisant dans certains cas. Alors toute la question, c'est par rapport à nos phases de vie, nos valeurs, à la diversité de notre population, quel type de politique publique mettre en œuvre pour que ce soit le plus efficace possible. pas ni l'incitation ni l'information, même si je suis un petit peu dubitatif sur l'impact de l'information sur les changements de comportement, il n'y a rien de restreux. Puis en même temps, pourquoi faire de la coercition en obligation quand ce n'est pas nécessaire ? En fait, c'est débile. Et donc, il y a une grosse partie des recherches en sciences sociales qui vivent justement à faire ce type de préconisations avec une implication, c'est qu'il va falloir être beaucoup plus intelligent dans notre manière de faire de la politique publique et l'accompagnement au changement. que ce qu'on pensait avant, parce que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait.
- Florence Gault
Alors, on va y revenir évidemment. Vous êtes l'un des pionniers de la sociologie du climat en France. Il y a 20 ans, ce champ de recherche était encore relativement émergent. Est-ce qu'on peut donner une définition ? C'est quoi la sociologie du climat à nos auditeurs ?
- Stéphane La Branche
C'est la discipline qui s'intéresse aux différents facteurs. comme les représentations sociales, les valeurs, mais aussi le contexte dans lequel on vit, l'urbanisme, les politiques publiques, et qui analysent comment ça entre en interaction avec nous, individus, et la transition. Et ces interactions vont dans les deux sens. Les interactions sont parfois congruentes, c'est-à-dire que l'envie des gens peut aller. dans ce sens de la transition, et des fois c'est contre la transition, et des fois c'est juste à côté. C'est de l'indifférence aussi, donc il y a plusieurs possibilités. Et donc en fait la sociologie tente de comprendre tout ça dans sa complexité.
- Florence Gault
Et ce que vous dites c'est qu'en fait le facteur humain aujourd'hui est au cœur du basculement de nos modes de vie.
- Stéphane La Branche
Je te dirais même plus, j'étais à une conférence... Ça faisait la troisième que je faisais en un mois, quatrième que je faisais en un mois, c'était à Marseille. Et il y avait le préfet, il y avait tous les élus, et j'étais la cinquième personne à passer, et j'en avais quatre qui avaient déjà parlé de transition écologique, transition écologique, et ce que je ne comprenais pas dans leur discours, mais je ne sais pas pourquoi ça ne m'avait pas frappé plus que ça avant, c'est que le titre, c'était transition écologique, et là, ils passent, en fait, 20 minutes à parler des freins économiques, des freins institutionnels. Mais pourquoi on... parle de frein économique si c'est pour parler de transition écologique. En fait, la conclusion pour moi, elle est devenue simple depuis ce temps. Je trouve que le terme de transition écologique est à la rigueur presque hypocrite, mais en tout cas, c'est à côté de la plaque. Il faut parler de transition humaine. On va régler la crise écologique si et seulement si on change nos modes de vie. Donc, c'est pas une transition écologique, c'est une transition humaine qu'il faut faire. aller un peu plus loin, sans vouloir faire peur à personne, c'est une transition de civilisation.
- Florence Gault
Mais effectivement, c'est sans doute un mot. Si on arrive auprès des gens en leur disant il va nous falloir engager une transition civilisationnelle, j'imagine que la réaction, elle peut être un peu compliquée, effrayante, de se dire, quoi ? Il faut qu'on abandonne notre monde ?
- Stéphane La Branche
Oui, bien sûr. Ou alors, il y a l'autre réaction qui dit, Ça veut dire quoi ? Et je peux faire autre chose. Parce qu'en fait, comment ça se traduit ça au concret, au quotidien ? Moi, je fais vraiment une sociologie du quotidien, des pratiques. La théorie, j'en ai fait ma thèse de doctorat, voire même ta métathéorie, et là, ça me saoule. Il faut que je n'ai pas la capacité, c'est que ça me saoule, ça sert à quoi ? Et donc, finalement, ça m'a permis aussi de confirmer une hypothèse que j'avais, c'est que les gens ne rentrent pas... pas autant qu'on le devrait, pour répondre à ta question initiale, dans les efforts de transition, c'est pas par grand débat idéologique ou grand refus de la nature. C'est le quotidien. C'est le fait d'avoir un deuxième enfant. C'est le fait d'habiter dans une ville sans transport en commun. C'est la temporalité extrêmement limitée et restreinte qu'on a par rapport au boulot. Voire pire quand on a des enfants, la crèche. On a tous peur de perdre notre place en crèche, donc on n'est jamais en retard à la crèche. On ne veut pas pas se faire engueuler par la nounou. C'est vraiment, c'est grave. Et ça, c'est ces petites choses-là de la vie quotidienne qui, cumulées ensemble, font qu'il y a beaucoup d'obstacles au changement, en fait. Et au-delà des obstacles au changement, j'ai eu des discussions aussi sur LinkedIn là-dessus. Pour moi, je commence aussi à de plus en plus penser et à dire qu'il est faux de parler d'obstacles au changement comme si c'était un barrage ou un mur et puis on ne peut plus avancer. En fait, ce qui nous empêche de changer, ce sont des forces très dynamiques et très actives.
- Florence Gault
C'est-à-dire ?
- Stéphane La Branche
Ben, le système capitaliste et consumériste est probablement le plus efficace au monde pour nous convaincre, nous et notre cerveau, surtout celui qui veut de la récompense immédiate, que c'est le meilleur système. Le système capitaliste en soi est sa meilleure pub et ça affecte directement notre neurologie. Ça c'est super actif et dynamique et puissant comme manière d'empêcher la transition écologique. C'est pas simplement un obstacle stagnant avec un mur qui bouge pas en briques. Non, non, non, c'est que ça va nous chercher dans nos sentiments, dans nos envies de nous faire plaisir rapidement, dans l'obtention de biens faciles, etc.
- Florence Gault
C'est-à-dire que c'est tellement ancré aujourd'hui dans... La société dans notre vision du monde, que très souvent d'ailleurs on entend cette phrase, mais on ne pourrait pas faire autrement. Oui, on est dans un système capitaliste, mais en fait, il y a quoi d'autre ?
- Stéphane La Branche
C'est ça, oui, c'est exactement ça. Et une partie du travail qu'il faut faire en matière de transition écologique, c'est d'ouvrir des possibilités. Même si c'est au niveau de l'imaginaire, des représentations sociales, montrer qu'il y a quelque chose d'autre possible. Parce qu'une fois que le cerveau a envisagé quelque chose d'autre possible, il peut commencer à se dire « comment j'y vais ? » Mais s'il n'y a pas ça, ça ne peut pas. Et ça, c'est une des grosses critiques que j'avais à l'égard des campagnes de sensibilisation sur l'environnement, que ce soit par les ministères, les associations, le GIEC, etc. C'est qu'on nous donnait tous un futur fermé, catastrophique. Il n'y avait pas d'autre option que celle-là. C'est quoi la réaction du cerveau et de la psyché face à une catastrophe qui arrive et qu'on ne peut pas résoudre ? C'est la fuite, c'est le déni, c'est l'hédonisme, c'est tout ça. Mais si on commence à dire non, il y a d'autres possibilités de la bonne vie, d'une vie qui va ressembler peut-être en partie à ce qu'on faisait, en 2050 même si on aurait réussi la transition complètement, on va continuer à bosser, ce ne sera peut-être pas le même travail, ce ne sera peut-être pas le même rythme. Mais on va devoir travailler. On a toujours travaillé dans l'humanité, même si c'était pour ramasser les fruits. Donc, ce n'était pas nécessairement pour de l'argent, mais quand même. Il y a toujours une fonction travail, récolte de ressources, etc. Mais on va les faire différemment. Peut-être que nos loisirs seront différents, nos voyages, nos vacances seront différentes. Mais on va en avoir quand même. Mais au moins, l'idée derrière ça, c'est de se dire, ce n'est pas un mur fermé. On peut envisager autre chose. Et là, déjà, on ouvre des possibilités.
- Florence Gault
Donc, ouvrir le champ des possibles. Oui. Ça passe aussi notamment par l'imaginaire, d'où l'importance de ce qu'on appelle sous ce mot. Alors, il y a certains qui disent que le mot n'est pas tout à fait juste, mais en tout cas, à ce moment-là, des nouveaux récits. Pouvoir, et Alain Damasio le disait il y a quelques mois dans un épisode du podcast, en disant qu'en fait, il faut pouvoir imaginer, d'où l'intérêt de la fiction, qui permet de préfigurer le présent. si on ne l'imagine pas, il y a peu de chances que ça se produise.
- Stéphane La Branche
Oui, puis on était plusieurs à le dire jusqu'en environ 2018. Et à peu près 2017-2018, il s'est passé une chose. De plus en plus, même les scientifiques en sciences sociales, etc., on voyait nos confrères sciences naturelles faire de la prospective. Prospective de prix de l'énergie. Les économistes étaient super bons avec ça. Ils ne prenaient pas le reste en compte, mais au moins, là-dessus, ils étaient bons. Prospective climat. La GIEC en fait depuis août. Et les prospectives de société, elles étaient où ? Elles. Il n'y en avait pas. Il y avait une allergie parmi notre corps de métier en sciences sociales, de dire « Ah ben là, vous voulez faire de la science-fiction, c'est pas de la bonne science. » Ben c'est un exercice en tout cas d'imaginaire, et donc il y a eu les scénarios de l'ADEME qui sont sortis, et de plus en plus, il y a même la fraise des imaginaires, le machin, le truc. L'ADEME a embauché mes anciennes étudiantes de IEP de Grenoble pour faire de la prospective de société. Donc moi je m'y attendais pas avant 2028-2030. Ah ben, ils l'ont fait plus rapidement que ce que je pensais. Justement parce qu'il y a cette conclusion qui dit qu'il faut imaginer notre société autrement, mais que ce n'est pas les climatologues qui peuvent nous donner une idée différente de notre société. Ça, c'est une question de science sociale. Encore faut-il vouloir s'embarquer, etc. Mais il y a des travaux là-dessus qui ont été faits et avec, bon, des enjeux méthodologiques aussi parfois. Est-ce qu'on regarde dans une boule de cristal ? Pour moi, là-dessus, quand j'en fais... J'essaye de rester dans du sociologiquement réaliste. C'est-à-dire que...
- Florence Gault
De ne pas aller trop loin dans des choses complètement... Je vois le regard, genre, quelle va être la suite de ma phrase ? Que va-t-elle dire ? J'allais dire des hypothèses folles ou ne pas pousser, en tout cas, le cursus trop loin.
- Stéphane La Branche
Oui, oui. Moi, je ne m'attends pas une autre. révolution de la culture tout de suite. Je n'attends pas une révolution de nos valeurs profondes. Donc, quand je lis des scénarios comme celui de l'ADEME Frugalité, je suis désolé, bon, je l'ai déjà dit au public, donc je peux le redire ici, c'est intéressant comme exercice, il faut le faire. Mais c'est comme s'ils avaient fumé de la marijuana en s'imaginant que tout le monde allait devenir des écolo-gandhis, des gandhis de l'écologie, et qu'on allait arriver à ça avec bonheur et envie. ici. complètement faux. Mais, ça donne quand même une image, il est peut-être possible d'acheter un outil pour un quartier, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'une perceuse. Il faut juste partager une perceuse. C'est pas compliqué, hein ? La voiture, l'autopartage, c'est l'idée aussi. Donc, il y a quand même des éléments de pratique, même si c'est pas... même si on ne deviendra pas une société entièrement basée sur la frugalité. tel que c'est vu dans le scénario, ça donne quand même des images ou des idées de dire, « Ouais, bon, franchement, c'est vrai que là, on exagère, on pourrait faire autrement, au moins là-dessus. » Donc, c'est quand même pas mal comme exercice. Et moi, j'essaie vraiment de rester un peu réaliste. Pour moi, ma position est la suivante. Il n'y a jamais eu de civilisation dans toute l'histoire de l'humanité où tout le monde était content d'être là où ils étaient. Jamais arrivé. C'est vrai aujourd'hui. Et puis, quand on aura réussi la transition écologique, si on l'a réussi, transition humaine, il y a des gens qui ne seront pas contents non plus et c'est... pas grave. Les malheureux écolos, éco-anxieux d'aujourd'hui qui font des séances de psy, Ils vont être beaucoup mieux dans leur peau, avoir beaucoup plus de bien-être en 2050 si on réussit. Et ceux qui sont super contents dans la consommation d'aujourd'hui, ils ne sont pas contents d'être là plus tard. Ce n'est pas plus grave en fait. L'idée quand même, c'est d'essayer de réduire au maximum les effets négatifs de tout ça sur la population, sur les inégalités, les effets des impacts du changement climatique, de la biodiversité, etc. Tout ça, il faut diminuer autant que possible pour éviter justement des scénarios politiques un peu... un peu à la Mad Max, quoi.
- Florence Gault
Alors, vous êtes également coordinateur scientifique du GIECO, le groupe international d'experts sur les changements de comportement. Il a été créé en 2020 par des scientifiques et des experts du comportement. Tout comme le GIEC met à disposition l'état des connaissances sur le climat, le GIECO a pour objectif de faire la même chose, mais sur les... connaissons sur le facteur humain qui permettront de faciliter les changements de comportement.
- Stéphane La Branche
Oui, c'est exactement ça. L'idée, surtout, je pense, dans les sciences sociales, on a tendance à garder nos résultats pour nous-mêmes. On a une approche beaucoup plus individualiste que les sciences naturelles, quand on publie, par exemple. Et il y avait, pour moi, il y a vraiment un besoin, une nécessité fondamentale de commencer à se parler entre nos disciplines. Alors... Alors, ceci étant dit, sur les questions de transition, la plupart des auteurs-chercheurs que je connais en sciences sociales, dans le sens très élargi de sciences sociales, en sciences des comportements, sont plutôt ouverts à d'autres disciplines. J'ai bossé avec beaucoup d'économistes, par exemple, je bosse avec des gens de management, etc., etc., qui sont aussi curieux de ma discipline. Donc, l'économiste ne va pas commencer à faire des représentations sociales, et le sociologue ne va pas commencer à faire que du lévier-prix, mais peut se dire, quand même, c'est un facteur que je peux tester. par rapport à d'autres facteurs que l'on fait en sciences sociales. Donc, il y a ce partage-là. Ça, c'est super important. Et moi, je pense que les gens qui vont sur les questions de climat et de biodiversité sont des gens qui, d'emblée, par défaut, sont intéressés par d'autres cultures, par une approche un peu plus interdisciplinaire. Donc, il y a ça qui se passe. Et l'idée derrière le GECO, c'est non seulement d'avoir différentes disciplines dans un même rapport, c'est bien, mais éventuellement d'avoir... différentes disciplines dans un seul chapitre sur une thématique spécifique. Et donc, l'aventure du GIECO ressemble beaucoup à l'aventure d'ailleurs des sciences sociales en France. Des sciences des comportements, Jacques Fradin, qui est le créateur, a eu cette idée il y a déjà un peu plus de 20 ans. Ça ne marchait pas. personne ne voyait l'idée pour l'utilité. Moi, j'ai commencé à bosser là-dessus en 2003 jusqu'en 2012. Je passais la moitié de mon temps à expliquer pourquoi un sociologue devait être à la table d'un projet sur le climat. Ensuite, je pouvais parler du projet de recherche que j'avais derrière, donc je perdais beaucoup de temps en fait. Il fallait que je justifie ma présence et mon existence quelque part. Sur les publications, c'était pareil. J'ai été un peu seul pendant un bout de temps. Je ne suis plus du tout. Ça, ça fait plaisir.
- Florence Gault
C'est la bonne nouvelle.
- Stéphane La Branche
Oui. Et depuis, les sciences sociales ont réussi à s'emparer de la question écologique. Il faut dire aussi que les sciences sociales sont un petit peu réticentes. Genre, non, mais c'est de la science. On ne peut rien faire avec ça, nous. Bien, il faut, en fait, aussi. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et le nœud du problème, il est humain. Donc, je suis désolé. Ce qui veut dire aussi que les solutions potentielles sont de l'ordre de l'humain. Ils ne sont pas de l'ordre de demander à des molécules dans l'atmosphère de changer de comportement. Ben non, c'est ridicule ça. Donc, il faut passer par les humains. Et donc, ça a beaucoup changé. En 2018, Jacques relance l'idée. Moi, je sens qu'il y a un tournant dans le vent. Le vent tourne là-dessus, sur la question des sciences des comportements. Je le vois dans des appels d'offres de l'Union européenne, dans les appels d'offres de l'ADEME, etc. Mais encore aujourd'hui... On est souvent, on crée un projet, on prend toutes les sciences qui nous semblent importantes et on se dit « Merde, il manque les sciences sociales » . Et on va chercher ça en dernière roue, ce que je trouve un peu vexant. De moins en moins, mais ça arrive encore. L'autre élément que je vois là-dessus, c'est… C'est le financement. J'ai bossé avec des gens qui étaient dans les technologies de l'énergie et quand on demande un budget à l'ADEME, par exemple, l'ADEME n'accepte même pas un budget en bas de 300 000 parce qu'ils ne veulent pas contractualiser. Mais en sciences sociales, on ne dépasse jamais 30-300 000, on se sent mal de demander autant. Donc, il y a vraiment des inégalités là-dessus et donc parfois, c'est un peu frustrant et il y a la question politique. Pour avoir un soutien politique pour le GIECO, Ils ne savent pas qui on est. Ils ne savent pas si on va pas prendre une position politique. Alors, le GECO ne prend pas de position politique, mais un auteur peut très bien dire « Attention, ces politiques libérales-là ont eu comme effet tatatata. Mais attention, parce que les politiques de Ausha ont complètement occulté la partie politique écologique de toute façon, donc c'est pas mieux non plus. » Eux peuvent dire l'inverse, OK ? Ça, moi, je m'en fous, mais c'est quand même un positionnement politique. Et là, prudence.
- Florence Gault
Puisqu'effectivement, le fait de toucher au comportement des personnes va forcément induire un changement de société. Et donc, c'est forcément un changement de politique au sens étymologique du terme, l'organisation de la vie de la cité.
- Stéphane La Branche
Oui, c'est exactement ça.
- Florence Gault
Et donc, c'est là où effectivement, ça coince et où effectivement, il y a une difficulté à aller chercher ce soutien-là des politiques.
- Stéphane La Branche
Oui. Et puis ça soulève aussi les questions de valeurs profondes, de valeurs politiques, mais de valeurs individualistes, de liberté, de droit à, de pas droit à, d'obligation à, tout ça. Depuis une centaine d'années, on a construit nos sociétés avec un système de « j'ai droit à, mais je suis aussi en contraint à » . Il y a tout ce système d'échange entre individus et entre l'individu et le groupe, qu'il soit organisé ou pas. Mais l'entrée du climat dans tout ça, de la transition écologique, fait que les règles de ce que je dois et ce qu'on me doit, ce que je dois faire, ce à quoi j'ai droit, sont en train d'évoluer. Et donc, ça va chercher quand même des choses assez profondes sur, justement, comment je vis en société, sur ce que je pense être un acquis. La télé, c'est considéré comme un bien fondamental dans la plupart des pays occidentaux. Ce qui est un peu ridicule quand on y pense, mais quand même. Et donc, tout ça fait qu'à un moment donné, ça peut coincer. Et donc, une partie pour moi des sciences des comportements, c'est justement cette tentative d'expliquer les différents facteurs qui vont jouer un rôle en matière de subjectivité, de contraintes quotidiennes, de pratiques, mais aussi on vit dans un contexte... qui est en partie objectif, dans le sens que j'ai un tram qui passe juste devant chez moi, il y a la route, je ne peux pas le transformer en jardin de ville. OK, bon. Mais s'il y a beaucoup de tram et qu'il y a des pistes cyclables, ça me facilite beaucoup la vie pour ne pas prendre la voiture. Même si je peux prendre ma voiture quand même. Et donc, il y a tout ça qui vient en interaction. C'est pour ça que j'adore les sciences des comportements, les sciences sociales humaines. C'est tellement plus complexe que des molécules dans la haute atmosphère.
- Florence Gault
Donc, Le GECO a pour objectif de pouvoir condenser tout l'état de nos connaissances justement sur ce fameux facteur humain. Vous allez dans les prochains jours sortir le premier volume du rapport. L'objectif, c'est vraiment qu'on fasse le parallèle avec le rapport du GIEC et donc d'avoir de manière régulière comme ça un rapport. Comment va s'organiser ce rapport ? On sait qu'il y a nos fameux trois volets pour le GIEC. Un, sur l'état des connaissances scientifiques. Deux, sur la manière dont on va s'adapter face aux dérèglements climatiques.
- Stéphane La Branche
Avant, c'était impact. C'est devenu adaptation. Très intéressant.
- Florence Gault
En troisième, le volet sur la manière dont on atténue nos émissions de gaz à effet de serre. Vous suivez un peu ce même schéma-là, avec évidemment une autre approche, j'imagine, mais comment est-ce que ça s'est articulé ?
- Stéphane La Branche
Pour notre premier rapport, on voulait dans le premier volume avoir des chapitres assez disciplinaires, en fait. Simplement parce que, déjà, faire comprendre ce que les études de communication, du management, de la psychologie fait, c'était déjà quand même pas mal sur des enjeux de transition. On a beaucoup insisté. dans notre appel à publication pour ne pas avoir les auteurs qui bossent sur la mobilité et qui nous expliquent la mobilité. En fait, la mobilité, on s'en fout un peu. Ce qui est important, ce sont les facteurs derrière la mobilité qui font qu'on va privilégier certains modes ou pas. Donc, c'est quoi ces facteurs-là ? C'est là-dessus qu'on veut se concentrer. Et donc, ça, c'est le premier volume qui est en… en maintenant en train d'être mis en page, faire sexy, attractif, etc., etc., avec des images et tout, qui devraient sortir fin avril, début mai. Donc ça, c'est prévu. Moi, j'ai terminé l'introduction, ce qui était assez facile. Et c'est moi qui rédige le chapitre final transversal. Qu'est-ce qui ressort des différents chapitres en termes de conclusions communes entre des disciplines qui ne se parlent pas nécessairement ?
- Florence Gault
Alors, dans les disciplines, qu'est-ce qu'on a, par exemple ?
- Stéphane La Branche
On a la psychologie. On a une approche un peu sociopolitique qu'on appelle les interventions, c'est-à-dire les modes d'accompagnement et de mesures pour amener à des changements qui font une nomenclature et ensuite disent, attention, ce type-là, par exemple, qui est ciblé, l'information ciblée à l'individu, en fait, ça n'a pas d'effet. sur les grands comportements, mais ça peut avoir un effet sur la représentation sociale, sur le niveau de compréhension de curiosité, etc. Des mesures qui sont à grande échelle, justement l'urbanisme ou des politiques publiques, ne vont pas avoir un effet très fort sur la représentation sociale, mais on va avoir un effet un peu plus macro. Mais éventuellement, ça donne un cadre dans lequel on existe et qui va faire qu'on va finir par avoir des choix qui vont être différents. Ce qu'on appelle une architecture de choix. Vous êtes un enfant, tu as choisi entre une banane, une orange et une pomme. Il n'y a pas de dessert dedans. Il y a une architecture de choix, on n'a pas mis le dessert. Voilà. En fait, notre société fonctionne, toutes les sociétés fonctionnent comme ça. Ça fait partie normale de n'importe quelle société, de n'importe quelle civilisation. Et donc, dans la transition, quels sont ces nouveaux... critères de choix qu'on va avoir au quotidien justement sur ces questions-là. Donc ça, c'est le premier, dont un qui est en psychologie sur l'éco-anxiété, tout d'abord sur le rôle des émotions en général et ensuite l'éco-anxiété. Est-ce que c'est un moteur de changement ou pas ? Je vous donne la réponse tout de suite. Ah oui, si, si,
- Florence Gault
je peux,
- Stéphane La Branche
je peux. Je vous dirais, merde, ça dépend des conditions.
- Florence Gault
C'est une fausse réponse, en fait.
- Stéphane La Branche
Oui. En fait, il y a des hypothèses qui ressortent. On n'a pas de réponse dure là-dessus. Et ça, j'ai insisté dans l'appel à publication et dans toutes les lectures des chapitres que j'ai faites. C'était de dire, dites-le qu'on n'est pas sûr d'un truc et dites-le pourquoi. Et quand on n'est pas sûr, donnez des réponses potentielles et partielles. Au moins pour donner des pistes. Donc, il y a un élément qui ressort très fortement. Face à l'éco-anxiété, à une angoisse, on peut être soit bloqué, soit on peut avoir envie de bouger. Un des deux. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux ? Donc, un premier élément, et ça c'est du transversal, c'est que la pédagogie et la psychologie infantile en matière d'environnement montrent que des contacts directs, sensibles avec le corps, avec le goût, les carottes qu'on mange, etc., à l'enfance, est un facteur important qui peut expliquer pourquoi à l'âge adulte, on a envie de protéger l'environnement et qu'on s'y intéresse. Donc, ce n'est pas des cahiers. des pages dans un manuel de SVT qui fait la fête, c'est le fait de grimper dans un arbre, des choses comme ça. Donc ça, c'est un premier élément, un contact à la nature qui donne une sensibilité, non pas un intérêt cognitif, d'abord une sensibilité à la nature. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle en anglais « self-efficacy » , la perception que j'ai, moi, de ma capacité à agir. Un. Deux, de ma capacité à avoir un effet sur le réel. C'est deux choses. Si en tant qu'individu, je me sens obligé d'avoir un effet sur le réel comme manière, moteur, motivation pour agir, je suis désolé, mais en matière d'environnement, on ne voit pas trop l'effet de ce que je peux faire. Moi, c'est la fin de la branche, ni personne d'autre. C'est un effort collectif. C'est des petites bulles qui vont finir par faire un lac, voir un océan. Mais si on se regarde en tant que bulle, en fait, ça ne change rien, donc je ne change pas. D'autres personnes pensent que le simple fait d'agir, donc ma capacité à agir, Agir tout court me suffit. Et ça, c'est les motivations intrinsèques. Donc, je suspecte, et ça, il commence à avoir des effets aussi, pas des effets, mais des études qui le montrent, je pense qu'une grosse partie des écolos sont des gens qui fonctionnent sur les motivations intrinsèques. On a un peu l'impression de se battre contre un peu comme Don Quichotte, contre les Moulins, mais ça suffit, ça. Moi, ça veut dire que je fais moins partie du problème qu'autrement. Il y a un peu de ça.
- Florence Gault
C'est quoi qu'il se passe, au moins, j'aurai agi et ça, c'est quelque chose qui est moteur.
- Stéphane La Branche
Oui, c'est ça. Suffisamment pour que je puisse continuer à avancer, même quand ça paraît un peu perdu.
- Florence Gault
Car j'aurai l'impression d'avoir au moins fait ma part et c'est là où, très régulièrement, dans les interviews, dans les témoignages que je peux recueillir, ça, ça ressort énormément.
- Stéphane La Branche
Oui, ça ne m'étonne pas, en fait. Je pense que c'est assez typique des écolos. Des écolos pendant le sens de Parti vert. Les gens qui sont impliqués dans la transition qui tentent de faire des choses. Il y a un troisième élément que j'ai moins vu souvent, mais je me demande si ça ne joue pas un rôle, c'est la question du perfectionnisme. Si je ne suis pas parfait, ou qu'il n'y a pas une solution parfaite qui va résoudre tout le problème d'un seul coup, Ce n'est pas bon, ce qui est un bel échappatoire quand même. Mais si je me dis non, toutes les solutions sont partielles et imparfaites, mais c'est mieux que rien du tout, c'est déjà un petit gain. Mieux vaut un gain de 3 % que même si on voulait 40. Mais le 3 %, c'est quand même 3 % mieux qu'avant. Bon, peut-être qu'on peut faire mieux que 3, mais 40 %, c'est peut-être trop. Donc, on joue aussi avec ça. Donc, il y a tous ces effets-là. Mais je pense que ces deux questions de la... perception à agir, de notre propre capacité à agir, liée à des motivations intrinsèques ou extrinsèques, et cette question d'avoir eu un contact à la nature avec l'enfance, c'est deux gros critères qui peuvent expliquer ça, en fait. Pourquoi certaines personnes, sous l'angoisse, bloquent, et d'autres se disent, non, il faut que j'agisse. En tout cas, ce que la psychologie nous dit, c'est que face à une angoisse, le simple fait de faire quelque chose diminue l'angoisse, même si ça ne résout pas le problème.
- Florence Gault
Est-ce que dans ce que vous avez donc pu compiler dans ce rapport, dans ce premier volume, est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes ou des choses que vous avez approfondies où vous vous dites, tiens ça jusque-là, on ne l'avait pas formalisé à ce point-là ?
- Stéphane La Branche
Oui, il y a une chose qui a été rendue beaucoup plus claire pour moi. J'ai toujours été critique de l'homo economicus. L'homo economicus, c'est la figure au centre des théories d'économique qui dit qu'on est des humains avares, rationnels dans le sens qu'on veut tout pour nous et qu'on veut faire le maximum de cash possible. Sauf que vous parlez à un psy ou à un sociologue, il va dire « Oui, on veut faire du cash, mais il n'y a pas que ça dans la vie non plus. » Parce que si on voulait que du cash, on ne fera pas d'enfant. Déjà. Ça coûte trop cher. Bon. Et donc, si on avait vraiment cette optique-là. Et donc, bizarrement, je l'ai lu, c'est un des chapitres que j'ai lu en dernier. Il critique beaucoup cette figure de l'homo oculmicus dans les entreprises pour dire, mais en fait, il y a d'autres figures qui existent, il y a d'autres types de chefs d'entreprise qui existent, qui pensent que l'entreprise est un acteur contributif, un acteur contributif au territoire, que ça peut apporter quelque chose au territoire, autre chose que des jobs, autre chose que des salaires. et ça existe donc Pourquoi se focaliser là-dessus quand il y a autre chose ? C'est un peu ce que je disais sur l'ouverture des possibles. Et quand j'ai réfléchi, cet homo economicus revient dans un autre chapitre sur la pauvreté. Et comment en fait les pauvres rentrent en relation avec la transition. Et en fait, c'est un gros problème parce que dans les pays pauvres, on leur promet un développement qui va ressembler au nôtre. On leur promet un style de vie qui ressemble au nôtre et qui est entièrement pas compatible avec ce qu'il faut faire. Donc, en leur vendant un rêve basé sur la consommation, en fait, on les piège. On les piège même profondément. Et ça, la figure de l'homo economicus est derrière ça aussi. Le progrès économique, pour le progrès économique, le restant va suivre. Il faut. On peut être très riche et malheureux. Voilà. Donc, ça, c'est une autre chose. Et l'homo economicus émerge aussi dans les questions d'innovation au sein des entreprises. Si on a une approche très financière, profit d'une entreprise, en fait ça induit un paquet de trucs sur les contrats que je signe, les clients que je veux, les fournisseurs avec qui je vais bosser, sur les méthodes d'évaluation de performance de l'entreprise, et j'en passe. Et donc cet homo economicus-là qui, dans mes premières lectures, a émergé de manière très très forte dans un seul chapitre. Et quand on relit ces trois autres chapitres-là, on se dit mais en fait ça c'est au cœur de l'analyse des autres. Ils font que le mentionner ici et là, mais en sourdine, en secondaire. Et donc ça pour moi ça a beaucoup confirmé ce que je croyais de l'homo economicus, ce que j'avais compris, mais a poussé ma idée à le comprendre dans des domaines que je n'avais pas vus avant en fait.
- Florence Gault
Et à l'inverse ? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, alors ça finalement ça ne ressort pas, alors je pensais qu'il y aurait peut-être quelque chose à creuser, où finalement vous vous êtes rendu compte que ça n'entrait pas en ligne de compte dans le facteur humain ?
- Stéphane La Branche
Ce n'est pas une surprise pour moi, mais ça va peut-être être une surprise pour ceux qui écoutent. Tous les chapitres sont d'accord pour dire que la rationalité et la cognition c'est bien bon, mais... Ça n'explique pas grand-chose, en fait. Ça explique en partie, et pas tant que ça. Derrière, il y a des moteurs. La cognition n'est pas un moteur, en fait. C'est un outil, ce qui n'est pas pareil. Donc, les émotions, mais le rôle des émotions, là... À part même les incertitudes que je viens d'expliquer sur l'anxiété, l'éco-anxiété et tout, le rôle des émotions, on est loin d'avoir compris pourquoi telle émotion peut amener à des changements. Toutes les études qui montrent que les émotions ont des effets, ont d'autres études qui montrent que la même émotion qui est censée avoir un effet positif dans la première, va avoir un effet négatif dans l'autre. Donc, il y a autre chose qui se passe. Donc, les émotions aussi, pour moi, une partie de la réponse, mais ça c'est de l'incertitude. Une partie de la réponse réside dans l'échelle macro. C'est-à-dire que vous et moi, on peut avoir exactement la même émotion face à quelque chose et ne pas réagir de la même manière. C'est de la socialisation, c'est parce qu'on vit sur un territoire différent, on vit quoi. Et donc pour moi, il y a en partie une explication psychologique et individualiste là-dessus, mais je pense que pour expliquer pourquoi certains vont dans une direction ou dans une autre, pourquoi on est bloqué ou pas sur le rôle des émotions, etc. C'est autre chose. Mais il y a certainement une émotion qui n'apparaît pas, malheureusement, dans la plupart des textes. Et c'est un truc sur lequel, avec Dominique Bourg, on a discuté aussi quelques fois. On parle de la peur, on parle de l'anxiété et l'amour de la nature. Les émotions positives à l'égard du vivant, on en a aussi. C'est pas la chose la plus importante dans notre civilisation, mais n'empêche que ça existe. Et quand on gratouille derrière les écolos, On arrive toujours à ça, quoi qu'il arrive. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'analyse pas autant ? Je ne sais pas. Pour moi, je pense que c'est un moteur très très fort.
- Florence Gault
Donc notre rapport sensible au vivant, dans l'émotion qui va se créer avec la nature, et qui d'ailleurs se joue beaucoup dans l'enfance, c'est ce que dit le philosophe Jean-Philippe Pierron dans son livre « Je éteins nous » . Et c'est pour ça qu'il invite à relire sa vie au travers de l'écobiographie. Quels sont nos liens aux vivants suffisamment marquants pour construire notre identité aujourd'hui ? Jean-Philippe Pierron, qu'on a reçu dans le podcast et qui nous a permis de créer avec Audrey Ranchin un arbre cabane studio d'enregistrement dans lequel on invite les gens à venir nous laisser leur témoignage de souvenirs à la nature. Et donc ces récits, on les diffuse dans le cadre du podcast pour essayer de reconstruire une mémoire collective autour de nos liens aux vivants. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose à aller creuser dans cette direction pour permettre aux gens de prendre conscience. Parce que si nous prenons conscience de notre lien à ce qui nous entoure, on peut avoir davantage l'envie d'aller la protéger.
- Stéphane La Branche
Alors, moi, j'entends toujours les mots « prendre conscience » avec beaucoup de méfiance. Parce que souvent, on est d'accord tous les deux, je sais comment tu l'as utilisé, mais pour être sûr que tout le monde comprenne, le GIEC va utiliser exactement les mêmes mots pour dire, prenez conscience de la catastrophe. Oui, mais la manière dont il parle de conscience, c'est connaître, comprendre rationnellement et cognitivement. Et je suis désolé, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne en termes d'avoir des impacts sur le changement. Si on veut dire prendre conscience, peut-être qu'il faudrait changer de terme, prendre sensibilité ou je ne sais pas trop quoi. Là, oui. Là, oui.
- Florence Gault
OK. Intéressant de voir, en tout cas, que ça passe par le sensible. Et que, enlever le côté sensible du facteur humain, on va rater quelque chose. On laisserait quelque chose de côté, en tout cas.
- Stéphane La Branche
Oui, mais s'il y a une différence entre nous et les animaux, certains animaux sont capables de symbolisme, c'est qu'on est des animaux symboliques, nous. On travaille, on fonctionne, on opère au quotidien avec des symboles. On se nourrit des symboles, on est des créateurs de symboles quotidiens. Et si on laisse tomber ce symbolisme qui est entièrement subjectif et collectif à la fois, on passe à côté d'un des moteurs fondamentaux de l'être humain. Donc pour moi, c'est un des avantages des sciences des comportements, c'est qu'on a des outils pour aborder la subjectivité. Et c'est là que le nœud du problème, il est. C'est là aussi que la complexité, elle est. parce que la subjectivité est plus difficile à prévoir, à planifier, à modéliser, etc. Mais n'empêche que, c'est là où on est le plus fort. Pour moi, c'est là qu'on a le plus grand apport. On peut faire aussi le nombre de voitures qui se promènent, le pourcentage de population qui blablabla. OK, mais pourquoi ? Dès qu'on commence à poser la question pourquoi un comportement, il faut rentrer dans la subjectivité. Parce que sinon, je donne un exemple, mais vraiment anecdotique a priori, c'est que quand en 2008, 2009, 2010, je faisais des études sur la mobilité à l'époque, je regardais ce que d'autres études avaient montré en termes d'enquête de mobilité et tout. Et on voyait que les statistiques d'usage du vélo augmentaient. Conclusion des chercheurs, c'était que... Les valeurs environnementales et écologiques augmentaient. Ma question a été, vous lui avez demandé pourquoi il faisait du vélo ? Parce que moi je fais du vélo, je suis un maniaque du climat, mais je ne le fais pas pour le climat, je le fais parce que j'aime ça. Pas besoin d'aller plus loin. Et quand on a commencé à poser la question « Pourquoi faites-vous du vélo ? » , on voyait bien que l'environnement était très loin dans les motivations, c'était à autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut rentrer dans la motivation. Ça a une implication super importante, ça. C'est que si vous prenez, et ça j'aime bien titiller les écolos, les verts en particulier là-dessus, c'est qu'ils présument trop souvent que tout le monde a la même idée que sur le monde, sur la nature. Et donc ils parlent nature. Oui, mais ça ne me dit pas comment devenir végétarien, moi. Je suis désolé, vous parlez entre vous. Donc, comme les techniciens et ingénieurs, kilowattheure, énergie, et quand ils parlent de kilowattheure, ils vont parler à 3 % de la population, parce qu'il n'y a personne qui comprend ce qu'est un kilowattheure. Donc, ça, c'est super important. Donc, faire amener à la lumière du jour de la compréhension cette dimension subjective de l'humanité avec tous ses facteurs. acteurs, etc. dedans, ça nous aide à mieux accompagner aussi. Il y a un vrai, vrai, vrai enjeu pratico-pratique derrière ça, en fait. C'est pas juste de l'esbrouf ou du pétage de nuages, comme on dit au Québec.
- Florence Gault
Stéphane Labranche, on a donc dressé un peu l'état des lieux, abordé en faisant la synthèse du futur rapport du GECO qui va prochainement sortir. Quelles sont du coup les solutions ? On est ici dans un podcast qui est tourné vers les solutions qui peuvent mettre en mouvement. Si on essaie un peu de résumer, ce seraient quoi les grandes directions, les grands facteurs ? de mise en mouvement pour finalement permettre aux gens d'agir ?
- Stéphane La Branche
Le premier, c'est de réduire l'effort cognitif que ça prend. Pour moi, ça, c'est… On arrête de réfléchir. Et pour ça, en fait, l'architecture, le design, l'architecture de choix, le type de choix que l'on donne… Franchement, carrément sous-exploité et sous-développé. Juste une anecdote qui montre bien comment ça marche. Quand on a eu le COVID, et qu'on rentrait dans les pharmacies, dans les lieux publics, on mettait au-devant, on a mis durant les premiers mois, le gel hydroalcoolique à côté de la porte en entrant. Il n'y a personne qui l'utilisait. Mais on ne voulait pas gêner l'entrée. Ça n'a pas été compliqué, on n'a pas émis une loi, vous étiez obligés de le faire. Non, très rapidement, on a compris que si on mettait le gel hydroalcoolique directement dans le milieu et que ça gênait, Les gens l'utilisaient. C'est le même choix. C'est exactement la même chose. C'est la même chose pour comment on organise une cuisine, comment on organise les appareils électroménagers. Le fait de faire une rénovation énergétique du bâtiment ne change rien aux comportements qui sont dedans, mais ça réduit beaucoup l'énergie consommée aussi. Donc, il y a des choses qu'on sait, ça on le sait, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées. qui vise à réduire les efforts cognitifs. Donc, à chaque fois qu'une entreprise, une collectivité territoriale me demande « qu'est-ce qu'on peut faire ? » , la première chose que je dis, c'est « vous réduisez l'effort cognitif que ça prend pour faire le changement chez les personnes que vous voulez changer. » En revanche, si vous êtes à l'initiative du changement, attendez-vous à avoir beaucoup plus de charge cognitive parce que vous prenez cette charge cognitive supplémentaire sur vos épaules pendant un certain temps, jusqu'à ce que les nouveaux comportements deviennent automatiques. Quand ils sont automatiques, il n'y a plus de charge cognitive. Mais ça, ça prend un temps. Non, il faut l'assumer. Si vous n'êtes pas capable, ne faites-le pas. Ou allez vous chercher un allié. Soyez deux plutôt qu'un, trois plutôt que deux. Et là, ça fonctionne. Deuxième chose, arrêtez de parler de climat pour changer les comportements. Ça ne marche pas. Et arrêtez de parler du rapport du GIEC. Ça ne marche pas non plus. Ça me saoule. Ce qui va fonctionner, c'est que vous voulez... Convainque vos amis de manger moins de viande. Vous pouvez leur donner un livre au complet sur les méfaits de la viande. Écologique, santé, économique, biodiversité, misère des producteurs, blablabla. Ou vous pouvez leur faire un bon bout végétarien et vous leur donner la recette après. Je suis désolé, ça va mieux fonctionner. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut imaginer des co-bénéfices. Sans même devoir mentionner l'environnement, on le fait pour améliorer le niveau de compréhension, mais il faut imaginer des co-bénéfices pour chaque effort demandé, des récompenses qui ne sont pas financièrement, ça peut être autre chose, c'est pas le problème, on va être beau à la plage l'été parce qu'on a fait plus d'exercices pendant l'hiver, une connerie pareille. Mais l'idée là-dedans, c'est justement de développer des co-bénéfices, mais des co-bénéfices qui sont structurés pour aller dans le sens de l'être ancien. Et ça, on commence à savoir comment faire sur certains domaines et sur d'autres, on n'est pas bon.
- Florence Gault
En fait, c'est faire vivre une expérience aux gens positive, qui apporte des émotions agréables, qui vont dans le sens de la transition. Mais c'est difficile de trouver effectivement la bonne expérience. J'y avais beaucoup pensé, notamment en réfléchissant à ce podcast, à ce que je voulais faire avec En un battement d'ailes. J'avais été très marquée au moment du Covid, justement, parce que nous avions vécu une expérience commune, alors à l'échelle de la planète, particulièrement donc chez nous, et nous avions vécu finalement l'actualité, c'était imposé, l'information pensée par les médias. avait été vécu par un grand nombre de la population. Et donc, ma réflexion, c'était justement, effectivement, de me dire, mais comment on peut faire vivre une expérience aux gens dans l'information ? Moi, dans mon rôle en tant que journaliste et en tant que média, comment faire vivre cette expérience aux gens pour les amener ? À prendre conscience, à prendre sensibilité, puisqu'on l'évoquait un peu plus tôt. Mais ça, c'est extrêmement difficile. Comment, au travers d'un journal, d'un journal télévisé, d'un podcast, comment faire vivre cette expérience pour aider à prendre conscience, à prendre sensibilité ? Je vais utiliser l'expression désormais.
- Stéphane La Branche
Je te dirais, ça, c'est un truc qui a émergé des sciences sociales aussi. Les sciences des comportements, c'est l'exemplarité. L'exemplarité, on pense toujours, ben, lui montre l'exemple, et donc ça donne envie. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est beaucoup plus subtil. Celui qui a réussi à atteindre son objectif de transition, par exemple, a réussi aussi à résoudre certains problèmes. Par défaut. Ça s'est pas fait tout seul. Impossible. Des problèmes techniques, financiers, de gestion, de management, de gouvernance, de machin, de truc, et... De soi-même aussi. Mais lui a réussi ou elle a réussi. Et cette personne-là, quand elle parle, est capable de parler de la manière qu'elle a résolu les problèmes. Ce qui fait que ça fait gagner beaucoup de temps aux autres. Et en plus, les autres se disent, « Ah ouais, donc en fait, elle aussi a eu les mêmes problèmes que moi. » Et ça, c'était sa solution. Il y a une reconnaissance.
- Florence Gault
C'est l'apprentissage vicarian.
- Stéphane La Branche
Oui. OK. Et ça, ça a vraiment un effet. L'autre chose, c'est qu'il y a une forme de légitimité. Il y a une chose qui est apparue assez clairement, c'est que vous ne pouvez pas prendre, je suis désolé, mais un ingénieur agronome d'une grande institution nationale pour dire à un producteur de carottes comment faire pousser ses carottes. Parce qu'il va se faire recevoir un coup de fourche. Mais si vous prenez un producteur de carottes, qui a fait une transition vers autre chose, et que lui parle à un autre producteur de carottes qui se pose des questions, c'est pas pareil. Même si le message fondamental est le même, c'est pas reçu de la même manière. Ça c'est une chose qui émerge très fortement d'un chapitre aussi qu'on a dans le rapport sur la communication. La communication c'est autant celui qui entend que celui qui l'émet. Et en plus, il y a de la signification, du signifiant qui est produit dans cet échange. Et donc, justement, le signifiant qui est produit entre l'ingénieur agronome d'une grande institution comme le CNRS qui parle d'un producteur de carottes, c'est un coup de fourche. Il n'y a pas de connexion là. Il n'y a pas la légitimité pour la personne qui entend. Mais le voisin, lui, qui a fait ça, oui. Et donc ça, c'est super important. Et on le voit en fait avec des villes qui sont très innovantes en matière de transition, dire oui, on a eu ce problème-là en matière de mobilité, où il n'y a pas assez de coups pour, blablabla, voici comment on trouve maintenant des solutions. Et donc, ça permet aux autres d'avancer plus vite aussi, ça c'est super important. Donc, l'exemplarité, c'est de la légitimité de celui qui parle, c'est le partage d'expérience, mais pas juste d'expérience positive. C'est quand je fais des conférences où il y a du partage d'expérience, j'essaye d'insister auprès des organisateurs pour dire aux gens qui partagent leur expérience, Donnez-nous trois problèmes que vous avez rencontrés, des obstacles, des trucs chiants pas possibles et comment vous les avez résolus. Ça, ça va intéresser les gens et ça va leur donner des outils pour résoudre le problème quand ils vont le rencontrer. Vous réduisez la charge cognitive.
- Florence Gault
Donc, on revient sur qu'est-ce qui le met au mouvement. Un, arrêtez de réfléchir. Deux, passez par le sensible.
- Stéphane La Branche
Oui.
- Florence Gault
Trois.
- Stéphane La Branche
alléger la charge cognitive de toutes les manières possibles. Il ne faut pas arrêter de réfléchir. Il faut arrêter de penser que la cognition et la réflexion mènent à du changement. Ça nous donne des outils pour nous dire comment changer dans la direction qu'on désire, subjectivité, émotion, changer. Là, oui. Sans les rapports du GIEC, on aurait fait quoi ? On aurait fait de la diversification énergétique avec du charbon. On ne fait plus de diversification énergétique avec du charbon parce qu'on sait qu'il ne faut pas le faire. Donc, je ne dis pas que la cognition n'a, et la rationalité, la donnée scientifique n'a pas d'impact, mais ce n'est pas un moteur de changement, ça nous donne une méthode par laquelle on peut mettre en œuvre des outils. qui, eux, proviennent d'un désir d'aller dans une direction ou pas. Avec tous les obstacles, les freins, les machins, les trucs et les contradictions que nous avons tous en tant qu'humains.
- Florence Gault
En tout cas, ce qui ressort là, en tout cas, de ce que vous dites, c'est que finalement, le déclic écologique tel qu'on peut beaucoup l'entendre, c'est une idée qui est assez populaire, finalement, n'existe pas. C'est un peu un mythe d'avoir un... L'illumination et l'ampoule qui s'allument.
- Stéphane La Branche
Je ne crois tellement pas. Oui, bon, pour une minorité de la population, je ne dis pas. Mais là, on a besoin d'un changement collectif et de civilisation. Et donc, le déclic écologique, en fait, pour moi, il y a même un piège plus profond que ça. C'est que tant que vous allez continuer à faire ça, vous allez augmenter vos chances d'avoir du climato-scepticisme. Vous allez avoir une contre-réaction. Donc, arrêtez d'en parler. Alors, il faut continuer d'en parler pour expliquer pourquoi on fait certaines choses, mais pas avec l'idée de base que ça amène à des changements. C'est autre chose qui va amener à des changements. La couleur que le changement va prendre, sa direction, son ampleur, etc., est grandement influencée maintenant par l'écologie. On ne peut pas dire que ça n'existe pas, parce qu'on fait des choses maintenant en 2025. On ne pensait même pas les faire en 2005. On ne peut même pas imaginer le faire. Donc oui, la cognition est nécessaire, mais ce n'est pas un moteur de changement de comportement ni de civilisation.
- Florence Gault
On parle aussi beaucoup de sobriété, souvent comme d'un effort, d'une contrainte. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de récit autour de cette notion, alors que pourtant ça pourrait être perçu comme synonyme de qualité de vie, voire de bien-être ?
- Stéphane La Branche
Ouais. La sobriété bienheureuse dont on parle, simplicité volontaire qu'on appelle au Québec. Le problème avec la sobriété, c'est que c'est vraiment interprété de manière négative par beaucoup. C'est du serment de ceinture, c'est du foutage de gueule, c'est la faute des Chinois, des entreprises. Ce sont tous des citations. Mais, Je pense qu'il y a aussi matière à améliorer notre sobriété sans trop devenir serrage de sonniture non plus. On consomme trop de trucs dont on n'a pas besoin ou qu'on pourrait partager facilement aussi, et sans que ça change quoi que ce soit à nos vies. Mais on a quand même cette idée-là qu'on a tous droit en bâtiment collectif à notre lave-linge, notre sèche-nivelle. Sauf qu'en fait, non, c'est comme la voiture. La voiture, à 90 % de son temps, ne bouge pas. Pourquoi pas faire d'autopartage plus ? Ça marche très bien, Citiz, d'ailleurs, grâce à ça. C'est pas du covoiturage. Le covoiturage, ça veut dire partager mon temps perso en voiture avec quelqu'un d'autre qui va peut-être me saouler ou va être en retard. L'autopartage, c'est ma bulle, mais je la partage avec d'autres, la bulle, mais pas en même temps. Ça, ça marche.
- Florence Gault
Au-delà des politiques publiques, on a pu l'évoquer, il y a des initiatives locales qui émergent partout, les monnaies locales, pour prendre certains exemples, des coopératives. Les circuits courts, c'est vraiment des exemples donnés au hasard. Est-ce que ces expérimentations peuvent être justement des modèles ? Et est-ce que ça peut alimenter l'imaginaire autour de ce qui peut se passer ensuite ? Et est-ce que ça, le fait de montrer ces expérimentations, de montrer ces exemples, peut être source de changement ou en tout cas alimenter l'envie d'avancer ?
- Stéphane La Branche
Complètement. J'aurais bien ta question plutôt aussi sur... Ton rôle en tant que journaliste, ça c'est un rôle que tu peux avoir. C'est-à-dire qu'il y a des villages quasi autonomes qui existent, qui ont des modèles de société ou collectivités un peu différents, avec même un compte en banque commun et des banques... Non, il y a des projets, mais ça on n'en entend pas parler. C'est bien pour eux, mais il n'y a pas d'exemplarité derrière. L'exemplarité nécessite nécessairement qu'on en parle. qui a une transmission de l'information quelque part, parce que sinon, il n'y a pas d'exemplarité. Ça existe, c'est bien, c'est alternatif, mais so what ? Et donc, ça, c'est un rôle que tu as, et ça, pour moi, c'est important. Parce que ça veut dire, il y a des gens, bon, ça fait un peu hippie comme machin, mais ils ont l'air heureux quand même. Peut-être que oui. En tout cas, ils ont pris une partie de leur destin en main, comme nous, on ne l'a pas fait, parce qu'ils ont décidé de construire un projet. un peu alternative de société avec des règles un peu différentes, etc. mais avec un partage de territoire, etc. Et franchement, ils ne sont pas plus mal. Ah bon ? Ben OK, pourquoi pas essayer ou en tout cas dire au moins donner un espace spécifique, même dans le droit, pour faciliter ce type d'alternative qui finalement fonctionne bien. Donc, pour moi, oui, absolument. Toutes ces expérimentations sociales sont super importantes et on doit en parler. Mais je vais même te renvoyer à un argument plus général. Dans un écosystème, plus un écosystème est diversifié, donc on parle de biodiversité, puis plus il est résilient au changement. Pourquoi ? Parce que si vous avez 10 espèces d'insectes puis il y en a 2 qui morfent parce qu'il y a un hiver, bien il y en a 8 autres. Si vous n'en avez que 2 puis il y en a des 2 qui meurent, il reste 50 %. Donc, plus un système est diversifié, plus il est résilient. C'est vrai pour les sociétés humaines aussi, j'en suis convaincu. Plus on a de la diversité au sein d'une société, plus on a des sources d'idées différentes, plus on a des imaginaires différents et plus on a des expérimentations différentes qui montrent que c'est possible. Si on n'avait pas eu Paris, Grenoble et Lyon entre 2005 et 2012 ou 2015, pour montrer qu'en fait il y avait des paquets d'alternatives à un paquet de secteurs. et qui était possible et qui avait un effet réel, on aurait fait quoi ? On aurait attendu la COP15 de Paris pour faire des trucs ? Alors, on est foutus si on fait ça. Ben non, on a mis en place des plans climat en 2012 parce qu'il y avait eu des villes qui avaient tenté d'expérimenter avec des trucs, qui avaient compris des choses et qui pouvaient être transformées en loi après ou en préconisation ou en partage de bonnes pratiques, des choses comme ça. Donc, pour moi, ça, c'est important. Il faut effectivement le faire. Encore une fois, c'est une question d'ouverture des imaginaires. Ouvrir les chakras, comme on dit. Je n'aime pas comme... Mais ça le dit bien quand même.
- Florence Gault
L'ouverture du champ des possibles.
- Stéphane La Branche
Voilà.
- Florence Gault
Si l'on vous demandait une seule mesure applicable dès demain qui pourrait avoir un impact significatif sur les comportements et sur la transition écologique, ça serait quoi ?
- Stéphane La Branche
Ouh là là ! Sur les comportements ?
- Florence Gault
Oui.
- Stéphane La Branche
Le plus important, ce serait de s'attaquer à l'alimentation. Il faut avancer rapidement sur les comportements. Pour moi, la rénovation énergétique, ce n'est pas un comportement, c'est une décision collective. Ensuite, on ne change pas de comportement si on ne veut pas à l'intérieur. Voilà, ça a eu des effets. L'alimentation, changer l'alimentation, c'est un changement de comportement. Ça veut dire aller acheter dans des magasins différents, dans des boutiques différentes, des produits différents, cuisiner différemment, apprendre à cuisiner différemment. Donc, c'est une charge cognitive qui est assez lourde, en fait. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais en termes d'impact sur l'environnement, moins on va manger de viande, mieux ça va être pour notre santé aussi. Mais mieux ça va l'être pour le climat, pour la biodiversité, pour la santé de l'eau, pour les... Voilà, voilà.
- Florence Gault
Les sols, etc.
- Stéphane La Branche
Oui, tout ça. Et donc là, c'est là-dessus qu'il est là, pour le dire franchement, on n'est pas très bons. dans les sciences des comportements sur cette question-là. Les sciences des comportements, notamment la psychologie, très fortes sur les problèmes d'anorexie et de boulimie, donc liés à l'alimentation. Il y a des centaines, voire des milliers d'articles publiés dans le monde là-dessus. Mais quand on regarde la place de l'alimentation dans la transition écologique, ou la... On le bat bon. Et là, il faudrait le faire. Donc, ça, si on pouvait mettre en œuvre un paquet de politiques publiques qui irait dans le bon sens, pas nécessairement obligatoire, mais on commence à en avoir. Tous les repas de mon gamin à la crèche sont bio, tous. Les desserts sont bio, tout est bio. C'est marqué dessus, tous les repas, toutes les semaines. Et d'avoir dans les cantines collectives, restaurants, dans les entreprises, etc., plus de menus végétariens, plus de beaux végétariens, avec une condition, il faut que ce soit bon à manger. Parce que quand je suis arrivé en France en 2000, j'étais végétarien, mais au bout de 7 ans, j'ai abandonné. Parce que ce n'était pas bon, c'était juste... Pas bon. Mais là, depuis environ cinq ans, les chefs s'y mettent. Et on le voit quand on fait un petit goûter ou on fait de la bouffe après une conférence. Franchement, ça n'a rien à voir. Là, les gens disent « Putain, c'est bon ça, c'est quoi ? » « C'est végétarien. » « Oh, mais c'est pas grave, c'est bon. » Voilà, là, on a compris.
- Florence Gault
Pour finir, Stéphane, vous qui analysez, justement, depuis des années, les dynamiques de changement, est-ce que vous avez des raisons d'être optimiste ? Qu'est-ce qui vous donne aujourd'hui l'impression que quelque chose est en train de bouger ?
- Stéphane La Branche
Oh là là ! Alors ça, c'est un peu spécial comme question parce que quand on regarde les projections, sciences naturelles, des impacts du changement climatique et de la biodiversité, la température, elle n'est pas très bonne. Mais quand je regarde le processus d'apprentissage depuis 15 ans en France, et dans d'autres pays. Sur les politiques publiques, les mesures, les accompagnements, on fait encore des erreurs. On a encore besoin de s'améliorer sur certains endroits, de vraiment ouvrir des champs. Mais franchement, on est moins cons qu'on l'était. Vraiment. Il y a eu un vrai, vrai effet d'apprentissage. Le retour d'expérience a été réel dans pas mal de domaines, notamment sur les questions de mobilité. Donc, on peut apprendre et on peut apprendre assez rapidement plus. Est-ce que c'est assez rapide pour régler le problème ? Non, je n'ai pas dit ça. Mais franchement, on n'est pas là où on était il y a seulement 15 ans. Donc avec tout ce qu'on sait sur la dépendance au sentier, l'inertie depuis une centaine d'années de civilisation d'énergie fossile, franchement... Ça, c'est plutôt positif, je devrais dire. C'est un peu étonnant. Même si on s'en va vers du plus 3 degrés et qu'on commence à parler d'un plus 4, même dans les ministères, de manière officielle, là, on se dit, oulala, ça, ça va être dur. Et donc, ça, c'est un petit peu catastrophique et pas juste catastrophiste. Et donc, là, voilà, je suis à la fois optimiste et pessimiste, quoi.
- Florence Gault
Vous voyez qu'il y a quand même du changement et qu'il y a des choses qui se passent, mais sans doute peut-être pas. pas suffisant encore pour pouvoir se projeter dans un futur.
- Stéphane La Branche
Sauf que si on va trop vite, on augmente les oppositions. Et donc moi, j'ai une question posée à pas mal d'écolos qui veulent amener leur gouvernement en cours pour dire est-ce suffisant ce climat ? S'il gagne ? certains tribunaux peuvent imposer à leur gouvernement d'aller beaucoup plus vite. En allant plus vite, vous allez augmenter les oppositions de la population. C'est automatique. Parce qu'ils sont pas prêts, parce qu'ils pensent pas que c'est important, ou pas important pour être... etc. Et donc, si on le fait trop vite, on va faire beaucoup d'erreurs qui vont être très contre-productives. Donc, il faut faire gaffe. Il faut quand même le faire intelligemment. Et là, c'est une question de course contre le temps, en fait. L'équilibre, on est limitant. On est vraiment limité.
- Florence Gault
Merci beaucoup, Stéphane, pour cet échange passionnant.
- Stéphane La Branche
Merci à toi.