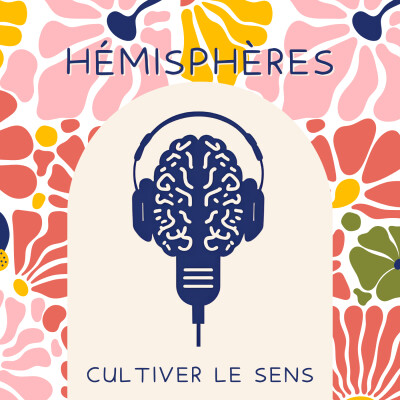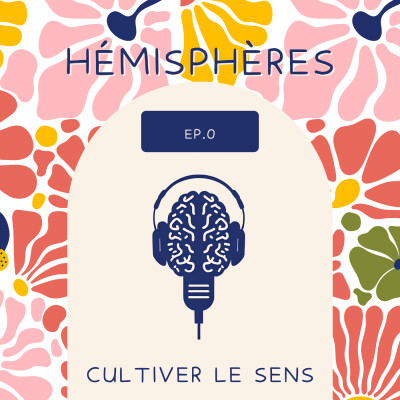Speaker #0Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Hémisphère. Je m'appelle Camille, je suis spécialisée en sciences de l'éducation, en psychologie de l'adolescent, en orthopédagogie, en neurosciences et en psychopédagogie. Un parcours issu de mon master M.E.V., de formations diverses et bien sûr de mes expériences de terrain. Aujourd'hui, à travers mon entreprise Hémisphère, ma page Instagram et désormais ce podcast, j'accompagne les ados et leurs familles avec une approche à la fois globale, bienveillante et profondément engagée. Mon objectif, m'adapter aux besoins de chacun pour les aider à s'épanouir. Ce qui m'anime, c'est d'aider les jeunes à se reconnecter à leurs apprentissages, à reprendre confiance en eux et à avancer malgré les obstacles ou les blessures du passé. Parallèlement, c'est tout aussi important pour moi d'offrir aux familles un espace d'apaisement, car selon moi, l'adolescence, malgré ses remous, peut aussi être une belle période de transformation et de dialogue. Ce podcast s'adresse donc à tous ceux que ces sujets touchent de près ou de loin, parents, enseignants ou tout simplement les curieux des enjeux liés à l'adolescence et l'école. Aujourd'hui, on va aborder une grande question à la fois complexe et essentielle. L'école peut-elle réduire les inégalités sociales ? Spoiler alert, la réponse n'est ni blanche ni noire. Mais pour y voir clair, on va plonger dans les théories, les faits, les dispositifs et quelques idées concrètes pour agir à notre échelle. Pour cela, je vous propose donc un petit cheminement qui va s'articuler en quatre temps. D'abord, on verra comment l'école peut parfois, malgré elle, reproduire les inégalités sociales. Ensuite, on va s'intéresser aux dispositifs déjà mis en place pour tenter de les corriger. Puis on explorera les pratiques pédagogiques qui peuvent transformer la classe au quotidien. Et enfin, je vous partagerai des conseils concrets, en particulier pour les parents. Comme le sujet est dense, très dense même, je dirais, j'ai préféré ne pas tout vous livrer d'un seul coup, ne pas vous assommer. Donc ce premier épisode va se concentrer sur les deux premières parties. Et puis, on va se retrouver dimanche prochain pour la suite, avec les fameuses pistes concrètes, les pratiques de terrain, les leviers à activer dans les classes, mais aussi à la maison. L'idée, c'est de prendre le temps. sans vous assommer, tout en allant au fond du sujet et en restant aussi clair et précis que possible. Mais trêve de bavardage, il est temps d'entrer dans le vif du sujet, préparer votre café, votre thé, régler l'autoradio pour m'écouter pendant votre trajet, sortir le linge de la machine ou continuer ce que vous étiez en train de faire, je ne veux rien savoir, ça ne me regarde absolument pas. En tout cas, restez curieux, attentifs, vœux, et surtout laissez-vous la possibilité d'ouvrir une ou deux portes intérieures, peut-être que certaines de vos certitudes seront bousculées, et c'est tant mieux. Pour commencer, je vous propose de déconstruire un my, bien ancré dans la société française, celui d'une école qui serait par essence juste et méritocratique. Et oui, l'école républicaine française repose sur un idéal, celui de la méritocratie. Qu'est-ce que la méritocratie ? En gros, si tu travailles dur, tu réussis, peu importe d'où tu viens. Mais est-ce vraiment le cas dans la pratique ? Vous allez voir que c'est souvent bien plus compliqué. Pour vous expliquer cela, il me semblait pertinent de vous parler un peu de sociologie. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est la sociologie et je vais me baser sur les propos récents d'une sociologue chercheuse au CNRS, Solène Brun, qui dit que la sociologie pose des constats, pas une science qui dicte des normes. La sociologie, en fait, elle prend une photo à l'instant T de la société, elle cherche à la décrire et analyser la manière dont en grande partie les inégalités fonctionnent. Et de fait, la sociologie démontre, explique qu'il existe des gens qui sont assignés à des positions minoritaires et qui, parce qu'ils sont assignés à ces positions minoritaires, vont avoir des trajectoires de vie différentes des personnes qui ne sont pas assignées à ces positions minoritaires. Donc, ça ne veut pas dire que quand des gens dans votre entourage vous donnent des exemples de 4 ou 5 personnes, ou 10 ou 100 qui ont vécu les choses différemment et qui n'ont pas connu ces expériences difficiles, que ça va remettre en cause les analyses sociologiques. Parce que la sociologie résonne sur des échelles de grandeur qui ne sont pas celles de l'anecdote de vos amis. Les sociologues passent des années à mesurer, à analyser sur des panels de personnes qui sont énormes. Parmi les sociologues, il y a des personnes qui se sont intéressées à la situation de l'école républicaine, notamment Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Ils ont écrit un livre qui s'appelle La reproduction. Et ils ont démontré que l'école valorise un capital culturel propre aux classes sociales dominantes. Ça veut ni plus ni moins dire que les compétences, les références implicites, le langage valorisé à l'école sont ceux que maîtrisent déjà les enfants issus des milieux favorisés. Un exemple concret. Un enfant à qui on lit des livres depuis tout petit, qui entend parler de politique à table ou qui va souvent au musée, va comprendre plus facilement certaines allusions culturelles en cours. Il se sentira à sa place, tandis qu'un autre pourra se sentir étranger à cet univers et se sentir de fait dévalorisé. Et ces écarts de traitement y prennent racine très tôt, dès les premières années de la scolarité. Basile Bernstein a montré que les enfants des classes populaires utilisent un code qu'il appelle le code restreint, un langage plus concret, plus contextuel, alors que l'école, elle, valorise le code. élaboré. Et cela, en fait, ça pose un problème Parce que les exigences ne sont pas les mêmes. Un enfant qui ne comprend pas la consigne ne manque pas d'intelligence, c'est juste qu'il ne décode tout simplement pas les mêmes références. Et cette critique du mérite nous amène à nous interroger plus largement sur l'idéal républicain qui structure aujourd'hui notre école depuis des décennies. François Dubé a largement travaillé sur cette question de l'élitisme républicain. C'est une conception de l'école qui, selon lui, prône l'égalité en théorie, mais qui, en pratique, valorise les plus performants sans se soucier des différences de départ. L'idée selon laquelle, selon lui, tous les élèves sont égaux devient simplement une machine à escure les plus fragiles. Imaginons un élève qui rentre à l'école primaire avec un vocabulaire limité, qui a peu d'habitude de lecture à la maison, qui a certes des parents bienveillants, mais peu familier avec les codes scolaires. Dès le CP, cet élève va suivre exactement le même programme que tous les autres, au même rythme, sans que ses fragilités de départ soient prises en compte. Et très vite, les premières évaluations vont révéler des difficultés. Les résultats vont être en dessous de la moyenne. et l'élève va perdre confiance. L'école valorise surtout la performance académique et la réussite visible, et elle ne va pas toujours proposer des ajustements nécessaires pour combler cet écart. Du coup, l'élève, on va lui mettre l'étiquette du faible, on va peut-être parfois l'orienter vers des dispositifs spécifiques, et il va se retrouver exclu symboliquement du groupe de bons élèves. Avec ce simple constat, on se rend compte que le principe de tous égaux devant l'école, ça devient un leurre, parce que ça masque les inégalités de départ, et faute de les compenser, ça peut même les aggraver. Et c'est cela que dénonce François Dubé, un élitisme républicain qui, sous couvert d'égalité formelle, produit une réelle injustice. Si on creuse encore, on voit qu'il y a un autre malentendu qui persiste dans notre école. On confond encore trop souvent égalité et équité. Égalité, on donne à tout le monde la même chose. Équité, on donne à chacun ce dont il a besoin pour réussir. Vous connaissez tous cette image. Imaginez trois enfants de tailles différentes qui veulent voir au-dessus d'une palissade. Si on leur donne à tous la même caisse pour monter, seul le plus grand verra quelque chose. Eh bien c'est ça l'égalité. Mais si on donne à chacun une caisse adaptée à sa taille pour qu'il puisse voir de l'autre côté, alors on est dans l'équité. Et c'est exactement ce que devrait faire l'école. Il y a une autre étape clé où les écarts se creusent, c'est celle de l'orientation. Je l'avais un tout petit peu évoqué dans un de mes carousels. Il a été montré que là encore, les choix ne sont pas complètement libres. L'orientation scolaire, c'est l'un des lieux où les inégalités sont les plus fortes. Raymond Boudon parlait même de choix réalistes, faits par les familles populaires. Autrement dit, quand un enfant de milieu modeste envisage des études longues, ses parents, par prudence, par peur de l'échec, par manque de moyens financiers, ils vont pousser souvent vers des filières courtes et sûres. C'est ce qu'on appelle un peu l'autocensure sociale. Et en réponse à ça, notre auteur vous disait qu'il fallait réchauffer les ambitions de ces élèves issus de milieux populaires, les autoriser à rêver grand, les accompagner pour qu'ils se sentent capables. Enfin, pour terminer sur cette première partie, impossible de parler d'inégalités à l'école sans aborder celles bien sûr liées au genre, ça serait très mal de me connaître si je n'avais pas abordé ce sujet-là, Marie Durubela a été l'une des premières à mettre en lumière les inégalités entre filles et garçons à l'école. Paradoxalement, les filles réussissent mieux à l'école, mais elles s'auto-limitent davantage dans leur choix d'orientation. Il y a des stéréotypes qui persistent, les garçons vont vers les filières scientifiques, les filles vont aller vers le soin ou l'éducation. J'en suis la preuve vivante. L'école a donc un rôle à jouer pour déconstruire ces modèles-là. L'élitisme républicain perdure parce que justement, vous connaissez tous dans votre entourage cette personne qui va vous raconter l'anecdote de cette femme qui est devenue astronaute, ou l'anecdote de ce garçon issu d'une famille de quartier populaire qui est devenu un grand ingénieur. justement parce qu'il y a des petites anecdotes, des petites exceptions comme ça, l'école va dire, regardez, la méritocratie fonctionne. Mais comme je l'ai dit au début, ce n'est que de l'anecdote. Quand on regarde un panel des pourcentages des enquêtes réelles qui ont été faites, notamment des enquêtes de PISA qui montrent que l'école reproduit les inégalités sociales, on se rend compte qu'en fait, tout cela n'est que de l'anecdote et que l'école doit réellement se remettre en question. Mais heureusement, tout n'est pas figé. On va voir dans cette seconde partie que l'école essaie, parfois avec maladresse certes, parfois avec réussite, de corriger toutes les injustices que je viens de vous évoquer. Nous allons voir maintenant les dispositifs qui existent pour rendre l'école plus juste. Parmi les dispositifs qui ont été mis en place, il y a bien sûr ce que vous connaissez tous certainement, vous en avez déjà entendu parler, anciennement les ZEP, maintenant les REP et REP+, ces réseaux d'éducation prioritaire et éducation prioritaire renforcée, qui visent justement à réduire ces inégalités scolaires en attribuant davantage de moyens humains et financiers à certains établissements, principalement situés dans des zones socialement défavorisées. Donc ça va se traduire par des effectifs allégés dans les classes, des temps de concertation supplémentaires pour les équipes pédagogiques et parfois même des projets pédagogiques spécifiques. Alors certes c'est un pas important vers plus d'équité, toutefois je considère pour ma part que ces efforts sont insuffisants si les pratiques pédagogiques ne sont pas adaptées aux besoins réels des élèves. Par exemple si les méthodes restent centrée sur un modèle transmissif, traditionnel, sans qui... aucune différenciation ni attention portée aux élèves à besoins éducatifs particuliers, aux parcours singuliers. Selon moi, les élèves les plus fragiles peuvent continuer de décrocher. Et en plus, dans ces établissements, il y a quand même un turnover. Si je prends l'exemple du 93, expérience que j'ai connue, nous sommes envoyés là-bas en début de carrière. L'objectif qui est humain et qui est normal pour chaque personne qui est envoyée d'abord en région parisienne, c'est de revenir dans sa région d'origine. Et de fait, les dispositifs qui ont été mis en place ne suffisent pas pour retenir ces enseignants dans la durée. Il y a des conditions de travail qui sont difficiles et du coup, ça limite la continuité pédagogique et l'efficacité à long terme. Autrement dit, les chefs d'établissement changent parce qu'eux aussi sont en début de carrière, les profs changent parce qu'ils sont en début de carrière, tout le monde change. Et donc du coup, les dispositifs qui ont été mis par une certaine équipe s'essoufflent au fur et à mesure que les gens qui tenaient le projet disparaissent. Injecter des ressources ne suffit pas. C'est selon moi le rapport à l'élève, aux apprentissages et à l'évaluation qu'il faut repenser. Et aussi ce système de mutation qui est très particulier dans l'éducation nationale qu'il faut repenser aussi. Pour que l'école puisse vraiment redevenir inclusive et que ce dispositif marche. Depuis la loi de 2005, la scolarisation des élèves en situation de handicap ou ayant des troubles des apprentissages, c'est un droit. Il y a de nombreux dispositifs qui ont été mis en place pour adapter l'école à ses élèves, à savoir les accompagnements des élèves en situation de handicap, les AESH. Il y a aussi des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, les PIAL, les dispositifs ULIS. Il y a aussi les plans individualisés comme le PAP, plan d'accompagnement personnalisé, le PAI, projet d'accueil individualisé, ou le PPRE, programme personnalisé de réussite éducative, que je vous ai décrit aussi dans un carousel qui va sortir dans les prochains jours. pour vous expliquer un peu la différence de chacun d'entre eux. Sur le papier, ces outils, ça montre une vraie volonté d'adaptation, mais leur application reste très inégale selon les établissements et selon les territoires. Il y a un manque de personnel formé, il y a un turnover ou même un manque d'effectifs dans les AESH, qui sont quand même des métiers assez précaires. Il y a un énorme délai administratif dans la mise en œuvre des aménagements. Il y a parfois un manque de concertation avec les familles. On voit ici que l'intention de ce dispositif se heurte à la réalité du terrain. Surtout, certains enseignants qui sont déjà surchargés vivent ces adaptations comme une pression supplémentaire. Il existe aussi, il ne s'en peut pas nier, des enseignants plus réticents qui refusent vraiment de remettre en question leurs pratiques, qui invoquent souvent le principe de la liberté pédagogique, et qui veulent maintenir un système, un cadre d'enseignement qui va être peu inclusif, et qui vont se baser sur ce qu'ils raccurent et ce qu'ils connaissent. Donc on remarque que le manque de formation initiale sur la diversité des profils d'élèves alimentent cette difficulté à vouloir réellement adapter leur posture. S'ils avaient été formés dès le début de leur carrière ou si on leur permettait des formations régulières, ils ne verraient pas ça comme une contrainte. Ce serait beaucoup plus facile pour eux de le mettre en pratique. Et puis derrière tout ça aussi, il y a quand même cette rancœur de la vision qu'ils ont dans la société elle-même. La société véhicule des stéréotypes, les enseignants sont parfois perçus comme des privilégiés ou des feignants. en raison des vacances scolaires, alors que les réalités du métier sont vraiment bien plus complexes. Il peut être compréhensible, je ne cherche pas des excuses, je dis juste que je peux comprendre, que certains enseignants, ils peinent vraiment à s'investir pleinement dans une institution qui les maltraite symboliquement et matériellement. Il y a le manque de reconnaissance, la pression administrative, l'isolement, je disais, au moment du système de mutation, et du coup, la précarité pour certains, parce que ça représente... un budget dans leur vie de faire des allers-retours entre la région où ils ont été mutés et tous les week-ends retourner voir leur famille. Ce système de mutation, ça contraint certains enseignants à passer des années loin de leur famille. Et du coup, ça accentue un peu ce sentiment de solitude, de déconnexion. Parce que quand ils sont dans une région étrangère, quand ils se font des amis, ça va être des amis profs. Donc il va y avoir une espèce d'entre-soi avec des problématiques de profs qui va... parfois aussi nuire à leur ouverture d'esprit et à la remise en question. Il y a un vrai décalage entre la représentation sociale qu'il y a, les attentes institutionnelles et la réalité de terrain. Et ce décalage contribue à fragiliser ce système d'inclusion parce que les profs ne veulent plus faire d'efforts. Je ne dis pas tous, attention, je mets la nuance parce qu'il y a quand même des profs, malgré tout, qui ont cette vocation, qui ont cette passion, j'en ai vu énormément. Mais je peux comprendre que quand ça fait 5, 6 ans que tu es dans une région que tu n'aimes pas, que tu as vu des collègues à toi partir, que tu as vu des chefs d'établissement partir, et donc du coup tu t'es investi dans certains projets qui permettaient l'inclusion, au bout d'un moment je peux comprendre que ta passion s'essouffle. À côté de ces grandes réformes sur l'éducation dite prioritaire ou sur l'école inclusive, il y a aussi des dispositifs plus ponctuels à l'échelle d'établissement. Parmi eux, peut-être que vous connaissez ce dispositif qui s'appelle le dispositif devoir fait. En gros, c'est un accompagnement gratuit des devoirs au collège. Il a été instauré en 2017. Il ne propose ni plus ni moins aux collégiens qu'un temps d'études accompagné pour réaliser leurs devoirs dans l'établissement. Alors, sur le fond, c'est une super idée, parce que parfois, les ados, quand ils rentrent chez eux, leurs parents sont encore au travail et se retrouvent seuls livrés à eux-mêmes face à leur cahier. Mais là, l'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui les accompagne pour faire leurs devoirs dans l'établissement. Et là encore, l'efficacité de ce dispositif, il est encore un peu limité. Même s'il est mis en place de manière uniforme, dans certains établissements, l'encadrement est toujours insuffisant, parce que ce n'est pas toujours des profs qui accompagnent, ou alors ce sont des profs qui ne sont pas forcément toujours bien formés. n'ont pas forcément la volonté de le faire, donc il y a un manque de suivi individualisé. Moi je considère encore, et il y a peut-être des anciens collègues à moi qui vont me dire « Non, non, Camille, tu te trompes, il y a eu une nette amélioration, j'espère en tout cas. » Moi je considère qu'il y a encore une sous-expositation de ce programme. Je ne suis pas convaincue que tous les collégiens, particulièrement ceux en grande difficulté, aient vraiment la possibilité d'en bénéficier. parfois il y a un manque de place parce que je l'ai dit il y a un manque de tuteur Parmi les dispositifs qui ont été également mis en place, c'est ce qu'on appelle les stages de remise à niveau pendant les vacances. Ces stages de remise à niveau, qui sont organisés pendant les vacances scolaires, ont été construits pour permettre aux élèves de consolider leurs acquis et de rattraper leur retard. Là encore, bien qu'ils puissent être bénéfiques pour certains, ils ont selon moi quelques limites. Déjà, tous les élèves ne sont pas systématiquement inclus dans ces dispositifs, ce qui fait qu'une partie des élèves en difficulté y échappe. Et d'autre part, une fois de plus, la qualité des stages dépend énormément de l'implication des enseignants et de la personnalisation des contenus. Si le stage est mal organisé, mal structuré, trop généraliste, il ne va pas permettre de traiter les besoins de chaque élève. Ça va rester un soutien temporaire, mais ça va être insuffisant pour changer vraiment leurs résultats scolaires. Si on continue à s'intéresser aux dispositifs qui ont pour vocation à réduire les inégalités, il y a ce qu'on appelle les internats d'excellence qui ont été lancés en 2010 dans le cadre du... du plan Espoir Bon Lieu. Et eux, ils avaient pour objectif d'offrir aux élèves issus des quartiers prioritaires un cadre pédagogique renforcé. Ça peut offrir une véritable chance aux élèves motivés, mais ils sont très sélectifs. Donc c'est là où ça relève de ce que je vous disais tout à l'heure, de l'anecdote, parce que les places sont limitées et il y a des critères de sélection qui sont très rigides. Ça coûte très cher. Il y a les frais d'inscription, il y a les frais de déplacement, ce qui empêche souvent les familles les plus modestes d'y inscrire leur enfant. Vous l'aurez compris, vu qu'ils peuvent accueillir qu'un nombre restreint d'élèves, comme je le disais, ça relève de l'anecdotique et ça laisse de côté une grande partie des jeunes qui pourraient vraiment bénéficier d'un tel dispositif. Du même genre, il existe aussi ce qu'on appelle les cordées de la réussite, une façon d'ouvrir les portes de l'enseignement supérieur. Ça, c'était pour vraiment répondre aux inégalités liées à l'orientation. Ce dispositif a été lancé en 2008. et ils visent à accompagner les élèves de milieux modestes vers l'enseignement supérieur. Il a été renforcé il n'y a pas longtemps, en 2020, pour proposer un accompagnement continu depuis la quatrième. Mais une fois de plus, ça reste très inégal. Parce qu'une fois de plus, ça dépend de l'implication des établissements partenaires et puis surtout de l'engagement des élèves. Parce que certains élèves, même si on les encourage du mieux qu'on peut, même si on les accompagne, ils peuvent rencontrer des obstacles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de modèle de réussite similaire autour d'eux, dans leur entourage. Puis il y a toujours ces problèmes de difficultés socio-économiques. Et de plus, la mise en œuvre de ces cordées de la réussite, ça dépend vraiment des partenariats locaux et la capacité des établissements à intégrer ces dispositifs dans leur quotidien. Donc il y a une vraie disparité selon les zones géographiques, les établissements, avec des établissements qui sont plus impliqués que d'autres, et certains lycées qui... dont ni les ressources humaines ni la volonté de participer activement. Et puis dernièrement, plus récemment, il y a eu une nouvelle approche territoriale qui a émergé. Je dirais que c'est ma préférée parce qu'elle répond directement à ma citation. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ce sont les cités éducatives, un dispositif qui fait travailler différents acteurs ensemble, les écoles, les associations, les collectivités, pour créer un territoire apprenant autour de l'élève. Ces cités éducatives englobent divers projets, ça va du soutien scolaire aux activités culturelles, sportives et citoyennes. Ce projet-là a vraiment pour objectif de renforcer la coopération entre les acteurs locaux, dans le but d'accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire et éducatif. L'idée principale, c'est de ne plus isoler l'école et de travailler en réseau. Cette idée, comme je vous l'ai dit, c'est ma préférée, parce qu'elle, pour moi, me paraît prometteuse, mais sa mise en œuvre reste complexe et inégale parce qu'elle demande une coordination. et une capacité à des acteurs différents de pouvoir travailler ensemble. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on ne fait pas le même travail, c'est parfois difficile de se mettre à la place de l'autre, d'écouter l'autre, bien que notre objectif soit commun. Révoir dans une entreprise comment on a du mal à faire travailler des adultes ensemble, imaginez quand c'est différentes institutions, entreprises, associations qui doivent réussir à se coordonner. Ça nécessite vraiment une forte volonté politique et une coordination efficace. Sans compter, bien sûr, comme à chaque fois, l'importance d'avoir des ressources financières et humaines. Donc voilà, dans cette seconde partie, je vous ai donc montré tous les dispositifs qui traduisent cette volonté quand même de l'éducation nationale et des ministres qui se sont succédés de vouloir répondre à cette problématique que l'école reproduit les inégalités sociales. Tous ces dispositifs sont utiles, on ne va pas cracher dessus, mais ils ne suffisent pas à eux seuls à combler les écarts. Parce que le véritable levier, toujours selon moi, il joue ailleurs, dans le quotidien de la classe, dans les interactions, les regards, les phrases qui peuvent être dites par les professeurs, par les éducateurs, les méthodes pédagogiques, les attentes qu'on formule. Dans ces petits gestes ordinaires qui, mine de rien, peuvent donner confiance, ouvrir l'horizon des possibles, réchauffer les ambitions. On arrive donc à la fin de cette première partie de notre podcast consacrée aux inégalités à l'école. On entend souvent dans des débats sur ce sujet que l'école, c'est ce grand pilier républicain qui garantit l'égalité des chances. Ce lieu où chaque enfant, quel que soit son point de départ, peut espérer trouver sa voie, apprendre, grandir, s'élever à condition qu'il se mette au travail. Et cette idée, elle est belle, elle est forte, mais quand on regarde de près, on l'a vu, à travers les mécanismes parfois invisibles qui freinent certains parcours, ou les tentatives institutionnelles pour corriger le tir, on mesure à quel point cette promesse, elle reste fragile. Et c'est là qu'on va commencer la suite de notre réflexion, parce qu'au-delà des politiques publiques, il y a... tout ce qui joue dans la pratique, comme je l'ai dit, sur le terrain, dans les salles de classe et autour. Donc dans le prochain épisode, on va parler de ces pédagogies qui peuvent faire évoluer les choses, de ces façons d'enseigner, d'accompagner, de faire le lien qui peut réellement redonner sur le terrain du pouvoir d'agir aux professionnels de l'éducation. Et je vous proposerai aussi des pistes concrètes, notamment pour les parents, au sein du cocon familial, pour mieux soutenir, motiver, donner un peu plus d'ambition. aux jeunes qui sont directement victimes de ces formes d'inégalités. Donc je vous dis rendez-vous dimanche prochain pour la suite. D'ici là, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast si vous pensez qu'il peut intéresser un de vos proches. Et surtout, prenez soin de vous et des adolescents qui vous entourent.