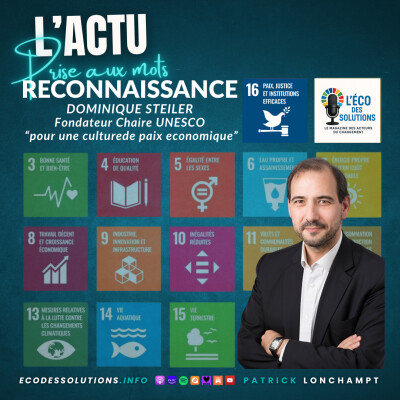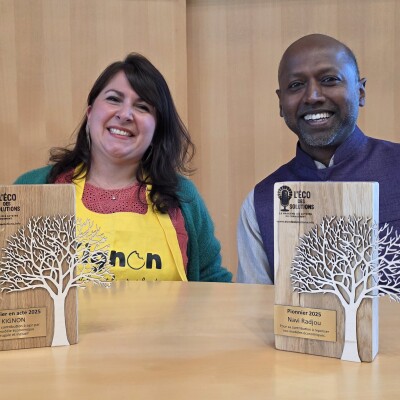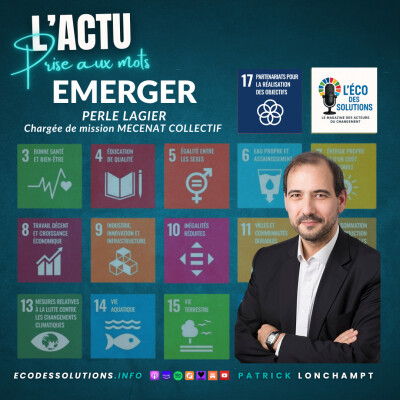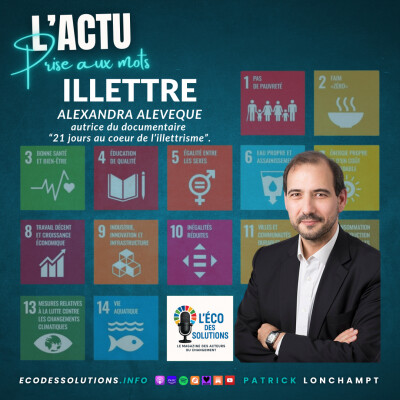- Speaker #0
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actu prise au mot, je suis Patrick Lonchamp et chaque semaine je vous emmène découvrir un mot qui fait l'actualité. Avec mes invités, nous passerons de la réflexion à l'action pour comprendre, décrypter l'enjeu de ce mot dans notre société contemporaine. L'actu prise au mot, c'est le podcast des mots qui font l'actu. Bienvenue à vous et bonne découverte. Et cette semaine, reconnaissance. Un mot que nous utilisons tous les jours mais dont nous mesurons rarement la profondeur reconnaissance, ce n'est pas seulement dire merci, du latin reconnectere, c'est reprendre connaissance, c'est affirmer à l'autre, je te vois, tu existes, tu comptes. Et cette semaine, nous sommes marqués par deux fois ce mot de reconnaissance. Tout d'abord la reconnaissance de la Palestine par la France au sommet des Etats à l'ONU et puis aussi la reconnaissance des actions menées depuis 10 ans maintenant par les acteurs du développement durable puisque ce 25 septembre, nous fêtons aussi le 10e anniversaire de l'agenda 2030 qui a reconnu il y a 10 ans 17 objectifs pour atteindre une planète plus soutenable à l'horizon 2030. Alors ce mot reconnaissance n'est pas un mot neutre puisqu'on réclame de la reconnaissance un peu partout, au travail, dans la rue, en politique. On reproche son absence souvent dans les écoles, dans les entreprises, jusque dans nos vies de couple. Bref, c'est peut-être la grande soif contemporaine, être vu, être entendu, être pris au sérieux. Je ne parle pas bien évidemment que des influenceurs qui nous empêchent de dormir lorsqu'on scrolle. Alors pourquoi cette soif ? Eh bien parce que notre époque produit de l'invisibilité à la chaîne. Invisibles sont les salariés, les précaires, les aidants familiaux. Invisibles sont les jeunes décrocheurs,
- Speaker #1
invisibles aussi.
- Speaker #0
sont ceux qui au quotidien font des efforts pour réduire leurs empreintes écologiques, efforts qui ne trouvent d'ailleurs que rarement valorisation. Et quand la reconnaissance manque, c'est tout le ciment social qui se fissure. Les philosophes comme Paul Ricoeur ou Axel Honnête l'avaient vu, la reconnaissance c'est la condition de la dignité, c'est ce qui permet à chacun, à chaque individu ou à chaque peuple d'exister pleinement. Et dans un monde saturé d'écrans, de chiffres et de discours, la reconnaissance. devient une sorte de boussole, elle dit ce qui compte vraiment. Et cette semaine, vous le comprenez, ce mot prend donc toute sa dimension géopolitique, géo-économique, géo-sociale. Et la France a choisi de reconnaître officiellement l'état de Palestine. Un geste qui ne règle pas tout, certes, mais qui rappelle une évidence. Il n'y a pas de paix sans reconnaissance, pas de coexistence sans ce premier pas qui consiste à dire « je te vois, tu existes, tu comptes » .
- Speaker #1
Cette actualité,
- Speaker #0
je le disais tout au début, résonne aussi avec l'anniversaire des 10 ans de l'agenda 2000 France de l'ONU. Et dans ces 17 objectifs du développement durable, il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement cette semaine. C'est l'ODD16, consacré à la paix, à la justice et aux institutions solides. Vous comprenez, on nous le dit clairement, sans reconnaissance mutuelle, pas de gouvernance efficace, pas de stabilité et pas de futur commun. Alors comment transformer la reconnaissance en levier de paix ? Comment éviter qu'elle ne reste Un geste symbolique, un mot creux. Peut-on en faire une force transformatrice dans nos vies, dans nos entreprises, dans nos relations internationales ? C'est ce qu'on va voir avec notre invité d'aujourd'hui, Dominique Steyler,
- Speaker #1
fondateur de Pax Economica, engagé depuis longtemps,
- Speaker #0
fondateur de la chaire UNESCO Économie de la Paix. Avec lui, on va évoquer comment cette culture de la paix peut s'insérer dans une culture économique. Il est notre invité d'aujourd'hui. Bonjour Dominique Steyler.
- Speaker #2
Bonjour.
- Speaker #0
Et j'ai oublié de préciser que vous étiez aussi docteur en management et psychologie,
- Speaker #1
ce qui nous permet de faire un tour d'horizon complet de cette question autour de l'ODD16,
- Speaker #0
comment bâtir une culture de la paix en lien avec l'ODD16. Allez, on commence, bienvenue dans l'actu prise au mot.
- Speaker #1
Le 22 septembre dernier, le président de la République Emmanuel Macron a reconnu au nom de la France, devant les chefs d'État rassemblés à l'ONU, en Assemblée Générale, la reconnaissance de la Palestine comme un État. L'ont suivi quelques autres États de référence, dont certains sont aussi autour de la table du Conseil de Sécurité. Et la reconnaissance aussi, c'est celle de cet anniversaire des 10 ans de l'agenda 2030. L'ODD 16 vise à la... La paix à l'institution solide, est-ce que ce type de reconnaissance diplomatique peut vraiment devenir un levier de paix Dominique Steyler ?
- Speaker #2
Wow, c'est une sacrée question. Et on a 10 minutes. Je crois qu'une des difficultés, c'est quand on évoque la paix, en tout cas dans le monde occidental, on évoque un but à atteindre. C'est-à-dire quelque chose qui serait absolu, réussi, qui fonctionne bien, etc. Et là, on a une difficulté. C'est pour ça que nous, la chaire UNESCO, on a fini par l'appeler culture de paix, parce que culture nous laisse un espace, nous laisse un écart dans lequel on va pouvoir travailler des choses. pour aller avec une intention de tendre vers quelque chose qui serait de l'ordre d'une paix. Je pourrais même aller plus loin, vers quelque chose qui serait de l'ordre d'une paix dont on accepte qu'elle se construit à l'intérieur même du chaos de la vie et des hoquets de la vie. Et là, dans tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, on a l'impression que la reconnaissance, à mon avis, donc le mot entre parenthèses, beaucoup trop tardive, que la reconnaissance serait en soi un gage de nous amener à une paix quelconque. Si je ne dis pas de bêtises parce que ce n'est pas mon domaine, mais en droit international, la reconnaissance est déclarative et pas constitutive. Donc tout le monde, tout État peut dire aujourd'hui je reconnais, sur le papier ça ne change rien du tout, surtout s'il ne se passe rien après. Alors déjà, quand je dis tardif, je ne parle pas de discrimination quelconque, ni vers le peuple juif, ni vers le monde musulman, je parle du sacré de la vie et des gens qui meurent. Et Tardif, pour moi, il est là. C'est un peu simple, à la fin d'un match, quand tout est joué, de venir dire « Ah ben non, c'était pas très bien. Tu n'aurais pas fait une porte comme ça. » Et ça, je trouve ça un peu difficile. Sur le fond, bien entendu que la reconnaissance va avoir un rôle qui est fondamental, y compris en termes de rôle pacificateur. Puisque être reconnu va permettre de réduire des logiques de rivalité, puisque j'existe d'une certaine manière. La difficulté, c'est que... Donc en soi... reconnaître un État de Palestine, c'est lui donner une chance d'être sur un pied d'égalité pour pouvoir discuter la paix. Ce qui, jusque-là, depuis la création d'Israël, n'a pas existé.
- Speaker #1
Et est-ce que ce n'est pas aussi, parce que vous disiez très justement que la reconnaissance était un déclaratif, au demeurant, quand une majorité d'États à travers la planète, à l'ONU, reconnaissent un État, ça ouvre aussi un certain nombre de droits. Droits à la reconnaissance, par exemple, comme certains. Certains commentateurs aiment aujourd'hui à le dire ou à le faire dire dans les médias l'ouverture à la reconnaissance d'un génocide, par exemple. Aujourd'hui, on en parle, mais il n'y a pas de reconnaissance. Il y a peut-être des crimes de guerre de la part d'Israël, comme il y a eu des crimes de terrorisme de la part du Hamas envers Israël. Mais ça ouvre aussi un certain nombre de droits, de droits économiques, de droits d'exploitation qu'aujourd'hui, la Palestine ne pouvait pas avoir.
- Speaker #2
Oui, c'est vrai. C'est vrai, et ça c'est vraiment la bonne chose, d'un point de vue diplomatique et de ce que ça peut ouvrir, c'est vraiment la bonne chose. Maintenant, je pourrais encore rajouter quelque chose à mon propos de tout à l'heure, c'est que finalement, pour que cette reconnaissance vaille jusqu'au bout, il va donc falloir qu'on passe du déclaratif au constitutif, ça c'est une première chose, mais il va falloir aussi, si vraiment on veut, qu'un parcours de paix se mette en place entre les deux États, et plus entre un État et un peuple. Alors il va falloir qu'il y ait une reconnaissance mutuelle. Sans reconnaissance mutuelle, l'ensemble des pays de la planète pourront dire que la Palestine n'existe pas. Ça sera difficile de faire entrer Israël, Israéliens et Palestiniens autour d'une paix s'il n'y a pas de reconnaissance mutuelle. Si vous n'existez pas, je ne peux pas vous reconnaître et je vais avoir du mal à faire avec vous la paix. Donc là, il va y avoir un énorme travail et je pense que dans l'ODD16, il y a tout un ensemble d'étapes qui peuvent permettre d'aller vers ça. d'étape. concrètes, la première étant bien entendu la dimension de l'urgence, la dimension de la priorité, sur comment on réduit la violence, puisque la priorité elle est à cet endroit-là, et une fois qu'on aura réduit la violence, on va pouvoir se servir des suites, des objectifs qu'on trouve dans cet ODD pour penser à la construction, mais je pense vraiment que le premier préalable c'était la reconnaissance, le second ça sera d'aller tout doucement vers une reconnaissance mutuelle, sinon on aura beaucoup de mal, et bien entendu que de façon classique, dans un conflit, Et à plus forte raison, dans un conflit comme ça international, avant d'en arriver à la reconnaissance mutuelle, il va encore se passer un petit peu de temps.
- Speaker #1
Alors comment justement, quels seraient pour vous les leviers pour passer de... On parle beaucoup, et au travers de la chaire UNESCO, parler de culture et d'économie de la paix. Comment est-ce qu'on peut passer justement de cette économie de confrontation, de cette culture de confrontation, à une économie de réconciliation ? Vous avez aussi, Dominique Steyer, des compétences de management et de psychologie. Comment est-ce qu'on peut arriver finalement à faire ce que l'Europe a réussi à faire fin des années 40-50, alors qu'il y avait eu un État, un fou, Hitler, qui avait dévasté la totalité de l'Europe ?
- Speaker #2
Oui, l'Europe a réussi à le faire, malheureusement, parce qu'elle a vécu un drame avant. Et pour moi, c'est un des aspects un peu désespérants du regard sur l'humanité, d'avoir l'impression qu'on est totalement inapte à la construction préventive et qu'à un moment donné, quand on met en place un système, il a tendance à fonctionner un petit temps, ensuite il se dégrade petit à petit jusqu'au clash suivant. Sur cette question de la culture de paix économique, ça fait quand même depuis 2008 qu'on y travaille, nous. Ça fait seulement depuis le début de la guerre en Ukraine qu'on arrête de se moquer de ces travaux quand on annonce que le modèle économique ultra-libéral tel qu'il est en place conduit à la guerre. Et si je ne le ramène pas à nous, je vais mettre trois périodes différentes. Entre 1910 et 1913, un économiste belge, M. Henri Lambert, qui était aussi un patron d'une verrerie industrielle, a écrit un livre qui sera publié qu'en 1919. Ce livre s'appelait « Pax Economica » . Que disait M. Lambert ? Il disait depuis la fin du 19e siècle, les ultra-riches dominent le monde. Et cette condition qu'on continue de voir comme étant très favorable parce qu'il y a de la croissance, moi, chercheur, je commence à la voir comme défavorable. Si on continue comme ça, on va à la guerre. Il n'a pas pu publier son livre, personne n'en voulait, mais il l'a publié en 1919. En 1935, un économiste français, M. Henri Heuser, qui lui était un spécialiste des droits de douane, a écrit un autre livre qui lui ne s'appelait plus... Pax Economica, mais qui s'appelait La Paix Économique. Dans son livre, M. Heuser dit, attention, je suis un économiste spécialiste des droits de douane, d'ailleurs, ça serait intéressant aujourd'hui, c'est dommage qu'il ne soit plus avec nous. Parce que lui, dans son livre, ce qu'il fait valoir, c'est de dire, il commence à y avoir danger et les droits de douane seraient encore un moyen de maintenir un équilibre entre les nations et de ne pas les amener au conflit. Si vous me suivez, il y en a un qui est en train de faire l'exact opposé. Mais ce monsieur, dans son livre, dit, attention, on a une crise économique, on a un taux chômage important on a une forte immigration européenne et les Européens basculent au populisme, si on continue, on va à la guerre. Et nous, on est au même endroit dans ce qu'on avance.
- Speaker #1
Dominique, attention de ne pas trop taper sur ton bureau avec tes mains, parce qu'on entend les chocs. En effet, ce n'est pas très encourageant ce que vous nous dites, Dominique Steyler, parce que si on prend 1919-1935... avec deux auteurs qui ont publié des ouvrages. Seriez-vous le loiseau de mauvaise augure, Dominique Serre, puisque vous écrivez sur la paix économique maintenant ? Est-ce que vous nous annoncez une guerre future qui semble pointer ? On parlait de paix économique avec vous. On a plutôt des États européens et des États mondiaux aujourd'hui qui construisent plutôt une économie de guerre.
- Speaker #2
Écoutez, quand j'ai écrit ce livre « Osons la paix économique » en 2017, ça a été mon premier désespoir. de voir ces deux ouvrages là et vous dire mince je suis en train d'en écrire un troisième les périodes et les écarts sont à peu près les mêmes à quelque chose près on va dire un bon an mal an au pouillet me près et je suis en train de redire la même chose c'est à dire dire attention je suis un chercheur qui depuis des années cumulent des données les humains ont du mal à la prévention le modèle ultra libéral est en train de dégrader les choses si on continue on va à la guerre et Et mon inquiétude, elle est clairement là. Et malheureusement... Et ce n'est pas cynique du tout. Malheureusement, depuis 2022 et le début de la guerre en Ukraine, alors qu'il y a des guerres partout sur la planète, mais celle-ci, elle est plus proche de nous. Depuis 2022, ça semble moins rigoler quand on annonce nous, attention, ce modèle-là nous emmène à la guerre. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui est d'une forme de pessimisme que je vais appeler de contexte, parce que la raison pour laquelle on travaille nous sur la culture de paix économique, c'est un optimisme fondamental sur la nature humaine et sa capacité collaborative. Maintenant, on sait aussi, et ça répondra en partie à un bout de la question de tout à l'heure, que pour que cette nature humaine collaborative soit effective, alors il nous faut tout au long de la vie une éducation à la culture de paix. Et nous, dans notre modèle économico-politique, nous sommes depuis 250 ans dans une culture de guerre, dans une culture d'hyper-compétition, d'hyper-financiarisation, d'hyper-exploitation, d'hyper-globalisation, d'hyper-consommation. c'est-à-dire tout ce qui... à la fin dégrade et enfin on est en train de s'en rendre compte, encore une fois malheureusement un peu tard. Et quand je dis qu'il faut travailler sur une question de culture, le gros mot qui est derrière c'est quel paradigme, sous quel paradigme on vit ? Alors pour faire vite c'est quoi un paradigme ? C'est simplement ce qu'un groupe humain constitue pour se faire une représentation commune du monde et plus facilement vivre ensemble. Le nôtre, il semble dire, l'homme est agressif par nature, donc il faut absolument qu'à chaque fois que je mène une action, je la mène pour mon intérêt bien compris. C'est-à-dire... l'impression qu'on est tous devenus des homo economicus. Et là, on a un challenge gigantesque, c'est que tant qu'on n'acceptera pas de faire bouger et de switcher de cette culture globale hégémonique... économico-politique ultra-libérale qui dit « je vaux parce que je suis seul en haut de la pyramide » , alors que ce qu'on dit, nous, c'est « la vie est interconnection par nature » , donc « je vaux parce que je suis en lien, en relation avec l'autre » , alors on aura du mal à s'en sortir. Mais ça, ça demande un effort que quelques pays ont réussi à différents endroits.
- Speaker #1
C'est ce que j'allais vous demander. Quelles sont vos sources d'espérance ? Qu'est-ce qui nous permet de regarder aujourd'hui des pays qui évoluent dans cette dynamique ? et qui pourraient être, quelque part, nos formateurs pour pouvoir transformer nos sociétés.
- Speaker #2
Alors, je vais prendre plusieurs sources espérantes. Je vais les citer comme ça, j'y reviendrai. Si vous voulez, Bérénité, en même temps que je parle, je vais parler de la Finlande et de son système éducatif. Je vais parler du sport, je vais parler des autres cultures et je vais parler de certains exemples en entreprise. Si je parle de la Finlande, dans les années 60, la Finlande se dit, notre modèle éducatif n'est pas fonctionnel. ils dégradent, ils ne permettent pas à nos enfants de devenir des enfants épanouis. Comment on peut changer les choses ? Ils vont décider dans les années 60 de transformer leur modèle éducatif en créant un Education Act qui est très court et qui dit « Nous voulons faire de nos enfants des enfants épanouis pour qu'ils puissent un jour devenir des adultes responsables. » Ça, c'est l'engagement des années 60. Pendant 30 ans, la Finlande a été mal classée dans les évaluations internationales. Pendant 30 ans, les autres pays se sont moqués de la Finlande. Mais si je regarde vu de ma chaise, pendant 30 ans, malgré les changements de gouvernement, la Finlande a su maintenir le cap de développer des enfants épanouis qui deviendront des adultes épanouis. On est 30 ans après, les résultats européens les meilleurs, c'est la Finlande. Ça pour moi, c'est un vrai espoir parce que ça veut dire qu'on peut avoir un gouvernement. Alors certes, le comparatif n'est pas simple puisqu'on est dans un pays plus petit, avec une population moins large, avec pas la même histoire. Bien entendu qu'il y a tout ça. Mais en tout cas, si c'est présent, c'est donc possible. Ça, c'est le premier exemple. Le sport. J'ai un exemple qui est beaucoup plus trivial, et il est beaucoup plus d'expérience personnelle, mais il y a beaucoup de gens qui ont dû l'expérimenter. Si on revient il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans les compétitions sportives, là, il y avait les championnats du monde d'athlétisme. Si vous regardez des images d'il y a 20, 30, 40 ans, les athlètes ne s'encouragent pas entre nations. Ils sont en compétition. Ils sont là pour gagner et pour faire gagner leur pays. Aujourd'hui, quand vous regardez une compétition internationale, ils sont là pour gagner. Ça, c'est certain. Par contre, si vous voyez un Suédois ou un Japonais courir pour sauter la perche, si un Français, un Allemand ou un Belge sur le bord d'un hôte, ils l'encouragent, ils tapent dans les mains. Quand le Japonais passe sa barre, le Belge le prend dans les bras. Ça a l'air anecdotique, ça ne l'est pas, parce que ça veut dire que ces jeunes qui ont entre 20 et 30 ans viennent de vivre un modèle éducatif qui leur dit, mais finalement, le sport, c'est bien un temps de rassemblement. C'est bien un temps où on est ensemble pour faire quelque chose qui... qui a eu une jolie émulsion ensemble. Je pourrais aussi le rapprocher, cet exemple-là, de ce qu'a permis, à mon avis, une partie de la dégradation sociale des 10-15 dernières années qui a fait que beaucoup de jeunes ont vécu en colocataire. Je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais nous, à mon époque, le rêve, c'était d'avoir notre appart tout seul.
- Speaker #1
Ah, bien sûr.
- Speaker #2
Et c'était complètement dans le développement du modèle économique. Il fallait grandir, avoir son appart, sa propre voiture. On pouvait aller à 5 au même match, chacun dans sa voiture, mais c'était fabuleux, chacun arriver avec sa caisse. Le fait qu'il y ait eu une dégradation économique a fait que nos enfants ont réappris ce que c'était que de vivre ensemble, et ils ont aimé ça. Au début, on s'est dit, ça ne va pas être facile, et en fait, ils ont aimé ça. Et parmi mes enfants, j'ai encore des enfants qui vivent en colocation alors qu'ils n'en auraient plus besoin du tout. Ça, c'était mon exemple 2. L'exemple, je garde les entreprises pour la fin, parce qu'il est très directement lié à notre question de départ. L'exemple 3. Il est vraiment pas facile à entendre, en tout cas chez les occidentaux, dans cette chaire UNESCO que nous avons construite, nous avons un projet majeur qui s'appelle « Apprendre d'ailleurs » . Il y a autour de nous tout un ensemble de peuples, de nations, qui ont conservé dans leur modalité culturelle la dimension du lien et du bien commun. Je vais juste prendre un exemple qu'on retrouve qui est très fort en Afrique, puis qui émerge beaucoup en Afrique ces derniers temps, qui est la philosophie Ubuntu, qui... peut se résumer en une phrase qui dit « Nous sommes, donc je suis » . C'est-à-dire que ce qui prévaut, c'est notre vie ensemble.
- Speaker #1
C'est le commun et le collectif.
- Speaker #0
Nous,
- Speaker #2
on n'a pas cette petite phrase, mais elle serait peut-être « Je suis, donc je suis » . Bon, on verra plus tard. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a donc la chance d'avoir dans la périphérie du monde occidental des peuples qui sont capables de nous rééduquer à ça. Mais là... Il faut imaginer le challenge.
- Speaker #1
Mais le voulons-nous vraiment ?
- Speaker #0
Voilà.
- Speaker #2
Qui va le vouloir vraiment ? Quel est l'occidental qui accepte de descendre de son tabouret et de dire « Ok, non, en fait, je peux apprendre. » Et si je vais aussi lancer une balle pas facile des fois de l'autre côté, je vais le prendre du côté africain, mais je pourrais le prendre en Asie-Orient, mais en Afrique c'est particulièrement fort, est-ce que le monde africain va lui accepter à un moment donné de passer au-delà de l'après-colonialisme pour revenir en lien et arrêter de lutter contre ? Puisque là on a d'un côté le monde occidental qui a du mal à s'en séparer, et de l'autre côté le monde africain qui a des fois du mal à ne pas lutter contre. Donc là on a vraiment une jolie porte de sortie. Et ce qui est intéressant, et je ne sais pas encore comment, mais il y aurait certainement besoin de les valoriser, bien sûr qu'en Europe, il y a des choses similaires. C'est toujours anecdotique. L'année dernière, je suis en vacances dans les Pouilles. Qu'est-ce que je vois ? Ma paire de lunettes est construite autour de ça maintenant. À 18h dans les Pouilles, dans tous les petits villages et les petites villes, les personnes âgées sortent les chaises, sortent les bancs et discutent.
- Speaker #1
C'était comme ça dans le sud de la France. Moi, j'ai connu ça dans mon enfance.
- Speaker #2
Et moi, j'étais en Moselle, c'était comme ça aussi. On avait un banc devant la maison, les personnes âgées qui avaient travaillé dans le jardin, à mi-chemin, elles s'arrêtaient, elles discutaient avec ma mère, qui était penchée à la fenêtre, etc. Ça, ça dit quoi ? Ça dit la culture de paix économique. C'est une culture qui dit comment on passe d'une vision du monde objet d'exploitation à une vision du monde sujet de relation. C'est le cœur de la culture de paix économique.
- Speaker #1
Et comme dit... Charles Benoît-Zick, que j'aime bien citer, il faut passer de l'entre-soi à l'entre-tous. On est le dit, ça fait dix ans que ces objectifs du développement durable ont été mis en place par l'ONU pour nous apporter finalement une boîte à outils, une boîte de réflexion. Comment est-ce que vous regardez ces dix ans passés, et ce sera ma dernière question Dominique Steyler, ces dix ans passés sur ces objectifs du développement durable ? Il ne reste plus que cinq ans. Bon, soyons clairs, on ne va pas tout régler en cinq ans, mais ceci étant, qu'est-ce qui s'est passé durant ces dix ans et qui vous donne un peu d'espoir ?
- Speaker #2
Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces ODD et les objectifs qui sont à l'intérieur, c'est, je vais refaire le parallèle avec ce que j'ai dit tout à l'heure quand je disais, attention, la paix, ce n'est pas un objet à atteindre. La paix, c'est une culture, en fait. Et une culture, c'est quelque chose d'évolutif. Et pour avoir quelque chose d'évolutif qui nous évite de nous perdre, quand on est en chemin, si on ne veut pas le perdre, où on a besoin d'une boussole particulière. Cette boussole, on peut la trouver dans différents endroits. En l'occurrence, les Nations Unies, avec les ODD, nous disent, ben voilà, on a construit de manière commune une boussole qui est représentée par les 17 ODD. Pour faire une petite parenthèse, j'ai eu récemment une discussion avec quelqu'un qui vient d'être en charge de réfléchir à une 18e sur la culture de paix, et qui me contactait en me disant, ben dans la notion de culture de paix, ça serait bien que vous soyez avec nous pour parler de la notion de culture de paix économique. Donc ce que j'aime vraiment bien dans ces ODD, c'est ça, c'est de dire ben voilà, on a un cap, on a une intention, elle va par là, et de les avoir posés nous permet de voir quand il y a dérive du cap, quand on bouge de ce cap-là. Dans l'ODD 16, dans sa toute première partie qui correspondait à l'une de vos questions, il y a très clairement le fait que la culture de paix a deux grandes facettes, la réduction de la violence, l'épanouissement et la santé. On a ces deux facettes-là. Très souvent on pense à la réduction de la violence, puisqu'on a tendance à penser à la paix que quand ça va mal. Donc là il y a guerre, on veut réduire la violence, mais on oublie que la paix se construit au long cours, quand ça va bien. Si je veux être prêt à faire la paix dans le temps de guerre, j'ai intérêt à avoir sacrément été éduqué à qu'est ce que c'est qu'être un guerrier de la paix. Et j'ai une petite phrase habituellement quand les gens viennent me chercher sur vous êtes des bisounours avec votre paix économique, je leur dis mais mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point... point, il est plus dur de faire face à la violence sans violence que de faire face à la violence avec violence. Je suis un ancien militaire, je sais très bien que faire face à la violence par les armes, ça fait mal, mais en soi, c'est plutôt un aveu de faiblesse, c'est que quelque chose n'a pas marché, donc j'en suis arrivé à être obligé de tuer. Ce que les gens ont des fois du mal à comprendre, c'est, dans mon regard, je ne peux pas tuer l'autre, puisqu'on a un interconnexion, si je tue l'autre, je me suis tué. Il y a donc un énorme effort à faire sur la culture. Et je vais terminer sur cette petite phrase. Tous les gens, en tout cas en France, mais à l'étranger ça marche aussi, si vous leur dites « qui veut la paix, prépare » , et là ils crient « la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre » . Eh bien, je m'inscris en faux à cet endroit-là. J'ai été préparé à la guerre. Et je savais que j'étais préparé à la guerre. Mais vraiment, est-ce que vous pensez qu'après vous êtes entraîné à la guerre pendant 3 ans, 7 ans, 10 ans, vous êtes prêt à la paix ? Absolument pas. prêt à la guerre. La vraie phrase, c'est Barthélémy Prosper-Enfantin au XIXe siècle, qui dit que qui veut la paix, prépare la paix. Si je veux des gens aptes à la paix, et l'une des compétences majeures de la culture de paix, c'est la capacité de confrontation. Si je veux des gens prêts à la paix, il faut que je pense à la phrase « qui veut la paix prépare la paix » . Pourquoi c'est la capacité de confrontation ? Parce que la vie restera la vie. Et le travail de la personne qui veut la paix, c'est de dire « ok, on est en tension, on est en conflit, mais je vais rester, je ne fuirai pas, je ne te tuerai pas, je reste là, mais on va trouver une autre façon de faire que de s'agresser » .
- Speaker #1
Merci beaucoup Dominique Seyler. C'est un peu l'avantage du podcast sur une émission de radio, c'est qu'on peut être un petit peu plus long si on dépasse, mais c'était tellement passionnant. qu'on aurait aimé vous entendre encore un peu plus. Je retiens, moi, de notre échange, la paix, ce n'est pas un objet, c'est une culture à construire. Et ça va tellement bien avec ce mot de reconnaissance, parce que la défiance se fait par la méconnaissance des gens. On sait bien que les religions sont souvent au cœur, d'ailleurs, de ces guerres. Et bien, reconnaître l'autre religion en tant que telle, et j'aime beaucoup aussi, moi, Emmanuel Lévinas, qui nous dit qu'il ne faut pas être dans la même thé, reconnaître l'autre et connaître l'autre. Pour ce qu'il est et pas pour ce que moi je suis et que j'aimerais qu'il soit. Voilà, ce sera mon dernier mot à moi, Dominique Steyler. Je vous souhaite une très très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mot dans l'actu prise au mot. Merci de votre fidélité. A très bientôt. Au revoir.
- Speaker #2
Merci beaucoup.
- Speaker #1
C'était l'actu prise au mot, un podcast original de Mediadvice Podcast Studio.
- Speaker #0
Vous pouvez nous retrouver sur le site de notre partenaire Mediatico ou sur les plateformes de podcast. dédié. Si vous préférez, n'oubliez pas de liker et de partager très largement.
- Speaker #1
Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter l'éco-des-solutions.info sur Substack, où on se retrouve régulièrement pour donner toute l'actualité des acteurs et des actrices du changement. Merci à vous tous et à vous toutes de votre fidélité.
- Speaker #0
A très bientôt, à la semaine prochaine, au revoir.