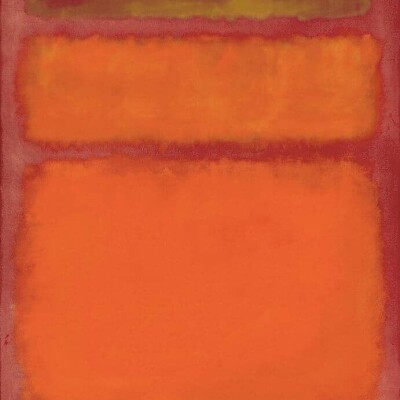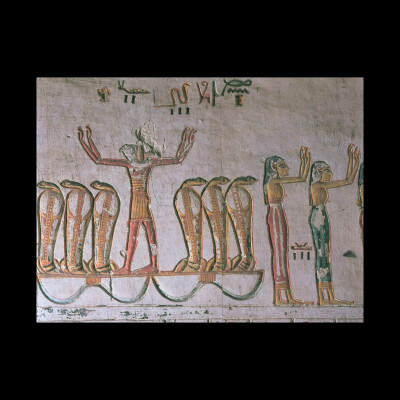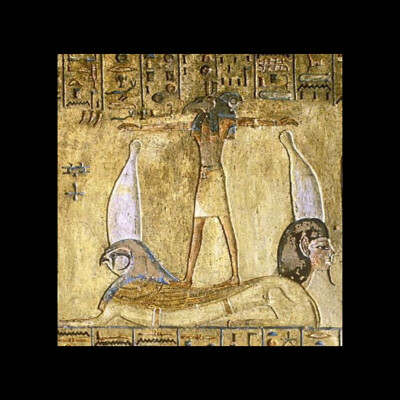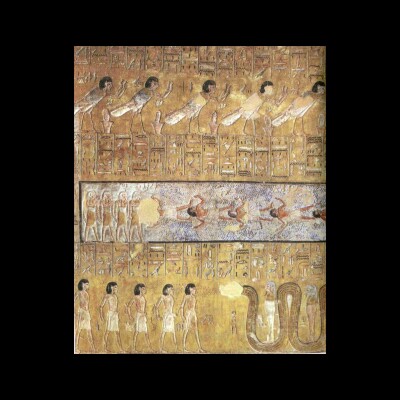Speaker #0J'ai un souvenir qui me restera gravé à vie. Quand mes filles sont nées, le premier papier officiel que nous avons reçu, avant même leur acte de naissance, est leur steuer nummer en français, leur numéro d'imposition. Une bonne manière de nous rappeler qu'en leur donnant la vie, elles devenaient également des contribuables, des redevables. Elles avaient déjà des comptes à rendre à l'État. J'avoue que sur le moment, cela m'a un peu hérissé les poils, mais avec le recul et toutes les recherches que j'ai pu faire sur la dette et le don, je le vois désormais avec un autre regard. Que tu le veuilles ou non, que ça te plaise ou pas, il n'existe pas de don sans dette. Ce qui nous gêne dans cette proposition n'a rien à voir avec sa véracité, c'est plutôt qu'elle vient heurter certains préjugés moraux. Dans nos sociétés contemporaines polissées, on idéalise le don gratuit et le sacrifice sans contrepartie. Bien que l'échange soit le mode de relation normal entre adultes, nous acceptons mal l'idée que toujours recevoir sans jamais rendre puisse être dangereux, voire destructeur. Si tu raisonnes ainsi, peut-être auras-tu une bonne conscience car tu viendras conforter ce que la morale véhicule communément. Mais dans les faits, c'est un leurre. Réfléchis. Quand on accuse quelqu'un d'être le fils de, ou la fille de, que lui reproche-t-on, si ce n'est le fait de lui avoir donné sans compter, qu'il n'ait pas rendu de compte ? On voit bien alors qu'il y a deux poids, deux mesures. Alors comment savoir où est le juste équilibre si on ne compte pas ? Dans ce second épisode de notre mini-série consacrée à la dette, nous allons explorer pourquoi le don engendre inévitablement la dette et comment cette dynamique influence notre comportement social, éthique et même notre bien-être personnel. Nous aborderons les travaux de recherche en ethnologie, en sociologie, en psychologie et répondrons à des questions fondamentales sur notre manière de gérer ces échanges implicites qui tissent les liens de notre humanité. Alors reste avec moi, car les nuances de cette relation sont vastes et profondes. Parfois, ce sera peut-être dérangeant. Mais n'oublie pas, nous pensons le monde en fonction de ce que nous connaissons Et pour tenter d'appréhender la complexité de celui-ci ainsi que celle de nos relations, il faut sortir de ta grotte, chausser différentes lunettes pour nourrir tes connaissances de points de vue divers et variés, afin d'éviter les raccourcis et les biais qui ne font que du bien à ton égo et à ton petit confort.
Speaker #0Dans ces cérémonies, Marcel Mauss distingue trois obligations indissociables. Donner, recevoir et rendre. Dans un premier temps, il faut donner pour montrer sa supériorité. Sinon, cela montre une incapacité à diriger le groupe ou tout simplement son infériorité. Dans un second temps, celui qui reçoit est obligé moralement d'accepter ce don, sinon il reconnaît de fait son infériorité. Enfin, dans un troisième temps, celui qui a reçu doit faire un contre-don. il est obligé de répondre aux défis qui a été lancés. Le potlach est basé sur la réciprocité différée et le principe est toujours de surpasser son rival en générosité. Le cadeau rendu doit être encore plus beau que le cadeau reçu. Le processus s'arrête lorsque la réciprocité ne peut plus être soutenue, conférant pouvoir et prestige au dernier donateur capable de surpasser son adversaire. Comme tu le vois, les dons et contre-dons ne sont donc pas destinés à l'enrichissement, mais ils permettent de renforcer les liens communautaires tout en démontrant la capacité du chef à soutenir sa communauté et ainsi solidifier son statut social et son influence. Alors à ce stade, tu te demandes peut-être quel est le rapport avec le fonctionnement de notre société et ton fonctionnement à toi. Ces traditions, au début associées uniquement aux tribus primitives, ont finalement pu être observées partout dans le monde. En effet, bien souvent, c'est dans les sociétés lointaines que les chercheurs découvrent les principes qui régissent ces organisations sociales et se rendent compte qu'ils sont très semblables aux nôtres. L'obligation de remboursement n'est pas folklorique, mais au contraire, elle est universelle. et puis sa racine dans le désir de cohésion sociale. Chez nous, quand tu y réfléchis, l'obligation de rendre un équivalent pour tout présent fait partie du social. Avec une différence, ce code est plutôt dissimulé que manifeste. Par exemple, nous rivalisons dans nos cadeaux de Noël ou d'anniversaire. Nous emmenons des fleurs ou une bouteille de vin quand nous sommes invités à dîner. Nous nous sentons ensuite redevables et nous devons rendre cette invitation. Et que dire des mariages, baptêmes, pots de départ et tutti quanti ? On se sent obligé de donner pour remercier, montrer son bonheur, afficher sa réussite, témoigner de son engagement et de son amour aux yeux du monde. Et quand on nous a donné, on se doit de rendre. Le terme allemand sich revanchieren, prendre sa revanche au sens littéral, est très parlant à cet égard. La gémologue en moi ne peut s'empêcher de te présenter l'exemple de la désormais traditionnelle bague de fiançailles en diamant, qui est devenue un must quand on veut déclarer sa flamme et proposer se proposer. Sache qu'aux Etats-Unis, il est de bon ton de dépenser trois mois de salaire dans un diamant, symbole du luxe et de l'éternité. Or, si tu ne le sais pas, cet usage n'a rien de vraiment traditionnel. Par contre, il joue avec brio sur la mécanique du potelage. Petite mise au point, ce rituel est le pur produit d'une campagne de marketing très efficace menée par la société De Beers. De Beers est le plus grand exploitant de diamants bruts au monde. Dans les années 1930 et 1940, la demande de diamants est en chute libre suite aux effets de la Grande Dépression. Pour revitaliser le marché, De Beers a l'idée de proposer des diamants plus petits et plus abordables, parce que c'est vrai qu'avant c'était un bien de luxe réservé aux plus riches. Et il va engager l'agence de publicité Ayor pour développer une campagne centrée sur l'idée que les diamants sont un symbole de statut éternel et de romance. et vous le dites avec plus de brillance plus de feu plus de feu un diamant de la terre un diamant de la terre de l'air Le slogan A diamond is forever créé en 1947, ainsi que les campagnes avec les plus grandes actrices, on peut penser à Judy Garland, Marilyn Monroe, ont solidifié cette idée, suggérant que les diamants étaient le seul choix acceptable pour les fiançailles, car ils symbolisent une relation inébranlable et durable. Initialement, la suggestion était de dépenser un mois de salaire. Avec le temps, cette règle est devenue deux mois. Et puis dans les années 80, De Piaz a promu l'idée que trois mois de salaire étaient le standard approprié pour montrer véritablement son amour et son engagement. Comme tu le vois, la réussite de cette campagne est évidente, car elle a non seulement augmenté la vente de diamants, mais a également profondément ancré dans la culture populaire l'idée que la valeur d'une bague de fiançailles est intrinsèquement liée à l'ampleur de l'engagement émotionnel et financier de la personne qui la donne. Ainsi, on peut faire plusieurs parallèles entre le potelage et cette tradition de la bague. Première chose, c'est un bien positionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on fait un don ostentatoire pour affirmer son statut social. Et tout ça, ça correspond donc bien au premier mouvement du potelage. L'achat d'une bague coûteuse sert de démonstration de statut. En suivant la règle des trois mois de salaire, l'individu monte non seulement son engagement envers son partenaire, mais aussi sa capacité à pourvoir aux besoins du couple et la mesure à laquelle il peut contribuer. Recevoir des cadeaux dans un potelage, deuxième mouvement, impose au destinataire l'obligation de reconnaître la générosité et le statut du donneur. De même, on pourrait dire, accepter une bague de fiançailles symbolise l'acceptation de la proposition de mariage et ça va renforcer les liens sociaux. Cela signifie également que le destinataire reconnaît reconnaît et apprécie l'amour et l'effort financier ou émotionnel du partenaire. Le troisième mouvement consiste à rendre pour maintenir ce cycle vertueux. Le destinataire d'un don lors d'un potelage est obligé de répondre avec un contre-don encore plus généreux pour maintenir ou améliorer son propre statut social et ne pas être perçu comme inférieur. Alors, bien que moins formalisé, le concept de rendre peut se manifester dans la réciprocité des engagements des mariés et dans la réciprocité des sacrifices personnels dans la relation. Le partenaire qui ne donne pas la bague peut montrer son engagement par d'autres contributions émotionnelles ou matérielles à la relation. Allons plus loin. Si on prend de la distance et qu'on regarde l'histoire, l'histoire avec un grand H, quand un roi envoyait ses émissaires avec des cadeaux aux chefs d'autres contrées, ce n'était pas un acte de générosité. L'intention était de créer de la dette. De même, quand une personne fait une offrande ou bien un sacrifice à une divinité, il ne s'agit pas simplement de l'honorer. Cette personne attend quelque chose en échange. Une faveur, de la reconnaissance, une protection. Alors pourquoi continuons-nous de penser que le don se doit d'être gratuit ? À mon humble avis, pour des histoires de morale mal placées. En effet, si tu penses et tu dis à haute voix que les cadeaux doivent être réciproques, si tu commences à compter, tu vas te faire très certainement traiter d'avare, de personnes bassement intéressées. Les bien-pensants verront en toi un pixou sans cœur et ainsi considéré, tu vas commencer à culpabiliser. Pourtant, nous allons le voir, celui qui refuse à l'autre le plaisir de s'acquitter de sa dette ne fait rien d'autre que de l'inférioriser et de le maîtriser. Alors souviens-toi de ça, si tu refuses à quelqu'un le plaisir de s'acquitter de sa dette, tu l'infériorises. Quand nous nous révulsons à l'idée de ne pas vénérer le don gratuit, c'est en fait l'enfant en nous qui se réveille et craint de perdre l'amour de ses parents en montrant qu'il puisse désirer des choses. Mais en gardant cette attitude, sache que tu ne considères que l'aspect superficiel du don et tu oublies, à tes périls mais également aux périls de ceux qui vont recevoir, le contexte et la partie inconsciente qui se joue. Bien évidemment, rappelons-le ici, le don privé entre personnes ne se fait pas par des échanges de biens matériels complètement équilibrés et la dette qu'il implique peut être comblée par de la reconnaissance, de la tendresse et ne doit pas forcément être quantifiée et équivalente. Alors résumons, parce que jusqu'à présent, on a parlé du don social. Ce que les ethnologues ont pu montrer, c'est 1. Le don social ne peut pas être refusé, sauf si le donateur le reprend à son compte. 2. La dette produite par le don initial doit être impérativement appurée par un don d'une valeur au moins équivalente. 3. Si un don reste sans réciprocité, le groupe coupable est rejeté, mis au banc de la société et peut même être militairement attaqué. Dans cet épisode, nous faisons un focus particulier sur le don personnel, le don psychique, et non sur le don social. Force est de constater que le don psychique crée une relation similaire au don social entre le donateur et le donataire. Premier point, le don personnel ne peut être refusé sans causer de conflit. Si par exemple ta mère t'invite à déjeuner et que tu lui dis non, ça pourra provoquer une réaction négative. Merci. Deuxièmement, toute dette doit être apurée, avec l'importante différence que la valeur de la dette personnelle est toujours d'ordre psychique, même s'il s'agit de biens matériels. Sa valeur ne peut être estimée que par le couple donateur-donateur, puisqu'il n'existe pas de valeur pour le remboursement de ses dons. Donc ça, c'est par exemple tes parents qui vont payer tes études. Même si c'est de l'argent, toi, tu vas te sentir redevable. Et ce que tu vas devoir, ça ne va pas être forcément l'équivalent de l'argent, mais ça va être la gratitude, le fait de devoir réussir tes études, etc. Troisième chose, le don resté sans réciprocité entraîne bien un châtiment. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est plus souvent celui qui l'a reçu qui se l'applique à lui-même. Et donc ça, par exemple, c'est la fameuse culpabilité. Selon le paradigme du don tel qu'il est formalisé par les travaux de Mauss, que nous le voulions ou non, nous inscrivons notre existence dans une logique d'alliance. dans une logique de don et contre-don, de dette et de créance. C'est à travers ces relations que se forment et se déforment l'identité et la valeur des sujets. En ce sens, nous sommes toutes et tous des enfants du don, non seulement en raison du don de vie qui nous a fait naître, mais également de manière continue au regard de la place que nous occupons. Et cette place, elle varie selon les contextes relationnels, selon notre parcours biographique, et nous évoluons tous à travers le cycle du donner, recevoir, rendre de manière continue. Ce parcours, en tant que parcours d'individuation, suppose donc que l'on puisse s'inscrire dans des espaces de dons et de dettes mutuelles. que chacun à sa mesure puisse non seulement donner, mais aussi accepter d'être endett��. C'est ainsi qu'on grandit, c'est ainsi qu'on devient adulte. Mais que se passe-t-il lorsque le cycle du don est bloqué, interrompu, contrarié, voire brisé ou renversé ? Lorsque l'un des partenaires ne veut ou ne peut donner, ou pas assez, ou trop, ou pire encore, lorsqu'au lieu de donner, il prend, de façon prédatrice, ce qu'il estime son dû. Que se passe-t-il lorsque le donateur ne reçoit pas ce dont il a besoin ou ce qu'il estime mériter, voire refuse tout don, donc toute dette ? Et au regard du troisième mouvement, celui du contre-don, Que se passe-t-il lorsque je me trouve dans la capacité de rendre ou que je refuse de donner à mon tour et garde jalousement ce que j'ai reçu ? En entendant le détail, on découvre une différence importante entre le don social et le don personnel. Le don social est offert au cours d'une cérémonie publique, ritualisée, et les modalités sont donc connues de tous. alors que le don entre personnes n'est généralement connu que d'elle ou dans un cercle restreint. N'étant pas ritualisé, le souvenir peut en être refoulé par le donateur ou encore sous-ou surestimé par lui. Et c'est ça qui va entraîner, dans tout le cas, des remboursements inadaptés et parfois des troubles psychiques. Il est important de le répéter. À quelque niveau que ce soit, le mode normal de relation entre adultes est l'échange et la réciprocité. La non reconnaissance de ce principe entraîne inévitablement des troubles. Une personne qui reçoit et qui ne peut s'acquitter de sa dette se trouve infériorisée par rapport au donateur et cela va entraîner forcément des sentiments négatifs. Le déroulement temporel et l'évaluation de la valeur du don personnel sont aussi fort différents entre les deux sortes d'échanges. Donc l'échange personnel et l'échange social. Les règles du potlatch établissent à deux années maximum le temps qui peut s'écouler entre le premier don et le cadeau offert en retour. Par ailleurs, comme on connaît la valeur du don, elle est connue de tous et donc elle ne peut prêter à confusion. Toutes les dettes psychiques, elles, n'ont ni le même destin ni les mêmes conséquences. Les dettes connues-reconnues peuvent être acquittées lorsque le bénéficiaire le désire. Le non-remboursement est alors un choix conscient et librement assumé. Ce qui devient vraiment problématique, c'est quand ces dettes sont inconscientes, méconnues ou niées. C'est là qu'elles nous tourmentent. On peut distinguer trois grandes catégories de dettes problématiques. La dette niée, car son souvenir est refulé, ça c'est la première. La seconde, la dette minimisée, sous-évaluée. La troisième, son pendant, la dette sur-évaluée. Et à ces catégories, j'ai rajouté deux autres, la dette qu'on s'auto-inflige et les dettes négatives. Il est temps de passer à la seconde partie qui va présenter la typologie de ces cinq types de dettes afin que tu puisses comprendre l'importance de respecter le cycle donner-recevoir-rendre.