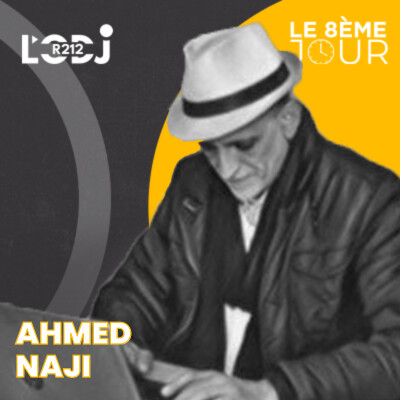Description
Rédigé par Hajar DEHANE le Mardi 8 Juillet 2025
C’est un revirement brutal, mais devenu banal sous la présidence Trump. Une semaine seulement après avoir suspendu plusieurs livraisons cruciales d’armement à l’Ukraine, le président américain annonce, lundi 7 juillet, l’envoi de « nouvelles armes défensives » à Kiev. « Ils sont frappés de manière très, très dure », a justifié Donald Trump à propos des Ukrainiens, lors d’un dîner officiel à la Maison-Blanche en présence du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou.
Cette volte-face, intervenue sans consultation apparente du Congrès ni du Pentagone, intervient dans un contexte de tensions accrues sur le front ukrainien et de paralysie diplomatique. Elle soulève des interrogations sur la cohérence stratégique de l’administration américaine, mais aussi sur ses motivations profondes.
Suspension brutale, réaction immédiate
Le 2 juillet, la Maison-Blanche avait pourtant confirmé la suspension des livraisons de plusieurs systèmes d’armes : missiles Patriot, obus de 155 mm, missiles GMLRS, Hellfire, Stinger, munitions pour F-16. Une décision justifiée officiellement par la priorité donnée aux stocks nationaux américains, mais dénoncée à Kiev comme un abandon en pleine intensification des frappes russes.
L’annonce, relayée par Anna Kelly, porte-parole adjointe de la Maison-Blanche, avait reçu l’aval du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, et du stratège Elbridge Colby — promoteur d’un recentrage des forces américaines vers la Chine. Pour Moscou, la décision américaine validait son analyse : « Moins il y a d’armes fournies à l’Ukraine, plus la fin de l’opération spéciale est proche », avait aussitôt commenté Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin.
Mais la pression militaire et diplomatique a fini par imposer un changement de cap. Plusieurs attaques russes — notamment sur Kiev, Kharkiv et Mykolaïv — ont causé des dizaines de morts et mis à mal les défenses antiaériennes ukrainiennes, désormais lacunaires.
Une diplomatie au point mort
Côté diplomatique, la situation est figée. Deux cycles de négociations entre Russes et Ukrainiens se sont tenus en Turquie, les 16 mai et 2 juin derniers, sans qu’aucun compromis n’émerge. Vladimir Poutine campe sur ses positions maximalistes : reconnaissance de l’annexion de régions ukrainiennes, promesse de neutralité de Kiev, renoncement à l’OTAN.
Des exigences inacceptables pour les autorités ukrainiennes, qui exigent, en retour, un retrait total des troupes russes. Depuis janvier, Donald Trump avait tenté un rapprochement direct avec le Kremlin, multipliant les appels avec Vladimir Poutine. Mais cette stratégie d’influence personnelle, déconnectée de toute architecture diplomatique formelle, a échoué à produire des résultats concrets.
À cela s’ajoute une fatigue stratégique palpable à Washington, où l’aide militaire à l’Ukraine, chiffrée à plus de 65 milliards de dollars depuis 2022, commence à faire débat, notamment chez les Républicains les plus isolationnistes.
Une guerre suspendue aux caprices de Washington
À Kiev, l’espoir d’une ligne claire s’amenuise. À Moscou, on mise sur l’usure politique des Occidentaux. Et à Bruxelles, la crainte d’un retour du "trumpisme transactionnel" – où tout soutien se monnaie – commence à resurgir.
Plus qu’un simple ajustement tactique, la décision de Donald Trump révèle l’incertitude croissante qui entoure l’engagement américain en Ukraine. À la veille d’une élection présidentielle, et alors que le conflit s’enlise dans une guerre d’attrition, les hésitations de Washington envoient un signal dangereux : celui d’un désengagement progressif, masqué par des annonces de façade. Pour l’Ukraine, le message est limpide : elle ne peut plus compter sur la constance de son principal allié.