- Speaker #0
Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
- Speaker #1
Ce qui place votre zone d'atterrissage à 5,0667 degrés de latitude nord et 77,3333 de longitude ouest.
- Speaker #0
Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel ? La seule variable constante est l'inattendue.
- Speaker #1
On ne peut pas la contrôler.
- Speaker #0
Je crois que vous êtes encore pire que ces créatures.
- Speaker #1
Elles,
- Speaker #0
elles n'essaient pas de se massacrer entre elles pour tirer le plus paquet de fric. Voyons si une capacité de poussée de 10% permet le décollage. Et 3,
- Speaker #1
2, 1...
- Speaker #0
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Bumons. Alors cet épisode est le dernier de la saison 8. Et pour l'occasion, j'accueille un habitué de nos podcasts, Martin Hébert. Salut Martin !
- Speaker #1
Bonjour Maxime !
- Speaker #0
Comment vas-tu ?
- Speaker #1
Très bien !
- Speaker #0
Alors pour ceux qui nous suivent régulièrement, tu sais que Martin vient du Québec. Donc aujourd'hui, pas de resto, pas de brasserie, pas de bière. On est à distance, à travers un écran, mais ça n'empêche que je pense qu'on va avoir un échange très, très intéressant. Et pour les autres, Martin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ?
- Speaker #1
Oui, bonjour. Je suis un anthropologue, donc professeur à l'Université Laval. Mes champs de recherche sont, on pourrait dire, les imaginaires sociaux, donc la manière dont les humains interagissent avec leur monde. à travers des représentations, à travers des discours, notamment l'utopisme, donc les manières dont on envisage la société souhaitable et aussi, je pense, comme on va en discuter aujourd'hui, la manière dont les humains envisagent leur futur et les effets de ces représentations-là dans notre vie politique actuelle.
- Speaker #0
D'ailleurs, on va parler d'anthropologie des futurs, on va en parler très très vite dans le podcast. Petite anecdote avec Martin. En fait, j'ai rencontré Martin au tout début de l'aventure des podcasts du MUMONS. Nous avions discuté dans les toutes premières saisons de la série de livres et sur Apple TV, puisque maintenant elle s'est incarnée à l'écran, de la série Fondation. Et il y a deux ou trois saisons, j'ai recontacté Martin. Je lui ai demandé s'il voulait refaire une intervention dans les podcasts du MUMONS en lui disant que je lui laissais un petit peu carte blanche sur les sujets qu'il pouvait me proposer. Et Martin m'a proposé une dizaine de sujets. Et donc au début je me suis dit bon je vais essayer d'en choisir un, on va voir ce qui va se passer. Et au final tous les descriptifs des sujets que Martin m'avait proposés étaient super intéressants. Et donc on a convenu avec Martin que plus ou moins à chaque saison il ferait une incursion, il aurait un épisode avec un sujet qu'il a amené. Et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur parce qu'il a déjà été abordé plusieurs fois dans les podcasts. C'est le climat et aujourd'hui on va parler... plus spécifiquement des fictions climatiques. Alors, dans les précédentes saisons, et plus exactement, j'ai été revérifié parce que je ne me souvenais plus, c'était dans laquelle, dans la saison 5, le dernier épisode de la saison 5, et aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 8, donc il y a un petit truc là, une petite récurrence. On avait déjà abordé le sujet avec Jean-Marc Ligny, qui est un auteur de science-fiction et de climate fiction, qui est un auteur français, et qui a écrit plusieurs livres, justement, sur de la climate fiction. Et, chère auditrice, cher auditeur, d'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté ce podcast avec Jean-Marc Ligny, je t'invite à aller écouter celui-ci, parce que l'idée que j'ai, c'est que ces deux podcasts forment un espèce de diptyque, rentrent vraiment en résonance. D'un côté, on aura l'avis d'un auteur qui s'est vraiment impliqué dans la rédaction de ces livres, et de l'autre, on va avoir un avis un peu plus méta d'un anthropologue, en fait, qui étudie ce genre spécifique de la climate fiction, et au final, qui se pose la question de comment l'anthropologie peut aider à... entre apercevoir ou à concevoir le futur. Mais avant de rentrer dans les détails, ce que je te propose, Martin, c'est de justement définir ce concept de « climate fiction » ou en français de « climat fiction » .
- Speaker #1
Premièrement, ce qu'il faut dire, c'est que les frontières de la fiction climatique sont quand même plutôt poreuses. C'est-à-dire que si on prend les fictions climatiques au sens large, c'est-à-dire les récits que les humains font pour parler... non seulement du climat, mais des causes du climat et des tendances du climat, on peut reculer jusqu'aux premières traces écrites qu'on trouve. On y voit des spéculations vraiment sur des déluges, les raisons derrière le déluge, les sécheresses et la manière dont ces sécheresses-là s'articulent plus ou moins avec la moralité ou la vitalité ou la force du souverain, que ce soit en Égypte, que ce soit en Inde. ou en Méso-Amérique, chez les Mayas, par exemple, il y a... constamment dans l'humanité cette volonté non seulement d'observer le climat, mais tenter de l'expliquer et surtout d'extrapoler. Donc ça, c'est la définition, on pourrait dire, la plus large qui est importante ici. Et évidemment, tout le monde sait que dans les dernières décennies, le climat a occupé une place, on pourrait dire, toujours croissante dans nos imaginaires et dans nos préoccupations. Toujours croissante, on pourrait débattre parce que, par exemple, dans une société... paysannes, les pluies et les tempêtes, etc., ce sont des préoccupations quand même très présentes dans la tête des gens. À l'échelle locale, souvent, on voit vraiment une obsession ou en tout cas une très grande préoccupation pour la stabilité, pour la fécondité du climat. Mais ce qu'on voit certainement depuis les années 1970, c'est une préoccupation qu'on pourrait dire d'ampleur globale dans l'humanité. non seulement pour des conditions climatiques et météo d'une région, mais maintenant, on en est à se préoccuper pour la qualité de notre climat à l'échelle de la planète. Donc, s'il y a une différence qui émerge, elle est vraiment là, une préoccupation pour l'ensemble du climat par, d'une certaine façon, l'ensemble de la population humaine. Et évidemment, ces grandes tendances-là donnent lieu à des créations artistiques qui s'expriment. Beaucoup dans les romans, on en voit au cinéma aussi, mais de plus en plus dans l'art, dans le théâtre, etc. Donc, ces préoccupations très pratico-pratiques débordent dans le domaine de l'art, de la création. Et éventuellement, à mesure que les œuvres se multiplient, à mesure qu'elles deviennent plus cohérentes, on voit des commentateurs, des critiques, commencer à définir un ensemble à l'intérieur de ces productions-là. qu'on va appeler les fictions climatiques. Donc, le terme lui-même apparaît quand même assez tardivement, dans les années 2010. Ce n'est pas qu'on n'en parlait pas avant, c'est que c'était diffus, c'était associé à d'autres types de préoccupations. Mais, disons, au fil des années 2000, on voit vraiment un champ de discours de plus en plus structuré autour des changements climatiques. Donc, avant les fictions climatiques, telles qu'on pourrait les définir en tant que sous-genre de la science-fiction, bien évidemment, il y a eu toute une... de préoccupation pour les mises en récit du climat. À cet égard-là, il faut inclure par exemple le film, le documentaire fait par Al Gore au début des années 2000, 2006 si je ne me trompe pas, Une vérité...
- Speaker #0
Une vérité qui dérange.
- Speaker #1
Oui. Donc, ce n'est pas de la fiction. Évidemment, le but de Al Gore était de communiquer des faits scientifiques, mais pour les communiquer, d'une manière efficace au public, il n'a pas eu le choix que de recourir à des dispositifs visuels, à des manières, des graphiques, des narrations, des récits qui sont poignants et qui vont rejoindre les gens. Donc, on voit le pont se créer entre ce qu'on pourrait appeler vraiment les sciences naturelles et le domaine de la création artistique.
- Speaker #0
Alors, ce qui est intéressant, je relève un élément que tu as partagé au tout début de ton intervention, c'est que... Au final, le climat, dès les premiers récits humains, il est présent. Par exemple, et je n'avais pas du tout réalisé ça avant de discuter avec toi pour préparer le podcast, on peut vraiment se poser la question de, est-ce que le déluge, ce n'est pas un espèce de proto-climate fiction, où les gens parlent d'un bouleversement climatique, des pluies diluviennes qui vont tout recouvrir, et d'une humanité qui se recrée. Alors bien entendu, c'est un récit biblique. Mais il existe dans plein d'autres civilisations, ce récit du déluge. Donc, ce climat, il est omniprésent dans le récit humain, en fait.
- Speaker #1
Absolument. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup du futur, mais les théories, disons, les plus admises sur les origines du récit, en fait, des récits de déluge, en fait, ils voient plutôt un écho du passé. Par exemple, certains auteurs ont amené l'idée, en fait, c'est tout à fait documenté, disons, empiriquement. qu'à la fin du Pleistocène, la fin de la dernière ère glaciaire, il y a eu des bouleversements environnementaux qui ont été très brutaux dans certaines régions, notamment dans la région de la mer Noire. Durant l'ère glaciaire du Pleistocène, la mer Noire était un lac d'eau douce dont le niveau se situait, on estime, à environ 100 m sous la Méditerranée. Donc, il y avait vraiment un écart immense, quand même un décalage très grand. Et autour de ce lac d'Odos, s'étaient établis des populations de pêcheurs, des villages, etc. Mais à mesure que les glaces ont fondu et que le niveau de la Méditerranée a augmenté, elle a fait une pression sur le détroit de Beaufort. Donc, Istanbul, le goulot d'étranglement qu'on trouve en Turquie entre l'Asie et l'Europe. et l'hypothèse qui a été quand même parce qu'on peut voir les taux de sédimentation, des choses comme ça, et que le détroit de Beaufort se serait ouvert, aurait véritablement décapsulé comme un bouchon de champagne, et la Méditerranée se serait déversée dans la mer Noire, vraiment avec une vitesse et une brutalité cataclysmique. Les auteurs parlent de plusieurs centaines de fois la force des chutes du Niagara, par exemple. Donc, ça a complètement anéanti les villages qui s'étaient installés autour de ce lac-là. Et on dit que le bruit de ce déferlement-là aurait été entendu à des centaines de kilomètres à la ronde, vraiment un grondement. Donc, une des hypothèses est que les récits de déluge sont la mémoire d'événements comme ça. Et, fait intéressant, on trouve le même genre de décapsulage dans la région des Grands Lacs en Amérique du Nord, sur la côte ouest de... des États-Unis, à la fin de l'ère glaciaire, c'était des barrages de glace qui cédaient. Et d'un coup, vous aviez littéralement une mer qui se déversait. Et on trouve aussi des récits de déluge chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord similaires.
- Speaker #0
Alors, en tant qu'anthropologue, qu'est-ce qui t'intéresse au final dans ce genre littéraire qu'est le « climate fiction » ? Et quand est-ce que t'as commencé à t'y intéresser et pourquoi ?
- Speaker #1
Albert Jacquard a écrit un livre qui s'appelle « Mon utopie » et dans ce livre-là, il amène une idée qui est absolument charnière pour comprendre nos réalités sociales et politiques. Il dit « Avec l'humanité, la chaîne de causalité habituelle où le passé cause le présent, donc en physique c'est ça, donc les événements qui viennent avant ont un effet causal sur les événements qui viennent après. » Jacquard disait « Avec l'humanité... » ce flot-là s'inverse, c'est-à-dire que les projections qu'on se fait de notre futur deviennent causales dans notre présent. Donc, quelque chose d'absolument inédit dans la nature, où justement la manière dont on anticipe, dont on spécule, dont on se projette dans l'avenir, a des effets tout à fait présents. Donc, le lien avec l'anthropologie, il est là, c'est-à-dire que longtemps, l'anthropologie a expliqué la culture, le présent. comme un héritage qui nous arrive uniquement du passé. Aujourd'hui, des anthropologues dont je suis reconnaissent aussi l'importance de ce qu'on va appeler les récits intentionnels du futur, c'est-à-dire la manière dont les gens littéralement se bâtissent soit des utopies ou des dystopies ou des récits apocalyptiques et la manière dont ils ramènent ces spéculations-là dans le présent et façonnent leurs actions en lien avec ça. Les fictions climatiques appartiennent tout à fait à cette catégorie de récits-là parce que, oui, on a beau avoir énormément de données, on a beau avoir des preuves scientifiques, des dérèglements climatiques, etc., l'avenir reste toujours ouvert aux projections qu'on y met. Donc, on est devant une diversité de scénarios, pas devant un seul. Et la manière dont les gens choisissent d'adhérer ou non à certains scénarios… la manière dont ils s'en inventent d'autres est une clé absolument centrale pour comprendre les dynamiques de nos sociétés aujourd'hui.
- Speaker #0
Et d'ailleurs, on va parler d'un terme qui au début, moi, me semblait un peu bizarre, le terme anthropologie du futur. Moi, l'anthropologie, la vision que j'en ai, c'est qu'elle étudie le passé, elle étudie à la limite le présent, ce qui se passe un petit peu maintenant en lien avec le passé, mais à aucun moment je me suis dit que cette anthropologie pouvait étudier le futur. Et comme tu le dis, c'est intéressant d'avoir cette perception du... futur, la projection que l'on effectue dans notre esprit un peu commun en tant que société du futur qui a une influence sur le présent parce que justement on a fait une projection, c'est assez intéressant je trouve comme angle d'attaque mais est-ce que l'anthropologie à l'heure actuelle, elle a tous les outils nécessaires pour pouvoir justement étudier le futur entre guillemets ?
- Speaker #1
L'anthropologie, bon premièrement tu pourrais t'excuser de ne pas avoir vu le lien entre l'anthropologie et le futur parce que l'anthropologie elle-même s'est intéressée au futur pendant un siècle sans s'en rendre compte. Donc, justement, à cause de toutes sortes de biais culturels, évolutionnistes, etc., les sociétés qu'on va dire ethnographiques ont toujours été cadrées comme des sociétés, Claude Lévi-Strauss dit, des sociétés froides, des sociétés prises dans l'éternel présent. Et quand elles n'étaient pas prises dans l'éternel présent, on les représentait comme, d'une certaine façon, tributaires de leur tradition, donc des sociétés qu'on va dire traditionnelles qui ne faisaient que répéter plus ou moins à l'identique ce que leurs ancêtres avaient fait, alors qu'objectivement... Quand on étudie des sociétés ethnographiques, au contraire, on constate une préoccupation constante chez les gens pour le futur, notamment à travers la divination. On a un enfant, on veut savoir s'il va être en santé, s'il ne sera pas. On a parlé des pluies, des rituels agraires. On part à la guerre, on consulte les augures. Donc, la préoccupation humaine pour le futur, elle était juste là sous nos yeux, mais on n'avait pas les... cadres théoriques pour lui faire une place. Évidemment, ça change, mais est-ce qu'on a les outils pour vraiment faire une ethnographie de notre rapport et du rapport des humains au futur ? Il manque beaucoup de pièces, on pourrait dire, dans ce puzzle-là, parce que le futur comme tel a été monopolisé par la technologie. Donc, les domaines de notre société qui ont été, à partir certainement du 19e siècle, les plus investis dans cette notion de futur, étaient très techno-optimistes. C'était des futurs technologisés, on peut dire, où la machine allait tout transformer, et après ça a été l'ordinateur, après ça a été la manipulation génétique. Donc, le discours sur le futur a été beaucoup entre les mains des sciences et technologies, alors que ce n'est qu'une... manière de parler du futur et il nous faut redécouvrir toute la gamme de nos discours à cet égard-là.
- Speaker #0
Et justement, sans nécessairement les faire rentrer en opposition, mais est-ce que la science-fiction et plus particulièrement ici, on est dans le sous-genre de la climat-fiction, est en quelque sorte mieux équipée pour concevoir en quelque sorte cet avenir, cette future, enviable ou non ?
- Speaker #1
Tout à fait. Je parlais de la domination des sciences et des technologies dans nos récits sur le futur. Évidemment, la science-fiction naissante reflète tout à fait ça. Donc, la science-fiction de l'âge d'or, elle est très centrée sur les fusées, les nouvelles technologies, les robots. Dans les années 30, 40, 50 en particulier, elle était tout à fait habitée par cette conception-là du futur. Et graduellement, la science-fiction a... fait sa propre critique avec des nouvelles générations d'auteurs qui ont émergé dans les années 60, qui disaient qu'en fait, spéculer sur le futur, ce n'est pas juste de s'imaginer qu'on va manger des petites pilules et se nourrir uniquement et on va avoir des voitures volantes. Parler du futur, c'est aussi parler des dynamiques qu'on voit déjà, par exemple, dans nos villes, les inégalités flagrantes, de parler de la montée du totalitarisme dans des sociétés, etc. Donc, on entre dans... dans les années 60, de plein pied dans ce qu'on pourrait appeler la sociale science-fiction, c'est-à-dire des extrapolations non plus à partir des technologies ou des sciences naturelles, mais plutôt des extrapolations faites à partir des sciences sociales, des tendances sociales qu'on observe. C'était l'ingrédient, disons, qui allait nous mettre sur la piste d'une science-fiction beaucoup plus axée sur une réflexion sociale. dense et complexe. Donc, la science-fiction se met, on voit émerger la science-fiction féministe, la science-fiction écologiste, qui va graduellement évoluer, justement, dans la fiction climatique. Donc, c'est un élément important parce qu'une grande composante des fictions climatiques qu'on voit aujourd'hui sont justement centrées beaucoup plus sur l'impact de ces changements climatiques-là. sur nos sociétés, sur nos subjectivités, que leur impact sur savoir si on va utiliser telle bidule ou telle autre.
- Speaker #0
Dans un des articles auxquels tu as participé, j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup parlé et qui, au final, fait référence à, j'ai l'impression en tout cas, un réel problème de l'humanité en tant qu'humanité. C'est l'article mentionné, c'est quelques mots, d'écrire les futurs. pour concevoir l'avenir. Et je voudrais rattacher ça justement à cette fameuse difficulté de l'humanité dont je parlais, qui pour moi est la capacité à se projeter très très loin dans le futur, mais de façon consistante. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend justement l'exemple des changements climatiques, c'est quand même quelque chose qui est très très difficilement appréhendable par notre société humaine. Tu as toute une partie des gens qui commencent à se rendre compte que la situation est quand même bizarre. D'autres qui disent, ben non, mais ça va se réguler de lui-même. D'autres qui disent, la technologie va nous sauver. Quoi qu'il en soit, on a vraiment, en tant que société humaine, du mal à appréhender d'une certaine façon, d'une façon unique. je vais dire, ce problème du climat. Et donc, est-ce que tu penses que cette science-fiction et cette climate fiction peut nous aider justement à nous projeter dans une réalité plus tangible pour nous ?
- Speaker #1
C'est certainement son ambition, c'est-à-dire de nous projeter... Les fictions climatiques ne font pas... Ce n'est pas de l'ordre de la futurologie, disons. Elles ne prétendent pas refléter un état exact. de la planète et de l'humanité dans un siècle ou deux siècles ou trois siècles. Elle a compris que c'est très périlleux comme exercice. Dans les années 60-70, justement, il y avait ce champ qu'on appelait la futurologie où carrément, bon, Alvin Toffler, Le choc du futur, est un des ouvrages qui marque bien cette tendance-là, où on était davantage dans l'extrapolation, par exemple, à partir de tendances démographiques, de tendances économiques, etc. Vous voyez un peu la procédure, on trace une courbe et on la prolonge encore un peu pour dire voici là où l'humanité s'en va. Ces éléments-là existent encore, mais avec le temps, on en est venu à être beaucoup plus sceptique face à cette Ausha. Parce qu'évidemment, il y a trop d'éléments, le système est trop complexe pour être capable de véritablement prédire de cette manière-là. Mais les réflexions ont évolué dans le sens où... le futur commence à être vu comme ayant, un peu comme je disais tout à l'heure, un effet causal sur le présent, c'est-à-dire que de parler du futur aide à orienter nos actions dans le présent. Emmanuel Wallerstein, un historien du système monde, on va dire, lui, s'est mis à parler, au début des années 2000, d'une nouvelle discipline qu'il appellerait l'utopistique. Et l'utopistique serait le mélange ... à la fois de cette prospective, c'est-à-dire est alimentée par des données objectives sur les projections démographiques, sur les projections climatiques, les projections du développement économique mondial, etc. Donc, il y a un aspect empirique, on va dire, mais auquel on vient de rejoindre un aspect, on pourrait dire, de science citoyenne où on crée des groupes de discussion, on crée des collectifs qui sont composés d'artistes. qui sont composés de gens en sciences sociales, de philosophes, de citoyens, de ce que vous voudrez, qui s'approprient ces scénarios-là et tentent de décider si ce sont des scénarios où nous voulons vivre ou pas, et si ce ne sont pas des scénarios souhaitables, qui développent des actions, des actions concrètes. Vous voyez, on passe d'une sorte de prospective passive, d'une certaine façon, dire simplement « voici où les choses vont » . à une prospective qui est beaucoup plus active, où on dit, bien, quels sont les futurs que nous souhaitons et que pouvons-nous faire pour y arriver ? Et là, bien, évidemment, il y a une projection dans l'avenir, mais évidemment, il y a des actions très concrètes dans le présent qui sont entreprises pour réaliser ces futurs-là qui sont souhaitables. Et inversement, des actions qui sont prises pour éviter les futurs dystopiques qu'on ne veut pas vivre.
- Speaker #0
Pour lesquels on ne voudrait pas vivre.
- Speaker #1
Absolument.
- Speaker #0
Justement, pour prendre un peu le contre-pied de ce que tu dis et de poser la question, c'est est-ce que la science-fiction rend toujours service à son propos ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait justement être dans un discours du type « oui, mais c'est de la fiction » , puisque dans science-fiction, il y a le terme « fiction » , « oui, mais c'est de la fiction » , et donc ça devient une espèce d'excuse utilisable où on se dit « mais non, c'est un scénario catastrophe pour servir le roman, pour servir l'histoire, jamais on arrivera là » . ce n'est pas possible, etc. Est-ce qu'elle est toujours constructive dans la perception qu'elle nous permet d'établir ?
- Speaker #1
Dans cette question-là, il y a vraiment deux questions qui sont contenues. La première, c'est est-ce que, dans tous les cas, le recours à la fiction pose problème ou peut potentiellement poser problème ? C'est quelque chose qui a vraiment à voir avec la nature de la fiction en tant que fiction. Et dans l'autre, versant de cette question-là, c'est-à-dire, est-ce que les fictions existantes, la manière dont les artistes ont abordé la fiction climatique ces dernières décennies, est-ce qu'il y a des choses problématiques là-dedans ? Pour répondre à la deuxième question, le reproche a été fait à la fiction climatique en général récente, qu'elle avait une tendance beaucoup trop apocalyptique, par exemple. Chaque fois qu'on parle du futur, on a des scénarios catastrophes, par exemple. La critique a été... que ce sont potentiellement des récits qui sont démobilisants pour les gens, liés par exemple à l'éco-anxiété.
- Speaker #0
Quelqu'un me disait, si tout se passe bien, il n'y a pas d'histoire.
- Speaker #1
Oui, c'est ça. Et ici, il y a une boucle de rétroaction parce que ce n'est pas le rôle des artistes non plus que d'être des pédagogues, de dire voici le chemin qu'on doit prendre. Les artistes reflètent souvent leur état intérieur et évidemment, on sait qu'on vit dans une époque très préoccupée où les scénarios de futur radieux ne sont pas très présents dans notre paysage. Donc... les fictions climatiques reflètent cette anxiété et viennent la nourrir dans certains cas où, justement, on nous présente des futurs où on va être au seuil de la survie, etc. Donc, il y a un effet de balancier là-dedans et il y a des auteurs qui ont tenté d'amener des fictions climatiques optimistes, mais évidemment, c'est un optimisme qui est, d'une certaine façon, une pure réaction. au climat de pessimisme généralisé. Donc ça, c'est le côté, quand on parle des œuvres concrètes, en théorie, il y a une préoccupation, disons, un peu plus subtile, mais qui est tout à fait réelle, qui est amenée. On a entendu parler du GIEC, le groupe international d'études sur le climat, et le GIEC est vraiment le fer de lance composé de dizaines de milliers de scientifiques et son rôle est de faire une... des synthèses de l'ensemble de nos connaissances sur le climat et de faire ces rapports et d'être vraiment dans la prospective. Lui, il est une prospective appuyée vraiment sur autant de données rigoureuses possibles. Et ces dernières années, le problème que le GIEC a rencontré, c'est de dire qu'on a des données, on n'a que ça, on a des masses et des masses absolument. Il produit des rapports de milliers de pages, etc. Et... les gens ne réagissent pas à ça parce que c'est trop abstrait. Donc, le GIEC s'est mis à travailler avec des artistes, avec des gens en vulgarisation scientifique pour dire comment est-ce qu'on fait pour toucher le cœur des gens ? Comment on fait pour les mobiliser autour des enjeux climatiques ? Et ça, évidemment, ce n'est pas juste de rajouter davantage de données, davantage d'arguments, c'est d'amener un changement qui est vraiment qualitatif. Et un de mes exemples préférés de ça... C'est la revue Geolino. Donc, en Allemagne, c'est la revue Geo, mais pour les enfants, donc, genre 7 à 12 ans. Eux, ils ont créé un jeu pour conscientiser, justement, les enfants au risque des changements climatiques. Donc, c'est un jeu de plateau. Mais au lieu d'avoir un plateau habituel, c'est un bassin d'eau. Et les cases du plateau sont des glaçons. Donc, vous faites des glaçons et vous les faites flotter. Et vous êtes un ours polaire. qui roule le dé et qui doit se promener de glaçon en glaçon pour aller atteindre l'objectif. Évidemment, la question est que vous devez parcourir toutes les cases avant qu'elles fondent et que votre ours polaire tombe dans l'eau. Donc, c'est une manière, on n'est pas tant dans la science-fiction, mais on est tout à fait dans la mise en récit, c'est-à-dire passer par un récit, un imaginaire très parlant, très concret pour communiquer aux gens cette urgence-là. super, c'est un outil éducatif, etc. Mais quand on se met à le décortiquer, par exemple, on pourrait dire que ce jeu-là reproduit un des biais de la conservation, c'est-à-dire de se centrer beaucoup sur les espèces trophées.
- Speaker #0
Donc, tout d'un coup, les enjeux environnementaux extrêmement complexes de l'Arctique deviennent juste à propos des ours polaires qu'on aime bien, qui sont sympathiques, etc. Vous générez de la sympathie pour les ours polaires, mais peut-être pas pour le phytoplancton ou pour des êtres qui ont aussi besoin d'être protégés, mais pour lesquels le public ne se mobilise pas. Donc, je ne sais pas si tu vois, mais en voulant appuyer sur des leviers émotionnels, on renforce parfois des stéréotypes. Et on entre dans un domaine où les scientifiques diraient que c'est plus compliqué que ça.
- Speaker #1
Et je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que comme tu le dis, il y a d'un côté les données et les gens ne sont absolument pas réceptifs. Et de l'autre côté, il y a par exemple le récit, où là, on voit que ça peut mobiliser toute une série de personnes, mais peut-être pas sur la globalité du problème, mais plutôt que sur des éléments ponctuels de ce problème. Ce qui fait que c'est extrêmement compliqué, en fait. et je reviens sur ce qu'on disait, extrêmement compliqué de mobiliser la société, d'avoir une vision globale commune qui nous dirigerait vers un futur plus souhaitable que celui vers lequel on se dirige à l'heure actuelle.
- Speaker #0
Et un autre exemple d'images fortes qui peuvent en venir à poser problème, justement, le GIEC parle beaucoup du fait qu'il est minuit moins une. Il faut agir, il est minuit moins une. Mais ça fait 20 ans qu'il est minuit moins une. pratiquement chaque ligne rouge que le GIEC a mis, elle a été traversée. On a des années record, etc. Donc, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un lève la main et dit « Est-ce qu'il ne serait pas plutôt minuit et cinq ? » « Est-ce qu'on n'a pas franchi le cap ? » Donc, créer une image forte, il est minuit et moins une, il faut agir, créer une situation où l'image s'érode avec le temps et peut devenir autant de... démobilisatrice qu'elle a été mobilisatrice à une certaine époque. Donc, pour reconnecter avec la science-fiction, la science-fiction ne fait que ça, mais à une échelle, évidemment, à une ampleur décuplée, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler avec une image, on construit des mondes, on articule des centaines et des milliers d'images ensemble, mais la logique fondamentale reste sensiblement la même.
- Speaker #1
Justement, autour de cette logique d'image, j'imagine que l'intérêt, c'est que l'image soit la plus réaliste possible pour nous mobiliser. Et donc, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment de l'importance à ce que la climat de fiction soit une fiction qui soit en fait sourcée et qui s'appuie sur des données réelles ?
- Speaker #0
Oui, d'avoir des assises solides est important, mais évidemment le domaine du roman ou du film de fiction ou de l'œuvre d'art n'est pas le réalisme scientifique. parce que sinon ça deviendrait un traité ou un livre pédagogique mais c'est un réalisme subjectif, c'est-à-dire comment on se sentirait à vivre dans ce monde-là là où est la force de la science-fiction et de l'art et d'expliquer ou en tout cas d'explorer notre rapport subjectif à des réalités objectives externes donc que ce soit sourcé c'est important parce que bien Je peux bien, je sais pas moi, écrire un roman de science-fiction sur le fait que demain matin, il y a une nouvelle ère glaciaire. Bon, le film a été fait probablement 15 fois. Subitement, une nouvelle ère glaciaire apparaît et comment les gens doivent survivre là-dedans. Donc, c'est une prémisse, mais évidemment qui n'est pas appuyée sur aucune tendance de fond. Il n'y a aucun scientifique qui soutient ça. Et là, ça devient comme un exercice. qui se nourrit de lui-même, qui est juste, bon, OK, voilà une prémisse intéressante, on va l'explorer. La fiction climatique, elle veut connecter avec les réalités de notre temps. Donc, minimalement, elle tente de s'arrimer sur des tendances qui sont quand même plausibles d'une certaine façon, même si elle les exagère. Le lien avec la science sourcée et rigoureuse, il est là, mais un ne mène pas à l'autre, nécessairement. C'est ça.
- Speaker #1
Par exemple, pour illustrer ce qu'on dit, le jour d'après peut pas être dans la catégorie « climate fiction » . C'est trop à côté, entre guillemets, de données réelles pour être dans ce type-là, mais ça reste une œuvre de fiction.
- Speaker #0
Oui, absolument. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, comme dans n'importe quel genre littéraire ou dans n'importe quel découpage qu'on tente de faire à l'intérieur des œuvres artistiques, les frontières ne sont jamais totalement imperméables et une œuvre comme ça, Comme la Guerre des Étoiles peut être vue comme de la science-fiction par certains et juste une fantaisie par d'autres.
- Speaker #1
Le fameux débat de Star Wars.
- Speaker #0
Oui, mais le jeu peut s'appliquer directement au jour d'après. C'est-à-dire que oui, on parle de grands bouleversements climatiques, mais... qui est juste un divertissement avec du popcorn. Il n'y a pas de prise sur vraiment des préoccupations que les gens ont. Tout à fait.
- Speaker #1
Alors, il y a quand même un contre-exemple plus concret et plus intéressant qu'on va discuter tout de suite. C'est un livre de Michael Crichton qui s'appelle « État d'urgence » et où justement, en fait, l'auteur, lui, va plutôt... C'est peut-être un des seuls livres, je vais dire, climato-sceptiques qu'on peut quand même mettre dans la catégorie « climate fiction » . Puisqu'il va parler de problèmes climatiques tout en minimisant la responsabilité de l'homme. Il va d'ailleurs pratiquement parler d'environnementalistes qui sont en fait des fanatiques égarés, perdus dans leur délire.
- Speaker #0
Et carrément des terroristes dans son livre. Voilà.
- Speaker #1
Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce bouquin de Christen ?
- Speaker #0
Ben, c'est un livre intéressant. Si je ne me trompe pas, c'est le dernier qu'il a écrit de son vivant. Après ça, il y a eu d'autres ouvrages publiés, mais qui avaient été écrits avant ça. Donc, ce livre-là est vraiment le dernier que Christian avait vraiment conscience d'être en train de publier. Et le livre se termine par une note de l'auteur qui devient d'une certaine façon son testament intellectuel, qui est extrêmement intéressant parce qu'effectivement, le livre a été taxé d'être climato-sceptique. On pourrait débattre. Christian se dit plutôt agnostique, mais agnostique en 2004, bon, c'est pas nécessairement se rendre à l'évidence. Mais l'élément qui est intéressant dans ce livre-là, c'est le côté, on pourrait dire, techno-optimiste de Christian. Donc, c'est vraiment, à mon avis, le message qui ressort du testament de quelques pages qu'il met à la fin, où en gros, il dit, oui, bon, le changement climatique... c'est clair qu'il existe, c'est clair qu'il y a du changement climatique, une portion est naturelle, une portion est causée par l'humain, donc les débats habituels. Mais là où son discours devient plus particulier, c'est quand il dit « dans le fond, ce n'est pas important » . C'est-à-dire qu'il le dit carrément, il dit « moi, je ne m'en fais pas pour les humains de l'an 2100. Ils vont vivre mieux que nous, ils vont consommer plus d'énergie que nous. » Et on parlait tout à l'heure de la prospective. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il extrapole à partir d'une tendance, disons certainement, du développement humain depuis le début du 19e siècle ou quelque chose comme ça. En disant, finalement, ce qu'il dit, c'est que chaque génération a vécu mieux que ses parents pendant de nombreuses décennies et quelques siècles sur la planète. Chaque génération a trouvé des solutions technologiques aux problèmes de la génération d'avant. On a résolu des problèmes d'approvisionnement de nourriture, des problèmes d'approvisionnement en eau, de gestion, par exemple, de la salubrité dans les villes, qui était un problème tout à fait catastrophique au 19e siècle. On a amélioré les systèmes de chauffage, etc. Donc, Christian, s'il pêche par quelque chose, c'est par son optimisme et, je dirais, par son évolutionnisme, en disant que chaque génération humaine vit mieux que ses ancêtres et ça va continuer. pour l'éternité. Depuis la publication du livre, en 2004, en fait, on commence à voir quelque chose qui est inédit, c'est-à-dire où on voit des avancées historiques commencer à reculer. L'espérance de vie, par exemple, dans les pays industrialisés, commence à régresser. La santé, le bien-être, certainement le bien-être psychologique, ne sont pas en constante progression. Elles ont atteint un plateau et il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que la qualité de vie en général et la prospérité se dégradent. Les pays occidentaux, par exemple, connaissent des baisses de productivité, ce qui était quelque chose d'inédit. Donc, Crichton injecte trop d'optimisme dans ses projections et dit finalement, un peu comme chez Asimov, on a déjà parlé de fondation, mais la planète de 30 heures... pas eu à composer avec les problèmes de l'urbanisation. Elle est devenue totalement une ville et ça pose aucun problème. Elle est encore plus prospère que n'importe quelle autre planète. Donc, il y avait cette notion-là de développement infini et de la capacité des humains à trouver tout le temps des solutions technologiques.
- Speaker #1
Et c'est un courant qui, au final, est quand même relativement présent dans nos sociétés. Il y a toute une partie d'ingénieurs, de chercheurs, etc., qui ont cette espèce de techno-optimisme. où ils te disent, jusqu'ici, on a toujours trouvé une solution à nos problèmes, il n'y a pas de raison qu'on n'en trouve pas une cette fois-ci. Donc, continuons à avancer comme on le fait et la solution arrivera.
- Speaker #0
Oui, sauf que ce qui a été observé, c'est que les solutions qui sont proposées sont toujours de plus en plus coûteuses. Par exemple, l'idée de délocaliser la production industrielle dans l'espace, d'aller miner des astéroïdes, d'aller s'installer sur Mars, etc., requiert des ressources extrêmement, en quantité énorme, à une échelle où la planète ne peut pas supporter ce genre d'investissement-là à grande échelle. Oui, il y a quelques multimilliardaires qui vont aller faire du tourisme spatial. On peut créer quelques stations, mais vraiment détendre la sphère d'habitation normale de l'humanité au-delà de la Terre est quelque chose de très, très peu probable.
- Speaker #1
Dans cette climé de fiction, au final, on retrouve toute une série de thèmes relativement communs qui émergent de façon assez régulière. Je voudrais qu'on s'en attarde sur quelques-uns. Il y en a plein, mais on ne va pas tous les mentionner. La première thématique que je voudrais voir avec toi, c'est cette fameuse conscience collective de la situation. C'est un peu cet appel à l'action pour lutter contre l'injustice et la domination de ceux qui cherchent à monopoliser les ressources. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce thème ? Et au final, au-delà de ce que tu peux nous en dire, c'est au niveau anthropologique, qu'est-ce que ces récits nous racontent sur notre humanité, en fait, du point de vue de ce thème ?
- Speaker #0
Oui. D'un... Le champ de la gestion des ressources naturelles, il existe un scénario qui est bien connu et étudié depuis longtemps qu'on appelle la tragédie des communs. C'est la difficulté d'amener les humains à gérer une ressource commune quand on a des bénéfices à en abuser personnellement. On dit, prenez pas votre voiture, on voit le bénéfice que la planète... en tirait si l'ensemble des humains cessaient d'utiliser leur voiture ou diminuaient dramatiquement. Mais à l'échelle d'une personne, ça peut être très pratique de prendre la voiture et d'aller quelque part. Et il y a un effet pervers là-dedans, c'est que moins les gens prennent leur voiture, par exemple, moins il y aura d'embouteillage.
- Speaker #1
Et donc, plus ce sera intéressant de prendre la voiture.
- Speaker #0
Exactement. Donc, ça devient un incitatif à mesure qu'on avance collectivement vers notre... but, bien là, il y a l'incitatif pour une personne d'en tirer parti et là, c'est l'effet domino. Le voisin dit, si lui prend sa voiture et moi, je me prive, pourquoi ce serait moi ? Il y a eu des volumes et des volumes d'écrits sur des manières de surmonter ce genre de défi extrêmement pervers pour l'humanité et on se rend compte que c'est une tâche. Donc, une des solutions possibles, c'est de se créer un cadre institutionnel. en disant que c'est carrément illégal. Si tu prends ta voiture, tu as une contravention. Dans la ville de Mexico, par exemple, ça marche avec les plaques d'immatriculation. Selon le numéro, certaines journées, tu as le droit de prendre ta voiture, d'autres journées, non. Et si tu as le mauvais numéro de plaque la mauvaise journée, c'est une contravention. Donc, d'ajouter des sanctions devient une façon de le faire. Une autre manière, c'est par des appels à la moralité, à développer une conscience au-delà de notre intérêt personnel. qui est le défi avec lequel le mouvement écologiste compose depuis des décennies, d'amener les gens à faire ce qu'on appelle les petits sacrifices pour un bien-être plus grand. Mais à chaque fois, il y a toutes sortes de débordements et d'effets qui viennent à l'encontre de cette dynamique-là. Et à l'échelle globale, cette dynamique-là joue énormément parce qu'il y a le discours de certains pays en développement. L'Inde au premier chef, la Chine aussi, qui vont dire aux pays occidentaux, mais l'Inde est particulièrement frappante de ce côté-là. Elle dit, regardez, vous l'avez eu, votre révolution industrielle. Vous l'avez eu, votre développement immense basé sur une pollution totale de votre environnement. Et maintenant, vous voulez nous en priver. Vous voulez que nous soyons les purs et restions dans la pauvreté alors que vous avez... pris tous ces bénéfices-là. Donc là, il y a la question de la justice climatique qui entre en jeu.
- Speaker #1
Et de la justice sociale derrière. Il y a toutes des questions derrière de justice. Et comme je dis toujours aussi, la justice n'est pas absolue, elle est relative. Ce qui est juste pour quelqu'un ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Et donc, on est sur des choses qui sont difficilement objectivables.
- Speaker #0
Même ces dernières semaines, il y a eu des sommets, des discussions encore une fois sur les compensations financières liées. Disons que les pays du Nord devraient payer aux pays du Sud. compenser cette inéquité-là. Évidemment, comme toujours, c'est extrêmement difficile que les pays riches se client à ce genre d'injonction-là.
- Speaker #1
Une autre thématique qui, de ce que je sais, te plaît beaucoup, c'est tout cet aspect géoingénierie. comme tu le disais, cette analyse du techno-optimisme, que nous disent les fictions climatiques sur cette géo-ingénierie, sur ce techno-optimisme au final ?
- Speaker #0
Le thème m'intéresse, mais ne me plaît pas particulièrement. Donc,
- Speaker #1
la nuance, oui. Tu as raison.
- Speaker #0
Mais c'est sûr qu'on a fait référence tout à l'heure à la science-fiction classique. Donc, vraiment la science-fiction très technophile qui a défini le genre. Et on trouve certainement des... des descendants de cette vision-là encore aujourd'hui, dans la vie réelle. Elon Musk, par exemple, qui va encore piloter l'idée qu'il y a moyen d'intervenir sur notre milieu. Mais il y a un auteur qui se nomme Neil Stevenson qui a écrit un roman qui s'appelle « Choc terminal » qui est tout entier construit autour de cette notion de géo-ingénierie. contrebalancer les changements climatiques. Donc là, c'est vraiment un scénario où on envoie des fusées avec des particules dans l'atmosphère qui vont bloquer les rayons du soleil, accentuer...
- Speaker #1
Généralement, quand tu parles de quelque chose comme ça, on en a parlé durant la préparation, mais moi, ça me fait toujours penser à l'effet Jurassic Park, c'est-à-dire que il y a tellement eu d'histoires sur des modifications volontaires du climat ou sur les dinosaures de Jurassic Park que... Quand quelqu'un va réussir à le faire, on sait tous que ça va mal se passer. Il y a tellement de récits qui racontent que ça se passe mal qu'il n'y a aucun monde, comme je dis, où ça peut bien se passer.
- Speaker #0
Et Neil Stevenson, si vous ne connaissez pas cet auteur-là, c'est véritablement un génie. C'est quelqu'un qui a toujours une vision un peu inattendue sur certains sujets. Et son approche à cette question-là est aussi intéressante. C'est-à-dire, il met en scène les promoteurs de ce genre d'initiatives-là. Certains pays, par exemple, qui sont plus particulièrement touchés par les canicules, des choses comme ça. Donc, il y a tout un réseau mondial de techno-optimistes qui décident de lancer ces fusées, d'injecter des produits chimiques dans l'atmosphère, etc. Et eux, leur approche, d'où le titre du roman, c'est de dire, bien, on n'a pas à régler le problème. On a juste à intervenir. jusqu'au point où ce serait encore plus dommageable qu'on nous arrête que si on continuait. Donc, le choc terminal, c'est une... Je fais référence à la pharmacologie, c'est-à-dire les conséquences qui viennent à quelqu'un qui suit un traitement de médicament, les conséquences de l'arrêter subitement. Des fois, bon, c'est ça qui peut tuer le patient. Donc, eux, ils veulent juste arriver au point de non-retour où on est obligé... de persister dans des stratégies de géo-ingénierie parce que leur mettre fin serait pire que le problème qu'on essaye de régler. Donc, très cynique, très sombre comme vision, mais qui résonne avec la manière dont, par exemple, les grandes puissances économiques traitent le système capitaliste mondial, c'est-à-dire comme il le disait en 2008, autour de la crise financière américaine, « too big to fail » . Donc, il vient un point où ... Notre intervention atteint une échelle telle qu'on ne peut plus l'arrêter, au risque de s'endommager nous-mêmes. Tout ça pour dire que les scénarios plausibles de géo-ingénierie restent à tester certainement. Il y a eu des scénarios de déployer un grand parasol, par exemple, en orbite pour bloquer les rayons du soleil, envoyer des particules d'aluminium. je ne sais pas quoi, dans l'atmosphère pour augmenter l'albédo de la Terre qui reflèterait davantage de rayons, l'ensemencement de nuages, ce que vous voudrez. Mais si je ne me trompe pas, Dubaï le fait, l'ensemencement de nuages déjà.
- Speaker #1
Et est-ce que justement, en reprenant ce concept de choc terminal, tu ne penses pas qu'on est sur cette voie-là ? C'est-à-dire que plutôt que de vouloir faire des efforts, on continue sur notre système ? Parce que je pense... L'être humain a une résistance au changement qui est quand même relativement importante. Et au final, on va atteindre ce point où à un moment, si on décide d'arrêter, en fait, ce sera plus dommageable que de pouvoir arrêter.
- Speaker #0
Oui, tu parles de l'effet Jurassic Park, mais il y a cet élément-là de jouer à l'apprenti sorcier parce qu'il n'y a certainement pas d'antécédent. Donc, il n'y a pas d'expérience antérieure sur lesquelles... on pourrait s'appuyer pour avoir vraiment une approche rigoureuse, un peu comme un chirurgien approcherait une chirurgie, en disant « OK, voici, on a une connaissance très pointue de l'anatomie humaine, il y a des milliers de personnes qui ont fait la procédure avant moi, on l'a perfectionnée, etc. » Là, c'est « il faut l'avoir du premier coup, sans trop savoir sur quoi on agit. » Donc déjà, c'est un problème. Et au-delà de ça, il y a un auteur en particulier, un philosophe, qui s'appelle Timothy Morton, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les hyper-objets » . Et Morton amène justement cette idée-là qu'aujourd'hui, vu qu'on essaie d'intervenir sur des systèmes globaux, on est aux prises avec des systèmes qui dépassent de loin notre capacité à les comprendre. Et pour lui, il existe minimalement deux de ces systèmes-là, c'est-à-dire le premier, c'est le capitalisme lui-même. On a vu justement avec les crises financières, etc., La complexité de l'économie mondiale, elle a atteint un point tel qu'il n'y a plus une personne qui la comprend dans sa totalité. Il y a des boucles de rétroaction, il y a des niveaux de complexité, il y a des points où on est face à un système qui va avoir des comportements des fois tout à fait imprévisibles. Bon, encore là, Jurassic Park explorait cette idée-là avec la théorie du chaos en disant, finalement... Quand un système atteint un certain degré de complexité, ses comportements deviennent beaucoup plus difficiles à comprendre. Et Morton va dire qu'en fait, un hyperobjet est au-delà de ce point-là, dans la mesure où il n'a à peu près pas d'état stable. Le deuxième système dont il parle, c'est le climat mondial. Et ça, c'est ce qui fait peur aux climatologues qui sont impliqués dans la prospective, c'est-à-dire la perspective. d'une transformation de notre climat qui n'est pas linéaire, mais qui a des courbes catastrophiques, c'est-à-dire des moments où le changement se déroulerait d'une manière très, très brutale. Parce que beaucoup de modèles qu'on a, c'est bon, il y a le réchauffement graduel, le CO2 s'accumule, etc. Mais par exemple, en Antarctique, il y a des glaciologues qui parlent du glacier de l'apocalypse, c'est-à-dire une... plaque de glace immense qui, je ne me trompe pas, au moins de la grandeur de l'état de la Floride, probablement de la grandeur de la Belgique. Beaucoup plus la Belgique.
- Speaker #1
Tout très kiki.
- Speaker #0
Quelques Belgiques, disons, et qui tient à un fil. Elle est vraiment au point presque de se séparer du continent antarctique et de se mettre à dériver. Donc, ils disent, si cette masse de glace-là s'ajoute aux océans, ce ne sera pas... On n'est pas... plus dans du changement linéaire, on est vraiment dans un impact brutal. Un peu... Bon, je parlais des catastrophes de la fin du Pleistocène, qui étaient dans un autre ordre de magnitude, mais il y a toujours cette crainte-là devant de tels événements. Comme par exemple, ces derniers mois, on a vu apparaître des publications de scientifiques qui disent « On a fait des calculs sur la fonte des glaces et la fonte du pergélisol et la quantité de... de CO2 et de méthane que ça va injecter dans l'atmosphère. Mais on avait oublié, un petit oubli, d'inclure dans plusieurs calculs la fonte des fonds marins. Donc, il y a du pergélisol aussi au fond de certaines portions de l'océan Arctique. Et là, les scientifiques se rendent compte que ça aussi, c'est en train de fondre et qu'il y a de l'émission de méthane qui vient de se rajouter par-dessus la portion terrestre. Donc là, ils disent « OK, ça, ça change la courbe. » Et dans les fictions climatiques, on voit ce genre de raisonnement-là beaucoup dans des scénarios, justement, de changements apocalyptiques brutaux. Margaret Atwood, entre autres, a fait une trilogie qui s'appelle la trilogie « Mad Adam » sur un monde qui viendrait après une catastrophe climatique, mais sa prémisse, elle est exactement celle-là. qui est celle de, non pas le lent glissement vers un monde transformé, mais vraiment un changement brutal qui fait que du jour au lendemain, l'humanité doit s'adapter d'un coup.
- Speaker #1
On arrive tout doucement à la fin de l'épisode, et il y a une question quand même fondamentale que je voulais te poser, c'est, à ton avis, comment peut-on mesurer, pour peu qu'on puisse le mesurer, mais en tout cas, quelle est l'importance de l'art au sens général, donc pas juste... les récits de science-fiction, mais vraiment l'art dans sa globalité. Quelle est l'importance de l'art comme générateur de mouvements sociétals, comme générateur de changements ? Et au final aussi, est-ce que l'art peut influencer à l'heure actuelle les débats sur les enjeux sociaux et écologiques qu'on devra relever dans le futur ?
- Speaker #0
En fait, il y a un vieux thème dans le changement social, on le voyait en mai 68, l'utopie maintenant. C'est un thème qui est très important. On le voit dans, bon, j'ai fait une recension de toute la littérature sur, par exemple, l'état de l'Afrique et son développement, où il y a une série de titres du genre l'utopie ou la mort, etc. Devant les grands défis mondiaux auxquels on fait face, Il y a plusieurs personnes qui commencent à dire que le changement graduel, réformiste, n'est plus véritablement une option. Le temps de mettre en place certaines mesures, ce mesure en décennie, si ce n'est pas en siècle, pour vraiment qu'on ait les effets, par exemple, de transition énergétique, des choses comme ça, si c'est fait vraiment au goutte à goutte, les bénéfices ne viendront pas au moment où on en a besoin. Donc, il y a ce nouvel appel qu'on voit et qu'on trouve, entre autres, dans un roman récent d'un des piliers des fictions climatiques, Kim Stanley Robinson, auteur qui a écrit la trilogie martienne, beaucoup de textes sur des fictions climatiques. Dans son dernier roman, le roman est intitulé Le ministère du futur. Et dans ce roman-là, justement, il y a une critique du gradualisme pour dire... En fait, ça prend des actes d'imagination, ça prend des actes de réinvention fondamentale de beaucoup de dimensions de notre vie. Ça sonne comme un slogan des hippies des années 60, mais ces auteurs-là, scientifiques dans certains cas, auteurs de fiction, artistes, vont dire qu'en fait, aujourd'hui, ça devient un peu une question de survie. Bon, il y a des aspects problématiques dans le roman de Kim Stanley Robinson sur... la brutalité de la mise en place de certaines des politiques qui l'amènent, mais la réflexion de fond, elle est là, c'est-à-dire que la voie réaliste est une voie qui demande un travail d'imagination radicale, c'est-à-dire un travail de réimagination, pas juste de notre manière de vivre localement, mais des rapports globaux entre le Nord et le Sud. une réflexion sur la reconfiguration des chaînes de production sur la planète. Donc, on est vraiment dans une pensée qui doit réinventer, d'une certaine façon, notre manière de vivre. Donc, encore là, on parlait de Christian et son roman État d'urgence, où lui disait, juste continuer à innover, l'innovation, la créativité humaine normale va régler le problème. Ici, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a vraiment un effort. plus délibéré et plus conscient et plus appuyé d'imagination et de réimagination qui est nécessaire. Et là, on entre dans le domaine qui est celui de la création artistique, autant que celui de la réflexion scientifique. Et ça, on l'a vu abondamment, comme on disait, le GIEC, sa tâche est d'accumuler des données probantes et de les compiler, etc. Mais accumuler des données ne mène pas naturellement à des solutions. Ça forme une assise de données. Et tôt ou tard, il y a une sorte de saut qualitatif qui doit être fait vers des propositions de dire, OK, voici une réimagination de nos sociétés.
- Speaker #1
J'ai l'impression que l'élément à retenir dans tout ça, c'est aussi, comme tu le disais à plusieurs reprises, c'est que cette projection dans le futur peut réellement influencer notre présent. Le fait d'imaginer le futur peut avoir un impact sur le présent. Et s'il y a bien quelque chose qui nous permet d'imaginer le futur, c'est l'art sous toutes ses formes. et de nous projeter dans quelque chose pour voir si on est OK ou pas OK.
- Speaker #0
Oui, absolument. Et on le sent autour de nous, au quotidien. Il y a un besoin criant pour des futurs optimistes. Et justement, il y a fait brièvement allusion, mais à l'intérieur des fictions climatiques, on voit émerger depuis quelques années ce qui a été nommé le « solar punk » . donc des scénarios de réimagination des sociétés humaines basées sur l'énergie solaire et plus largement le hope punk le punk de l'espérance où on tente de présenter des utopies positives finalement, on revient vraiment à ça pour donner quelque chose à quoi se raccrocher et à quoi raccrocher l'action plutôt que d'avoir juste des actions désespérées devant les grandes pétrolières etc alors je...
- Speaker #1
pense qu'on n'en a pas parlé durant la préparation, donc je sais que je vais te prendre au dépourvu et j'en suis désolé. On finit chaque épisode par une citation et je ne sais pas si tu en as une sous la main.
- Speaker #0
Je l'ai déjà donné. Je pense que la citation d'Albert Jacquard de tout à l'heure est tout à fait appropriée, c'est-à-dire lorsqu'il mentionne qu'avec l'avènement de la conscience humaine, le futur devient causal. Donc, réfléchir au sens de cette phrase-là peut certainement nous aider à saisir toute cette anthropologie du futur, toute la place et toute l'utilité que peuvent avoir les œuvres d'art consacrées aux fictions climatiques.
- Speaker #1
Super. Martin, merci beaucoup pour ces échanges. Cher auditeur, chère auditrice, j'espère que tu as apprécié toutes ces réflexions sur cette fiction climatique et sur ce qu'elle peut ou non apporter à notre société et dans les défis aussi. qu'elle va devoir relever dans un futur proche et plus lointain. On se retrouve dans quelques semaines pour la nouvelle saison, et non pas le prochain épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Bumons. À très très bientôt. Martin, salut, et on se retrouve aussi certainement dans la saison 9 pour un échange sur un sujet qu'on n'a pas encore déterminé, mais on échangera là-dessus.
- Speaker #0
On va se retrouver certainement.
- Speaker #1
Super, bonne journée et à très très bientôt. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons, et franchement j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.
- Speaker #2
Bonjour, je m'appelle Jean-Claude, je suis le directeur de l'Université de Paris.



![[Trailer] Épisode 129 - Carlo Rovelli cover](https://image.ausha.co/YnEtkz8bZtJQXmnEN5a0iLkU3SHNCkEV5nxH6C8J_400x400.jpeg)
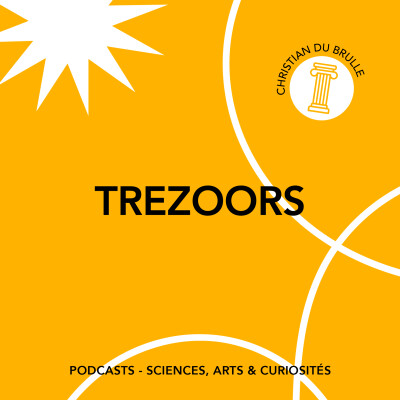
![[Trailer] Épisode 128 - Trezoors | Feat. Christian Dubrulle cover](https://image.ausha.co/e2hRPNecxKZRvrf3YnZcZptQucTv1C7oh4jW4oj3_400x400.jpeg)