- Speaker #0
Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
- Speaker #1
Ce qui place votre zone d'atterrissage à 5,0667 degrés de latitude nord et 77,3333 de longitude ouest. Rien de tout ça derrière.
- Speaker #0
Qu'est-ce que le réel La seule variable constante est l'inattendue. On ne peut pas la contrôler. Je crois que vous êtes encore pire que ces créatures. Elles, elles n'essaient pas de se massacrer entre elles pour tirer le plus gros. Voyons si une capacité de poussée de 10% permet le décollage.
- Speaker #1
Et 3, 2, 1...
- Speaker #0
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Alors aujourd'hui, je commence une série d'épisodes qui me tient vraiment beaucoup à cœur. En collaboration avec une toute nouvelle chaire de l'UMONS, qui s'intitule Ingénieur Objectif Transition, je vais accueillir toute une série d'invités. qui vont aborder avec moi les enjeux socio-écologiques au travers de plusieurs épisodes qui seront répartis à partir d'aujourd'hui dans les prochaines saisons. Alors la particularité de cette série, c'est qu'elle va coexister avec un ensemble de conférences proposées par la chaire. En effet, les invités sont déjà intervenus et leur présentation, leur intervention, est, en tout cas pour la personne que j'accueille aujourd'hui, déjà en ligne sur la chaîne YouTube du MUMONS. Alors... Cher auditeur, chère auditrice, tu vas me dire, pourquoi faire un podcast sur quelque chose qui existe déjà Et bien, simplement pour venir enrichir tout ce qui a été échangé, partagé, durant leurs interventions. Pour éviter, en fait, de longues séances de questions-réponses durant les conférences, les organisateurs, et je profite du podcast pour leur faire un petit coucou, et moi, on a décidé, en fait, de proposer au public d'écrire une ou plusieurs questions à destination des intervenants sur un post-it. Nous avons récupéré ces post-its, Christine et Sébastien qui se reconnaîtront les ont triés, rassemblés, synthétisés, et on obtient ainsi toute une série de questions-réactions que je vais aborder justement dans cet épisode avec mon invité du jour. Alors pour les habitués, tu me connais, je me garde quand même quelques questions perso sous le coude. C'est ainsi qu'aujourd'hui, suite à la conférence Limite Planétaire et Donut, que tu peux déjà retrouver sur la chaîne YouTube du MUMONS comme je le disais, J'accueille Paul van der Straten. Salut Paul.
- Speaker #1
Salut Maxime.
- Speaker #0
Comment vas-tu
- Speaker #1
Je vais très bien, merci.
- Speaker #0
Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est Paul van der Straten
- Speaker #1
Oui, moi c'est Paul. Et donc je travaille à l'ASB, qui s'appelle le RCR Carré, le Réseau des Collectifs en Recherche de Résilience. Et je suis affecté là-bas à un projet sur le donut justement. Le projet s'appelle BeDunut. Donc voilà, j'invite... tous les auditeurs et les auditrices à aller voir notre nouveau site web qui vient de paraître très récemment pour voir tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est pour ma casquette professionnelle. Sinon, je suis un Bruxellois d'une trentaine d'années. Et voilà pour l'essentiel, il me semble.
- Speaker #0
Parfait. J'ai deux petites questions à te poser pour compléter un peu cette présentation. Et c'est des questions que je vais essayer de poser à chaque invité qui viendra dans le cadre de la chaire. Est-ce que tu peux nous partager un échec écologique dont tu es fier
- Speaker #1
Alors, un échec écologique dont je suis fier En tout cas, un échec écologique dont je suis fier, je ne sais pas. Mais un échec écologique qui est très actuel, c'est ma consommation de chat GPT. D'accord, ouais. C'est vrai que c'est au niveau, je dirais, des gros postes un peu environnementaux classiques auxquels on pense, consommation de viande, déplacement, etc. Comme moi, je suis sensibilisé. Ce sont des sujets qui me tiennent à cœur depuis longtemps. J'ai quand même déjà pas mal adapté mon style de vie. Mais récemment, je trouve l'intelligence artificielle quand même redoutablement efficace pour mon travail. Mais je sais pourtant que ça pollue énormément. Et donc là, je suis vraiment en dissonance cognitive et j'ai du mal encore à la résorber ou à trouver une ligne de conduite dans laquelle je me sentirais bien. Mais comme c'est tout nouveau, je me laisse un peu le temps d'y réfléchir. Et j'espère que je vais trouver une solution.
- Speaker #0
Très bien. Et je vais dire, à l'autre extrémité du spectre, une réussite écologique qui te paraît importante pour toi
- Speaker #1
Au-delà de mes gestes à moi, quotidiens, etc., qui sont importants quand même, je continue à le penser. Je pense que c'est mon engagement, sans doute au sein de mon métier. Je fais partie aussi d'autres organisations comme les Shifters. Et donc là, je pense... C'est sans doute la chose dont, sur le thème de la transition de serre, je suis le plus fier, c'est de participer à ce grand projet qui est le Donut et qui va vraiment dans la bonne direction, je pense. Et donc, voilà, je travaille et je trouve beaucoup de sens.
- Speaker #0
Super. Alors justement, on va quand même... en trois minutes top chrono, remettre un cadre pour que l'auditeur et l'auditrice qui n'auraient pas encore vu la vidéo sur YouTube, et c'est une vraie invitation, n'hésitez pas à aller la voir parce que ça va être vraiment complémentaire, mais pour comprendre le cadre, est-ce qu'en trois minutes, tu peux nous expliquer ce qu'est le donut
- Speaker #1
La théorie de donut, c'est une théorie qui a été inventée par Kate Haworth, une économiste anglaise contemporaine, et elle, elle regarde l'état du monde un peu avec ses... C'est l'unette d'économistes et elle remarque qu'aujourd'hui, nos sociétés sont vraiment toujours mues et animées par la volonté de croître au niveau économique, ce qu'on appelle la croissance économique, qui est mesurée par l'augmentation du PIB. Ça reste l'objectif principal, tant au niveau macroéconomique que même au niveau microéconomique des entreprises, surtout des grosses entreprises qui cherchent toujours à augmenter leur part de marché, augmenter leurs profits, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... À la base, cette croissance économique était attachée à une promesse de prospérité forte. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde vraiment les chiffres, cette prospérité n'est plus d'actualité. Dans le sens où il y a vraiment des gros dépassements environnementaux, des gros enjeux écologiques qui se posent aujourd'hui. Et puis même au niveau social, on remarque que nos sociétés sont de plus en plus polarisées en termes idéologiques. On le voit aujourd'hui avec Trump, les Musk, etc. Dans beaucoup de nos pays aussi. Et puis même au niveau social, au niveau des revenus, il y a de plus en plus d'écarts de richesses qui se creusent. Et donc elle, elle pense qu'il faut redéfinir la façon dont on conçoit le bien-être par rapport à ses enjeux, en fonction de, non pas de chercher toujours à croître, toujours de façon indéfinie le plus loin, mais de penser la prospérité en fait comme un espace entre deux limites essentielles, un plafond écologique qui est le cercle extérieur du donut, qui est composé de différentes limites et frontières planétaires. Et puis, un plancher social de l'autre côté, qui est le cercle intérieur du donut, et qui empêche les individus de tomber dans différentes formes de pauvreté et de précarité. Voilà en très gros ce qu'est l'idée du donut. Donc, l'idée de viser cet espace, vraiment l'espace de la chair du donut, qui est donc un espace juste d'un point de vue social et sûr d'un point de vue écologique.
- Speaker #0
Alors justement, la première question, et donc ici, je passe dans les questions qui ont été rassemblées et qui donc, au final, représentent un petit peu... ce qui s'est passé dans l'amphi lorsqu'il y a eu la présentation et les questions qui ont émergé chez les gens. La première question que je voudrais te poser, justement, en me faisant porte-parole de ces personnes, c'est quel est le statut exact du donut Est-ce que c'est une théorie et un modèle Est-ce que c'est plutôt un outil visuel et quantitatif pour le développement durable Comment ça se positionne un peu comme outil
- Speaker #1
Très bonne question, en effet. Alors, à la base, c'était vraiment une... théorie que Keith Hort a écrite. C'est son livre dans les années 2010 qui est paru, La théorie du donut. Et en fait, ça a reçu tellement d'échos positifs. Les gens se sont tellement dit, en fait, moi j'ai envie de m'approprier ce modèle-là qui me parle, qu'on est de plus en plus en train de se diriger vers quelque chose de plus concret qu'une théorie, qu'on pourrait appeler un modèle sans doute, donc avec une partie plus théorique, mais aussi des outils, des instruments qui viennent rendre vraiment cette théorie très concrète. On peut parler aujourd'hui de modèle parce que c'est vraiment quelque chose qui est applicable sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de territoires, d'entreprises, d'organisations, etc. qui se l'approprient. Donc voilà, on a dépassé le stade de la théorie aujourd'hui.
- Speaker #0
Et c'est un outil international. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas juste en Belgique qu'on l'utilise. C'est vraiment partout dans le monde que cet outil est en train de s'incarner à différents endroits.
- Speaker #1
Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très stimulant à observer et même à participer. Puisque nous, avec Bruxelles, on a été une des villes un peu pionnières. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a vraiment un énorme réseau, particulièrement de villes, mais aussi au niveau d'entreprise, ça se développe fort. Et donc, il y a des échanges de pratiques avec toutes ces villes, des partages de savoirs, des échanges d'expériences. Donc, c'est super riche de ce point de vue-là. Et en effet, cette dimension globale, je pense qu'il y a des initiatives de note dans tous les continents du monde. En fait, quelque chose d'extrêmement riche.
- Speaker #0
Alors là, il y a une question plutôt sur les indicateurs, c'est-à-dire ce qu'on entend par là, c'est que... Pour avoir cette représentation graphique du donut, il faut utiliser des indicateurs, donc des éléments qui vont nous permettre de dire où on se trouve. Et la personne se demandait, au final, comment sont quantifiés les indicateurs et comment quantifier quelque chose qui intrinsèquement va être qualitatif, par exemple le bien-être. Comment on dit le bien-être est à autant de pourcents ou autant de points, etc.
- Speaker #1
Alors, au niveau des territoires, on quantifie ça vraiment via des indicateurs. Si je reprends par exemple l'exemple de Bruxelles, on a fait tout un travail pour récolter toutes sortes d'indicateurs qui nous disent quelque chose sur l'état écologique de Bruxelles, sur l'état social de Bruxelles. Au niveau social, puisque la question est un peu orientée dans ce sens-là, tu peux un peu appréhender, approcher la question du bien-être via des indicateurs qui disent quand même quelque chose de ce bien-être. Typiquement, si tu as par exemple une population qui consomme beaucoup de médicaments, où il y a... beaucoup d'incarcération, où il y a beaucoup d'analphébitisation, où il y a beaucoup de taux d'obésité, par exemple. Tous des indicateurs de ce type-là On sent en fait que plus il s'empire, plus ça va dire quelque chose, il y a quelque chose comme du mal-être dans la société, le taux de violence, le taux de criminalité, etc. Et donc, à travers ces indicateurs-là, on peut essayer de voir un peu où est-ce qu'on se situe justement au niveau du bien-être humain.
- Speaker #0
Là aussi, c'est une modélisation. J'imagine que pour pouvoir faire un donut dans une ville, il faut aller vraiment pêcher partout différentes informations. les rassembler derrière d'autres informations pour faire apparaître des tendances comme sur le bien-être, par exemple.
- Speaker #1
C'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment un travail de récolte d'indicateurs. Et puis, voilà, c'est un travail qui peut être un peu technique au niveau de la récolte des indicateurs, au niveau statistique, etc. Mais qui est assez riche et intéressant à réaliser aussi.
- Speaker #0
Et est-ce que dans la communauté Donuts, il y a un espèce de mode d'emploi de quels indicateurs vous devez aller voir pour le bien-être, par exemple Ou... un partage d'expériences, etc. Comment ça se passe dans la communauté
- Speaker #1
Donc, à la base, il y avait vraiment le donut standard proposé par le deal. Il y avait donc les neuf limites planétaires qui sont vraiment ce référentiel maintenant standard, reconnu par la communauté scientifique, qui permettent vraiment d'analyser la situation environnementale de façon holistique et complète. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une grosse tendance à se concentrer uniquement sur la question du carbone et qui amène par ailleurs plein d'autres défauts. Donc ça, il y a neuf dimensions, neuf indicateurs qui structurent déjà bien le travail. Et puis après, au niveau social, il y en a douze qui préviennent des objectifs de développement durable. Donc à nouveau, là, Kate Raworth, elle ne sort pas quelque chose de son chapeau. Les objectifs de développement durable, c'est vraiment une grammaire internationale très forte où il y a un consensus où vraiment l'ensemble des pays du monde ont signé, ont dit Ok, voilà, ça c'est des indicateurs qu'on va poursuivre dans le cadre de chacun de nos nations. dans le cadre domestique, pour tous se diriger vers un agenda commun. Là aussi, le socle social, il est assez consensuel, normalement. Ce qui se passe, c'est qu'étant donné la diversité, en fait, des contextes dans lesquels chacune des villes se trouve, à Bruxelles, Bruxelles n'a pas les mêmes enjeux qu'une ville en Amérique du Sud, qu'une ville en Asie, etc. Au sein de ces grandes catégories, de ces grandes dimensions, chaque ville peut venir. remplir, un peu documenter toutes ces dimensions avec des indicateurs qui lui sont propres pour refléter ses enjeux propres. Et alors, Kate Raworth et son équipe peuvent même parfois accepter que certaines dimensions par exemple du plancher social bougent un peu aussi. Par exemple, si on trouve vraiment que la dimension culture est particulièrement importante pour notre ville ou la dimension, comme on en parlera peut-être tout à l'heure, du transport, etc. est vraiment un facteur important. Il y a un peu de latitude à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est qu'au moins ces 12 indicateurs du plancher social soient documentés.
- Speaker #0
Alors, un indicateur que l'on connaît bien et qui parle beaucoup, entre autres, aux ingénieurs et au monde politique, c'est bien entendu le PIB. A priori, et dis-moi si je me trompe, le PIB n'est pas représenté dans le donut. Donc, c'est super intéressant déjà ça. Et donc, la personne se demandait, mais au final, est-ce que c'est vraiment réaliste ou réalisable dans un monde globaliser, d'oublier le PIB. Une autre personne se demandait, mais au final, est-ce qu'on ne peut pas venir nourrir ce PIB en intégrant des éléments comme ceux que l'on prend à la planète dans ce qu'incarne le PIB
- Speaker #1
Très bonne question. Là, je vais quand même renvoyer vers le livre de Kate Raworth aussi, où il y a vraiment, elle, elle prend près de 300 pages, elle a expliqué en fait pourquoi elle propose ce nouveau modèle qui est, c'est vraiment alternatif par rapport au PIB. Donc l'idée, c'est de quand même euh... Non pas forcément mettre à la poubelle le PIB, mais d'avoir vraiment un indicateur, enfin le donut deviendrait l'indicateur principal. Et donc le PIB serait plutôt un indicateur qui serait une sorte d'indicateur économique, une sorte de variable d'ajustement, un outil, mais qui serait au service d'une sorte de prospérité telle que l'a définie le donut. Donc on remplace un peu le statut du PIB comme un instrument économique, mais pas un objectif en soi. Et donc, par rapport à la question, est-ce qu'on pourrait finalement venir alimenter un peu le PIB avec des indicateurs plus du donut L'idée est quand même de s'en détacher vraiment parce que lorsqu'on s'intéresse vraiment à la question du PIB, on se rend compte que le PIB, il résume la question de la croissance économique. Et en gros, je comprends un peu cette question, est-ce qu'il est possible de faire de la croissance, par exemple, verte
- Speaker #0
Je pense que c'est ce qui se dégage derrière aussi, un peu entre les lignes de cette question, tout à fait.
- Speaker #1
C'est ça. Et donc, finalement, de faire quelque chose qu'on connaît, mais en essayant de rendre plus verte nos modèles de production et de consommation. Et ça, quand même, la théorie de note est assez précautionneuse par rapport à ça, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'études en économie qui montrent à quel point, finalement, la croissance verte ne remplit pas vraiment son objectif, si elle visait vraiment à la décarbonation. en fait, à diminuer véritablement l'ensemble des pressions qu'on fait exercer sur l'environnement. Aujourd'hui, il n'y a aucun cas empirique de croissance verte qui en atteste. Donc, même si on prend les économies qui ont été le plus loin là-dedans, comme les économies scandinaves, au Danemark, etc., qui vont très fort dans l'électrification, le développement des énergies renouvelables, etc.
- Speaker #0
D'ailleurs, durant la conférence, je ne sais plus si c'est toi ou c'est Éric Lambin qui présentait ce tableau, où justement, on checkait un petit peu tout ça. Et on voyait qu'il n'y avait aucun cas réel qui, à l'heure actuelle, vient nourrir cette possibilité.
- Speaker #1
C'est ça, il y a plusieurs critères qui viennent vraiment confronter un peu, de savoir si vraiment une croissance peut être dite verte. Et en effet, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun cas empirique qu'il ait. Et si on se basait uniquement là-dessus, il nous faudrait encore des années, des années, des années, enfin beaucoup trop longtemps pour espérer, je dirais, sauver les meubles un peu écologiques. Et donc, ce n'est pas une option, une alternative sérieuse aujourd'hui, la croissance verte. Si on regarde sérieusement les choses, il faut accepter de revoir un peu vraiment nos facteurs de succès, nos indicateurs de succès et donc de repenser les choses à ce niveau-là.
- Speaker #0
Alors justement, tu le disais, pour certaines villes où la mobilité serait peut-être plus importante, c'est des choses qui peuvent apparaître plus clairement. Il y a une question qui a été posée dans ce sens-là, qui disait pourquoi le transport et la mobilité ne sont pas repris dans les facteurs sociaux du donut
- Speaker #1
Oui. C'est une bonne question parce qu'en effet, ça peut paraître comme un indicateur social quand même de base. La capacité de pouvoir se déplacer fait partie vraiment de notre bien-être. Alors je pense justement parce que Keith Howard avait le souci de se baser uniquement sur les ODD, ses objectifs de développement durable, et que, sauf erreur de ma part, il n'est pas repris dedans. Et donc, dans le donut générique un peu standard, on n'en parle pas. Mais je sais que dans la plupart... Lorsque les villes s'approprient et font un peu leur portrait de Notaelle, souvent il y a vraiment des indications, même une dimension en plus sur la dimension de la mobilité, qui est bien sûr essentielle.
- Speaker #0
Et une autre personne, un petit peu dans la lignée de cette question, si tu veux, se demandait mais est-ce que c'est pertinent d'opposer la dimension sociale et la dimension environnementale dans un modèle Et donc je retransforme un peu la question pour me l'approprier, est-ce qu'au final dans ce modèle, c'est vraiment se dire que la dimension... environnementales et la dimension sociale sont opposées. Alors,
- Speaker #1
je vais peut-être faire un mea culpa si mon exposé n'était pas assez clair de ce point de vue-là, parce que vraiment, l'idée de la théorie de notes, c'est de ne pas du tout opposer les deux et de vraiment dire qu'en fait, une réelle prospérité ne peut être atteinte que si vous avez résorbé vos impacts écologiques, mais que vous avez aussi tiré tous les gens hors de la misère, vraiment renforcé votre plancher social pour faire en sorte que cette prospérité, ce bien-être soit réellement partagé avec tous les citoyens et les citoyennes. Comment ça s'incarne Nous, par exemple, typiquement dans nos ateliers, lorsqu'on travaille avec des organisations, des projets, des territoires, etc., chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui est sur la table, on le scrute vraiment au travers de toutes ces dimensions sociales et environnementales pour justement, lorsqu'on se demande, tiens, on va mettre telle action en place ou telle mesure, quels vont être ces impacts sociaux et environnementaux Et si on remarque... que sur telle mesure écologique, elle est très vertueuse, en effet, elle va apporter une bonne chose, mais au niveau social, c'est une catastrophe. C'est vraiment l'idée de pouvoir déjà en prendre conscience et puis de pouvoir modifier ça, quitte en fait à se dire que ce n'est pas la bonne mesure à prendre si c'est à ce point néfaste sur le plan social. Donc vraiment, l'idée, c'est de penser les deux de concert et comme il y avait un slogan qui disait un peu de réconcilier fin du monde et fin du mois. C'est vraiment ça l'objectif de cette théorie.
- Speaker #0
Pour prendre un exemple extrême, on ne devrait pas tomber dans une espèce de dictature verte où toutes les frontières planétaires sont bel et bien respectées, mais où au niveau du palier social, c'est complètement l'enfer. Et à l'inverse, on ne peut pas être dans un monde qui ressemble un petit peu à ce qu'on nous vend pour l'instant, où toutes les limites planétaires sont complètement dépassées, où les frontières planétaires, on verra qu'il y a une nuance dans un autre épisode des podcasts. où en fait le palier social est plus ou moins assuré. C'est vraiment l'idée de cette théorie du donut, c'est de trouver l'intermédiaire, la zone commune entre ces deux éléments.
- Speaker #1
Exactement, c'est ça, c'est de s'assurer ces deux formes de bien-être, bien-être environnemental et social, qui, c'est le pari qui est fait, et l'énorme défi qui est posé aujourd'hui aussi à nos sociétés, mais qui est possible de concilier.
- Speaker #0
Si on prend un peu de recul par rapport à cette théorie, cette théorie, à cette modélisation. Est-ce que toi, tu y vois des faiblesses dans cet outil Est-ce que tu y vois des améliorations possibles qui pourraient être intégrées par la suite
- Speaker #1
Est-ce que j'y vois des faiblesses Une des faiblesses que j'y vois, c'est que c'est encore beaucoup d'acteurs qui se disent c'est sympa, c'est une belle idée, mais ça manque encore de comment vraiment on met ça en application. Et donc ça, c'est un peu notre travail à nous. C'est d'encore multiplier les cas concrets, les exemples de transition, les applications sur le terrain. Il y en a de plus en plus d'outils, de business case, de villes qui se transforment. Mais d'avoir peut-être encore des transformations en plus grande échelle et de montrer vraiment... L'impact transformateur du donut. Ça, je pense que c'est vraiment une chose. Une autre chose, mais qui n'est pas propre, je pense, à la théorie donut, peut-être comme outil, c'est qu'elle peut être un peu vite étiquetée, je pense, politiquement. En tout cas, à Bruxelles, on a eu ces enjeux-là. Et malgré qu'elle essaye de penser vraiment les choses, je trouve, de façon assez large, en matière sociale, environnementale, etc. Et donc, ça devrait normalement parler quand même à tout un chacun. Il se trouve que, voilà, c'est pas... Enfin... politiquement, certaines familles s'y retrouvent mieux que d'autres, et donc, le jeu politique est engagé à ce moment-là, et donc, ça devient un outil de telle partie ou de telle partie, et donc, ça, ça peut être un peu dommageable aussi, je trouve. Mais ça, c'est plus de l'ordre de comment c'est approprié, enfin, voilà. C'est pas inhérent à la théorie du 2 minutes.
- Speaker #0
Je reviens sur le premier point que tu as mentionné, parce que ça me permet de faire la transition avec une autre question qui était connectée, c'est-à-dire que, en tout cas pour la personne qui a posé cette question, l'outil... Donuts paraissait assez complexe à utiliser. Et donc, elle demandait, au final, comment on fait pour ne pas s'y perdre, pour ne pas se noyer Est-ce qu'il existe des ressources qui peuvent aider Par où on commence, effectivement Et tu parlais, justement, d'espèces de boîtes à outils qui peuvent exister. Donc, c'est peut-être l'occasion d'en parler un peu.
- Speaker #1
Oui. Alors, pour ceux qui ont ce sentiment, j'ai envie de vraiment aller sur le site du DEAL, le Donuts Economic Action Lab qui est le site vraiment de... de l'équipe un peu qui entoure Kate Raworth et qui fait vraiment la promotion du donut et qui soutient toutes ces initiatives internationales, qui fait le développement d'outils, etc. Et donc, ils ont, eux, une multitude de ressources, de cas concrets qui permettent vraiment, je trouve, de bien comprendre de quoi il s'agit et des tas d'animations aussi qui permettent, justement, un peu de dégrossir peut-être cette complexité apparente qui n'en est finalement, je pense, pas vraiment une parce que le... Finalement, une des beautés du modèle, c'est quand même qu'il est simple. En une image, on peut comprendre ce que c'est. En une image, cette image du donut, où tu vois finalement peut-être là où tu dépasses et où est-ce que tu devrais aller, tu comprends quelle est l'idée générale. Alors en effet, après, il est possible d'aller plus en profondeur. Il y a notamment les sept principes de la théorie de donut pour ceux qui sont intéressés à aller comprendre vraiment le message et les raisons qui amènent ce modèle. Ou sinon, ce site-là, le site du deal. Et puis après, notre petit site à nous, Bid'e-Notes, où il y a beaucoup de vidéos, de ressources, de documentations, de rapports qui peuvent expliquer un peu mieux ce que veut dire appliquer la théorie de notes. Il y a vraiment maintenant beaucoup de ressources en ligne qui permettent de mieux comprendre.
- Speaker #0
Et j'ai l'impression aussi qu'une façon de mieux appréhender cet outil, c'est de participer à un atelier, en fait. Oui,
- Speaker #1
tout à fait.
- Speaker #0
Nous, le 27 mars, on organise un atelier pour l'Université de Mons. pour essayer de pratiquer un petit peu. Je pense que c'est en le faisant en groupe, avec des personnes qui l'ont déjà fait pour l'une ou l'autre entité, qu'on arrive à s'approprier effectivement cet outil qui peut paraître complexe ou en tout cas, peut-être pas dans le mindset habituel au début.
- Speaker #1
Oui, c'est ça. C'est la voie royale pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, avoir un atelier que notamment nous, on propose. Mais il y en a d'autres aussi. C'est super parce qu'on peut alors vraiment se pencher sur qu'est-ce que ça veut dire Le donut dans le cadre de mon institution, dans le cadre de mon projet, dans le cadre de mon groupe de citoyens. Donc ça, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter ou d'autres pour avoir une appropriation un peu plus en profondeur et se faciliter un peu la vie.
- Speaker #0
Alors justement, cette question de l'échelle, je pense que c'est une question hyper importante. Ce que je veux dire par là, c'est au final, jusqu'où on va et où on s'arrête Est-ce qu'on fait un donut par personne Est-ce qu'on fait un donut pour une ASBL Est-ce qu'on fait un donut pour une entreprise, pour une ville Est-ce qu'on fait un donut pour un continent Ou est-ce qu'on fait un seul donut pour le monde entier Comment un petit peu cet outil se situe dans toute cette gamme d'échelles que je viens de citer
- Speaker #1
Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'il existe un donut mondial. Et je pense que c'est quand même intéressant de regarder aussi les choses d'un point de vue mondial pour voir globalement, par exemple, où en est l'état du monde au niveau écologique, puisque c'est quand même commun à nous tous, finalement. Le climat, par exemple, qui se dérégule, ça va être une thématique qui va concerner l'ensemble des pays du monde. Et donc, ça a sa pertinence aussi de regarder les choses, même d'un point de vue mondial, d'un point de vue très large, je dirais. C'est qu'au niveau social, en fonction des contextes, ça va fort varier. Les pays anglo-saxons, qui sont parmi les plus aisés, par exemple, ou les pays européens, n'ont pas du tout les mêmes enjeux sociaux que les pays africains, par exemple. Et donc, pour ça, c'est intéressant, en effet, d'aller... dans le détail et d'essayer de réaliser ces portraits de notes au niveau d'une nation, même d'un territoire, d'une région.
- Speaker #0
mieux illustrer comment, dans notre contexte, quels sont nos enjeux, quels sont nos dépassements, où est-ce qu'on peut encore s'améliorer. Donc tout ça, pour moi, c'est pertinent de faire. Au niveau des organisations même, ce que préconise le deal, donc Kitrawards et tout ça, ce n'est pas spécialement de réaliser son portrait. Parce que finalement, il y a déjà beaucoup aujourd'hui d'autres outils qui permettent de faire une sorte d'analyse d'impact de votre association, des bilans carbone. des bicorps, etc. Il y a aujourd'hui beaucoup de référentiels, de labels, de ressources qui existent pour faire ça. Donc l'idée, ce n'est pas spécialement d'en rajouter un, puisque le donut ne veut pas spécialement être un label. Et donc on sait que les labels peuvent amener une sorte de dérive, où on peut vite cocher les cases et ne pas se pencher sur une réforme profonde. Donc le message que veut adresser la théorie du donut aux entreprises, il essaie de toucher une autre dimension qui est, celui de ce qu'on appelle le design des entreprises, et donc de repenser vraiment la façon dont l'entreprise fonctionne au travers de cinq niveaux. Au niveau de la mission, de sa gouvernance, de son réseau, de sa propriété, de ses finances. Et c'est à ce niveau-là, il nous semble, qu'un vrai travail de transformation peut être fait, et non pas simplement, des fois un peu rapidement, même si c'est bien de le faire, mais comme certaines dérives aujourd'hui peuvent nous le laisser voir, que de simplement... cocher un peu des indicateurs rapidement sans amener une transformation plus profonde du mindset et de l'état actuel du business. Et alors au niveau individuel, à nouveau, le Donut Commerce s'utilise dans un niveau collectif. Ce n'a pas été la grande direction qui a été prise puisque c'est des enjeux globaux, internationaux. L'idée, c'était de voir à une échelle plus large. Mais sur le site du deal, par exemple, il y a aussi des outils qui sont proposés si c'est l'envie. De se dire, tiens, où est-ce que j'en suis, moi, au niveau de toutes ces dimensions et de faire une petite évaluation personnelle. C'est possible aussi. Mais voilà, ce n'est pas la grande direction qui a été prise.
- Speaker #1
Ce n'est pas l'utilité principale de l'outil, mais c'est une porte d'entrée aussi, parfois, pour les gens, peut-être pour initier quelque chose dans un environnement qui leur est connecté.
- Speaker #0
C'est ça, oui.
- Speaker #1
Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé à Bruxelles Parce que depuis tantôt, depuis le début de l'épisode, tu nous dis, voilà, à Bruxelles, on a été prendre des indicateurs pour essayer de faire le donut, etc. Comment ça s'est passé Comment cette idée est venue sur la table à un moment de se dire on va faire un donut pour Bruxelles Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce donut Quels sont les résultats Et est-ce que de ces résultats, il y a déjà eu des mesures qui en ont découlé pour essayer de modifier les choses Oui.
- Speaker #0
Alors, petit flashback. Donc, c'était lors de la législature précédente. En 2020, Barbara Tracht, la secrétaire d'État à la transition économique, commence, débute son mandat. et souhaite un peu trouver une théorie qui l'aidera à guider son action politique. Et elle tombe sur la théorie de notes qui l'inspire beaucoup, et elle décide de le prendre un peu comme cadre d'action. Et donc elle décide d'initier le projet de notes, qui était le projet Brussels de notes d'une part, qui a eu vraiment vocation à essayer dans un premier temps en tout cas, de réaliser ce portrait de notes. Donc ça c'était vraiment nous une de nos grosses activités, enfin une de nos grosses missions, c'était de réaliser... Ce portrait, avec tous les indicateurs qu'on a dû aller récolter, c'était un gros travail de récolte d'indicateurs, un gros travail méthodologique aussi, pour savoir comment réaliser ce portrait, de savoir à partir de quand on identifie qu'on entre dans cette zone du donut. Il y a plein de questions un peu plus techniques et méthodologiques qui se posent qu'on a dû prendre à vrai le corps, puisque, pour rappel, la théorie du donut, c'est quelque chose d'assez neuf, puisqu'en 2020, il y avait encore très peu de cas d'application. On parait aujourd'hui, dans les cinq dernières années, il y a eu vraiment un boom de connaissances et d'applications. Il y avait juste Amsterdam avant nous qui avait déjà fait un travail préalable. Et donc, un gros travail au niveau de ces recherches d'indicateurs qui a mené à la réalisation du portrait de notes, qui a vraiment vocation à servir d'un peu de tableau de bord, de tableau de pilotage de la région. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été construit. Ce n'est pas encore le cas, malheureusement, aujourd'hui, mais on continue à le promouvoir dans ce sens-là. Deuxième chose, elle a décidé aussi de... de cadrer sa stratégie de transition économique avec ce cadre du donut. C'est la shifting the economy. Donc, nouveau, j'invite les auditeurs et les auditrices qui sont intéressés à aller googler, comme on dit, la shifting economy. Donc, il y a toutes les ressources en ligne. Et donc, ça, c'est la stratégie de transition économique qui vise, en fait, à rendre l'économie bruxelloise compatible avec le modèle du donut. Et donc, quel était le moyen pour y arriver L'idée était de dire qu'on va essayer de... pousser tous les acteurs économiques vers cette zone du donut, et ils ont donc défini une forme d'exemplarité sociale et environnementale pour les acteurs économiques. Et l'idée était de dire, en fait, voilà, à partir de 2024, toutes les subsides, les aides économiques... que propose la région vont être augmentés pour ces acteurs-là. Et puis en 2030, tous les acteurs économiques de la région ne pourront bénéficier de ces aides économiques, moyennant le fait qu'ils montrent qu'ils travaillent, qu'ils font des efforts au niveau de ces exemplarités sociales et environnementales. Et donc, il y a de nouveau, il y a tout un mécanisme de reconnaissance, qui a été mis en place par la région. Mais l'idée était vraiment d'agir dans ce sens-là, donc d'utiliser un peu les aides économiques comme des incitants. pour les attirer, je dirais, dans la zone du donut. Donc voilà, il y a eu le portrait, ce qu'on appelle le niveau macro, la politique publique, la shifting des économies au niveau meso, puis on a aussi travaillé avec des entreprises du territoire, au niveau micro, puis il y a eu tous les ateliers de sensibilisation, les présentations, etc., qu'on a réalisés, qu'on appelle ça plus au niveau nano, mais qui ne sont pas moins importantes, donc voilà un peu le tableau général. de ce qu'on a fait.
- Speaker #1
Donc j'entends tout ce qui a été fait. Comment, au final, ce tableau de bord s'incarne maintenant J'entends qu'il y a des décisions d'ici 2030 qui ont été prises pour petit à petit tenir compte de ce tableau de bord à certains niveaux. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de partager et qui sont en effet la conséquence du travail que vous avez mené
- Speaker #0
Donc là, je t'avoue qu'il y a un gros enjeu avec le nouveau gouvernement.
- Speaker #1
La prochaine question, c'est comment le changement de législature influence-tu ça Donc vas-y, je te laisse.
- Speaker #0
Voilà, je vais peut-être... de faire d'une paire de coups. Donc, on a un gros enjeu là-dessus aussi, puisque ce ne sont pas les mêmes parties de la précédente majorité qui se sont retrouvées dans... Enfin, qui vont, a priori, il faut toujours être prudent, se retrouver dans la nouvelle majorité. En tout cas, qui sont, par sorti, plébiscitées des dernières élections. On ne sait pas exactement ce qui va être conservé. Sans doute que les choses vont être modifiées, même si peut-être le cap général va être modifié. Mais donc, voilà. Avoir... quand le prochain gouvernement sortira sa déclaration de politique générale. Mais sinon, ce qui est certain quand même, c'est qu'a priori, la shifting economy sous une forme ou une autre restera en place. On verra laquelle. Mais une autre réalisation concrète, en tout cas qui est en cours de travail et on espère qu'elle va bientôt atterrir, c'est la réalisation d'un outil d'aide à la décision au sein d'une administration. L'idée, en fait, c'est de dire est-ce qu'on peut utiliser de nouveau le cas du donut pour, en fait, un peu screener, comment dire, analyser les différents projets qui passent dans les administrations et se demander, tiens, en fait, est-ce qu'il y a des facteurs co-bénéfices, des bénéfices sociaux, environnementaux, etc., de ce projet auquel on n'aurait pas pensé Ou alors, en fait, est-ce qu'il y a des points, justement, des impacts négatifs de cette politique publique Donc, en fait, l'idée, vraiment, c'est de nouveau un peu l'atout, je dirais, holistique de Nutt, c'est de, chaque fois qu'il y a une remise de projet, etc., c'est de se dire, est-ce qu'on a bien pensé à tout Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'améliorer encore des aspects du projet Parce qu'on se rend compte en fait que, par exemple, au niveau de la consommation de l'eau, ce projet-là, il n'est pas aussi vertueux qu'on le voudrait, donc on peut peut-être changer ça, etc. Donc ça, ce sera vraiment un outil d'aide à la décision qu'on espère qu'il va aboutir aussi.
- Speaker #1
Ça pose aussi, ce que tu nous racontes là, la question du leadership. C'est-à-dire que, comme tu le dis à un moment, tu as le pouvoir politique incarné par une personne. qui a dit, ben voilà, on va utiliser cet outil-là, c'est le bon truc, on y va. Et la personne, au final, dans sa question, c'est un petit peu ce qu'elle voudrait savoir, c'est comment créer le leadership nécessaire pour se lancer dans l'application d'une méthodologie de notes, que ce soit au niveau d'une ville ou d'une entreprise.
- Speaker #0
Alors c'est vrai qu'à Bruxelles, les choses se sont faites avec l'impulsion de Barbara Trecht, mais je pense que la théorie du note, elle insiste fort aussi sur la dimension collective et participative, etc. Et donc, a priori, un peu dans le narratif, je pense, l'idée, ce n'est pas tellement de tout seul, comme ça, d'aller essayer de vouloir imposer ou quoi ce nouveau modèle. C'est vraiment de se demander, en fait, la théorie de notes incite vraiment sur la dimension très participative, collective, etc. Et donc, je dirais que ce serait plutôt une forme de leadership collectif. Donc, se demander, en fait, comment mon groupe, comment ce modèle peut faire sens pour nous. dans le cadre de notre travail, de notre façon de vivre, le territoire, en tant que citoyen, etc. Et comment on peut alors se l'approprier de façon sensée Je répondrais dans ce sens-là d'essayer de penser les choses de façon assez collaborative et en co-création pour se lancer dans une asserviture de notes.
- Speaker #1
Et donc peut-être qu'une façon d'outiller les leaders, c'est par exemple de les former à la décision sociocratique, par exemple. Ce qui leur permettrait déjà d'avoir des visions, je vais dire, sur ces processus collectifs qui sont, comme tu l'expliques, à l'origine du donut.
- Speaker #0
C'est ça, c'est ça. Après, si je veux dire, s'il y a des dirigeants ou bien sûr des gens qui ont un certain niveau de pouvoir, qui veulent engager quelque chose au niveau de notre... C'est vrai, nous, on l'a déjà vu et c'est tout en bien, tout honneur et autant y aller. Mais c'est vrai que dans l'implémentation, etc., il faut... Enfin, vraiment, nous, on insiste pour chaque fois, c'est d'être le plus participatif. Et en effet, comme tu dis, utiliser des outils de sociocratisme. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on remarque dans les dynamiques de transition, dans les projets de transition, etc. tant que c'est l'initiative de quelques convaincus en fait souvent ça a du mal vraiment à faire tâche d'huile et à décoller à décoller exactement et donc nous on essaie de se prévenir un peu de ce côté un peu bulle parfois de la transition et de l'entre-soi et vraiment de dire en fait si on fait quelque chose il faut directement aller voir l'ensemble des parties prenantes d'un projet ou d'une institution et de réfléchir ensemble à ça pour que ça devienne un projet transversal et qui touche tout le monde et pas simplement L'éco-team, les personnes les plus sensibles à la transition, parce que souvent, le potentiel de transformation est assez limité. Et donc, vraiment, d'essayer de convier tout le monde à bord, quitte à devoir faire des compromis, etc. Mais ça aura d'autant plus d'impact. Et en plus, ça permettra de les sensibiliser, en effet, dans le même temps. Donc, nous, on insiste vraiment là-dessus. C'est capital, il nous semble.
- Speaker #1
Tu le disais, tu as travaillé à l'échelle nano avec des entreprises aussi du territoire. Et ici, j'ai une question qui provient certainement de quelqu'un qui est dans une entreprise ou qui est connecté indirectement et qui se disait, mais voilà, comment les entreprises peuvent-elles influer sur le plancher social via des soutiens à des associations ou d'autres idées, par exemple
- Speaker #0
Alors ça, c'est ce qu'on appelle un peu la dimension distributive. Comment une entreprise peut-elle devenir la plus distributive par nature Et ça, c'est assez fascinant aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'appropriations d'entreprises très différentes. qui font de la distribution sous une forme ou une autre. Durant la conférence, j'avais parlé de l'exemple de FairBnB, qui est l'alternative éthique à Airbnb. Donc, au lieu que tous les profits, enfin les engrangers à l'occasion d'un échange, d'un logement entre un hôte et un voyageur, en fait, que ces profits-là que capte la plateforme FairBnB, en fait, il va venir alimenter des projets locaux, d'associations. Donc, voilà une façon un peu de redistribuer aussi le... la richesse générée à l'occasion de ce service-là. Mais il y a plein d'autres façons de penser, en fait, de comment essayer d'améliorer le bien-être et d'essayer de se penser au travers de ce prisme de la distribution. Il y a, par exemple, des entreprises comme Norcis en France qui redistribuent une partie des profits avec ses employés. Donc, au lieu que les profits viennent uniquement gonfler les dividendes des actionnaires, on redistribue avec les employés qui sont quand même les premiers à la manœuvre d'avoir généré cette richesse. Donc, c'est sûr. Une autre forme aussi que je trouve super inspirante, c'est toutes les entreprises, les associations aujourd'hui qui décident de se fixer un peu ce qu'on appelle des tensions salariales limitées.
- Speaker #1
Le plus bas salaire et le plus haut salaire ont par exemple un écart de 20% maximum. Voilà,
- Speaker #0
il me semble que dans les... C'est au frère de ma part, celle-là, il faut prendre ce que je dis avec des pincettes parce que je ne suis pas exactement sûr, mais il me semble que dans les entreprises... De l'économie sociale, il faut qu'il y ait un maximum de tension salariale de 1 à 6. C'est-à-dire que le salaire le plus haut ne peut qu'être 6 fois supérieur au salaire le plus bas. Alors on se dit, a priori c'est déjà beaucoup, et pourtant en fait dans le monde de l'entreprise privée, ça décolle parfois de façon... Il y a des tensions salariales de 1 à 100, et plus quand on va même aux Etats-Unis, etc., où là ça devient astronomique. Donc voilà encore une autre façon d'essayer de répartir la richesse et de... que la richesse générée profite au plus grand nombre. Et puis, voilà, après, il y a des choses plus classiques, comme faire de la philanthropie. Il y a encore, l'autre jour, une chouette idée, c'est de proposer de la rondille solidaire. Chez Nature et Découverte, par exemple, ils font ça. Où, lorsque tu passes à la caisse, ils te disent, tiens, si tu veux passer à l'unité supérieure, ça permet de financer, alors ça ne te coûte rien, ça coûte quelques centimes, mais ça permet une petite initiative qui permet de redistribuer un peu de valeur. dans des projets qui ont du sens. Donc, il y a vraiment une myriade de possibilités. C'est super intéressant. Et ça peut passer, enfin voilà, dernière chose aussi, ça peut passer simplement par amélioration du bien-être des employés. Oui,
- Speaker #1
tout à fait.
- Speaker #0
Permettre de télétravailler, permettre d'avoir des horaires plus flexibles, veiller à l'ergonomie, veiller à ce que tes employés ont une bonne hygiène de vie, veiller à leur santé, enfin voilà, proposer la sieste. Il y a vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses possibles. Tout ça contribue à améliorer le bien-être.
- Speaker #1
Il y a aussi, on en parle de plus en plus, ces entreprises régénératives qui se mettent en place pour justement intégrer ces enjeux écologiques et sociaux, mais tout en se positionnant comme, ce n'est pas qu'on va juste faire attention, c'est qu'on va créer quelque chose qui va améliorer la situation.
- Speaker #0
C'est ça. C'est la définition qu'on donne un peu à la régénération qui devient un terme dont on entend de plus en plus parler. Il y avait l'économie circulaire, il y avait la durabilité, puis le nouveau terme à la tomote, c'est la régénération. Et c'est vrai que ce n'est pas pour rien qu'il décolle, c'est parce que l'idée de dire en fait, On est dans une situation avec une urgence telle qu'aujourd'hui, j'irais avoir un impact neutre, simplement viser le net zéro. C'est déjà un énorme pas, qu'on s'entende bien. Mais c'est même bien de se penser comme un acteur contributif et positif et de se demander, tiens, comment moi aussi, je peux contribuer en retour à tous les services que me procure la nature. Donc là, il y a plein de chouettes initiatives aussi. Notamment, j'avais parlé durant l'entreprise... durant la conférence à cette entreprise Interface, qui est une entreprise américaine qui produit des tapis et des carpetes, et qui s'est dit, tiens, en fait, nous, on va essayer d'imiter la forêt. Et donc, tous leurs tapis sont conçus, en fait, est-ce qu'ils captent du carbone Et donc, voilà, aussi, typiquement, en fait, là, on est vraiment dans de la contribution positive. Donc, voilà un exemple parmi tant d'autres, aujourd'hui, qui existe.
- Speaker #1
Alors, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Je me suis réservé quelques questions aussi pour la fin, qui ne vont pas être tant des questions... techniques, mais plutôt des questions inspirantes et sur la situation globale. Première question que je voudrais te poser, c'est pour toi, avoir de l'impact, ça veut dire quoi en fait
- Speaker #0
C'est une très grande question, c'est une très bonne question. Nous, on a une réflexion aussi là-dessus. Alors comment des associations comme la nôtre, quand on reste une petite association, on peut vraiment quantifier notre impact C'est difficile parfois, en tout cas pour nous, de vraiment quantifier notre impact parce qu'on fait beaucoup de sensibilisation aussi. Alors voilà, on peut montrer qu'on a fait X séances, touché X personnes, etc. Mais moi, je pense quand même que le fait de redessiner les imaginaires, etc., de travailler sur les consciences et les messages qui sont apportés, ça a un impact capital, en fait. Donc, c'est difficile à quantifier. Mais ce qu'on remarque quand même souvent, lorsqu'on étudie un peu les théories du changement, etc., c'est que souvent, d'abord, avant que le changement se manifeste sur le terrain, il faut d'abord qu'il y ait une... un changement dans les esprits. De ce point de vue-là, en fait, moi, j'ai tendance parfois à penser qu'il vaut mieux avoir sensibilisé son personnel, les gens autour de soi, etc., que c'est plus puissant que de rajouter trois, quatre panneaux solaires. C'est bien sûr, il ne faut pas opposer les deux, mais je veux dire, même si ce n'est pas quantifiable, ça a vraiment aussi de l'intérêt. Mais sinon, voilà, nous, lorsqu'on fait des ateliers avec des entreprises et qu'elles décident quand même, suite à notre atelier, de mettre en place telle et telle action, Pour nous, c'est vraiment de l'impact concret et direct. Et au-delà de la sensibilisation qui a été opérée, c'est vraiment de l'impact tangible. Au travers d'exemples comme je te disais, lorsque une nouvelle administration, par exemple, met en place un outil d'idéal décision, voilà, là, concrètement, quelque chose qui se passe. Lorsqu'une politique publique comme à Bruxelles, c'est aussi de l'impact, comme la shifting d'économie cadre sa politique publique avec la théorie de notes, c'est de l'impact. C'est vrai que... L'impact de tous les gens qui travaillent dans la transition, il n'est jamais à la hauteur de ce qu'on pense actuellement encore, de l'urgence de la situation, et on est toujours un peu confrontés à ça. C'est difficile encore aujourd'hui de parvenir vraiment, notamment à convaincre les gens qui ne sont pas du tout dans ce monde-là et sensibilisés à ça. Mais ça reste un travail passionnant et on se sent à sa bonne place.
- Speaker #1
Est-ce qu'il y a des ressources que tu souhaites partager à l'auditeur et à l'auditrice qui nous écoutent Des choses qui t'ont peut-être inspiré, qui t'ont fait faire un switch dans la tête quand tu les as lues. Donc voilà un petit peu des ressources que tu te dis, ça, il faut vraiment passer le voir ou le lire pour comprendre certaines choses.
- Speaker #0
Très bonne question. Mais au-delà de Kate Raworth, on aura compris que c'est quand même la réponse principale. J'ai deux penseurs qui m'ont pas mal impacté, enfin inspiré récemment. C'est Timothée Parry qui a écrit le livre Ralentir ou périr Moi, je trouve qu'il était une super synthèse sur la question un peu de la croissance verte au niveau économique. On ne comprend pas toujours bien ce qu'il en est. Il y a vraiment beaucoup d'approches plus technologiques, plus de sobriété, etc. Et je trouve que lui, il fait une magnifique synthèse de ça dans son livre et il est assez convaincant. même de suivre sur les réseaux, etc. Je trouve que c'est vraiment une très chouette personnalité. Et alors, je sais que j'aurai la chance de le recevoir très prochainement. C'est Olivier Hamant, avec son concept de robustesse. Je me suis mis son podcast récemment. Il y a pas mal de vidéos sur lui en ligne. Et je trouve que c'est une super grille de lecture aussi pour analyser le monde. Et ça a été pour moi... Alors que je suis quand même quelqu'un qui baigne dans ces enjeux-là depuis longtemps. Après l'avoir bien écouté, essayer d'avoir bien compris, je me suis dit, c'est vraiment une lecture du monde que tu peux appliquer partout. Et même en voyant des sujets d'actualité, j'étais là, tu pourrais lire les choses avec ce prisme-là, robustesse vs performance, etc. Je trouve que c'est une lecture super riche. Donc voilà, Timothée Parec et Olivier Hamon, vraiment deux personnes clés.
- Speaker #1
Dernière question avant la citation, qui arrive toujours en fin d'épisode. Qu'est-ce que t'ont toi du passé je vais dire ton toit d'il y a 10 ou 15 ans, viendrait dire aujourd'hui à ton toit du présent
- Speaker #0
C'est une très bonne question. C'est peut-être la question la plus difficile à répondre. Moi, je dirais d'avoir confiance. Ouais, à un niveau personnel, d'avoir confiance que oui, qu'il y a quelques années, moi, j'étais encore soucieux de beaucoup de choses, de l'état du monde, même à des niveaux plus personnels, etc. Et que petit à petit, en fait, je trouve malgré... que l'état du monde n'est pas spécialement mieux. Une fois qu'on est dans l'action, on se sent légitime, on se sent qu'on est à la bonne place, etc.
- Speaker #1
Merci. Et donc maintenant, je te propose de partager cette citation. Je le dis à chaque épisode, mais cette citation, ce n'est pas nécessairement un grand homme ou une grande femme qui doit l'avoir dit, c'est juste une phrase ou un groupe de phrases qui synthétisent, qui symbolisent un petit peu le propos qu'on a échangé aujourd'hui.
- Speaker #0
Ouais. Là, récemment, j'étais tombé sur une citation qui était pas mal encore. Je pense que c'est de Margaret Mead. Elle disait, genre, ne doutez jamais de la capacité d'un petit groupe à changer le monde parce qu'en effet, en fait, c'est la seule façon dont les changements ont été amenés récemment. Voilà, je ne le dis pas avec les bons mots, etc., mais c'était globalement l'idée. Et en fait, peut-être particulièrement aujourd'hui, on se sent dépassé par l'ampleur des phénomènes, etc., mais que c'est extrêmement stimulant aussi d'agir à un niveau local et qu'en fait, on n'est jamais à l'abri. Je pense, par exemple, à Greta Thunberg, par exemple, qui avait, en fait... initié une action, elle s'est dit qu'est-ce qui est juste pour moi de faire en ce moment, c'est d'aller me mettre devant le parlement de son pays et d'aller manifester. Et puis ça a pris une proportion gigantesque. Elle a été réunie par des milliers de gens, ça a donné lieu aux manifestations, enfin au soulèvement pour le climat en 2018, ça a donné lieu au Green Deal, on pourrait dire que finalement ça a donné lieu au Green Deal au niveau européen. On ne sait jamais en fait, sur des faits papillons qui peuvent amener les choses. Donc, Il faut suivre l'élan du cœur, là où l'enthousiasme vous porte. Même si c'est des actions qui paraissent à une petite échelle, ça vaut quand même le coup, moi je pense.
- Speaker #1
Eh bien, Paul, merci beaucoup pour ce moment particulier. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté ce podcast. Et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Science avec Curiosité, le podcast du Mimons. À très très bientôt. Au revoir à tous. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour, ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets, ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.
- Speaker #0
Bonjour, je suis Jean-Claude, je suis en train de me faire un petit déjeuner. Je vais vous montrer comment faire un petit déjeuner.



![[Trailer] Épisode 129 - Carlo Rovelli cover](https://image.ausha.co/YnEtkz8bZtJQXmnEN5a0iLkU3SHNCkEV5nxH6C8J_400x400.jpeg)
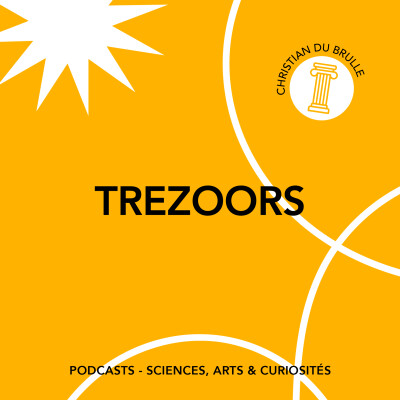
![[Trailer] Épisode 128 - Trezoors | Feat. Christian Dubrulle cover](https://image.ausha.co/e2hRPNecxKZRvrf3YnZcZptQucTv1C7oh4jW4oj3_400x400.jpeg)