- Speaker #0
Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
- Speaker #1
Ce qui place votre zone d'atterrissage à 5,0667 degrés de latitude nord et 77,3333 de longitude ouest.
- Speaker #0
Rien de tout ça, Véry. Qu'est-ce que le réel ? La seule variable constante est l'inattendue. On ne peut pas la contrôler. Je crois que vous êtes encore pire que ces créatures. Elles, elles n'essaient pas de se massacrer entre elles pour tirer le plus gros paquet. Voyons si la capacité de pousser de 10% permet de décollage. Et 3,
- Speaker #1
2,
- Speaker #0
1... Chers auditeurs, chères auditrices, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Comme promis, je continue la série d'épisodes en collaboration avec la chaire de l'UMONS, ingénieur objectif transition. Le but de ces épisodes est de venir compléter l'expérience vécue durant le cycle de conférences proposé par la chaire. Pour rappel... À l'heure où tu écouteras cet épisode, la conférence sur les frontières planétaires et sur le donut est déjà accessible en ligne sur la chaîne YouTube du MUMONS. Et donc, après l'épisode avec Paul Van Der Straten, j'accueille aujourd'hui Éric Lambin. Bonjour Éric.
- Speaker #1
Bonjour.
- Speaker #0
Comment vas-tu ?
- Speaker #1
Tout va bien.
- Speaker #0
Après quelques petits soucis techniques, nous arrivons enfin à enregistrer cet épisode, donc on est très heureux d'être là. Est-ce qu'en quelques secondes, j'oserais dire, tu peux me dire qui est Éric Lambin ?
- Speaker #1
Je suis professeur d'université et je fais une recherche sur les changements d'utilisation du sol, les interactions entre l'activité humaine et l'environnement terrestre.
- Speaker #0
Alors, le but n'est bien entendu pas de refaire la conférence en podcast, ça ne servirait à rien, mais bien de venir compléter l'expérience. Juste pour remettre un cadre, est-ce qu'en cinq minutes, tu peux nous expliquer en quoi consistent les frontières ? planétaire et aussi pourquoi tu préfères ce terme frontière au terme limite.
- Speaker #1
Alors ce concept de frontière planétaire a été proposé par un groupe de scientifiques dont j'ai fait partie il y a quelques années. En clair, c'est une série de valeurs sur des variables biophysiques qui caractérisent l'état du système Terre pendant la période géologique qu'on appelle l'holocène, c'est-à-dire les 11 000, 12 000 dernières années, qui est la période géologique. pendant laquelle l'espèce humaine a prospéré, a domestiqué les plantes, les animaux, a développé l'urbanisation, l'industrialisation. Donc c'est une période qui était très favorable au développement humain, qui était relativement stable. Et donc l'idée, c'est que cette période est caractérisée par une série d'attributs du système terrestre, le climat, la biodiversité, le cycle de l'eau, et que nous avons intérêt à maintenir ces conditions pour continuer à prospérer sur Terre. Ce n'est pas des limites dans le sens où il n'est pas impossible de mener la subsistance de l'espèce humaine en dehors de ses paramètres, puisque l'espèce humaine existait bien avant l'holocène. Ce sont des frontières dans le sens où si on dépasse cet ensemble de valeurs sur ces variables biophysiques, l'espèce humaine se retrouvera en territoire inconnu, non familier, et pour lequel le mode de vie, la civilisation actuelle aurait du mal à se maintenir.
- Speaker #0
Alors ici, je vais reprendre des questions qui ont été rédigées par le public qui a participé à la conférence. Ça a été collecté à la fin et bien entendu, j'ai pris parfois la liberté d'ajouter quelques petits éléments. La première question, je la trouvais assez intéressante, c'est au final, comment on mesure ces frontières planétaires ? A priori, c'est quelque chose de très global. Donc, comment on fait pour les évaluer ?
- Speaker #1
Alors, c'est une très bonne question. Elles ne sont pas mesurées directement, c'est une estimation. sur base à la fois des études paléoclimatiques sur l'état du système Terre au cours de son histoire longue, mais également des modèles de simulation qui simulent sur ordinateur des modèles compliqués, très complexes du système terrestre et qui, lorsqu'on pousse certaines variables au-delà de l'état actuel, on observe par simulation des effets en cascade, un espèce d'emballement de certains changements. C'est une estimation. Ce concept de frontière planétaire est très solide sur le plan conceptuel, sur le plan quantitatif. Il faut savoir que ces valeurs qui sont suggérées aujourd'hui sont associées à des marges d'erreur, des marges d'incertitude plus ou moins élevées selon les frontières auxquelles on parle.
- Speaker #0
Alors, une fois que cette frontière est dépassée, on arrive, comme tu le dis dans la conférence, en territoire inconnu. On ne sait pas ce qui se passe. Mais fondamentalement, est-ce qu'on peut revenir en arrière ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut repasser la frontière dans l'autre sens pour revenir à une situation plus contrôlable, plus enviable ?
- Speaker #1
Alors, en principe, oui, sauf que certaines de ces frontières sont associées à ce qu'on appelle des points de bascule, c'est-à-dire des changements de régime, donc tout à coup une accélération très forte des changements du système terrestre, un peu analogue au basculement entre une période glaciaire et une période interglaciaire, et donc le retour en arrière est très difficile. Il ne suffit pas de refaire un pas ou deux en arrière, il faudrait... changer très fondamentalement certains paramètres pour revenir à l'état initial. Donc c'est très risqué de dépasser ces frontières, parce que certaines, pas toutes, mais sont associées à ces points de bascule.
- Speaker #0
On parle très souvent du climat autour de ces frontières planétaires. Or, quand on voit le schéma durant la conférence, en tout cas l'incarnation de cette théorie sur un graphique, on voit que le plus grand dépassement touche au final la biosphère. Et donc, est-ce que pour cet exemple de la biosphère, tu peux... préciser les problématiques, les dangers liés à ces fameux points de bascule dont on vient de parler.
- Speaker #1
Ce qu'on appelle dans ce jargon l'intégrité de la biosphère, ça correspond essentiellement à la biodiversité, la biodiversité génétique et la biodiversité fonctionnelle. En effet, en plus du défi climatique, on parle beaucoup aussi du défi de la perte de biodiversité, on érode un peu l'architecture de base de la vie sur Terre, de toute la biosphère. avec là aussi des conséquences très significatives. Et juste pour prendre un exemple très concret, beaucoup d'insectes ont un rôle de pollinisation des plantes, notamment des cultures, des arbres fruitiers. Et donc, lorsque la population d'insectes pollinisateurs descend sous un certain seuil, tout d'un coup, les rendements agricoles diminuent de manière considérable pour certaines cultures, toutes les cultures qui sont pollinisées par ces insectes, notamment les arbres fruitiers, certaines céréales, etc. Donc là, évidemment, il y a un effet direct sur la sécurité alimentaire de l'humanité.
- Speaker #0
Dans la conférence, tu as proposé toute une série de solutions. Ici, la question se demande, mais au final, où est-ce que ces solutions ont déjà été mises en place et est-ce qu'on peut de ce fait en tirer des leçons ?
- Speaker #1
Oui, en réalité, au moins une ou deux de ces solutions ont déjà été mises partout dans le monde, en application dans tous les pays. Chaque pays a déjà... promu ou un projet pilote sur un certain type d'intervention. Ce qu'on tire comme leçon, c'est que un, la difficulté, ce n'est pas de faire un petit projet pilote, un petit projet de démonstration, mais c'est de vraiment mettre en œuvre ces solutions à une échelle suffisante que pour transformer le système. Deux, le défi, ce n'est pas de se dire, on va pousser une solution, mais pas les autres parce qu'il y a vraiment une dimension systémique dans la mise en œuvre de ces solutions. Il faut ... Il faut plusieurs solutions qui se renforcent les unes les autres. Et trois, très souvent, on voit des pays qui ont été pionniers sur certaines solutions, qui péniblement ont mis en œuvre toute une infrastructure pour résoudre un problème très fondamental, peuvent reconnaître un retour en arrière extrêmement rapide à l'occasion d'une élection, d'un Trump ou d'un Bolsonaro ou d'un autre leader populiste conservateur qui va... en quelques jours, effacés des années, si pas des décennies de progrès. Donc voilà, c'est cette fragilité de ces solutions, c'est difficile de les mettre en œuvre à l'échelle, et c'est important d'avoir une pensée systémique, c'est-à-dire c'est l'ensemble, c'est le paquet de solutions et pas simplement l'une ou l'autre qui va résoudre le problème.
- Speaker #0
C'est un peu inquiétant comme bilan, entre guillemets, que tu nous proposes là.
- Speaker #1
Malheureusement, il faut être réaliste et autant on peut avoir de l'espoir, autant l'observation réaliste des évolutions géopolitiques récentes ne porte pas l'optimisme.
- Speaker #0
En effet. Alors gardons quand même espoir, comme tu le dis, et imaginons un monde où tout ça est possible. Quels sont les leviers qu'il faudrait privilégier ? Quels sont ceux qui ont le plus d'impact ? Et à un moment donné, au vu de l'urgence qui est décrite, c'est... Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de recourir à un moment aux sanctions plutôt qu'aux incitants ?
- Speaker #1
De nouveau, je reviendrai avec cette notion de pensée systémique. Il faut un ensemble de solutions qui soient différentes mais complémentaires, qui ont des effets de synergie. Elles se divisent en trois familles de solutions. D'abord, informer les acteurs, récolter des informations précises sur l'évolution du système. communiquer largement ces informations, ensuite créer des incitants, des incitants positifs pour créer une envie de mettre en œuvre ces solutions, et enfin pour les acteurs qui seront toujours derrière, les traînards qui vont toujours résister à une transformation vers des pratiques plus durables, là en effet il faut des sanctions pour lever un peu le plancher minimum de pratiques. Mais c'est vraiment la complémentarité entre ces différentes solutions qui va faire avancer le système. Donc il y a eu beaucoup d'études qui ont étudié l'efficacité de l'une ou l'autre solution. Et chaque fois la réponse est la même, tout dépend du contexte, tout dépend de l'écosystème des politiques dans lequel une solution particulière s'insère. Est-ce que cet écosystème politique est favorable ou au contraire, elle va ralentir la mise en œuvre d'une solution particulière ?
- Speaker #0
Alors, pour la question suivante, je vais donner un chiffre qui va permettre de comprendre pourquoi elle a été posée. Donc, pour faire simple, 1% de la population la plus riche au monde pollue deux fois plus que 50% de la population la plus pauvre. Et donc, comment faire bouger les plus riches qui sont au final responsables quand même d'une grande part, en tout cas, de l'émission de CO2 ? Le chiffre que j'ai donné se concentrait sur l'émission de CO2. Et comment mobiliser les personnes qui ont le plus d'impact ? En sous-entendu, à priori, dans le monde dans lequel on vit, si on a beaucoup d'argent, on peut avoir beaucoup d'impact.
- Speaker #1
Alors ces super riches ont évidemment un impact environnemental très important, mais en très large partie via leurs investissements. Si on est multimillionnaire, si on est milliardaire, on ne peut pas consommer pour des milliards de dollars chaque année par des activités polluantes. Et donc l'essentiel de leur impact, c'est la manière... dont leurs capitaux sont investis. Est-ce qu'ils sont investis dans l'industrie du pétrole ou plutôt dans une industrie verte ? Donc là, c'est un levier très important, c'est développer les outils de finances vertes et essayer d'orienter ces capitaux vers des fonds plutôt vertueux sur le plan durabilité. Ce qui exige aussi, évidemment, que ces fonds verts ont un rendement financier à peu près équivalent, en moyenne équivalent, si pas légèrement supérieur. au fond plus polluants. Et donc là, il y a un levier d'intervention pour pénaliser un petit peu les investissements les plus néfastes pour la planète et booster les investissements verts pour orienter cette masse de capitaux vers des activités vertueuses.
- Speaker #0
D'ailleurs, j'en profite pour partager une petite info par rapport à ça. Il y a Eva Sedoun, une Française, qui, par rapport à ce que tu viens de nous raconter, a créé une... plateforme où le but, c'est d'avoir recensé tous les investissements verts qui étaient viables. Et donc, elle monte un espèce de fonds d'investissement vert, en fait, avec plein de projets différents où on peut venir soutenir à son échelle, avec plus ou moins de capitaux, ces projets. Et je trouve que c'est dans cette philosophie-là et c'est assez intéressant. Alors, au final, ça pose aussi une question qui est, j'ai l'impression, la grande question. C'est comment amener l'être humain dans une vision altruiste ? Comment comment transformer l'être humain en un être réellement altruiste et comment intégrer les solutions dont on a parlé jusqu'ici dans un monde où en 2025, on l'entend très souvent, le climat, ça emmerde l'économie. Et je pense qu'on peut remplacer le climat par l'écologie. L'écologie, ça emmerde l'économie.
- Speaker #1
Je pense qu'il faut être réaliste, on ne peut pas changer la nature humaine. Je pense que toute personne a des aspects altruistes dans certains éléments de sa vie et des aspects plus égoïstes pour d'autres éléments. Certains vont être très altruistes vis-à-vis de leurs enfants, ou vis-à-vis de leur communauté, ou les membres de leur église. D'autres seront plus généralement altruistes, mais auront des aspects plus égoïstes pour certaines dimensions de leur vie. Je ne pense pas qu'on peut compter sur une transformation profonde de la nature humaine pour résoudre ces problèmes. De toute façon, on n'a pas le temps. Donc, il faut faire en sorte que ce soit dans les intérêts de chacun de réaliser cette transition, d'adopter des pratiques plus durables, que ce soit économiquement plus avantageux, mais aussi socialement. C'est pour ça que dans la conférence, à un moment, j'ai beaucoup parlé de l'importance de modifier les normes sociales, parce que finalement, les normes sociales sont associées à une espèce de sanction sociale. Si quelqu'un me voit jeter un plastique dans la rue, je vais être sanctionné socialement par mes amis, par les personnes qui vont observer ce comportement. Donc c'est créer un environnement de décision, décision alimentaire, décision énergétique, décision de mobilité qui va favoriser, qui va pousser les consommateurs, qu'ils soient altruistes ou égoïstes, et personne n'est 100% altruiste ou 100% égoïste. mais qui vont pousser les gens vers l'adoption de pratiques plus durables.
- Speaker #0
Est-ce qu'il y a aussi dans cet altruisme un enjeu à retravailler en local avec les gens qui nous entourent, qui sont nos voisins de rue ou de maison directe pour justement monter des petits projets locaux qui ne vont peut-être pas faire la différence à l'échelle globale, mais qui vont initier un changement vers l'altruisme ?
- Speaker #1
Oui, notamment en local, mais pas seulement en local, parce qu'aujourd'hui, évidemment... avec les réseaux sociaux digitaux, on peut avoir un réseau social mondial avec des gens qui vivent à l'au bout de la planète, mais avec qui on échange quotidiennement parce qu'on a des intérêts communs. Donc oui, toutes les solutions sont bienvenues, les solutions locales, les solutions régionales, nationales, mondiales, tout ce qui fait avancer l'affaire est à prendre vu l'urgence dans laquelle on est.
- Speaker #0
On le disait, l'écologie, ça emmerde l'économie. Est-ce qu'une écologie qui n'emmerderait pas l'économie, c'est une écologie qui serait dans une optique de croissance verte ? Or, toutes les recherches ont l'air de converger. Cette croissance verte est un espèce de mythe qui ne peut pas exister.
- Speaker #1
Oui, je pense qu'il faut en effet se méfier un peu d'un slogan croissance verte, décroissance, etc. Parce que c'est... Ce sont des mots qui simplifient des réalités très très complexes. L'important, c'est la décarbonation physique de l'économie, une activité économique qui gère de la prospérité, mais prospérité dans toutes ses dimensions, pas uniquement la dimension économique. Donc une vie riche, une vie profonde, une vie connectée avec les autres, avec soi-même, avec la nature, mais qui ne génère pas des externalités environnementales et sociales considérables. Donc il faut repenser en effet certaines activités économiques et les centrer sur des valeurs morales plus fondamentales qui sont celles qui apportent la satisfaction de la vie.
- Speaker #0
On a parlé des ultra-riches, on va parler d'une autre part de la population, le monde politique, qui aussi a un rôle à jouer, tu l'as dit précédemment, en une élection, des dizaines d'années de mobilisation peuvent complètement s'effondrer en quelques mois et on le voit à l'heure actuelle aux États-Unis. Et donc... comment mettre en mouvement les acteurs du monde politique, alors qu'on peut apercevoir, en fait, dans toute l'Europe, une grande montée de l'extrême droite qui se soucie peu du futur climatique de nos pays, qui n'hésite pas à même remettre en cause cette crise socio-écologique, et où on a aussi des autocrates climato-sceptiques qui sont au pouvoir et qui assument complètement leur vision du monde. Et on a aussi, je vais dire, peut-être les moins pires, mais qui ont quand même leur part dans la balance, c'est les auto-centrer, c'est-à-dire, je vise à préserver mes intérêts. Comment on peut faire avec ce monde politique actuel ?
- Speaker #1
Très bonne question, question difficile. Je pense que, de nouveau, il faut éviter une vision un peu dichotomique du monde. Il y a les bons et les mauvais, les bons altruistes, etc. Et puis les mauvais égoïstes, les politiques, etc. Le monde politique, finalement, est constamment à l'écoute. du sentiment dominant de la population. Cette population peut évidemment aujourd'hui être fortement manipulée dans la perception du monde, notamment par les réseaux sociaux. Je pense que le monde politique bouge en réponse à une pression, une expression forte des électeurs, des citoyens, des consommateurs, de la société civile, vers des valeurs de durabilité. avec également un impératif de gestion de crise. Il se fait qu'en plus de mon travail de professeur d'université, je suis aussi conseiller scientifique en chef de la Commission européenne, donc du Collège des commissaires, donc j'interagis avec les commissaires européens. Et c'est quand même frappant de voir à quel point ces dirigeants sont constamment en régime de gestion de crise, consacrent l'essentiel de leur temps à gérer un problème qui est apparu aujourd'hui, qui doit être résolu pour ce soir. La fraction de leur temps qu'ils peuvent consacrer à des visions à long terme est extrêmement réduite. C'est très rare parce que c'est l'urgence du moment. Donc, il faut vraiment créer un mouvement social et une mobilisation aussi des acteurs économiques très important pour donner cette vision à long terme auquel finalement le politique répond. Voilà, donc je suis un peu mal à l'aise avec une... Une vision qui dirait qu'il y a les bons citoyens qui veulent la durabilité et les mauvais politiques qui sont à défendre leurs intérêts. Parce qu'en réalité, il y a des bons et des mauvais dirigeants, ça c'est clair. Mais le rôle du politique est d'être un peu au charbon, au jour le jour, heure après heure, à gérer un peu toutes ces urgences. Mais en réponse à ce qu'ils perçoivent comme étant les préoccupations principales de la société civile.
- Speaker #0
Un exemple qui est intéressant par rapport à ce que tu expliques là, c'est ce qui s'est passé en Suisse il y a quelques semaines. Donc, ils ont fait un référendum pour déterminer si une économie qui tenait compte des limites planétaires devait être intégrée dans la Constitution. Et le peuple suisse s'est positionné à plus de 60% de non. Et donc là, on le voit, c'est les Suisses qui se positionnent. Alors, bien entendu, derrière, il y a des inputs vers les gens qui habitent en Suisse du monde politique. qui donne des couleurs au discours, c'est clair. Donc, c'est très complexe à comprendre comment les choses s'influencent. Mais néanmoins, il y a cette volonté des gens. Yann Kovic, il dit, le politique est un exécuteur testamentaire, c'est-à-dire que les entreprises, les citoyens ont une volonté et il est censé incarner cette volonté. Après, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais on voit qu'il y a un changement là qui devrait se produire aussi.
- Speaker #1
Exactement.
- Speaker #0
Ça pose au final la question de la gouvernance, le monde politique. Et on est face à un problème mondial. Ce n'est pas un problème territorial, ce n'est pas un problème continental dans le sens continent. C'est un problème mondial qui est énorme. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas une gouvernance mondiale à la mesure du problème ? Est-ce qu'on doit aller vers une dictature verte mondiale ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Parce qu'on a parfois l'impression que tant qu'il n'y a pas un leader fort... qui serait l'exact miroir de Trump, entre guillemets, qui prendrait des décisions pour le climat, ça ne bougera pas. Comment tu te positionnes par rapport à ça ?
- Speaker #1
Alors, dictature, non. On tient beaucoup aux libertés. Et de nouveau, pendant 15 ans, j'ai travaillé 6 mois par an aux États-Unis. Donc, je suis effaré de voir à quelle vitesse, en un mois déjà, un régime autoritaire se met en place par une censure de la science, un contrôle des médias, etc. Donc, on ne veut absolument pas de ça pour le... la planète, donc ce qu'on a à la place est un processus multilatéral, relativement faible, comme les Nations Unies, parce que ça dépend de la bonne volonté de tous les pays, il y a des droits de veto, n'importe quel pays peut se retirer à tout moment d'un traité international. Et donc là, par opposition à cette notion de gouvernance verte, il y a un autre concept qui me paraît beaucoup plus attractif, c'est ce qu'on appelle la gouvernance polycentrée, un grand nombre de centres de décision nationaux, multilatéraux, locaux, par secteur, qui se mettent en place, qui sont autonomes, qui chacun poursuivent leurs objectifs, mais qui sont idéalement coordonnés, qui ne sont pas en opposition les uns aux autres, et qui tous, à plusieurs niveaux, chacun avec son instrument, fait avancer cette transition vers un développement plus durable. C'est plus... désordonnée, c'est plus chaotique, mais c'est plus respectueux des aspirations de chaque communauté parce qu'évidemment il y a des différences très grandes entre les aspirations des individus, des communautés, des pays selon leur situation historique, présente, etc. Donc voilà, il faut malheureusement accepter la situation un peu désordonnée, en anglais on dirait messie, qui fait avancer les choses comme ça, un peu à Ausha droite. à condition que le mouvement général soit directionnel, qu'il y ait une direction qui soit relativement cohérente. Et c'est un peu ça qui est difficile à assurer. C'est un peu l'orchestration. C'est comme, vous avez un orchestre symphonique, si chacun joue sa partition qui est différente des autres, ça fait une cacophonie horrible. Et donc, il faut quand même un espèce de chef d'orchestre qui donne une direction générale. Mais en aucun cas, à mes yeux, ça doit être un dictateur vert, aussi bon soit-il. Ça doit être un ensemble de valeurs portées par des intellectuels, par des influenceurs, on dirait aujourd'hui, qui montrent l'importance de marcher un peu tous dans une direction commune.
- Speaker #0
Il y a un exemple particulier que je voudrais aborder avec toi dans ce cadre-là, c'est celui de la restauration de la couche d'ozone. A priori, quand le monde a décidé de se mobiliser pour ça, il n'y avait pas de gouvernement mondial exactement. Et donc, est-ce qu'on pourrait s'inspirer ? de ce qui a été mis en place pour restaurer cette couche d'ozone et le déployer pour d'autres limites planétaires.
- Speaker #1
Alors là, tu fais référence au protocole de Montréal, qui a en effet résolu très rapidement ce problème de la couche d'ozone une fois qu'il a été découvert. Évidemment, il y avait deux éléments qui ont facilité cette adoption d'un traité commun. Un, c'est que c'était... La destruction de la couche d'ozone était un problème véritablement existentiel à très court terme. On était à peu près à la moitié de la densité de l'ozone transosphérique, avec déjà des conséquences énormes sur la vie humaine, sur les cancers de la peau, sur la photosynthèse. Et deux, surtout, il y avait une technologie de substitution très facile et moins chère. Il suffisait de remplacer les CFC, les chlorofluorocarbones, par d'autres. produits chimiques, notamment les hydrofluorocarbones et d'autres, et qui finalement n'augmentaient pas les coûts de production. Donc c'était une simple substitution technologique, sans aucune pénalité économique. Donc voilà, les gens se sont très vite mis d'accord, en effet, faisons ça. Maintenant, on dit souvent que c'était un succès, mais il faut quand même se rendre compte que, alors que ce traité date d'il y a quelques décennies... Il y a deux, trois ans, par satellite, tout d'un coup, les scientifiques ont découvert qu'il y avait encore d'énormes émissions de CFC qui détruisent la couche d'ozone en Chine. Donc, une usine, enfin une industrie, continuait pourtant à produire ces CFC, à les libérer dans l'atmosphère. Heureusement, on avait la technologie satellitaire pour les détecter, pour les localiser, donc intervenir. Mais même un cas aussi facile, si je puis dire, n'a pas été un succès à 100%. Mais il est clair que... Ce protocole de Montréal a servi de modèle à une série d'autres processus multilatéraux, la Convention internationale sur le climat, sur la biodiversité, sur la dégradation des terres, sur les espèces invasives. Donc il y a une série de conventions multilatérales qui cherchent à résoudre des problèmes, mais qui sont beaucoup plus compliqués, comme le changement climatique, la perte de biodiversité, et donc qui sont beaucoup moins efficaces. Mais en réalité, ce modèle est déjà mis en œuvre, c'est le protocole de Paris, etc.
- Speaker #0
un enjeu pour l'industrie, parce que c'est un acteur aussi qui va devoir se mobiliser, c'est cette fameuse compétitivité industrielle. Est-ce que tu aurais quelques recommandations à la communauté européenne pour réconcilier à la fois la politique de compétitivité industrielle et les enjeux socio-écologiques en fait ?
- Speaker #1
En réalité, ce qui va conférer une forte compétitivité aux industries dans le monde dans lequel nous sommes, ce sont précisément... des activités industrielles liées à la décarbonation. Ce sont des produits, des voitures, des systèmes d'isolation des maisons, de production alimentaire qui émettent beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre par une petite production. Et c'est déjà d'ailleurs la priorité aujourd'hui de la Commission européenne, c'est d'investir dans la compétitivité, investir massivement, on parle de 100 milliards d'euros, dans une activité industrielle qui est associée à la décarbonation, donc à une industrie plus propre. Ce seront des technologies, des acteurs qui vont être à la pointe du progrès industriel dans les décennies à venir, puisqu'on aura absolument besoin, de plus en plus urgentement besoin de ce genre de technologies. Donc, en investissant massivement là-dedans, l'Europe se met à la pointe de ce secteur, alors que les États-Unis qui, sous Trump aujourd'hui, vont réinvestir dans le charbon et dans le pétrole vont... sont en train d'investir dans des industries qui sont complètement dépassées, dont on n'aura plus besoin, et donc se mettent en retard en termes de compétitivité.
- Speaker #0
Durant la conférence, la question du nucléaire n'a pas réellement été abordée, donc je voudrais le faire ici. Pourquoi justement tu n'as pas abordé comme un moyen de décarbonation le nucléaire ? Est-ce que c'était un problème de temps ou est-ce que c'était une volonté assumée ? Et comment, de ton point de vue, tu positionnes le nucléaire par rapport à l'éolien et le photovoltaïque ? par exemple, qui sont dans les énergies « vertes » , mais qui constituent des sources d'approvisionnement intermittents.
- Speaker #1
Alors, en effet, de manière volontaire, je n'ai pas lâché le mot nucléaire, parce que dès qu'on le fait, on génère une sorte de réaction positive ou négative, et donc tout à coup, le débat ne se fait plus qu'autour du nucléaire. Mais donc, voilà, le nucléaire existe déjà, il couvre à l'échelle mondiale 9% de la production d'électricité. Le système énergétique mondial du futur aura besoin encore d'une certaine part de nucléaire, puisque la plupart des autres sources sont intermittentes, pas toutes, mais beaucoup, surtout le solaire et l'éolien. Donc on a besoin certainement de maintenir une capacité de production nucléaire. Quel est le pourcentage exact ? Je ne peux pas le dire. La France est à 70 %, d'autres pays sont beaucoup plus bas. Donc en effet, il faut pouvoir... compléter les sources intermittentes par des sources beaucoup plus stables. Aujourd'hui, le nucléaire est quand même relativement cher. La construction, en tout cas, pas l'opération, mais la construction de centraux nucléaires est chère, ça prend du temps. Mais oui, je pense qu'il faut maintenir cette capacité, cette compétence, chercher à l'améliorer autant que se peut. Mais ce ne sera jamais 100% la production d'électricité parce qu'il y a d'autres moyens beaucoup moins chers et beaucoup moins risqués. Mais donc voilà, ça a sa place dans le mix énergétique.
- Speaker #0
Plusieurs fois lors de nos échanges, on a utilisé le terme avoir de l'impact. Comment on fait pour avoir de l'impact ? Comment on fait pour changer les choses ? Pour toi, ça veut dire quoi avoir de l'impact ? Comment tu incarnes cela ? Et au final, je vais ramener la question à quelque chose qui me concerne directement, c'est comment une institution universitaire peut-elle être acteur avec des leviers, des solutions ? Et donc, comment une institution universitaire peut avoir de l'impact ?
- Speaker #1
Bon, chacun a évidemment de l'impact selon son activité, selon son réseau social, selon ses compétences et toute forme d'impact, même un impact local. J'éduque mes enfants avec des valeurs de développement durable et déjà une valeur inestimable. Comme professeur d'université moi-même, on a de l'impact, un, via la formation de nos étudiants, deux, via nos projets de recherche, une recherche qui vise à... chercher des solutions, comprendre les défis, les obstacles au déploiement de ces solutions. Et trois, via le service à la société. Dans mon cas, j'ai plusieurs activités de conseiller scientifique auprès de, je l'ai dit, de la Commission européenne, mais aussi de fondations philanthropiques privées. Et donc, voilà, partager cette expertise pour essayer d'orienter des décisions dans une direction plus durable. Du nouveau, il n'y a pas de petit impact. Chacun peut avoir un impact majeur, même très local. Ça a déjà un effet important à long terme.
- Speaker #0
On arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Encore quelques minutes. Je voudrais terminer par deux questions, peut-être, pour nourrir l'auditeur et l'auditrice. Et une question un peu plus philosophique de toi à moi. Est-ce que tu voudrais bien partager trois ressources ? Des livres, des vidéos, un peu ce que tu veux. qui ont réellement eu un impact fort sur toi, qui ont changé un petit peu le mindset dans lequel tu étais ou la vision du monde que tu portais jusque-là ?
- Speaker #1
Je lis beaucoup. Je lis beaucoup de choses très différentes. Et de nouveau, je pense que c'est ça qui m'influence. Ce n'est pas tellement chercher un gourou qui m'aurait montré la voie, mais plutôt m'exposer constamment, journalièrement, à tout un ensemble de perspectives très économiques, très technologiques, très poétiques, très philosophiques. pour exercer mon espèce de sens critique et de sens de la synthèse pour ramer toutes ces pièces ensemble. Donc de ce point de vue-là, peut-être que je mettrais en avant deux ressources sur plus des auteurs qui n'ont pas seulement écrit un bon livre, mais ont vraiment fait une œuvre, donc une série de travaux qui représentent une espèce de trajectoire intellectuelle. Un qui m'a influencé, c'est Jared Diamond, un auteur américain, qui écrit toute une série de livres assez différents les uns des autres, mais qui se suivent de manière relativement logique et qui représentent une très bonne vulgarisation. Jared Diamond est quelqu'un qui lit beaucoup, mais qui a cette capacité de digérer, d'expliquer de manière extrêmement claire, très imagée, très parlante, des concepts scientifiques relativement compliqués. Et je pense que ça, c'est une aptitude très importante dans le monde dans lequel nous sommes. Il ne suffit pas de générer un savoir approprié, mais il faut être capable de le communiquer de manière claire. Et peut-être dans un autre registre, un autre auteur qui a fait toute une œuvre très cohérente, mais qui n'est pas du tout scientifique, c'est un penseur d'origine écossaise qui s'appelle Kenneth White, qui est décédé il y a deux ans, en 2023. et qui a fondé un mouvement qu'il a appelé la géopoétique, qui est une espèce de manière de vivre, de manière plus pleine, en connexion avec le monde, avec la nature, de trouver un sens plus profond par la manière dont on interagit avec le monde naturel, et qui a écrit un très grand nombre de livres, mais à la fois des essais, c'est une œuvre poétique très riche. et également quelques récits de voyage où il a mis en pratique un peu ses valeurs de géopoésie. Et donc, c'est certainement deux auteurs que j'ai suivis, que je relis régulièrement et qui influencent ma manière de penser.
- Speaker #0
Super. Toute dernière question avant qu'on se sépare. Si ton toi du présent pouvait rencontrer ton toi du passé, il y a 10-15 ans, qu'est-ce que tu voudrais lui dire comme message ?
- Speaker #1
Je suis plutôt tourné vers le futur que vers le passé, mais c'est clair qu'il y a 10-15 ans, au moment où toute la science sur l'impératif de cette transition vers un développement durable était tellement évidente, tellement claire, je n'aurais jamais pu imaginer qu'on allait rencontrer autant d'obstacles, autant de retours en arrière, tel qu'on l'expérimente aujourd'hui, avec ce virage vers l'extrême droite. J'ai naïvement pensé de manière trop rationnelle. Les données scientifiques sont claires, les solutions sont connues, il suffit de les mettre en œuvre, allons-y. Jamais je n'avais imaginé qu'il y aurait une telle résistance irrationnelle, émotionnelle, politique, à quelque chose qui me paraît tellement évident.
- Speaker #0
Eh bien Eric, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré pour cet épisode. Merci beaucoup d'être venu aussi à l'Université de Mons. Chers auditeurs, chères auditrices, je t'invite aussi à... à aller voir la conférence sur YouTube. Comme ça, tu auras vraiment un écosystème complet qui se fait écho. Et sur ce, je te souhaite une très, très belle journée. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Eric, à très, très bientôt, j'espère.
- Speaker #1
Merci beaucoup.
- Speaker #0
Belle journée à toutes et à tous. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs... Si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.



![[Trailer] Épisode 129 - Carlo Rovelli cover](https://image.ausha.co/YnEtkz8bZtJQXmnEN5a0iLkU3SHNCkEV5nxH6C8J_400x400.jpeg)
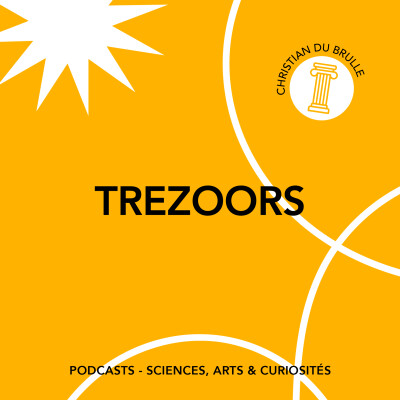
![[Trailer] Épisode 128 - Trezoors | Feat. Christian Dubrulle cover](https://image.ausha.co/e2hRPNecxKZRvrf3YnZcZptQucTv1C7oh4jW4oj3_400x400.jpeg)