- Speaker #0
Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
- Speaker #1
Ce qui place votre zone d'atterrissage à 5,0667 degrés de latitude nord et 77,3333 de longitude ouest.
- Speaker #0
Rien de tout ça derrière. Qu'est-ce que le réel ? La seule variable constante est l'inattendue.
- Speaker #1
On ne peut pas la contrôler.
- Speaker #0
Je crois que vous êtes encore pire que ces créatures. Elles, elles n'essaient pas de se massacrer entre elles pour tirer le plus gros. Voyons si une capacité de poussée de 10% permet de décollage. Et 3, 2, 1... Chers auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Aujourd'hui, je suis dans la salle Utopia du Mondanéum. Il est 10h du matin, donc plutôt que de la bière sur la table, tu vas retrouver du thé, du café et des viennoiseries. Et on est le 14 mars. Hier soir, donc le 13 mars au soir, c'était l'inauguration de la nouvelle exposition du Mondanéum, Cité des possibles, des utopies aux réalités de demain. Cette exposition va être ouverte et être accessible pendant un an. Et autour de la table, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir quatre personnes qui ont contribué à la réalisation de cette exposition. Alors j'accueille aujourd'hui Aurélie Montigne, Antoine Dabé, Camille Paris et Margot Savignac. J'espère n'avoir écorché aucun nom. Comment vous allez ?
- Speaker #2
Ça va très bien, merci beaucoup pour cette invitation.
- Speaker #3
Ça va bien, je suis contente de pouvoir parler du projet.
- Speaker #0
Super.
- Speaker #1
Oui, ça va très bien aussi. On est au soleil, on est bien. Et en plus, on va parler d'exposition et d'utopie. Donc,
- Speaker #2
c'est parfait.
- Speaker #0
Et justement, on va revenir sur toute une série de concepts. Mais avant ça, je pense que pour l'auditeur et l'auditrice qui écoutent ce podcast là maintenant, ce serait bien qu'en quelques mots, parce qu'on est quand même quatre autour de la table, en l'occurrence cinq, puisque je suis là aussi, que vous puissiez vous présenter chacun en 25 secondes. On essaie ? Possible ?
- Speaker #2
Moi je suis Antoine Dabbé, donc comme mes deux camarades présents je suis étudiant du master muséographie de Arras à Artois, dans lequel du coup on a été muséographe de l'exposition, et personnellement je suis apprenti médiateur scientifique et je suis aussi historien des sciences de formation.
- Speaker #0
Bienvenue Antoine.
- Speaker #4
Moi c'est Camille Paris, j'ai plutôt un profil d'histoire de l'art, histoire et muséologie, et donc comme Antoine étudiante apprentie muséographe dans le master de l'université d'Artois.
- Speaker #0
Super.
- Speaker #3
Et donc, moi, c'est Margot Savignac. Je suis aussi muséographe de l'exposition en tant qu'apprentie. J'ai plutôt un profil art, plus précisément art moderne et art contemporain.
- Speaker #0
Super.
- Speaker #1
Alors, moi, c'est Aurélie Montigny. Je suis la directrice du Mondanéum, qui est un centre d'archives privés et un espace muséal à Mons.
- Speaker #0
Et petite anecdote, les trois étudiants, en tout cas les trois personnes en formation qui ont participé à l'exposition, ... On entre autres court avec Serge Chaumier, avec qui on avait déjà fait un podcast par le passé, autour des questions de quelles sont les responsabilités du musée et quel est le rôle de la muséographie dans un musée. J'ai pu revoir Serge hier, j'étais très content d'échanger avec lui. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le sujet de ce podcast. Le sujet de ce podcast, c'est vraiment l'exposition. Cette exposition a été développée par deux partenaires, le Mondanéum et l'Université de Darras. C'est un projet qui a pris deux ans pour... aboutir et qui va être accessible pendant une année. Alors, le premier élément que je voudrais discuter avec vous toutes et Antoine, c'est comment aujourd'hui, dans le contexte économique, politique, social, écologique dans lequel on se trouve, on peut encore rêver d'utopie ? Vous avez 10 minutes.
- Speaker #1
Alors, ça, c'est une vaste question et moi, je poserai en fait plutôt la question inverse. dans ce contexte qui est le nôtre aujourd'hui, comment ne pas rêver d'utopie ? Parce que quelque part, l'utopie, c'est un peu connoté en fait. On a l'impression que dans un monde qui est un peu régi par l'immédiateté, de se poser, de rêver, c'est contre-productif. Mais en fait, l'utopie, elle a cette force de nous pousser à réfléchir à ce qui ne nous convient pas dans une société, finalement dans une ville, dans sa vie, de manière plus générale. et... de dépasser cette analyse pour essayer de trouver des solutions, des alternatives pour améliorer tout ça. Donc l'utopie n'empêche pas l'action, c'est pouvoir de dépasser cette analyse pour essayer d'imaginer autre chose. Et donc dans une société forcément qui est en crise, c'est vraiment le contexte idéal pour pouvoir se dire on veut autre chose, l'humanité tend vers autre chose. Et donc pour moi, une société qui n'aurait pas cette capacité d'imaginer, de réfléchir à une meilleure version d'elle-même, En fait, c'est une société qui n'a pas tellement d'avenir. Donc, l'utopie est nécessaire. Maintenant, c'est sûr que... C'est pas à pas, il faut pouvoir prendre le temps de réfléchir de manière un peu ponctuelle, de mettre en place des projets qui ne vont pas forcément révolutionner la face du monde, mais qui, petit à petit, vont faire bouger les lignes pour arriver à quelque chose de concret.
- Speaker #0
Super. Est-ce que l'un de vous veut compléter cette réponse ?
- Speaker #2
Oui. En soi, je n'aurais pas su mieux dire qu'Aurélie, parce que c'est effectivement ça un peu l'utopie pour nous. Nous, c'est important de dire que l'utopie, c'est un peu un moyen, c'est un outil, à la fois pour critiquer la société dans laquelle on vit. pour la réimaginer, mais aussi pour la rêver, pour la fuir, si c'est compliqué. Et dans nos lectures et nos recherches, on s'est rapidement rendu compte que les utopies étaient fortement liées à des périodes de crise. Et ces crises sont très subjectives, ça dépend beaucoup de la période dans laquelle on est, de qui on est, où est-ce qu'on se trouve, et aussi ce qu'on a vécu. Et c'est très important de garder ça en tête, d'avoir sa propre utopie vis-à-vis de tout ça.
- Speaker #0
J'ai l'impression aussi qu'au final, cette utopie, elle va jouer un rôle essentiel, c'est de montrer qu'il y a des futurs alternatifs. enviable ou non à décider ensemble, mais qu'il y a des scénarios alternatifs que celui qu'on vit maintenant et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que vous êtes en train de nous partager. Alors dans le titre de l'exposition, il y a le terme cité qui est utilisé. Une première question que je me suis posée c'est pourquoi utiliser le terme cité et pas le terme ville ? Quelle est la différence pour vous ? Et l'autre élément que je voudrais savoir c'est au final qu'est ce qui caractérise pour vous une cité ? Quels sont les éléments constitutifs de base qui vont permettre par exemple de différencier une cité d'une autre cité ?
- Speaker #1
Alors par rapport au terme de cité, nous c'est vrai qu'on est directement partis sur ce terme-là puisque la base de l'exposition c'était de parler de la cité mondiale de Paul Hotelet telle qu'elle a été définie, donc c'était vraiment la notion de cité mondiale. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, on a dû établir un peu un langage commun entre nous parce que le mot cité n'avait pas la même définition en France qu'en Belgique ou en tout cas dans... dans l'esprit des étudiants et dans le nôtre, et donc on s'est dit sur quoi on va partir, en sachant que de toute façon, nous, le terme cité allait apparaître, puisque c'est la dénomination de la cité mondiale. Et donc, on a établi un langage commun, en fait, un socle commun, et on s'est dit, le terme cité est plus global dans la mesure où ça dépasse un peu cette notion d'architecture, de tissu urbain qu'on pourrait imaginer plutôt dans le terme de ville. Et avec cette notion aussi de, dans une cité, il y a des citoyens qui participent à la construction de cette ville, qui mettent des valeurs. Et on trouvait que c'était un peu plus représentatif, en tout cas, du propos de la cité mondiale qui avait été imaginée par Paul Autelet. Et donc, c'est vrai qu'on a appliqué ce terme de cité aux autres villes idéales, dans vraiment cette idée de, il y a des valeurs derrière, dans ces projets utopiques. On a envie d'en tendre vers quelque chose. Il y a une quête qui est présente avec une... une participation active des personnes qui la constituent. Donc c'était vraiment dans cette optique-là.
- Speaker #4
Je pense aussi qu'il y a une différence d'échelle entre la ville et la cité. On peut voir des cités incluses dans des villes, comme les cités ouvrières, les cités jardins, pour faire un peu référence à l'histoire. Et puis dans le terme de cité, il y a aussi tout un aspect plus communauté. C'est plus proche au niveau des valeurs. Ça change complètement d'une ville. La ville, ça fait vraiment beaucoup référence à l'urbanisme, alors que les... Une utopie, ce n'est pas forcément que de l'urbain. Ça peut aussi être dans un cadre beaucoup plus à la campagne, plus en retrait de tout ça.
- Speaker #0
J'imagine que cette utopie intègre aussi, comme vous l'expliquez là, un ensemble de tissus social qui se fondent avec la cité urbaine, qui se fondent avec la ville plutôt urbaine et qui devient justement quelque chose de plus grand en termes de concept, j'entends, qui est la cité.
- Speaker #3
Aussi, c'est vraiment une question qu'on s'était posée en interne avec le Monde d'Anéum et nous aussi les apprentis muséographes. C'est pour ça que dans l'exposition, on retrouve des petits points à chaque séquence avec des définitions pour que justement le visiteur ait ce langage commun et puisse comprendre notre propos.
- Speaker #0
Tout à fait. Alors j'ai visité l'exposition hier. Pour être franc... Le podcast s'est décidé vraiment à l'arrache hier soir. On ne va pas... Je pense qu'à un moment, il faut mettre carte sur table. Mais c'est super. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on fait les podcasts les plus intéressants. C'est un peu en mode surprise. Quoi qu'il en soit, j'ai découvert l'exposition hier pour préparer le podcast. Et ce que je trouvais intéressant, justement, c'était ces guidelines que vous donnez tout au long de l'exposition pour qu'au final, il y ait un langage commun. Et s'il y a un langage commun, il y a une construction commune qui peut émerger.
- Speaker #2
En effet, pour nous c'était vraiment important de se dire comment est-ce qu'on parvient à l'utopie, et de donner les clés à tout et chacun pour faire la sienne. C'est un peu le découpage de l'exposition, c'est déjà pourquoi il y a une utopie, généralement si ça parle à un constat, un constat qui est actuel pour chacun, c'est quelque chose qui va mal dans notre vie, dans notre société, et on aimerait le changer. C'est une observation, on parle de déconstruire le monde, et dès qu'on a fait cette déconstruction, on peut commencer à aller vers la suite, qui est imaginer ce qu'on aimerait. pour nous, pour les autres, et aussi à qui se destinerait l'utopie qu'on imagine, la cité idéale qu'on imaginerait. Et enfin, d'accès fait, il est temps de bâtir cette cité. Et deux questions se posent, où est-ce qu'on peut la faire et comment est-ce qu'on la fait ? Et c'est important dans toutes ces réflexions de bien prendre en compte que l'utopie, l'idéal, c'est subjectif, mais qu'une cité, ça se fait à plusieurs. Et donc que ces subjectivités doivent se combiner.
- Speaker #0
Et au final, je rebondis sur ce que tu dis, ça pose vraiment la question des... quelles sont les valeurs sur lesquelles on se base pour construire une cité idéale ? Et je vais prendre deux exemples très, très opposés. J'imagine que la cité idéale de Trump et de Musk ne sera pas notre cité idéale ici, dans ce que nous avons vendu. Et donc, cette question des valeurs, elle est centrale. Et ce que j'aime aussi dans ce que tu expliques, c'est que tu donnes un petit peu un mode d'emploi, au final, sur comment repenser notre manière d'habiter le monde et comment essayer ensemble de construire quelque chose de différent.
- Speaker #3
Et justement, la dernière séquence... qui clôture l'exposition, c'est qu'on laisse la part aux visiteurs de s'exprimer. Et donc, c'est vraiment une séquence à part entière. Et on essaye de le guider dans ses réflexions avec un petit jeu débat minute pour essayer d'échanger entre visiteurs. La clôture de cette exposition, c'est vraiment ça. C'est prenez possession de tout ce qu'on vous a donné dans l'exposition et faites-en quelque chose. Votre façon de faire sera toujours la meilleure façon de répondre à ça.
- Speaker #0
Alors l'exposition, elle s'axe en deux parties, je dirais. Il y a une partie plutôt historique qui revient sur le contexte des cités utopiques, pourquoi les cités utopiques, un peu le comment. Et ensuite, justement, le comment est plus détaillé dans la partie actuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, la cité utopique a encore un rôle à jouer dans les réflexions, par exemple, politiques ou les réflexions sociales à mener ? J'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu plus sur cette partie historique. Tu le disais Aurélie. À la base, la Cité mondiale, c'est un rêve, celui de Paul Hôtelet, entre autres. Il y a toute une série de personnes autour de lui, mais il est un petit peu l'emblème de cette Cité mondiale. On a fait un podcast spécifique sur le mondanéum, machine à penser le monde. C'est l'épisode 77, chers auditeurs, chères auditrices, si tu veux retrouver ce podcast. Donc, on ne va pas revenir en détail sur cette Cité mondiale. On va se donner un petit challenge, Aurélie. Est-ce qu'en trois minutes, tu peux nous résumer le concept de la Cité mondiale ? Et après, l'auditeur et l'auditrice qui voudraient en savoir plus, je l'invite vraiment à aller retrouver cet épisode 77 et à l'écouter, parce que ça donnera vraiment aussi pas mal de perspectives à cette exposition.
- Speaker #1
Oui, alors la Cité mondiale, en fait, c'est assez simple. Finalement, c'est simple et c'est compliqué à la fois. Mais c'est simple dans la mesure où l'objectif est clair depuis le départ, c'est de parvenir à établir une paix universelle. Et donc, ça, c'est le concept aussi du monde d'Anneum. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire du monde d'Anneum et de la Cité mondiale. c'est que la cité mondiale est vraiment imaginée comme l'aboutissement ultime de tout ce concept qui a créé les différentes institutions de l'histoire du monde d'Aneum. C'est cette conviction profonde que la connaissance mène à la paix universelle et que le partage des connaissances permettrait d'y arriver, que chacun puisse être informé, pouvoir apprendre à se connaître. C'est la compréhension mutuelle entre les peuples et ça c'est vraiment la conviction. le but de toute leur vie au fondateur du monde d'Anneum, donc Paul Hôtelé, Henri Lafontaine et Léonie Lafontaine. Et cette cité, elle est imaginée comme ça, une cité qui est consacrée à la connaissance, à la coopération internationale, à la compréhension mutuelle entre les peuples. Et donc, ils ont imaginé cette cité comme étant vraiment un phare de connaissances qui éclaire un peu le monde. Voilà, c'est assez simple finalement dans l'objectif parce que c'est ça qui est un peu fou dans l'histoire du monde d'Anneum, c'est qu'en fait, ils ont eu... cette conviction profonde pendant 40 ans. Et dans un contexte, c'est quand même hyper compliqué, parce qu'on est dans un contexte entre la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et ils ont toujours été animés par cette volonté et la foi, c'est presque un acte de foi, de se dire que malgré tout ça, ils restent persuadés que la connaissance va amener à la paix universelle et que donc, si on met en place les outils pour y arriver, en fait, on va y arriver. Donc, ce n'est pas du tout utopique dans l'idée, en tout cas dans leur idée à eux. Et ça ne l'était pas non plus forcément au départ, puisque la Cité mondiale obtient quand même à la base beaucoup de soutien de l'État. Donc elle est imaginée à plein d'endroits différents. Mais c'est vrai qu'après, le contexte d'entre-deux-guerres n'est plus favorable à ce genre de projet vraiment dédié à la paix dans le monde. Et c'est là où on bascule vers l'utopie.
- Speaker #0
Dans ton discours hier, tu employais un terme que je trouvais assez fort, qui était relégué au rang d'utopie. Donc vraiment, elle a été poussée, entre guillemets, à ce niveau-là, alors qu'au début, elle n'était pas imaginée comme une utopie. Elle était imaginée comme un projet concret, réel, qui allait voir le jour et qui allait être physique. Ça allait être du dur.
- Speaker #1
Et c'est d'ailleurs pour ça que plusieurs architectes ont vraiment fait les plans. Donc ça veut dire qu'on n'est pas juste dans une cité concept. Il y a eu des plans, il y a eu plusieurs architectes, dont le corbusier. qui ont travaillé dessus, ça a été vraiment imaginé de manière très, très aboutie. Et donc, pour que des architectes s'y penchent de manière aussi poussée, c'est que clairement, on n'était pas dans quelque chose d'utopique. Alors maintenant, quand on voit le projet avec notre regard d'aujourd'hui, dès le départ, forcément, le contexte a évolué. Donc, on se dit, oui, mais ça, ça paraît un peu irréalisable. On peut aussi se poser plein de questions sur les dérives éventuelles que... Même le projet de cité mondiale aurait pu ouvrir la voie. Finalement, c'est quelque chose d'assez élitiste, assez totalitaire. Et donc là, ça pose la question de se dire, même avec les meilleures intentions du monde, à un moment donné, comment aurait pu évoluer cette cité ? Mais voilà, c'est vrai que le terme utopie est un peu connoté, mais ce n'était pas du tout imaginé comme une utopie à la base. Donc ça, c'est important de le préciser.
- Speaker #0
Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au final, cet imaginaire qui devait s'incarner, mais qui devient une utopie, est l'embryon d'une réflexion commune qui a inspiré des visions qui perdurent encore aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi pour ça que cette cité mondiale est le point de départ de votre exposition, puisqu'elle a encore une influence sur toute une série de réflexions qui sont menées aujourd'hui. Et justement, dans ces influences, alors peut-être directes ou indirectes, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cités utopiques qui ont été rêvées et qui n'ont pas été réalisées ? et à l'inverse, dans un deuxième temps, de cités utopiques qui ont été réalisées et qui donc peut-être ont quitté un petit peu ce giron de l'utopie et qui sont devenues de véritables projets.
- Speaker #2
Oui, on a un projet qu'on a découvert dans nos lectures et qu'on n'a pas abordé dans l'exposition, c'est un projet de Walt Disney qui s'appelle Epcot. Alors peut-être que vous connaissez ce projet, actuellement ça existe vraiment, c'est une partie du parc d'attractions de Disneyland, mais à l'origine c'était vraiment une cité qui voulait montrer le monde. dans ces diverses cultures, et il y avait vraiment une volonté des habitants, de vie, etc. Et c'était un projet qui était concret, mais qui s'est transformé petit à petit en un parc attraction. Donc ça a vraiment dérivé très fortement vers la dérive touristique.
- Speaker #0
Tout en gardant, en fait, cette partie mondiale où le principe, en fait, dans Epcot, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est intéressant, c'est juste pour coller à ce que tu dis, c'est que tu retrouves des employés de tous les autres parcs Disney dans le monde dans cette partie-là, et chaque employé, en fait... dans la partie du monde qui le concerne. Par exemple, ceux qui viennent de Disneyland Paris sont dans la partie française. T'as Tokyo, t'as... Vraiment, à chaque fois qu'un Disney est implanté quelque part, il est représenté à Epcot. Et il y a encore cette partie de faire découvrir le monde. Encore une fois, je n'émets pas de jugement, je dis juste ce qu'il y a factuellement. Ou ils ont une attraction qui est assez intéressante où tu voles au-dessus du monde, en fait, dans une espèce d'hémisphère. Visuellement, c'est super impressionnant, et c'est vrai, c'est très très beau. Après, je pense que Disney incarne aussi un propos capitaliste qui est assez important à l'heure actuelle. Il faut remettre en perspective de ça. On n'est pas en train de dire que Disney, c'est la voie à suivre. Est-ce qu'il y aurait une autre cité utopique peut-être à partager qui vous a marqué ?
- Speaker #2
En termes d'autres projets utopiques, ça ne serait pas vraiment un projet. Ce que signifie l'utopie à son origine, tel que ça a été pensé par Thomas More, c'est une ville nulle part. Une ville qui n'a pas de lieu dans lequel s'ancrer. Et là, pour citer Paul Ricoeur dans l'un de ses ouvrages, « L'imagination d'une autre société située nulle part ne permet-elle pas la plus fantastique contestation de ce qui est. » C'est utopique dans son sens le plus beau et en même temps le plus actuel, parce que c'est aussi une critique de la société dans laquelle on vit.
- Speaker #0
Et donc, de ce que je comprends dans ce que tu me dis, c'est que l'utopie a réellement un rôle critique. Parce que, en fait, quand on emploie le terme utopique... Au final, dans le langage courant aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un « oui, mais c'est utopique » , c'est « oui, tu rêves les yeux ouverts, laisse tomber, ça ne s'incarnera jamais » . Or, ce que tu me dis là, c'est qu'en fait, l'utopie, au-delà d'être un rêve qui n'a pas de lieu, c'est un rêve qui vient critiquer dans son ensemble la société.
- Speaker #3
Mais je pense qu'en fait, le propre de l'homme, c'est aussi de vouloir toujours ce qu'il n'a pas et toujours vouloir améliorer. Et donc, les cités utopiques ont ce rôle de toujours aller vers le rêve. Et je trouve ça beau qu'on aille toujours chercher ce qu'on n'a pas et toujours vertueux pour la personne qui le rêve.
- Speaker #0
Et j'entends que l'utopie idéale n'a pas de lieu. Cependant, il y a quand même des utopies qui sont devenues un peu plus concrètes. Est-ce qu'on peut aussi en parler ? Parce que j'ai l'impression que dans l'exposition, il y a des informations là-dessus.
- Speaker #4
Oui, en fait, dans les années 1970, on a toute une émergence de communautés basées sur un mode de vie communautaire, notamment The Farm au Tennessee, La Baracque à Louvain-la-Neuve et puis Auroville aussi en Inde. C'est des communautés, plutôt vraiment des cités là pour le coup, qui basent leur mode de vie sur l'autosuffisance, la décroissance et la préservation de l'environnement. Ces trois cités sont encore actives aujourd'hui. Il y a des habitants qui y habitent.
- Speaker #0
Et par rapport aux enjeux qu'on doit affronter, ou en tout cas prendre à bras le corps aujourd'hui, ça paraît des exemples qui sont très intéressants et peut-être même inspirants au final. Oui,
- Speaker #4
parce que pour le coup, c'est des questions, les questions environnementales et tout ça, c'est des questions qui se posent aujourd'hui, qui sont toujours d'actualité. Et je pense que c'est peut-être pour ça, justement, que ces cités sont encore actives aujourd'hui. Ça fait totalement sens à notre époque, aujourd'hui encore, même 50 ans après.
- Speaker #0
Aurélie, tu voulais compléter quelque chose ? Oui,
- Speaker #1
je voulais... effectivement, parler un peu du fait que le mot utopie est un peu connoté péjorativement. Au départ, quand on a commencé à parler un peu de l'intention de l'exposition autour de nous, on a eu parfois des réactions qui étaient assez tranchées sur le fait du genre, enfin, pourquoi les utopies ? On n'en est plus là, en fait, vu l'urgence de la situation. Maintenant, il faut agir. Déjà, on se rend compte qu'on n'a pas forcément la même définition du mot utopie. Et après, en fait, elle nous a fait un peu réfléchir. On s'est dit, mais il faut que ça apparaisse dans le titre. de l'exposition que finalement, peut-être qu'à la notion d'utopie, on va faire un lien directement avec les réalités de demain. Il faut qu'on ancre les utopies dans les enjeux actuels, pour ne pas passer à côté, pour ne pas encore passer pour des doux rêveurs et de se dire qu'effectivement on n'en est plus là, vu le genre de la situation, mais d'insister sur le rôle social que peuvent avoir les utopies. Et donc c'est vrai que ça, ça a vraiment été au centre de la réflexion sur le titre et de se dire qu'on ancre sur l'actualité. Et il n'y a pas de réponse à ces enjeux-là, mais l'idée de l'exposition, c'est d'apporter grâce à ce qui s'est déjà fait. On ne va pas repartir de zéro à chaque fois. Il y a des choses à prendre, des leçons à tirer du passé, des différents projets qui ont été mis en place, qu'ils se soient réalisés ou pas finalement, mais il y a des enseignements à en tirer. Et à partir de là, c'est de permettre d'enrichir la réflexion pour pousser justement, et de se dire « et demain en fait ? » Et c'est la dernière section, elle s'appelle comme ça, c'est « et demain ? » Qu'est-ce qu'on a envie pour demain ? C'est dépasser un peu la notion d'utopie pour l'ancrer dans le présent. C'était vraiment ce qui était important pour nous. C'était un enjeu crucial et on s'est bien demandé à un moment donné comment on allait dépasser ça pour ne pas passer à côté justement de l'exposition.
- Speaker #0
Et au final, ça nous permet un petit peu de basculer sur cette partie plus actuelle justement qu'il y a dans l'exposition et qui est essentielle et qui a pour but de montrer aujourd'hui à quoi doit servir, et j'utilise le terme doit de façon consciente, une utopie. une utopie, une cité utopique dans toutes les réflexions qu'on doit mener. Pour illustrer aussi ça, je prendrai des propos qui ne sont pas les miens, des propos d'Arthur Keller qui dit qu'en fait, à l'heure actuelle, on n'a plus besoin de gestionnaire, on a besoin de visionnaire qui travaille au bien commun. Et justement, ces utopies sont là pour nourrir les visionnaires et faire en sorte qu'on aille vers un futur enviable. Et ça va poser d'autres questions ensuite qu'on abordera.
- Speaker #2
C'est sûr qu'on a besoin de rêveurs. Et c'est en rêvant à plusieurs qu'on arrivera à faire une cité du futur. Et qui correspondra ? au plus grand nombre. Bien sûr, il y aura plusieurs cités parce qu'une cité universelle, ça ne peut pas vraiment exister, dans le sens où les utopies, les idéaux, c'est propre à chacun. Mais l'utopie, ça doit servir à ça. L'utopie, l'idéal, ça doit servir à se questionner sur ce que nous, on a besoin par rapport aux crises dans lesquelles le monde se trouve et comment est-ce qu'on peut parvenir à les mettre en place, les rendre concrètes sans forcément tomber dans des dérives.
- Speaker #0
Et tu me permets de faire une très très belle transition. C'est la question justement des dérives. puisque une utopie, c'est... Au départ, je caricature le rêve d'une personne, peut-être d'un petit groupe de personnes, mais qui va peut-être vouloir imposer cette vision du monde à un autre groupe. Et donc, comment ne pas tomber dans les dérives ? Comment une utopie pourrait devenir une dystopie ? Typiquement, ce qu'on vit aux États-Unis est certainement l'utopie d'une part de la population et une dystopie pour une autre part de la population. Comment éviter de tomber dans des situations aussi extrêmes au final ?
- Speaker #1
Ça me fait un peu penser, on a eu cette discussion ensemble avec Luke Skuyten hier soir, qui disait qu'en fait, une utopie ne doit pas être l'œuvre d'un seul homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on revient à cette idée de co-construction, de différentes personnes qui doivent la constituer, parce qu'effectivement, même avec les meilleures intentions, encore une fois, c'est toujours un peu ce proverbe qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est que... Même avec les meilleures intentions du monde, si c'est aux mains d'un seul homme et si c'est pensé par un seul homme, à un moment donné, est-ce que ce n'est pas la voie royale pour arriver vers une dérive complètement totalitaire ? Donc voilà, c'est peut-être pour l'empêcher, empêcher cette dérive, c'est effectivement de co-construire à plusieurs des grands penseurs qui à un moment donné, et pas que des penseurs d'ailleurs, mais chacun dans son expertise, dans ses compétences, amener quelque chose pour tendre vers un idéal, en sachant que l'idéal, on n'y parviendra probablement pas. Et ce n'est pas un échec en soi, mais d'avoir cette quête vers quelque chose d'absolu et de pouvoir s'améliorer, de pouvoir évoluer, accepter que le projet évolue aussi. Ça, ça me paraît essentiel. Mais voilà, je pense que ça, c'est un peu les clés. Pour éviter un peu les dérives. En tout cas, dans les exemples qui sont présentés dans l'exposition, les dérives, c'est souvent totalitaire, sectaire, parce que c'est la pensée unique, en quelque sorte.
- Speaker #0
Et au final, est-ce que ce n'est pas ce qui oppose l'utopie et la dystopie ? C'est qu'une utopie, j'ai l'impression, il y a une espèce de positivisme derrière, il y a une espèce de futur enviable pour le bien commun qui n'est pas derrière la dystopie. De facto, quand on parle d'utopie, il y a ces notions de bien commun qui arrivent, ces notions de construire un projet ensemble, avec les gens et pour les gens.
- Speaker #2
Utopie pour un, dystopie pour autre. C'est-à-dire, si c'est l'utopie d'une grande personne, d'une personne mégalomane avec beaucoup d'argent qui veut faire une cité, il y a de fortes chances que ça devienne une dystopie pour beaucoup de personnes. D'où l'importance à ce moment-là que l'utopie soit l'expression d'un groupe, et d'une volonté de plusieurs.
- Speaker #0
Et ça met en pratique toute une série de démarches de sociocratie. où le citoyen, le membre, la personne qui y habite devient un élément constitutif des décisions qui sont prises dans la cité en l'occurrence. Une question que je me suis posée en visitant l'exposition, c'est est-ce qu'au final, de votre côté, vous avez pris chacun et chacune le temps de réfléchir aux éléments qui seraient indispensables dans votre cité utopique à vous ? Puisque j'entends, au départ, c'est un élément très personnel qui après se construit à... à plusieurs, mais ce point de départ reste personnel. Et donc, est ce que vous seriez d'accord éventuellement de partager ces réflexions si vous les avez menées autour de votre cité idéale à chacun et à chacune ?
- Speaker #3
Je vais commencer. C'est une question qu'on s'est posée à un moment donné tous ensemble pour savoir quelle était notre cité idéale. La mienne, je dirais qu'elle est féministe et qu'aussi elle est justement dans le collectif et le partage. Et je pense que c'est chouette parce que ça rejoint beaucoup les valeurs du Mundaneum avec le fond d'archives féministes, avec la vision de Paul Hôtelet sur toutes ces connaissances et le partage. Merci.
- Speaker #4
La mienne, elle serait plutôt basée sur la slow life, si je peux dire ça comme ça, où on est plutôt dans une démarche de décroissance et puis qu'on ramène tout d'un point de vue local. Je rêve d'une cité où il y a plein de friperies. Plein de marchés de seconde main.
- Speaker #0
Très bien pour moi, trop cool.
- Speaker #2
Moi, à titre personnel, ce serait plus un peu, pour prendre un exemple, dans Star Trek. C'est de la SF, c'est une société où l'humanité n'a plus pour but de faire de l'argent ou de produire. Son but, c'est vraiment de faire de la connaissance, c'est de faire de la recherche. C'est une société où on n'a plus de différence de classe sociale ou de grandes inégalités entre les genres et entre les origines et tout ce qui est possible. Et où on peut chacun aspirer à faire ce qu'on veut. et à être comme on veut.
- Speaker #0
Super. Il ne reste que toi Aurélie.
- Speaker #1
Oui, alors moi c'est un peu plus terre à terre. Il n'y a pas vraiment de grands idéaux. Moi ma ville idéale, je ne sais pas si vous connaissez la pub Grani. Où en fait on voit des gens qui se baladent dans la ville, mais qui sont complètement végétalisés. Ils cueillent une pomme, ils se baladent. C'est vraiment la campagne dans la ville, un peu où la nature a repris tous ses droits. C'est ma ville idéale. C'est comme ça que je le... Enfin voilà, reconnecter avec la nature, de pouvoir avoir des espaces vraiment verts, des arbres, plus du béton. Après, il y a plein d'autres choses, le féminisme et tout. Mais tu vois, le premier truc, moi, c'est vraiment ça.
- Speaker #0
Très bien. Alors, il y a une utopie qui s'incarne un peu plus que les autres dans l'exposition. Tu en as parlé brièvement il y a quelques minutes. C'est l'utopie de Lux Keuten. Est-ce que quelqu'un d'abord peut expliquer qui est Lux Keuten ? Pourquoi il était là hier et pourquoi il est présent dans l'exposition ? qu'est-ce que son utopie véhicule comme message ? Alors, Luke Skuyten, c'est un architecte qui a beaucoup travaillé sur, justement, les questions de la ville du futur. Alors lui, il travaille beaucoup sur les cités végétales. D'ailleurs, il travaille avec des biologistes. Il est convaincu qu'on doit s'inspirer de la nature pour pouvoir créer des nouveaux modèles. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Et donc, il imagine plein de choses qui s'inspirent de différents écosystèmes qu'il a pu observer. les habitards, brelais, donc ça va même jusque dans la communication entre, par exemple, les différentes espèces. Donc il a vraiment un système de réseau. Donc c'est assez complexe comme pensée, mais il va jusqu'à imaginer aussi la mobilité en fonction de cette conviction qu'il a de devoir s'inspirer de la nature. Donc pour lui, toutes les solutions en fait sont là, c'est juste qu'on ne regarde pas au bon endroit. Si je résume, je ne sais pas s'il serait d'accord avec ça, mais si je résume un peu sa pensée telle que je l'aperçois.
- Speaker #1
C'est ça que j'ai essayé de trouver. C'est très bien.
- Speaker #0
Et donc... Donc pourquoi on a voulu le présenter dans l'exposition ? Parce que ça nous paraissait intéressant d'ouvrir la dernière section « Et demain ? » avec le projet de quelqu'un qui a déjà pensé de manière très construite. Le fait qu'il soit architecte, qu'il soit dessinateur, très porté sur la poésie aussi, ça nous semblait être une bonne manière de faire cette transition-là, d'avoir à la fois quelque chose d'hyper abouti, d'hyper construit, mais avec ce rêve qui caractérise en fait toutes les utopies qu'on a pu présenter jusqu'à présent. Donc c'était hyper... En plus, ce qui est chouette avec lui, c'est que c'est une vision très positive. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans quelque chose d'alarmiste. Il veut répondre à l'enjeu majeur écologique. Lui, c'est une alternative à la transition, à ce problème écologique qui est le plus gros problème, je suis d'accord avec lui, qui nous pend au nez. C'est une des solutions, une des alternatives que lui propose, mais c'est dans quelque chose de très positif. Et même, son dernier bouquin parle d'un monde désirable. Donc pour lui, en fait... Il n'y a pas ce poids que pour avoir certaines utopies, ce devoir de dire il faut absolument agir, on va aller dans quelque chose d'hyper radical et ce sera très oppressant, ce ne sera pas du tout positif parce qu'on est au pied du mur et en fait on n'a pas le choix. Lui, il a une optique hyper positive par rapport à ça. Il est dans le rêve, il est dans quelque chose de très végétal et pour lui, en fait, on doit le désirer ce monde de demain. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit mettre sur les épaules de nos enfants, des générations à venir en disant maintenant... Voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait, à vous de trouver ça et tout le poids du monde sur les épaules. Non, c'est vraiment quelque chose qui se co-construit et c'est très positif en fait comme vision. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit tendre pour essayer de dépasser un peu et d'avoir quelque chose, de pouvoir rêver encore et pas tomber dans un genre de désespoir en disant, il faut qu'on trouve des solutions parce que là, c'est pas alarmiste et c'est pas angoissant ni anxiogène comme ce qu'on pourrait parfois entendre comme discours.
- Speaker #1
Tout à fait, et d'ailleurs son discours hier, puisqu'il est intervenu lors de l'inauguration, était extrêmement inspirant. Je me suis dit, je vais faire un podcast avec ce monsieur, donc voilà, ce sera pour la prochaine saison je pense, mais il y aura quelque chose autour du travail de Luke Skuyten et de sa vision du monde. Alors à l'opposé, dans l'exposition, vous présentez aussi une autre utopie qui s'incarne à l'heure actuelle, qui s'appelle The Line, dont on a déjà discuté avec Pascal Simons dans d'autres podcasts, Dion Lyon, il y a plusieurs saisons. Cette utopie, je ne sais plus si on peut l'appeler une utopie puisqu'elle a un lieu maintenant. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ? Est-ce que vous pouvez la présenter pour que justement après, on puisse un peu comparer ce que Luke Skuyton a imaginé, ce que les personnes derrière de l'Aïn ont imaginé ? Est-ce qu'il y a des points communs ? Est-ce qu'il y a des divergences ? Lequel est le futur le plus enviable ? Pour qui ? Vous voyez toutes les questions vers lesquelles je vais.
- Speaker #2
En effet, c'est vrai qu'en termes de termes, Ces deux, The Line et la cité végétale de Luke Skryten, utilisent le même terme. L'écologie, l'environnement, la nature, etc. Pourtant, ça n'a absolument rien à voir en pratique. Et pour nous, dans l'exposition, c'était vraiment important de montrer tous les types d'utopies qui pouvaient exister. À titre personnel, The Line, c'est une dystopie, pour moi, sur beaucoup, beaucoup d'échelles, parce que c'est, de part, une utopie qui est capitaliste, qui veut recommencer et accentuer ce qu'est le capitalisme et ce qu'est la hiérarchie des classes. et les iniquités dans le monde. Mais en plus, ça n'a absolument rien à voir, rien d'écologique, parce que c'est un environnement qui n'est pas hospitalier, c'est le désert, ça veut créer un énorme bâtiment fait de métal et de verre.
- Speaker #1
Une espèce de grande ligne, en fait, qui traverse le désert, une ligne de plusieurs kilomètres. On ne parle pas de quelque chose...
- Speaker #2
C'est ça, qui va faire 30 kilomètres, je crois, 500 mètres de haut. Du coup, il va séparer une biodiversité déjà sur place, qui va déplacer des populations entières sur son chemin, mais qui se dit écologique, parce qu'il se dit zéro carbone.
- Speaker #1
Je pense que tu as employé des termes assez intéressants, c'est-à-dire pour toi c'est une dystopie, pour d'autres c'est une utopie. Ça pose la question du futur enviable et surtout ça pose la question c'est est-ce qu'il existe un futur enviable pour la société humaine ? Est-ce qu'au final la réponse à ce grand paradigme de que va devenir la société humaine dans le futur, c'est peut-être une société qui vit dans des milieux extrêmement différents ? Une partie pourrait vouloir aller vivre dans The Line et une autre partie, comme Aurélie, voudrait aller plutôt vivre dans la cité de Luxe-Coyton. Est-ce que justement, ce n'est pas la pluralité aussi de la cité qui pourrait répondre aux enjeux de demain ?
- Speaker #0
Oui, clairement. En fait, ce qui est intéressant avec The Line, si on la confronte avec la cité de Luxe-Coyton, c'est qu'on est vraiment dans le cœur de la problématique de l'utopie. C'est-à-dire que tous les deux répondent à l'enjeu sociétal majeur que représente l'écologie. Mais c'est deux alternatives différentes, c'est deux propositions différentes. De là, le fait que ce soit installé dans un désert, c'est aussi pour répondre à ce défi écologique potentiel que pourrait représenter le réchauffement climatique, à un moment donné, de se dire qu'on va devoir habiter dans un milieu inhospitalier dans l'avenir. Et donc, c'est une proposition, c'est une alternative. Alors moi, je trouve que sur le papier, effectivement, c'est pour répondre à cet enjeu écologique-là. les intentions qui sont derrière ou l'interprétation occidentale. que nous, on peut avoir de ces intentions, peuvent poser problème. Mais ça n'empêche que c'est une solution, en fait. C'est de dire comment on pourrait habiter un désert. Moi, je trouve ça intéressant. Après, ce qu'on y met derrière, la vision qu'on pourrait en avoir, ça questionne aussi sur le fait qu'effectivement, l'utopie n'est pas universelle. Quand on voit Dubaï, il y a des gens qui adorent Dubaï, que leur rêve, c'est d'aller à Dubaï. Moi, ce n'est pas du tout mon rêve, mais ce n'est pas pour ça que ça existe. Ça répond aux attentes et aux besoins d'une grande partie de la population. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des utopies plurielles, je pense. Et c'est là, ça incarne vraiment ce vers quoi on doit tendre. Les utopies des uns ne sont pas les utopies des autres. L'utopie, dystopie, la frontière entre les deux, c'est une question d'interprétation et de culture, je pense vraiment. Et effectivement, nous, ça nous choque, mais je pense que c'est notre vision occidentale. Le capitalisme, oui, si on imagine une cité utopique idéale aux États-Unis, ce ne sera pas la même que celle qu'on va imaginer en Russie, quoique peut-être que... Ça va se rejoindre dans les...
- Speaker #1
Il y a des petites convergences. Oui, il y a des petites convergences,
- Speaker #0
mais on ne prend pas de politique. Aucun choix. Mais voilà, et donc ça, c'est toute la pluralité, la diversité de l'humanité. Il faut l'accepter. Moi, je ne suis pas du tout contre, en fait. Maintenant, ça posera plein de questions, comme Dubaï, la construction, les gens, l'esclavage, l'exploitation des travailleurs. Ça peut poser plein de questions, mais ces questions-là vont se poser aussi pour d'autres cités idéales occidentales. Il ne faut pas qu'on ait un regard ethnocentré par rapport à ça. C'est juste un exemple.
- Speaker #1
J'ai l'impression en fait qu'une question, même si l'utopie est plurielle, si la frontière entre utopie et dystopie est très mince, il y a pour moi peut-être une notion de bien commun, mais pas généralisée aux personnes qui sont dans la cité, mais au monde entier. C'est peut-être utopie justement de le dire, mais de se poser si ce qu'on est en train de construire ne détruit pas quelque chose d'autre, même si c'est à des milliers de kilomètres. et j'ai l'impression que là, il y a peut-être une grille de lecture aussi à avoir pour questionner au final les utopies qui se construiraient. Je pense que ça pourrait être intéressant. Est-ce que vous pourriez partager quelques ressources documentaires qui vous ont marqué tout au long de votre travail et qui pourraient peut-être inspirer l'auditeur et l'auditrice pour découvrir d'une autre façon aussi le sujet que vous traitez dans l'exposition ?
- Speaker #2
Oui, en soi, j'en aurais une que je pourrais conseiller, c'est l'idéologie et l'utopie de Paul Ricoeur. C'est un ouvrage qu'on a lu assez tôt dans le projet, qui m'a beaucoup nourri dans le sens où c'est un ouvrage qui va déjà présenter les différentes notions d'utopie dans l'histoire, et les différentes utopies qui peuvent exister. Et du coup, il va montrer à quel point c'est subjectif. J'en ai beaucoup parlé juste avant. Il va parler des utopies au regard de la famille, au regard du travail, de l'environnement. Et il parlera de Manheim, de Fourier et de Saint-Simon aussi, qui sont trois philosophes savants occidentaux qui ont chacun eu une différente conception de l'utopie.
- Speaker #1
Super, merci.
- Speaker #0
Alors nous, c'est assez facile, puisque au niveau de la cité mondiale, forcément, notre source première, c'est les archives. Et alors après, effectivement aussi, sur les notions d'utopie, qui sont quand même un peu philosophiques, je suis tombée en préparant mon petit discours pour le vernissage d'hier sur un article super intéressant de Anne Staquet. Je crois que c'était sur la nécessité des utopies ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment hyper inspirant, où elle explique vraiment la nécessité d'une utopie aujourd'hui. Donc voilà, pourquoi pas aussi un prochain sujet de conférence, ici au Mondanium, ce serait pas mal. Et autrement, d'un point de vue tout à fait personnel, moi, ma grande ressource, ça reste 1984, d'Orwell, parce que c'est vraiment, en termes d'utopie-dystopie, là, on est vraiment dans quelque chose d'hyper parlant. Et voilà, je pense que... Pour moi, c'est vraiment les archives. Je vous invite d'ailleurs à venir les voir.
- Speaker #1
Avec plaisir.
- Speaker #3
Moi, comme ressource, je conseillerais de venir dans l'exposition, puisque à la fin, on a un petit coin avec justement des ressources pour aller plus loin. Donc, il faut venir.
- Speaker #1
Bien joué.
- Speaker #2
Et une autre qui m'a beaucoup, enfin qui nous a aussi beaucoup un peu inspiré, c'est un documentaire produit par Arte, et qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne Le Vortex, avec la participation de Architectons et de Enfants de l'Est. C'est un documentaire qui s'appelle Le Brutalisme, l'architecture de la dépression. et qui, bien que le titre ne donne pas trop envie, parle de comment l'imaginaire et l'utopie a inspiré l'architecture notamment russe après la Seconde Guerre mondiale.
- Speaker #1
Ça évite un petit peu ce regard ethnocentré, entre guillemets, d'avoir notre vision occidentale de l'utopie. Là, on vient se confronter à une autre vision d'une autre utopie sur un autre territoire qu'il est important de comprendre aussi.
- Speaker #2
C'est ça.
- Speaker #1
Avant de passer vraiment à la conclusion de cet épisode, je voudrais vous demander, est-ce que vous auriez chacun une dernière phrase, quelque chose à échanger avec l'auditeur et l'auditrice pour le convaincre ou la convaincre de venir explorer ce thème dans l'exposition ?
- Speaker #2
J'aimerais voir apparaître dans les imaginaires collectifs beaucoup plus d'utopie à présent, beaucoup plus d'imaginaires nourris, florescents et optimistes parce qu'il en manque cruellement actuellement et nous, notre but, c'est vraiment d'ouvrir des portes. dans cette expo.
- Speaker #1
L'expo est en quelque sorte un vecteur pour initier la création d'une utopie multiple chez les individus qui viendraient la voir.
- Speaker #3
Aussi requestionner la société dans laquelle on vit. Fais référence à ce que tu viens de dire Antoine, justement pour réanimer un peu cette envie de créer de nouvelles utopies.
- Speaker #2
Si.
- Speaker #0
Pour moi ce serait, l'utopie n'empêche pas l'action. On n'est pas que de simples rêveurs. On essaye aussi de réfléchir à d'autres choses. Et donc, ne pas se braquer sur le mot utopie dans le titre et venir vraiment découvrir la force des utopies et ce qu'ont fait d'autres communautés pour essayer de changer le monde. Ça, je trouve ça hyper positif.
- Speaker #1
Super, merci.
- Speaker #3
Moi, je dirais que ce qui est important, c'est de s'écouter entre nous et d'échanger. Et du coup... l'exposition peut permettre de s'ouvrir à d'autres visions.
- Speaker #1
Très bien. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Et tous les podcasts se terminent de la même façon depuis le début. C'est par une citation, en tout cas une phrase, qui pourrait synthétiser en quelque sorte tout le propos qu'on a tenu durant l'épisode. Cette phrase, je ne vous ai pas pris au dépourvu. On l'a préparée en amont, mais je la trouve très très belle. Je ne sais juste pas qui va la dire.
- Speaker #3
La cité utopique idéale doit se construire avec les gens qui vont l'habiter.
- Speaker #1
Je pense que ça symbolise bien un petit peu le message que vous essayez de faire passer aussi dans cette exposition, c'est qu'il n'existe pas une utopie. L'utopie doit se construire avec les gens et pas venir un peu d'une approche très top-down, mais plutôt d'une autre manière. Et moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cette exposition hier. Le lieu Mondaneum, c'est un lieu que j'apprécie aussi beaucoup, donc je pense que c'est... C'est important de venir le visiter parce qu'il questionne toute une série de choses, de préconceptions au final qu'on a sur notre société et qui doivent être enlevées les unes après les autres pour justement pouvoir imaginer librement un futur enviable pour demain. Et c'est sur ces mots que, chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis au revoir. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Science, Art et Curiosité. Merci à toutes et à tous d'avoir... participer à cet épisode et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des choses ensemble autour de cette exposition. A très très bientôt et bonne semaine ! Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS et franchement j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons.

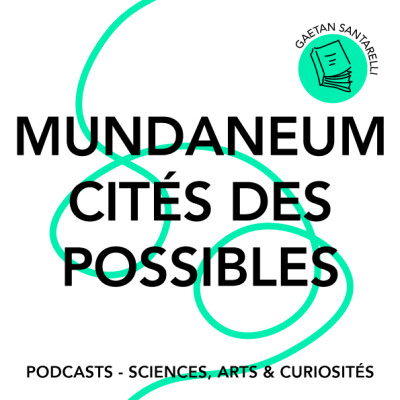
![[Trailer] Épisode 122 - Les champignons de l'apocalypse | Feat. Audrey Dussutour cover](https://image.ausha.co/NhJuWOCVmvgbrk9DyqJldFyB5tt46uqdmopehb2Q_400x400.jpeg)

![[Trailer] Épisode 121 - Les dents de la mer cover](https://image.ausha.co/kIBFllb55ZYmP2ZXhJtu348mN874jg7D0ut25Z4z_400x400.jpeg)
![[Trailer] Épisode 120 - La cité des possibles (Mundaneum) cover](https://image.ausha.co/xOQUkSSTPeFPaYouEaDoNg82OogsbnI91wtecAlG_400x400.jpeg)