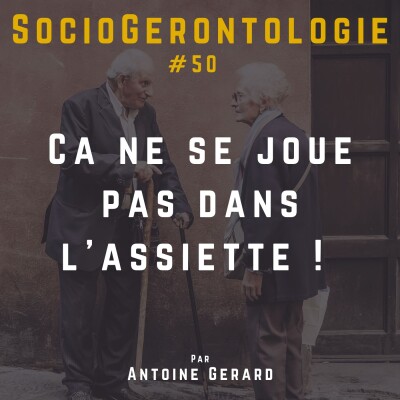Speaker #0Et si je vous disais que la question de la nutrition des personnes âgées ne serait le pas dans l'assiette ? Alors oui je sais, vous avez goûté la bouffe de l'EHPAD et vous vous êtes dit pas ouf. Vous avez regardé le budget consacré à la nourriture et vous vous êtes dit ouais je comprends. Vous avez regardé les chiffres de la dénutrition et vous vous dites faut agir. Remettons le goût au cœur du repas. En voilà une bien bonne idée. Je vous arrête tout de suite, votre start-up n'est pas la seule à y avoir pensé. Que vous me croyez ou non, c'est aussi ce que cherchent à faire les chefs de ces cuisines. Sauf que la question de la nutrition et plus généralement de la restauration ne se règle pas dans l'assiette. C'est en tout cas la thèse de ce podcast et la contribution que je peux faire en tant que socio-gérontologue à tous ceux qui cherchent à faire avancer le chemin public. Je suis Antoine Gérard, socio-gérontologue et fondateur de Bistroberta. Et dans cet épisode, à l'ancienne, de sociogérontologie, je voudrais vous parler de la restauration en établissement. Pas de calories, pas de protéines, mais de ce qui fait qu'un repas devient un moment de vie. Et de comment on peut donner, redonner, l'envie d'être à table. Pour cet épisode, comme les autres, ce que je vous partage, c'est le fruit de mes recherches sociologiques réalisées ces dernières années pour le compte de différents clients. Et je ne vous cache pas qu'avec le développement de Bistroberta, Ces sujets retrouvent un intérêt majeur pour moi, mais on n'est pas là pour parler de moi. Commençons. Commençons par être honnête. La restauration en Ehpad, c'est probablement le sujet le plus commenté, le plus débattu, le plus rempli de questionnaires de satisfaction de toute la maison. On demande aux résidents s'ils ont aimé le poisson du vendredi, si les portions sont suffisantes, si le pain est trop dur, si la soupe est trop salée, et c'est très bien de le faire. Mais il faut quand même se dire une chose, on ne leur demande pas grand chose d'autre. Il n'y a pas tant d'occasion dans une année où un résident peut donner son avis. On ne lui demande pas son opinion sur la politique de soins, ni sur les plannings d'animation, ni sur la couleur des murs ou la température de sa chambre. Mais on l'interroge sur la purée. Et quand on tend un micro à quelqu'un qu'on n'écoute jamais, il parle. Et souvent il parle de tout sauf de la purée. La restauration devient alors le lieu d'expression de toutes les frustrations. Pas seulement celle du goût, mais celle du quotidien, du manque de choix, du sentiment d'être infantilisé ou simplement du besoin d'exister. Quand un résident nous dit que le poisson est froid ou pas bon, il dit parfois « on m'a pas demandé si j'avais envie de manger du poisson aujourd'hui » . Et ça c'est important, ça change tout d'ailleurs. Tant que la restauration restera le seul espace d'expression dans l'institution, elle sera par définition une source d'insatisfaction. Alors oui, c'est pas une occasion, quand je dis ça, de vous déculpabiliser ou de ne pas travailler sur le sujet. C'est juste pour prendre conscience que le problème, quand on parle d'assiette, il est souvent pas dans l'assiette. Alors on fait quoi ? pour faire en sorte que les gens soient satisfaits de la restauration, ou en tout cas que ça ne soit plus une source d'insatisfaction, voire même, le Graal, qu'ils reprennent plaisir à manger. Admettons qu'on ait fait tout ce qu'il faut sur le papier. Un bon chef, des menus équilibrés, des produits locaux, un peu de liberté dans les choix, et pourtant, ça ne marche toujours pas. Parce que ce qui gâche le plaisir, ce n'est pas ce qu'il y a dans l'assiette. C'est ce qu'il y a autour. Et là je vais être très concret, il y a deux choses principalement, mais il y en a d'autres, deux choses principalement, qui pourrissent l'expérience du repas en établissement. Le bruit et la lumière. Le bruit d'abord. Ces grandes salles à manger, carrelées, pleines de tables, où le moindre coup de fourchette résonne comme dans une piscine municipale. Des conversations entre soignants qui se croisent, des bruits de bouche, la vaisselle qui s'entrechoque derrière la porte battante de la cuisine. Tout ça fait un fond sonore permanent, fatigant, voire même agressif. Et pour beaucoup de résidents, le bruit c'est une vraie douleur. Ça empêche de se concentrer, de savourer, d'échanger. On ne dîne pas, on survit au repas. Et puis il y a la lumière, les néons blancs, les plafonniers parfois violents, les reflets sur les couverts en inox. On a beau parler de salles de restaurant, On est souvent plus proche d'un service hospitalier que d'un bistrot de village. Et vous savez quoi ? C'est fou le nombre de repas qui se passent dans des ambiances sans chaleur, sans ombre, sans nuance. On ne peut pas avoir faim dans une lumière de bloc opératoire. Alors oui, on peut continuer. à parler de la qualité des produits. Mais si on ne peut pas s'entendre, si on est éboui, si on a froid, on peut se servir le meilleur gratin dauphinois du monde, personne n'en profitera vraiment. Ces irritants-là, ce sont des détails. Mais si on veut redonner envie de manger, il faut d'abord redonner envie d'être présent. Présent dans la pièce, dans le moment, dans l'ambiance. Et ça, ça ne demande pas de budget. Jouer avec les lumières, installer des paravents, demander aux équipes de faire moins de bruit, proposer un service en musique, abandonner les grandes salles de restaurant pour de plus petites. Bref, plein de choses qu'on peut faire. Travailler les irritants, c'est bien, indispensable même, mais c'est pas suffisant. Pour satisfaire le résident, et donc in fine, permettre une excellente nutrition, n'oublions pas l'objet de ce podcast, il faut aussi répondre... à l'attente du résident en matière de repas. Et là, je ne vous parle toujours pas de ce que veut manger le résident, mais de comment il veut manger, comment il veut prendre son repas. Parce que oui, si la nutrition semble être un sujet physiologique, la question du repas, elle, est culturelle. En fait, dans la majorité des établissements, on navigue entre deux modèles. Celui de la cantine, celui du restaurant. Deux modèles assez artificiel, qui ne colle pas vraiment avec la vie quotidienne des résidents. La cantine, c'est rapide, organisé, contrôlé. Tout le monde mange en même temps, au même endroit, le même plat. C'est efficace pour les équipes, mais ça renvoie à une image de dépendance, de masse, de prise en charge. Et le pire, c'est que la cantine ne laisse aucune marge de manœuvre aux résidents. Pas de choix de place, pas de rythme personnel, pas d'initiative. Même le geste de couper son pain ou de se resservir disparaît. C'est un modèle que les établissements cherchent à mettre à distance, de plus en plus et le plus possible. Son alternative, c'est le modèle restaurant. Service à l'assiette, serveur, nappe blanche, c'est mieux perçu mais en fait tout aussi normé. C'est une expérience de représentation, pas de liberté. On est servi, on attend, on ne participe pas. C'est joli sur le papier, mais ce n'est pas une expérience de tous les jours. Les établissements naviguent entre ces deux modèles, chacun mettant le curseur où il veut, ou plutôt où il peut. C'est d'ailleurs même devenu un argument de différenciation des établissements entre eux. Pour autant, aucun de ces deux modèles ne correspond à ce que veulent vraiment les restaurants. Ce qu'ils veulent, c'est donc ni la cantine ni le restaurant, c'est manger chez eux. Alors oui, je sais, c'est compliqué. On n'est pas chez soi quand on partage un espace collectif. Ou en tout cas, le dire ne suffit pas à ce que les gens le ressentent. On n'a pas sa cuisine, ni sa table, ni ses horaires. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'en rapprocher ? Parce que manger chez soi, ça veut dire quelque chose de très précis. On le sait tous, chez soi le repas c'est rarement parfait. Mais c'est le nôtre, ça correspond à nos habitudes, à notre routine, à ce qu'on apprécie faire ou ce qu'on est capable de faire. Alors le modèle domestique du repas, c'est quoi ? Déjà, c'est un repas souple. Chez soi, on ne mange pas forcément à heure fixe. On ne finit pas tous ensemble. On picore, on se resserre, on discute, on mange à son rythme. C'est aussi une table vivante. Il y a le plat posé au centre, la salade, le fromage. Et chacun se sert un peu dans l'ordre qu'il veut, il compose son assiette. Il n'y a pas d'entrée plat fromage dessert chronométré. Puis c'est un endroit où on retrouve la liberté du geste. Tendre le bras pour se servir, pour couper du pain, pour verser de l'eau. Le modèle domestique c'est également une ambiance. Pas de blouse, pas de hiérarchie entre celui qui sert et celui qui mange. Un soignant, un animateur, un résident, tout le monde est à la même table. On mange ensemble, point, sans se poser de questions. Enfin, c'est une routine. On mange souvent la même chose. Les plats qu'on aime, les recettes qu'on connaît, les aliments qui constituent la base de notre alimentation. Parce que la répétition, ce n'est pas un manque de variété. C'est une forme de continuité et donc de sécurité pour le résident. Alors, oui, le modèle domestique, c'est pas forcément ce qu'on peut mettre en place, mais il y a quand même des choses par lesquelles on peut commencer. On peut commencer par remettre des plats à partager. Même symboliquement, un saladier de pommes de terre, une corbeille de pain, une carafe d'eau, le partage redonne de la présence. On peut assouplir le service. Chacun peut se joindre à l'heure qu'il souhaite et prendre le temps qu'il faut. On peut travailler la mise en scène. Une grande table, une nappe colorée, une lumière chaude suffisent à casser cet effet cantine. On peut inviter à participer. Un résident peut aider à mettre la table, à plier les serviettes, à couper le pain. Et puis on peut inviter les équipes à manger avec. Enlever la blouse, s'asseoir, partager un repas, un café. Pas pour faire plaisir, mais pour créer un cadre normal. Le modèle domestique, ce n'est donc pas copier la maison. C'est essayer de retrouver ce qu'elle représente. La liberté, la convivialité, la normalité. Et bien sûr, quand on mange chaque jour à la maison, on a envie, de temps en temps, de manger au restaurant. Et là aussi, il s'agit de travailler toute cette symbolique du restaurant lorsqu'on est en mode restaurant. Je vais m'arrêter une seconde sur la question du rituel. Parce qu'un repas, ce n'est pas seulement de la nourriture. C'est un moment symbolique, un repère dans la journée, une petite scène de vie. Les rituels, ce sont ces gestes qu'on répète sans y penser. Tresser la table, dire bon appétit, partager le pain, attendre que tout le monde soit servi, des gestes simples mais essentiels. Parce qu'ils rappellent qu'on fait partie d'un tout, d'un collectif, et qu'on existe encore dans ce collectif. Ce n'est pas un luxe, c'est un besoin psychologique fondamental. quand on perd ses repères, le repas devient mécanique, quand on les retrouve, il redevient un moment de vie. Et c'est ça qu'on cherche à faire. Et quand on passe en mode restaurant, évidemment, le rituel change aussi. Ce n'est plus le quotidien, c'est le temps de la célébration. Et il faut que ça se voit, il faut que ça se sente. Une ambiance différente, une tenue différente, quelque chose qui marque le coup. Parce que le plaisir de manger ne vient pas seulement de ce qu'il y a dans l'assiette, mais du sens qu'on donne au moment où on le partage. Bon maintenant qu'on a parlé du cadre, revenons un petit peu à ce qu'il y a dans l'assiette. Parce que oui évidemment ça compte, mais là encore, il faut remettre un peu d'ordre dans nos priorités. La plupart des politiques alimentaires en EHPAD partent d'une malattention. On veut prévenir la dénutrition. Alors on compte, on équilibre, on enrichit. On met des poudres de protéines, des yaourts enrichis, des CNO. Et sur le papier c'est parfait. Les AGR, les apports journaliers recommandés, sont atteints, l'ARS est satisfaite, les familles sont assurées. Sauf qu'en pratique, ça ne marche pas. Parce que le problème des personnes âgées en établissement, ce n'est pas la carence en vitamines, c'est le désintérêt pour manger. Autrement dit, on ne lutte pas contre la dénutrition en remplissant les gens, mais en leur redonnant envie de manger. Le but, ce n'est pas de faire un repas parfait. c'est que la personne ait envie de manger et surtout qu'elle mange suffisamment. La première règle qu'on pourrait s'appliquer c'est donc d'arrêter de chercher l'équilibre à l'échelle d'un repas. L'équilibre c'est à la journée voire à la semaine. Chez soi on ne mange pas équilibré chaque repas et pourtant sur la durée ça s'équilibre naturellement. Donc on peut très bien avoir des repas sans légumes puis un autre plus végétal le lendemain, ce n'est pas grave. Ce qui compte c'est ce que la personne ait du plaisir à manger. Et c'est là qu'intervient le vrai levier, le goût. Les plats qu'on connaît, les textures qu'on aime, les odeurs familières, les aliments rassurants. Je vais prendre l'exemple des patates vapeurs. Si les résidents veulent manger des patates vapeurs tous les soirs, et bien qu'on leur fasse des patates vapeurs. Parce que l'enjeu, ce n'est pas de cocher les cases nutritionnelles. L'enjeu, c'est qu'ils mangent et qu'ils mangent avec plaisir. Est-ce que c'est varié ? Non. Mais c'est appétissant, réconfortant. et satisfaisant pour eux. La variété ne doit pas être une contrainte à poser, mais une possibilité offerte. Et donc non, goût et nutrition ne sont pas antinimiques. Ce qui donne du goût, c'est la crème, le fromage, le beurre. Mais c'est aussi ce qui permet d'enrichir le repas. On peut enrichir avec le plaisir. Un peu de sauce, un peu de matière grasse, un peu de plus de cuisine. Là encore, c'est pas une question de budget. Enfin si, un peu quand même. Mais c'est surtout une question de philosophie. Je sais ce que vous allez me dire. La crème, c'est le restaurant qui le paye. Les compléments, c'est le budget pharmacie. Oui, je sais. c'est plus facile de compter une dose de protéines en poudre que combien de grammes de crème la personne a mis sur ses patates. Je sais tout ça, mais à un moment, si on veut améliorer les choses, il faut qu'on accepte de changer d'indicateur. Le jour où on arrêtera de compter les protéines ou les calories, pour recommencer à compter les sourires à table, en fait, ce jour-là, on aura fait un vrai pas en avant contre la dénutrition. Bon allez, passons à une autre idée forte. Si on veut aller au bout de cette logique, il faut accepter une idée toute simple, mais assez dérangeante pour nos institutions. Manger, ce n'est pas forcément prendre un repas. Alors, dans nos vies de tous les jours, on le fait tous. On déjeune parfois sur un coin de bureau, on grignote sur le pouce, on saute un repas, on se fait un dîner improvisé avec ce qui traîne dans le frigo. Et pourtant, on ne se dit pas qu'on mange mal. On dit qu'on mange comme on vit, en fonction du quotidien. Pourquoi dans les établissements ? On devrait faire différemment. La vie ordinaire, c'est pas 12h tout le monde à table, 18h15 on recommence. La vie ordinaire, c'est davantage un résident qui préfère prendre son repas dans sa chambre, un autre qui grignote au bistrot en fin d'après-midi, une dame qui ne veut qu'un café le matin mais se rattrape le soir. Et devinez quoi ? Ce n'est pas grave. Parce que la vraie question, ce n'est pas où ni quand ils mangent, c'est s'ils ont envie de manger. Manger, ce n'est pas forcément prendre un repas. Il nous faut donc redonner de la liberté. Alors ça veut pas dire créer du chaos, ça veut dire donner des options simples et concrètes. Quelques exemples, allez. Une corbeille de fruits ou un placard à grignotage dans la chambre. Un mini-frigo pour garder un yaourt ou un morceau de fromage. Un bistrot, une buvette, une épicerie, où on peut prendre un verre ou un enca à toute heure. Des temps souples de service, un déjeuner ouvert sur une plus grande plage, plutôt qu'à midi pile, comme si la sonnerie d'école alertait de l'ouverture du restaurant. Alors oui je sais, vous allez me dire, mais comment savoir ce qu'ils mangent ? Et souvent on résiste à cette idée de laisser un peu de liberté par peur de perte de contrôle. On veut savoir ce que les résidents mangent, combien, quand, comment. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin de peser les assiettes. Il suffit de peser les personnes. Le meilleur indicateur de nutrition, ce n'est pas la fiche repas, c'est le poids stable et le niveau de forme de la personne. Quand une personne va bien, sourit, bouge, participe. Qu'elle mange ici ou là, qu'elle prenne son café au bistrot ou son yaourt dans sa chambre, peu importe, ce qui compte, c'est qu'elle vive pleinement. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de passer à peu près 15 minutes à parler de restauration et de nutrition, sans presque jamais parler de ce qu'il y a dans l'assiette. Et en fait, c'est ça le vrai sujet. Parce que la question de la nutrition des personnes âgées, ce n'est pas... Une affaire de nutriments. C'est une affaire de contexte, de culture, de relation. Et c'est sans doute pour ça que ce n'est pas un nutritionniste qui vous en parle aujourd'hui. Un nutritionniste vous dira combien de grammes il faut par jour. Moi je vous parle de ce qui fait qu'on a encore envie de les manger. Je vous parle de lumière, de bruit, de liberté, de plaisir, de symboles, de gestes, de rituels, de tout ce qui précède ou empêche l'acte de manger. Et si on veut vraiment s'attaquer à la question de ce qu'on mange en établissement... Il faut apprendre à regarder au-delà de l'assiette, pas seulement dedans. Parce que les gens ne mangent pas pour se nourrir. Ils mangent pour exister, pour partager, pour faire partie de quelque chose. Ce qui nourrit, ce n'est pas seulement ce qu'on avale, c'est ce qu'on vit autour. L'ambiance, la liberté, le goût, le lien. Alors non, ce podcast n'est pas un cours de diététique. Désolé si c'est ce que vous attendez. Allez voir des nutritionnistes ou des chefs pour ça. C'est une invitation à penser autrement la restauration en établissement. A se dire que lutter contre la dénutrition, c'est d'abord redonner l'envie de manger. Et que redonner l'envie de manger, c'est d'abord redonner l'envie d'être là.