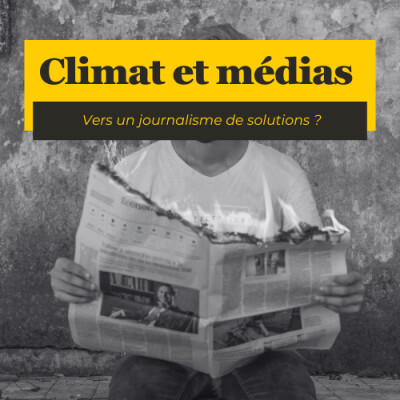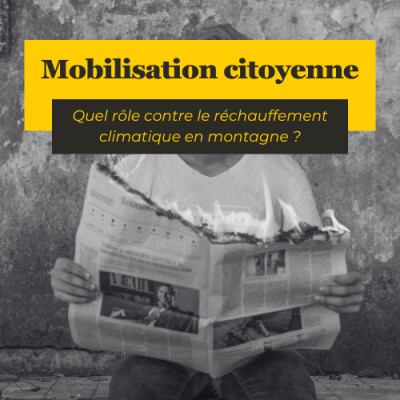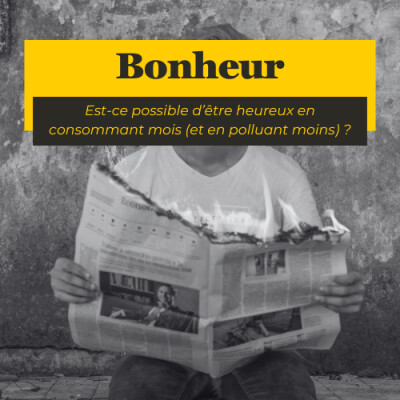- Speaker #0
100%
- Speaker #1
du réchauffement que l'on observe est dû aux activités humaines.
- Speaker #0
100% ? En cause, les transports qui sont à l'origine de 31% des émissions de gaz à effet de serre.
- Speaker #2
Donc il faut ralentir le rythme.
- Speaker #0
Ce n'est pas possible. Et la mauvaise nouvelle, c'est que soit le rythme en ralentit nous, soit il se ralentira tout seul.
- Speaker #3
C'est de la physique,
- Speaker #2
c'est de la chimie, ça ne nous plaît pas,
- Speaker #3
mais c'est comme ça. Nous avons aujourd'hui toutes les connaissances, toutes les technologies et toutes les ressources financières qui nous permettent d'atteindre ces objectifs, qui nous permettent de limiter le réchauffement.
- Speaker #2
Alors ? On change ? Dans une interview donnée à France Info en juin dernier, Christophe Cassou, directeur de recherche au CNRS et climatologue, a rappelé combien la communication sur le climat est cruciale, notamment sur l'efficacité des leviers d'action. Et ses propos soulignent une évidence. Face à une crise climatique aux conséquences bien réelles, il ne suffit plus de connaître les faits. Il faut comprendre comment nous percevons ces informations et comment nous y réagissons. Une clarté d'autant plus nécessaire dans un monde où la désinformation s'installe. Alors, j'ai voulu creuser. Comment la couverture médiatique du climat a-t-elle évolué ces dernières années ? Les Français estiment-ils que le sujet est correctement traité ? Comment notre cerveau intègre-t-il des informations anxiogènes ou au contraire plus constructives ? Et enfin, quel récit et quelle solution pour une information à la hauteur des enjeux climatiques ? Une enquête que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ACHO, le podcast climat. qui s'interrogent sur un monde en pleine mutation. Bah l'écoute ! En avril dernier, un collectif de trois ONG a recensé plus de 128 cas de désinformation climatique sur les radios et télénationales entre janvier et avril 2025. Plus récemment, c'est une quarantaine de députés qui ont appelé à légiférer pour protéger le droit à l'information face à la dégradation du débat public en matière de climat. Et quand on sait que les médias généralistes sont le premier canal d'information des Français sur le climat, la question se pose. pose. Les médias français en font-ils assez pour informer les citoyens sur la nature exacte de la situation climatique ? Spoiler, oui et non. En 2020, une étude de Reporters d'Espoir a passé au crible les sujets se rapportant explicitement au réchauffement climatique dans les journaux télévisés, à la radio et dans la presse écrite entre 2010 et 2019. Verdict ? En 10 ans, le temps consacré à l'environnement a nettement progressé. Dans les JT du soir, il a presque triplé. de 5 à 17,3% pour TF1 et de 5 à 12,4% pour France 2. La presse écrite nationale a suivi la tendance, passant de 0,57 à 3,8% d'articles évoquant le mot climatique sur la même période. Seul bémol, les matinales radio, leur part dédiée au climat reste quasi inexistante malgré des millions d'auditeurs chaque matin. Une évolution croissante, confirmée par l'étude du cabinet de veille médiatique Tagalé, qui met en avant le fait que les médias français sont passés de 22 000 contenus sur le climat par mois en 2013 à 150 000 en 2023, soit un sujet journalistique sur 25. Pour comprendre cette évolution, Laurent Cordonnier, sociologue et directeur scientifique de la Fondation Descartes, me livre son analyse.
- Speaker #0
En réalité, ce qu'on constate, c'est que depuis pas mal d'années, la qualité de l'information sur le climat en France, dans les médias, a beaucoup augmenté. On passe d'une situation dans laquelle des acteurs climato-sceptiques notoires avaient leur place sur les plateaux de télévision, dans les radios ou dans les colonnes des journaux, à une situation où c'est devenu quand même plus rare, bien qu'on constate aujourd'hui, et ça c'est un peu une nouveauté très récente pour le coup, que certaines chaînes d'info continuent ou certains médias plutôt situés à droite ou à l'extrême droite du spectre politique, du moins qui partagent cette sensibilité là redonne la parole à des climato-sceptiques, à des propos climato-sceptiques un peu renouvelés en réalité. C'est moins le climato-scepticisme à la grand-papa avec cette affirmation qu'il n'existerait pas de dérèglement climatique ou que c'est une illusion, qu'on est dans une fluctuation normale, etc. En revanche, c'est des versions un peu modernisées du climato-scepticisme qui consistent à dire, par exemple, que l'être humain n'y joue pas de rôle, qu'il s'agit en réalité d'événements tout à fait naturels et que ce ne sont pas nos modes de fonctionnement qui peuvent... influencer là-dessus. Mais néanmoins, globalement, dans l'ensemble de l'environnement médiatique français, on constate que les choses se sont pas mal améliorées ces dernières années. Et j'en veux pour preuve le nombre de médias qui se sont mis à s'engager en faveur d'une meilleure couverture du dérèglement climatique. Et ce n'est pas seulement des parents en l'air, puisque beaucoup de rédactions se sont engagées, ont commencé, ou même pour certaines d'entre elles déjà, à réaliser des formations de tous leurs journalistes au sein de leurs médias. Donc, formation aux questions climatiques. Ça traduit la prise de conscience que le sujet du climat n'est plus un seul sujet, un peu périphérique, ou même important, mais isolé des autres sujets, qu'il s'agit d'un sujet transversal. Parce que quand on forme un journaliste économique, par exemple, aux questions climatiques, dans une rédaction, c'est bien parce qu'on a pris conscience qu'on ne pouvait pas traiter des questions économiques sans avoir aussi une sensibilité à un regard, et surtout une compréhension, une connaissance de la situation climatique. Donc, ça, c'est des éléments qui vont dans le bon sens. De manière plus générale, ce que note la littérature internationale sur ces questions, c'est que dans beaucoup de pays, on a une tendance qui a diminué au sein des médias, qui était celle de vouloir donner un écho à tous les points de vue sur les questions climatiques. Cette idée journalistique très répandue qu'il faut refléter la diversité des points de vue sur une question, qui est une idée toute tout à fait louables, on va dire, sur les questions sociales, sur les questions politiques, où des diversités de sensibilités peuvent s'exprimer. En revanche, sur des questions pour lesquelles on a un consensus scientifique, cette idée ne fait aucun sens, parce que ça reviendrait à mettre au même niveau, sur le même plan, le consensus scientifique d'un avis individuel, éventuellement d'un scientifique même, mais plus souvent d'un ingénieur ou quelqu'un de la société civile. qui irait contre cet avis et il faudrait ouvrir son micro aux deux paroles. On voit bien qu'il y a une dissymétrie telle dans la force de la preuve qui est amenée par la communauté scientifique dans son ensemble et par certains scientifiques isolés de l'autre côté ou plus souvent des gens qui ne sont pas eux-mêmes spécialistes du climat qu'on ne peut pas se permettre de mettre ces gens-là sur un même niveau. Et là aussi, on constate qu'en France, comme dans beaucoup d'autres pays, cette tendance-là a beaucoup diminué dans les médias. On ne donne plus la parole de la même manière aux différents points de vue sur le climat dans la plupart des médias. À nouveau, il peut y avoir des exceptions, malheureusement, sur ce point-là. Et ce que je voudrais aussi souligner, avant de répondre très directement à votre question, c'est que de manière générale le fait de s'informer par les médias augmente Statistiquement, la compréhension, en tout cas est associée avec une compréhension plus élevée du sujet climatique, avec de meilleures connaissances factuelles sur le sujet, mais également avec une disposition plus marquée à vouloir prendre des actions, mais aussi tout simplement avec une croyance plus élevée dans le dérèglement climatique, dans son existence, mais aussi dans son origine anthropique et dans la gravité de ses conséquences. ça c'est ce qu'on constate en France, que j'ai constaté dans mon étude de 2022 en France, par exemple. Mais ce que je constate aussi avec une étude en cours, dans laquelle sur un très grand nombre de pays, cette fois dans le monde entier, j'observe ce résultat qui est que, du moins dans les pays dans lesquels il y a une forte liberté de la presse ou une bonne liberté de la presse, le fait de s'informer sur le climat via les médias généralistes... a un effet positif sur la croyance dans le dérèglement climatique, dans son origine humaine et la gravité de ses conséquences. Et alors, c'est quoi le problème ?
- Speaker #2
Eh bien, il est triple en fait. D'abord, les temps d'antenne consacrés aux enjeux environnementaux dans les médias audiovisuels français restent très faibles. 3,4% selon l'Observatoire des médias sur l'écologie. Ce chiffre accuse même une baisse de 30% par rapport à 2023, une diminution que Laurent Cordonnier explique par la conjoncture actuelle.
- Speaker #0
Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de raisons, on peut imaginer plein de raisons, aussi des raisons exogènes. On est en train de vivre actuellement une période un peu étrange et disons-le un peu folle sur beaucoup de sujets, sur des sujets politiques, avec ce qui se passe aux États-Unis, avec un président de la première puissance mondiale qui tous les jours sort une nouvelle dinguerie. Donc c'est clair que dans ce contexte-là où les médias se doivent quand même de suivre... ce qui se passe aux États-Unis, se doivent de suivre ce qui se passe en Ukraine, parce qu'on a la guerre sur le sol européen, se doivent de suivre ce qui se passe en Israël et en Palestine, parce qu'il y a deux populations qui sont en train de se massacrer. Et donc, il y a beaucoup d'autres sujets dans cette période-là. Donc, il y a une concurrence de l'attention qui se fait dans les médias, mais je pense que là-dessus... Les médias devraient s'en tenir et bien avoir à l'esprit les chartes qu'eux-mêmes sont nombreux à avoir signées, en se disant que tous ces sujets-là, aussi graves soient-ils, quand bien même on leur trouverait une solution, on resterait avec le problème, avec la menace anthropologique qu'est le dérèglement climatique. Donc il ne s'agit évidemment pas de faire une concurrence aux menaces, ce n'est pas comme ça qu'il faudrait voir les choses. Le dérèglement climatique est lui-même aussi vecteur de tensions politiques, est lui-même aussi vecteur de guerres, de famines, et de montées indirectement, ou parfois même un peu assez directement, de régimes autoritaires, etc. Donc je pense qu'il faut aussi essayer sur ces sujets-là de garder le climat à l'esprit, non pas parce qu'il faudra en faire une obsession, mais parce qu'il faut bien que ce sujet-là ne sorte pas des préoccupations et des sujets de peur des Français, pour que tout cela aboutisse à ce qu'on ne puisse plus considérer normal que lors d'une élection présidentielle, chaque parti n'ait pas un programme sur le climat de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de pages. extrêmement détaillée, qui puisse donner lieu à de l'évaluation par des scientifiques, par des journalistes, etc. Comment aujourd'hui on peut se retrouver lors de la dernière campagne pour les européennes sans que personne ne parle de climat ? Tout ça, c'est possible à cause de nous, parce qu'on n'exige pas ça. Quelle que soit l'orientation politique des citoyens, ils n'exigent pas encore de sérieux Merci. sur les programmes climatiques, y compris d'ailleurs chez les écologistes, qui n'ont pas non plus quelque chose à tomber par terre de ce côté-là. Et donc, si on arrive à garder une attention sans susciter l'angoisse, mais en suscitant la peur nécessaire que la situation exige, et en suscitant surtout l'idée qu'on peut en sortir, on ne mettra pas de terme aux dérèglements du jour au lendemain, etc. évidemment, mais... On peut essayer de limiter la casse, voire d'améliorer la situation dans certains cas, mais à condition d'une action politique vigoureuse, d'ampleur, décidée et basée sur la science. Si on arrive à faire comprendre ça à la population, la population l'exigera de la part des candidats et n'élira plus ou n'élira jamais un candidat qui n'a pas un programme tangible, solide sur le climat. On en est très loin aujourd'hui. Mais c'est ça l'objectif à la fin. Et évidemment, cet objectif, une fois qu'il sera atteint, espérons-le, aura de la répercussion aussi sur le niveau européen, parce qu'on sait que la France joue un rôle central en Europe, et donc elle peut donner des directions à l'Union européenne. Et l'Europe, ce n'est pas rien dans le monde. Je réponds indirectement à l'argument des moins de 1% des émissions qui viennent de France. Alors déjà, ce n'est pas vrai, parce qu'il faut considérer les émissions importées. Mais l'Europe, ce n'est pas rien, ce n'est pas moins de 1%. C'est une des premières puissances économiques au monde, quand on la considère. C'est 400 millions d'habitants, c'est plus que les États-Unis, c'est un PIB plus élevé que les États-Unis, quand on prend l'Europe dans son intégralité. Donc, littéralement, l'Union européenne, c'est la première puissance au monde. Et donc, le jour, si elle est unie, le jour où l'Union européenne décide de proche en proche à devenir vraiment active sur ces questions-là et décide éventuellement de mesures assez fréquentes, Les frontières pour l'importation de produits qui ne respectent pas certains critères, elles pourraient avoir un réel impact sur le fonctionnement mondial de l'économie et donc sur la direction qu'on prend en termes de dérèglement climatique.
- Speaker #2
Justement, si une couverture médiatique de qualité est indispensable pour comprendre les enjeux climat et énergie, qu'en pensent les Français ? D'après une étude de la Fondation Descartes, beaucoup se montrent critiques. Plus d'un sur deux jugent le ton trop alarmiste, politisé, militant et moralisateur. Mais surtout... toutes les enquêtes le confirment. Les Français attendent des réponses concrètes. Selon le baromètre Cantar pour la Croix en 2024, 65% estiment que les médias parlent trop de problèmes et pas assez des solutions. Et ils sont même 73% à réclamer un journalisme plus utile qui montre comment agir. Explication avec Laurent Cordonnier.
- Speaker #0
Ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est ce fait que de manière pas unanime au sein de la population, mais de manière très large et de manière... très homogène ressort cette demande d'un journalisme de solution. Et ça, ça fait écho depuis lors, depuis mon étude. C'est quelque chose qui a été retrouvé dans d'autres études, y compris dans d'autres pays occidentaux en général. Et ça montre probablement que c'est sur ce point-là que les médias devraient faire mieux aujourd'hui. Et aussi, surtout, se demander à quoi devrait ressembler du journalisme de solution. Parce que le journalisme de solution peut être très, très mal fait aussi. ça peut être faire une espèce de publicité à une forme de technosolutionnisme un peu simple, en allant interviewer la nouvelle start-up qui promet la nouvelle source d'énergie miracle, etc. ou la nouvelle solution qui réglera tous les problèmes. Ça peut rassurer une partie de la population, mais ce n'est pas ça le journalisme de solution. Le journalisme de solution, de mon point de vue, ça doit être un véritable journalisme d'investigation. C'est-à-dire que les journalistes qui veulent faire du journalisme de solution devraient enquêter sur les solutions qui peuvent être proposées, pourquoi pas par des entreprises aussi, mais par les politiques. par des associations, etc., en mettant ces solutions proposées à l'épreuve de la connaissance scientifique. Comme le ferait un journaliste qui travaillerait, je ne sais pas, sur les vaccins et qui irait voir des spécialistes des vaccins pour demander l'efficacité, les effets secondaires, etc., avant de relayer ou non l'appel à une campagne de vaccination, par exemple, ou d'avoir un regard vraiment de... on va dire, d'enquêteurs journalistiques sur ces questions-là. Le journaliste de solutions, ça devrait être ça. Ne pas faire la pub à un con ou à une entreprise qui propose une solution miracle, mais investiguer sur cette solution, voir les limites. Ça ne veut pas dire rejeter, c'est pas parce qu'une solution a des limites qu'il faut la laisser tomber, puisqu'on sait très bien qu'il n'y aura pas de solution parfaite, il n'y a pas de solution miracle, ça n'existe pas. Mais nettement voir les limites potentielles, voir parfois les effets secondaires négatifs de certaines solutions qui pourraient être mises en place. Et par solution, évidemment, ça concerne aussi les questions, et ça c'est très important et peut-être un peu oublié, les questions d'organisation sociale, de transformation de la société. Solution, ça renvoie très vite à technologie ou éventuellement à taxes ou ce genre de choses. Mais on sait aussi que nos sociétés industrielles vont devoir se transformer dans une certaine mesure si on veut limiter de façon un peu significative le dérèglement climatique et ses effets. Dans ce cas-là, il faut enquêter aussi sur les modèles sociaux qui sont proposés. Parce que là aussi, on peut faire appel à des spécialistes, à des chercheurs, à des scientifiques sur ces questions pour savoir par exemple si une solution sociale est réaliste. Je vous donne un exemple, est-ce qu'il est réaliste ? de proposer de la décroissance. Ça, c'est une question qui peut susciter de la recherche sociologique, qui peut susciter des points de vue d'experts sur ces questions. Moi-même, étant docteur en sociologie, quand on me dit la décroissance, ça peut être une solution, ma réaction en tant que sociologue, c'est de me dire d'un point de vue sociologique, à part par la force, je ne vois pas très bien comment on peut imposer quelque chose du genre, puisqu'on voit que systématiquement, la question de pouvoir d'achat, c'est la... la préoccupation numéro une des Français de façon récurrente, etc. Ou parfois ça passe en deuxième parce qu'il y a un événement particulièrement marquant, mais c'est toujours en tête, des préoccupations. Et le décroissantisme, par définition, c'est réduire le pouvoir d'achat. Une fois qu'on a pu comprendre ça, le journaliste ou la journaliste peut enquêter, essayer de voir le réalisme de la solution proposée, les effets. Il faut chaque fois travailler avec un panel de chercheurs. Par exemple, le journalisme de solution doit consister à pouvoir essayer d'évaluer à la tonne près le gain qu'aurait telle ou telle mesure, à la tonne de CO2 émise ou non émise, le gain qu'apporterait cette mesure, qu'elle soit sociale, qu'elle soit technologique, etc. Et voir dans le grand schéma des choses ce que ça change. Est-ce que du coup c'est un changement significatif ? Est-ce qu'il est réaliste d'un point de vue technologique ? Est-ce qu'il est réaliste d'un point de vue social ? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit mis en place ? Si oui, dans quelles mesures ?
- Speaker #2
Pour faire face à ces demandes citoyennes, les médias doivent donc repenser leur angle éditorial ainsi que le contenu proposé. D'abord, parce qu'une information de qualité peut pousser aux gestes concrets. Ensuite, parce qu'un flot d'informations trop négatives peut produire l'effet inverse. Défiance, anxiété, paralysie. Un mécanisme décrit par Paul Rosin sous le nom de biais de négativité. Pour comprendre précisément ce qu'une information un peu trop alarmiste peut faire à notre cerveau, Pourquoi elles nous figent plus qu'elles ne nous mobilisent ? J'ai interrogé Stefano Palminteri, chercheur en sciences cognitives à l'Inserm.
- Speaker #3
Alors, donc, de toute façon, déjà ici, on parle d'informations qui ont une balance négative. Donc, balance, c'est un peu ce qui va dire, est-ce que c'est une balance neutre ? C'est quelque chose qui n'a pas tellement de charge affective. Une balance positive, c'est ce qui a une charge affective positive. Une balance négative, c'est l'opposé. Donc les informations, les images, les sons d'ailleurs qui ont une balance négative, ils ont la caractéristique de capturer déjà l'attention de façon très forte. Donc on est attiré par les choses avec une balance négative. Et c'est là, tout simplement, parce que les choses avec une balance négative, elles ont été soit par apprentissage, soit par l'évolution. associé à des choses pour lesquelles il faut faire attention, parce que c'est une menace, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qu'il faut mobiliser des efforts pour pouvoir s'en éloigner le plus rapidement possible. Donc c'est typiquement des simulations, encore une fois, que ce soit auditive, visuelle ou verbale, qui va induire une réponse attentionnelle, donc on va diriger l'attention vers ces choses. après d'un point de vue motel ou d'un point de vue cognitif aussi. une réponse d'évitement qui va faire en sorte qu'on ne sera plus soumis à cette stimulation. Le problème, c'est que le cerveau doit essayer d'arbitrer le type de réponse d'évitement. Donc, une forme d'évitement immédiat, ça va être celui de dire, « J'étends la télé, j'arrête d'écouter la radio, je ne lis pas l'article, donc je ne suis plus soumis à cette stimulation. Donc, en quelque sorte, j'ai un rétipique complet que je ne reçois pas. » Et après, il y aurait en réalité une réponse qui est encore plus adaptative. qui est un peu plus à leur terme, c'est-à-dire qu'on a intégré qu'il y a cette menace, donc plutôt que juste l'éliminer, on va mettre en place un acharnement d'actions très compliqué pour que ça ne se produise plus. Donc là, ce serait la mise en branle des comportements, par exemple, pro-environnementaux, qui peuvent être d'ailleurs des choses très différentes. Il y a celui directement connecté, on peut utiliser moins d'eau, par exemple, ou recycler, et c'est des choses qui... comportements individuels ou la liberté pour la partie politique qui pense à une politique plus sérieuse, par rapport aux questions environnementales, etc. Or, je ne sais pas si ce qu'on appelle les cadrages négatifs, ces cadrages par menace, par danger, etc., ce sont les plus... les problèmes de générer, justement, cette réponse constructive. C'est quelque chose qui est commun dans la psychologie expérimentale depuis le temps. depuis les années 40, 50, etc., il y a une asymétrie entre, en général, la récompense et la punition. C'est-à-dire, la punition va souvent induire ces comportements d'évitement, mais plutôt d'évitement immédiat, un peu à couche crème. Elle ne va pas aider tant que ça dans la construction des comportements complexes, adaptatifs, à long terme, etc. En revanche, généralement, la récompense, elle ne peut plus être utilisée par rapport à ça. par rapport à la construction des comportements complexes. Parce que la récompense, elle nous dit ce que nous voulons faire bien. Donc, on va répéter cette action. La punition, elle nous dit qu'il y a problème. Elle ne nous dit pas quoi faire. Donc, on échappe, on se cache, on fait quoi, on a des critères, on n'y croit plus, etc. Donc, vous voyez que ce n'est pas très directionnel. La récompense, elle est plus directionnelle. Ça, on l'a fait bien. Vous regardez, cette politique a apporté la réduction des incendies de X%. Merci. Donc on dit que la politique a été bien, on va la généraliser, etc.
- Speaker #2
À l'inverse, je me suis donc demandé, que se passe-t-il dans notre cerveau quand on reçoit une information qui propose une solution concrète ? Pour Stefano Palminteri, montrer des solutions ne suffit pas. Pour que ces informations déclenchent un véritable passage à l'action, il faut aussi prouver leur efficacité.
- Speaker #3
Pour mon pari, comme pour l'éducation d'ailleurs, je vais plutôt miser sur le positif que sur le négatif, ou bien avoir une... une bonne balance des vies. C'est-à-dire pour ne pas décrocher complètement les gens et pour se comprendre que justement, il y a des stratégies qui ont porté de bons résultats. C'est vraiment ça pour moi qui est clair. Parce que il ne faut pas juste donner une solution, mais pour montrer que la solution, elle a marché. Et c'est ça qui va générer ce sentiment de remboursement, ce sentiment d'émulation aussi, d'imitation. Et après, l'autre chose qui est aussi importante, c'est par rapport au général que justement vous appréciez. justement comment est-ce qu'on peut communiquer plus de mieux ces informations-là. Il y a toute une expérience, un extent sur comment est-ce qu'il faut communiquer ces informations de façon plus efficace. Je vais citer un étude parmi d'autres, mais en gros, la simplification est très importante. Donc, typiquement, il y en a, bon, qui sont plus ou moins parlantes. Par exemple, il y a une très grande utilisation des infographiques. On dit infographiques, on parle des infographiques ou des datas, pourcentages. 1,5 degrés, c'est une établiété, mais pourquoi un centimètre de la mer, ça ne vous dit quoi, etc. Il y a l'étude, je crois que j'ai des collègues qui disent qu'à cette forme, si je m'abuse, il doit montrer qu'elle est binarisée, donc sans flipper l'information, ça a un impact plus fort. Par exemple, l'information, ça serait les températures moyennes, donc on voit cette courbe, que si, c'est vrai qu'on peut discerner mais il y a une tendance, voilà. La même chose, ça parle de combien d'épisodes, combien de fois, c'est un lac, par exemple, il se glace pendant l'hiver. Donc, vous voyez, l'information, c'est oui ou non. C'était congelé, pas congelé, etc. Et donc, c'était binaire. Et apparemment, il y avait vachement plus d'impact. Les gens n'avaient pas une chiffre à calculer, mais juste voir qu'il y avait deux états du monde. Donc un état de monde dans lequel ça ne va jamais plus glacer parce qu'il fait trop chaud. Et un autre dans lequel... Et vous voyez qu'en bas, il y avait un biais de bloc climatique vers un état et puis l'autre. Petite astuce, on ne ment pas aux gens, donc c'est toujours quelque chose qui est absolument, et ça c'est fondamental dans le monde de l'éthique, et puis pour entretenir la crédibilité avec le public, les scientifiques qui disent des choses vraies, c'est presque une trivialité mais c'est important, mais on simplifie quand même l'information, c'est-à-dire on passe sur la même donnée scientifique qui en réalité est complexe, numérique, et on dit c'est quoi la conséquence visible, c'est par exemple l'état de glace sur la voie. ou pas. Voilà ce qui se passe.
- Speaker #2
Autre point, comme le montre l'étude de la Fondation Descartes, plus les Français s'informent sur le climat dans les médias généralistes, plus leur niveau de connaissance progresse. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'ils multiplient les sources, presse, télé, radio, l'information devient un moteur d'engagement. Résultat, s'informer régulièrement incite non seulement à adopter des gestes favorables au climat, mais aussi à accepter des mesures contraignantes. D'où la nécessité d'avoir une information de qualité et qui propose des solutions concrètes. Mais alors, pourquoi cet impact reste-t-il si limité ? Eh bien parce que d'un côté, les journalistes manquent de formation sur les enjeux climat et énergie, et de l'autre, les scientifiques, pourtant jugés les plus crédibles par l'opinion publique sur l'information climatique, connaissent mal le fonctionnement des médias. C'est précisément pour combler ce fossé qu'a été créé l'association Expertise Climat, fondée par Célia Gauthier, que je vous propose d'écouter.
- Speaker #1
Le message clé, c'est vraiment de se dire que, même si ce sont deux mondes qui sont très différents, Ils partagent quand même une même contrainte qui est le temps, parce que même si les journalistes sont en temps très immédiat, les chercheurs ont un temps plus long, les chercheurs, ils travaillent énormément. Ils travaillent tout le temps, ils sont également fortement sous contrainte. Et ils ont un même intérêt qui est d'informer. Les journalistes informent, les chercheurs veulent faire passer leur savoir. Donc il y a un vrai partenariat possible, en fait, au moins une compréhension mutuelle, plutôt que de se considérer comme étant... Voilà, pas allant dans le même sens. Alors pour ça, bien sûr, il faut quand même... On leur explique qu'on ne met pas tous les médias au même niveau. Même si on veut travailler avec tous les médias, il y en a qui font un peu mieux leur travail que d'autres. Parfois, c'est lié aux moyens, la plupart du temps, dont ils disposent. Il y a aussi des médias d'opinion, ça c'est certain. Donc voilà, on essaie aussi de partir de là où sont les journalistes et des capacités, des possibilités, des ressources dont ils disposent. dans leur rédaction. Et les chercheurs se mettent un peu à leur niveau et les aident là-dedans. Un bon exemple de ça, c'est le journal Météo-Climat de France Télévisions. Sur la 2 et la 3, tous les soirs, il y a un temps qui est dédié à la science environnementale et climatique, puisque juste après la météo, il y a une question d'un téléspectateur qui est posée et un chercheur ou une chercheuse répond. face caméra. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a conçu en partenariat avec France Télé. Et donc, il y a une grande partie de notre réseau scientifique qui est passé au journal Météo-Climat. Et ce qui est intéressant, c'est que les journalistes, comme il les faut venir à la rédaction, ils ont une petite heure dans eux, ils leur posent plusieurs questions aux téléspectateurs. Et ils les font répéter jusqu'à ce qu'ils aient la bonne pastille vidéo. Et eux, ils comprennent. Il faut vraiment que je sois le plus claire possible, en 45 secondes, le plus illustré, incarné possible.
- Speaker #2
Au-delà de la formation aux enjeux climat et énergie des journalistes, j'ai interrogé Célia Gauthier sur les difficultés que rencontrent les scientifiques pour faire entendre leur voix dans l'espace médiatique. Une question qui m'est venue en lisant une étude parue dans Nature Communication. Les chercheurs y ont analysé 100 000 articles sur le climat, publiés entre 2000 et 2016. Et le constat est assez frappant. Les climato-sceptiques y sont 49% plus visibles que les climatologues. Alors certes, cette étude date un peu, mais cette sous-représentation des scientifiques n'est pas neutre. Explication.
- Speaker #1
La première difficulté, elle est liée à leur contrainte à eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, parce que la recherche, c'est extrêmement... compétitives, concurrentielles, ils ont de moins en moins de moyens dans la recherche, et en fait, alors qu'ils sont une source essentielle pour les journalistes dans la couverture des enjeux environnementaux, et ils le seront pendant les décennies à venir, ils sont un point de repère, un socle commun de connaissances. C'est pas du tout reconnu dans le monde de la recherche de faire cette vulgarisation, de faire ce travail de diffusion. Il y a quelques chercheurs qui le font. mais c'est presque du bénévolat en fait. Il n'y a pas d'évaluation, très très peu de ça. Et donc pour leur carrière par exemple, ce n'est pas pris en compte. Et donc c'est un arbitrage qu'ils font très souvent sur leur temps personnel.
- Speaker #0
Le deuxième obstacle, c'est lié à ce stade, je pense, à la compréhension de ces enjeux par les journalistes et maintenant, on pourrait dire par leur chefferie, comme on dit dans la profession, par les rédacteurs en chef et les directeurs et directrices de rédaction. On a quand même probablement un petit problème de génération et de compréhension de ces enjeux. qui, dans certains médias, à ce niveau de management dans les médias, sont encore considérés comme quelque chose en plus de l'actu politique, l'actu économique, etc. Il y a des médias qui ont totalement compris qu'il fallait mettre de l'environnement dans tous les angles. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une couverture uniquement environnementale, mais en tout cas, il faut aller questionner. Et chaque fois qu'on parle d'un sujet sécurité, ou d'un sujet santé, ou d'un sujet transport, ou agricole, peu importe, se demander quel est le lien avec la transition écologique. Comment le changement climatique va interagir avec ce secteur ? Qu'est-ce qu'il va modifier ? Et donc ça, il y a certains médias qui ont compris et qui le mettent en place. Et je pense notamment à Ouest France, qui vraiment est un précurseur dans le domaine, avec une équipe qui a vraiment réussi à diffuser une pratique à l'échelle du groupe. majoritaires dans ma région, enfin qui dominent en tout cas le paysage médiatique. Mais il y a d'autres bons exemples de ce type-là. Et ça, ça repose vraiment sur les chefs. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours complètement compris. Donc, il faut continuer les efforts de formation. Il y a aussi un troisième obstacle qui est actuel, on va dire. C'est qu'après avoir quand même amélioré leur contenu, augmenté leur contenu sur les questions climatiques et environnementales, les médias se disent que ça commence à bien faire, que maintenant, c'est un peu trop anxiogène. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, maintenant qu'on a dit qu'on avait battu les records de température le mois dernier ? Est-ce qu'on va redire la même chose ce mois-ci ? Comment on fait pour continuer à couvrir cette question ? Maintenant qu'on a couvert les éco-gestes et les choses qu'on peut changer au niveau individuel, Et... Voilà, et que les gens ont compris, on a quand même des signaux faibles dans les sondages qui montrent que, par exemple dans un sondage de Parlons Climat de la fin de l'année dernière, début 2025, 75%, 3 Français sur 4, pensent que les Média ont au fond assez pour les informer sur ce qu'ils peuvent faire par rapport à l'environnement. Donc les éco-gestes c'est bon, et donc là maintenant c'est qu'est-ce qu'on fait, et cette idée que l'information environnementale ou climatique est trop anxiogène les bloque un peu. et notamment au niveau des chefs. Nous, on propose des choses très concrètes par rapport à ça. D'abord, on dit que ce n'est pas vrai que les Français ne veulent plus être informés par rapport à l'environnement. C'est même plutôt tout à fait l'inverse. On a quand même l'environnement qui figure parmi les premières priorités des Français. Et deuxièmement, il faut vraiment parler des leviers d'action. C'est ça. Les gens veulent une information rigoureuse, scientifique et axée sur... comment agir, mais pas comment agir à moi, à mon niveau, et suis limitée dans mes capacités d'action. Et encore, je m'estime être plus privilégiée qu'une grande partie de la population. Mais comment structurellement la société peut changer, avec quelle politique publique, dans les territoires, au niveau national ?
- Speaker #1
Ce qu'il ressort de toutes ces études et de mes échanges, c'est qu'il apparaît aujourd'hui indispensable pour les médias de montrer des pistes concrètes pour agir face au dérèglement climatique ... via notamment le journalisme de solutions. Et pour cause, une étude de l'université de l'Oregon a montré par exemple que les lecteurs d'articles orientés solutions ressentent une volonté d'agir plus forte pour le climat. De la même façon, le Center for Media Engagement souligne que ces lecteurs se sentent mieux informés, plus optimistes et plus enclins à partager et à agir. Pourtant, ces angles dits solutions restent rares. Ils sont six fois moins fréquents que les récits dits de catastrophes. Alors, qu'est-ce que le journalisme de solutions ? Réponse avec Sophie Roland, journaliste, productrice et formatrice.
- Speaker #2
Alors pour moi, le journalisme de solution n'est pas différent du journalisme traditionnel. En fait, il en fait partie intégralement. Ça fait partie du journalisme. D'ailleurs, la vraie victoire, c'est le jour où on ne dira plus journalisme de solution. C'est journalisme tout court en réalité. Mais c'est vrai que ce n'est pas complètement intégré, parce qu'on ne le pratique pas encore assez au quotidien, dans les rédactions. Moi, je le définis en disant que c'est un peu le sixième W du journalisme. Dans les écoles de journalisme, en fait, on apprend les fameux 5 W. Quand on est étudiant en Master 1, on apprend le What, Why, Who, When, Where. Le Quoi, Pourquoi, Qui, Quand, Où. Et ça, c'est la base de notre métier, les 5 W du journalisme. On apprend tout ça quand on débute. Le sixième W, c'est What do we do ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Et donc, le journalisme de solution, c'est ça. C'est un peu ce sixième W qui complète finalement l'angle traditionnel de l'actualité. Voilà, donc exemple, si on parle du harcèlement scolaire à l'école, ça c'est le problème. Mais si on veut l'angle et solution, il y a un dispositif de lutte qui existe pour lutter contre le harcèlement scolaire. Faisons un sujet là-dessus. Ça, c'est le sixième W. Donc je dirais que c'est un angle plus constructif qui complète... finalement l'information factuelle du jour. Voilà. Alors moi, je n'aime pas trop et surtout, je n'aime pas quand on dit aux journalistes positifs ou quand on dit aux journalistes de bonnes nouvelles. Ce n'est pas du tout ça le journalisme de solution. On ne va pas opposer journaliste négatif au journaliste positif. Évidemment, il est plus positif que journaliste de solution, mais surtout, ce n'est pas journaliste de bonnes nouvelles. Ah, qu'est-ce qu'il y a de beau aujourd'hui ? Quel est le train qui arrive à l'heure aujourd'hui ? Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment de compléter l'actualité qui va traiter effectivement du fait du jour par qu'est-ce qu'on peut faire ? face aux problèmes qu'on a soulevés dans les faits du jour. Donc ça, c'est vraiment un angle différent qui va compléter et puis qui va aussi faire que l'information soit plus équilibrée, beaucoup moins anxiogène, parce que l'actualité au quotidien, elle est profondément déprimante. Donc ça, ça peut être effectivement, le journaliste de solution, un moyen de rééquilibrer, on va dire, l'information. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le pratiquer n'importe comment. Le journalisme de solution, ce n'est pas du journaliste bisounours. Évidemment, tous ces sujets, il faut les traiter de façon équilibrée. Pour les traiter de façon équilibrée, au Solution Journalism Network, on a défini quatre critères. Un sujet de solution équilibrée, ça veut dire celui qui va déjà décrypter la solution. Comment elle marche, la solution, premièrement ? Ensuite, c'est quelles sont les preuves d'efficacité de la solution ? Est-ce qu'elle marche vraiment ? Qu'est-ce qui me dit qu'elle marche ? Ensuite, quelles leçons je tire de cette solution pour que je puisse la répliquer ailleurs ? Et surtout... Quatrième critère, les limites de la solution. Ça c'est très important parce que ça va apporter de la nuance, parce qu'aucune solution n'est magique.
- Speaker #1
Formée au journalisme de solution, Sophie Roland intervient désormais auprès des grands médias de l'audiovisuel pour les former aux enjeux climat et énergie et au journalisme de solution. Je lui ai donc demandé quels étaient justement l'état des connaissances des enjeux climatiques et du journalisme de solution dans ses rédactions.
- Speaker #2
Alors moi je fais des formations... au changement climatique dans les rédactions, effectivement, TF1, France Télévisions, M6. J'ai commencé les premières, on les a faites en 2022. Et évidemment, j'ai intégré le journalisme de solution dedans. Ça me paraissait indispensable. Mais la première partie de ces formations, c'est vraiment de les consacrer aux connaissances scientifiques. Parce qu'effectivement, beaucoup de journalistes ne les avaient pas forcément. On ne nous apprend pas ça, nous, à l'école de journalisme. Moi, j'ai démarré il y a 25 ans. À l'époque, ça n'était pas intégré. C'est en train de changer, mais ça ne l'était pas. Donc pour ceux qui ont commencé il y a longtemps, c'est important en formation continue de leur apprendre un peu le socle de connaissances minimales. À savoir, c'est quoi le changement climatique ? Ça veut dire quoi ? Quel est l'état du consensus scientifique ? Que dit le GIEC ? D'abord, c'est quoi le GIEC ? Comment il fonctionne ? Et la biodiversité, bien évidemment, parce qu'on parle beaucoup de climat, mais c'est au sens large des neuf limites planétaires aujourd'hui qui sont en train d'être dépassées les unes après les autres. Donc c'est déjà, voilà, réviser, voir. l'état des connaissances scientifiques, pour qu'ils aient bien conscience des enjeux. Et ensuite, notre approche en tant que journaliste, c'est d'essayer de savoir comment, nous, on peut s'améliorer dans notre traitement. Et comment s'améliorer, ça veut dire au quotidien, dans les factuels, comment on doit travailler mieux avec les scientifiques, parce que c'est vrai que je pense que pendant longtemps, on n'avait un peu pas tellement ça dans notre carnet d'adresses, sans que ça devine quelque chose de trop complexe non plus. On n'est pas un journal scientifique, justement. On n'est pas un journal scientifique, l'ingité. Mais néanmoins, les intégrer davantage. Et puis apprendre, évidemment, à contextualiser, par exemple, beaucoup plus les événements météo au regard du changement climatique, faire davantage de liens, en fait, entre une canicule aujourd'hui, là, si elle est en train d'arriver, et ce que c'est lié au changement climatique. Mais surtout, expliquer aussi qu'est-ce qu'on fait face à ça. Et donc, évidemment, intégrer les solutions, comment on traite des solutions, à la fois d'adaptation, comment on se prépare à tout ça, et aussi comment on lutte. Contre tout ça, lutter, ça veut dire atténuer, ça veut dire réduire nos gaz à effet de serre. Donc, quelles sont les solutions dans la mobilité, dans notre alimentation, dans notre façon de nous déplacer, de chauffer, dans la protection de nos écosystèmes ? Et évidemment que moi, ce que j'essaie de leur partager beaucoup, c'est d'essayer au maximum d'éviter de tomber dans les techniques du greenwashing, parce que c'est bien ça le risque aujourd'hui quand on va traiter des solutions, et notamment des solutions technologiques. Et puis les éléments de langage des lobbies sont extrêmement puissants. Quand les journalistes reçoivent des communiqués de presse, où tout d'un coup on a inventé cette solution, c'est super, ça marche, on va décarboner l'aérien, ça va être parfait, on ne remet pas du tout en cause la façon dont on voyage. Non, tout ça évidemment c'est totalement illusoire, mais justement comment les journalistes doivent éviter de tomber dedans ? Là aussi, je leur partage des techniques, les bonnes questions à se poser pour éviter de se faire un petit peu mener en bateau, on va dire, par l'élément de langage de l'entreprise ou de la start-up ou de la personne en tout cas qui incarne cette solution. Donc ça, c'est important. Et puis, pour moi, il y a quelque chose de très important aussi dans ces formations, c'est d'essayer de partager ce que j'appelle les nouveaux récits. C'est-à-dire que pour moi, le constat, l'explication du problème, c'est une chose. L'explication, la compréhension, la mise en perspective, c'est très important aussi. Des reportages, plus d'émotions et de solutions, c'est important. Mais c'est aussi de se dire, en fait, on sait que, on sait tous construit sur ce récit des années 70, qui est le récit des énergies fossiles. On sait qu'aujourd'hui, il y a un enjeu, si on veut respecter l'accord de Paris, c'est d'en sortir. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui essayent de faire cette transition. Et donc, ça veut dire qu'ils changent profondément de mode de vie à plein de niveaux, que ce soit des citoyens, que ce soit des entreprises qui vont changer leur modèle d'affaires, que ce soit des collectivités qui vont changer la façon de chauffer ou de faire fonctionner l'éclairage de leur ville. Donc, ils vont essayer d'être plus autonomes énergétiquement. Et ces récits-là, il faut qu'ils soient plus visibles dans les médias. Ils ne le sont pas assez aujourd'hui, parce que c'est un peu des solutions, comme on dit, qui murmurent. Les problèmes hurlent, les solutions murmurent. Et donc, il faut qu'on aille chercher ces solutions-là. Et il y a plein de gens, en fait, qui transitionnent. Et ça fait du bien d'aller les voir parce que ça permet aussi de comprendre que, effectivement, ce n'est pas simple, mais en même temps, ça fonctionne, ça peut fonctionner. Il peut y avoir des avantages à changer, on peut gagner à changer. Et ça, c'est un récit un peu différent, complètement différent du récit qui nous enferme, en fait, dans ce récit des années 70, sur lequel on s'est totalement construit, mais dont on sait que si on continue ce récit-là, On n'y arrivera pas.
- Speaker #1
Si les médias français ont encore du chemin à faire, je me suis posé une dernière question. Est-ce différent ailleurs ? Dans les pays où la sensibilité écologique est plus forte, est-ce que les rédactions accordent plus de place au climat et au levier d'action ? Et dans ceux déjà frappés de plein fouet par le dérèglement climatique, l'information prend-elle une autre tournure ?
- Speaker #2
Les premiers pays les plus impactés sont effectivement les pays les plus sensibilisés au journalisme de solutions. notamment par exemple, il y a eu tout un développement de solutions dans les pays africains. Et ça, c'est important. Le SGN, vraiment, ce Change and Network, on a développé beaucoup d'histoires, beaucoup de médias ont été formés à ça. Et il y avait une demande, une forte appétence pour l'ingénierie de journalisme de solution. J'ai vu aussi en Asie, j'ai vu en Inde. J'ai des collègues en Inde, mais c'est incroyable le nombre de sujets solutions qui ont émergé, qui ont vraiment énormément explosé. Pareil en Amérique latine. Donc ça, c'est aussi intéressant. Moi, j'interviens plus en Europe. Dans les pays européens, qu'est-ce que je vois ? En fait, ce que je vois, c'est que ce n'est pas encore majoritaire, vraiment globalement, le journaliste de solutions, parce qu'il souffre d'idées reçues. Et après, moi, j'accompagne aussi. Avec le Solution Journalism Network, on accompagne des rédactions en Europe pour essayer justement qu'elles puissent faire davantage de sujets solutions, notamment prix de climat, mais pas que. Et on voit bien que ça change, on voit bien qu'elle change, on voit bien qu'elles essayent d'intégrer ça davantage. Et que notamment, je peux citer des exemples. J'avais travaillé avec Libération dans une série qui s'appelait Pistes vertes, sur les solutions au changement climatique dans les pays les plus impactés. Je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, moi, je veux beaucoup de sujets et de solutions dans Libé. Moi, en ce moment, j'accompagne une journaliste de l'ARD en Allemagne qui veut essayer de renforcer le traitement du climat dans sa rédaction. Moi, je l'accompagne pour qu'elle change ça. Parce qu'elles sont les résistances en interne. On se dit, comment on peut lever les obstacles ? Comment on peut emmener tout le monde ? Donc voilà, ça, c'est aussi des choses qui sont en action, qui montrent que ça avance, quoi. Et que, justement, il faut le journalisme de solution. Il faut traiter d'un angle plus constructif pour avancer dans ce traitement, en fait, du climat. J'ai encore un autre exemple l'année dernière. J'avais travaillé dans le cadre, encore une fois, d'un partenariat qui avait mis en place le Solution Journalism Network en Europe. J'avais en fait, et Transitions, qui est un média basé en République tchèque, j'avais accompagné trois médias européens, un en Tchéquie, EcoNews, en République tchèque, un Versbeton aux Pays-Bas, et Radar en Italie. Des médias plutôt habitués à faire de l'investigation. Et là, on a fait les solutions en PFAS, par exemple. Et donc ça, c'est intéressant, parce que derrière ce qu'ils nous disent, ces journalistes, une fois qu'ils ont mieux compris ce qu'est le journalisme de solution, une fois qu'ils se sont dit « Ah oui, quand même, c'était intéressant de le traiter sous cet angle-là » , ils ont envie de continuer. Donc ça, ça leur montre qu'une fois qu'on a partagé les techniques, qu'on a partagé la clé de compréhension de ce qu'est vraiment le journalisme de solution, ça leur donne envie de continuer davantage à pratiquer ce journalisme-là. Et ça, c'est très encourageant, même si, et c'est la difficulté pour beaucoup, c'est que c'est vrai que ça demande aussi du temps, une journée de solution. Parce que ce n'est pas un sujet qu'on va faire comme ça, en deux minutes, le matin pour le soir. Surtout si on veut le faire bien, si on veut le faire de façon rigoureuse et équilibrée, ce n'est pas toujours simple. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut pouvoir avoir le temps de réunir des preuves d'efficacité, avoir le temps de montrer bien les limites. Voilà, ce n'est pas juste, j'appelle l'entreprise qui a mis en place une solution, et hop, je vais faire le sujet. Donc, c'est ça aussi, des fois, qui va freiner dans les rédactions, en fait, le fait que ce journalisme de solution se développe davantage. Après, il y en a qui ne reviendraient pas en arrière. Je pense, par exemple, à Mediacité. C'est un très bon exemple, Mediacité, parce que, en fait, c'est un média local d'investigation. Et ce média local, en fait, une fois qu'il a été formé, d'ailleurs, par le SGN, derrière, il a vraiment essayé de convaincre les autres journalistes que c'était intéressant. Et notamment, Mathieu Slis, qui fait partie de Mediacité. Il vient de créer une newsletter justement consacrée aux solutions. Et il lui dit, pour justement qu'investigation ne rime pas seulement avec révélation, il faut aussi qu'elle rime avec solution. Et je pense que c'est ça qui est important, qui est super. Encore une fois, c'est un jeune journaliste qui a deux ans, trois ans de métier qui se dit, l'investigation, on voit bien que si on ne le traite que sous l'aspect révélation, on lasse les gens, on donne un côté anxiogène et désespérant. Alors qu'en revanche, maintenant, ma newsletter solution... Et les angles solutions qu'on va pouvoir traiter davantage dans Mediacité vont nous permettre d'aller plus loin. Une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'ils travaillent maintenant avec Berth Betten aux Pays-Bas, le média local qui fait de l'investigation, qui lui aussi a compris que les angles solutions étaient intéressants. Ils travaillent ensemble et ils vont en fait, chacun dans leur pays, aller trouver des solutions qui peuvent peut-être être applicables chez l'autre. Là, ils ont travaillé sur le narcotrafic, justement, des techniques qui ont été mises en place du côté de Rotterdam. Et Matthew Slees s'est allé voir si c'était applicable, justement, à Lille, si c'était inspirant ou pas. Et ça, je pense que c'est un avenir très important du journalisme de solutions. C'est vraiment du journalisme collaboratif qui va renforcer, en fait, les connaissances de ce qui se passe dans un autre pays, qui peut inspirer un autre pays. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire au Solution Journal Network. C'est avec ces réseaux de partenariat, d'essayer d'accompagner plusieurs rédactions en même temps. C'est que ce titre des liens, et qu'ensuite, elles puissent travailler ensemble pour développer des sujets solutions.
- Speaker #1
Et voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à la couverture médiatique du climat. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura permis d'éveiller votre connaissance sur le sujet. Pour plus d'informations sur cette thématique, et si vous souhaitez notamment retrouver toutes les études citées dans l'épisode, rendez-vous sur le site du podcast www.hopodcast.fr. Vous pouvez enfin retrouver les autres épisodes sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts ou encore Deezer. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et un commentaire, ça m'aidera beaucoup. A très vite pour un nouvel épisode !