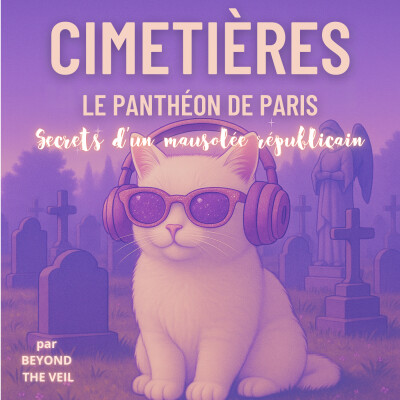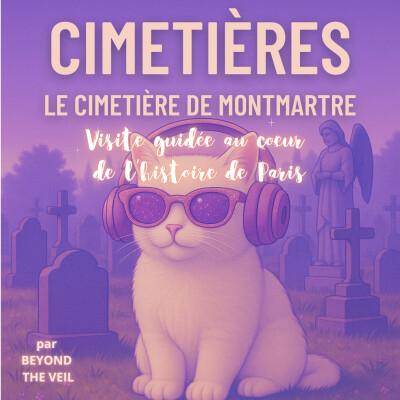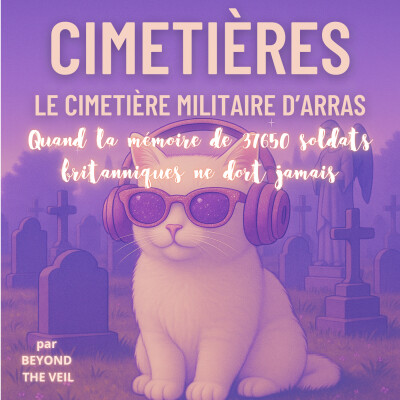Speaker #1Bloopers : Sérieusement, j'entends un bébé qui vient avec son bébé. C'est pas ici que je vais trouver de la porcelaine. On va dire qu'elle est venue pour la crypte et elle est restée pour le pendule.
Quand on gravit la montagne Sainte-Geneviève, au cœur du quartier latin à Paris, on ne peut pas rater cette masse néoclassique surmontée d'un dôme monumental. Ce lieu, c'est le Panthéon. Monument, mausolée, symbole républicain, c'est aussi un cimetière. Un cimetière politique.
Hello mes petits soleils et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre saga de l'été, Cimetière. Je suis toujours Virginie, ancienne conseillère funéraire, passionnée de tourisme et guide auto-proclamée de vos balades de l'été. Et dans cet épisode dédié aux lieux funéraires parisiens, je vous emmène avec moi dans un lieu que j'ai toujours voulu découvrir, le Panthéon. Et oui, ce podcast, c'est l'occasion aussi pour moi de cocher des cases dans ma wishlist. Le Panthéon, c'est un monument qu'on regarde souvent de l'extérieur sans en comprendre le sens profond ou sans même savoir qu'il se visite. C'est un édifice où les morts sont choisis par la République et racontent une certaine vision de l'histoire. Aujourd'huije vous emmène dans sa crypte, mais aussi dans les controverses. Qui mérite d'y reposer et pourquoi ? Est-ce une distinction ou une forme de récupération ? Alors, vous êtes prêts pour un épisode qui interroge, mais sans parti pris ?
C'est parti !
Alors, avant de commencer cet épisode, ici je suis à l'extérieur du Panthéon. Ma voix sera normale. Ensuite, ma voix sera un peu plus basse, dans la mesure où je serai à l'intérieur du Panthéon. Et donc, par respect pour les visiteurs, par respect pour le lieu, je parlerai beaucoup plus bas.
Avant de rentrer dans ce lieu emblématique, contexte ! Tout commence au VIe siècle. Après sa conversion au christianisme, le roi Clovis fait construire sur la montagne Sainte-Geneviève une basilique pour abriter sa sépulture et celle de son épouse Clothilde. En 512, Sainte-Geneviève, protectrice de Paris contre les Huns, y est inhumée à son tour. L'entretien des reliques est confié aux chanoines. Très vite, ce coin du quartier latin devient un haut lieu de pèlerinage et un haut lieu de savoirs avec la Sorbonne, les arènes de Lutèce et les thermes de Cluny à proximité. En 1744, Louis XV tombe gravement malade. Il promet que, s'il guérit, il fera bâtir une nouvelle église en l'honneur de Sainte-Geneviève. Il guérit et confie le projet à l'architecte Jacques Germain Soufflot. Soufflot rêve d'un manifeste architectural, un bâtiment qui conjugue la pureté grecque, la légèreté gothique et la grandeur de la Renaissance, avec un plan en croix grecque inondé de lumière grâce à 45 fenêtres. Dès 1763, il imagine une place monumentale encadrée par une école de droit et une école de théologie, l'actuelle mairie du 5e arrondissement. La première pierre est posée en 1764. Soufflot meurt en 1780 et c'est son élève Rondelet qui achève le chantier en 1790, à la veille d'un bouleversement politique majeur. Sauf que, vous vous en doutez, vu la date, la révolution éclate. L'église n'est pas encore consacrée. que l'Assemblée Constituante décide de la transformer en Panthéon National pour honorer les grands hommes de la patrie. Le 4 avril 1791, Mirabeau devient le premier inhumé. Il sera ensuite transféré ailleurs. Voltaire entre la même année, Rousseau et Marat en 1794. La devise aux grands hommes « la patrie reconnaissante » s'affiche sur le fronton. Pendant tout le XIXe siècle, le Panthéon hésite entre Église et Mausolée. Sous Napoléon Ier, la Nef redevient lieu de culte tandis que la crypte accueille les sépultures. la monarchie de Juillet et le Second Empire alternent les fonctions. Ce n'est qu'en 1885, à la mort de Victor Hugo, que le Panthéon devient définitivement un temple laïque de la mémoire républicaine. Les funérailles nationales, suivies par une foule immense, consacrent le monument comme nécropole de la nation.
Alors là, je suis encore à l'extérieur de ce monument, puisque comme d'habitude, j'arrive très tôt. Mais en arrivant face au Panthéon, ma première impression, c'est déjà, c'est immense. On est accueilli par sa façade monumentale inspirée du Panthéon de Rome. Il y a un portique à colonnade corinthienne. Huit colonnes de 22 mètres de haut soutiennent un fronton sculpté par David d'Angers. Et on y lit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aux grands hommes la patrie reconnaissante. Les figures sculptées représentent la patrie au centre, entourée de grands hommes qu'elle honore. Mirabeau, Voltaire, Rousseau, Lafayette et d'autres figés dans la pierre comme dans une photographie politique du XIXe siècle. A j’t’avais dit Micheline ! Ça va parler un peu politique, mais je ne prends pas parti.
Forcément, la grandeur de ce bâtiment, les détails architecturaux au niveau de la façade aussi, montrent que c'est un espace qui est pensé pour inspirer le respect de ces grands hommes et ces femmes inhumées ici. Parce que oui, on en reparle tout à l'heure, mais il faut savoir que la première femme inhumée au Panthéon y est rentrée en 1995. Excusez-moi, en quelle année a été construit le Panthéon ? Patriarcat mon amour ! Ah je t'avais dit aussi Micheline, j'essaie de ne pas prendre parti, mais quelque part, je suis un être humain, mais je suis une femme. Voilà, on ne va pas rentrer dans le débat etc etc. Mais quand tu vois quand même Micheline, que ça date quand même de la fin du 18ème siècle et que la première femme a été inhumée en 1995, on va peut-être remettre l'église au milieu du village hein les gars !
Alors, je viens de rentrer dans le Panthéon et je suis tout de suite dans la nef, cette très grande nef, de chaque côté il y a des peintures, j'ai envie de vous dire, des œuvres peintes, des sculptures, c'est très très grand. Alors je parle tout bas, j'espère vraiment que ça va s'entendre. C'est magnifique, c'est magnifique. Face à moi j'ai le pendule de Foucault qui se trouve au centre de cette nef. Et derrière, avec vue sur le pendule, est tournée vers nous la représentation de la Convention nationale. Alors forcément, je suis venue pour la crypte. Waouh ! Ici, j'ai une sculpture à l'effigie de Denis Diderot, 1713-1784. Et juste au-dessus, il y a inscrit « L'encyclopédie prépare l'idée de la Révolution » . C'est vraiment joli. Il y a vraiment cette impression quand on franchit la porte que tout change. Il n'y a plus de bruit de la ville, ça résonne, c'est solennel. La Nef, elle, elle est grande, elle est sobre, elle est symétrique surtout. Elle est faite de pierres très claires. On a du marbre, des dorures qui sont très discrètes par contre. Les peintures que je vous décrivais là, l'entrée en mode « Oh mon Dieu, c’est des peintures, non, j'ai repris mes esprits » . Ce sont des fresques. Les murs sont décorés de fresques qui retracent l'histoire chrétienne et monarchique de la France. C'est un rappel des origines religieuses du lieu. On remet un peu l'église au milieu du village et avant une récupération politique de l'après-révolution du lieu, savoir qu'à la base, ça avait été choisi comme un lieu de culte. Après, de ce que j'ai lu, c'était la volonté de Soufflot d'unir le gothique à la rigueur antique.
Là, moi, j'arrive au centre et je suis face au pendule de Foucault. Je vous l'ai pris en vidéo, donc là, vous pourrez le voir sur Instagram. Il se trouve sous la coupole et c'est un des objets scientifiques les plus célèbres du XIXe siècle. Il a été installé en 1851 et c'est un dispositif simple. Une sphère de métal qui est suspendue à un long câble et qui prouve la rotation de la Terre. Il inscrit la science et la rationalité au cœur de ce qui fut autrefois ce sanctuaire religieux. Devant le pendule, enfin quand je suis face au pendule, j'ai qu'une envie, là c'est de lever la tête. Et quand je lève la tête, eh bien je vois peint l'apothéose de Sainte Geneviève. C'est un hommage à la sainte patronne du lieu. C'est peint, c'est magnifique, c'est grandiose. Un nouveau mot, c'est grandiose. Il suffit simplement de lever les yeux pour voir cette coupole. C'est du détail. On est quand même dans du religieux. On a la vie de Clovis, l'apothéose de chien de Geneviève. Au-dessus de la Convention nationale, on a quand même une représentation du Christ. On sent quand même le mélange entre la République et la religion. Je suis hyper impressionnée. C'est comme une église. En fait, c'est ça. Ça a été d'abord pensé comme une église. Et de toute façon, là, on le voit. C'est vraiment pensé comme une église. Sauf que l'intérieur de l'église est à la gloire de la République. Voilà, c'est tout. Comment je viens de vous dire ça de façon blasée ? Je viens de m'en rendre compte. Je suis en train de me dire, de toute façon, les gars, c'est décoré comme une église. Et puis, au lieu de mettre des chaises pour s'asseoir et prier, on a mis de la décoration de la République. Oh, shit. Désolée, pour ce ton blasé. Non, je ne m'excuse pas pour ce ton blasé. Non, on va assumer un petit peu ces positions.
Vous avez la possibilité, moi je ne l'ai pas fait, mais vous avez la possibilité, lorsque vous réservez votre billet, parce que vous pouvez le réserver en ligne, comme ça vous ne faites pas la queue, vous avez la possibilité de prendre un audio-guide, soit de faire une visite en mode « wow » , ou alors de prendre un audio guide et vous avez des points avec des petits panneaux sur le sol qui vous indiquent à quel moment s'arrêter pour entendre le contenu de l'audio guide. Moi je ne l'ai pas fait et je n'ai absolument pas préparé cette visite. On y va à la découverte, allez Zé parti !
Voilà, j'ai un script pour tout vous dire. j'ai des petites parties que je vais vous lire, forcément, parce que je me suis documentée, parce que j'ai envie que cet épisode soit documenté, mais yolo quand même ! Là, je suis devant une fresque qui se trouve à gauche de la représentation de la Convention nationale. Et cette fresque, c'est la vie de Sainte Geneviève par Pierre Puvis de Chavannes, qui a été réalisée entre 1889 et 1898. Alors en fait, ici, Puvis de Chavannes met en avant le rôle protecteur de Sainte Geneviève. Il choisit pour cela un épisode clé de la vie de la Sainte, le ravitaillement de Paris. Alors que la ville est assiégée en 465, des denrées sont secrètement acheminées par la Seine, afin de sauver la population de la famille. Le panneau de droite, l'un des plus connus du peintre, dépeint Sainte Geneviève de nuit, sur une terrasse d'où elle veille sur la ville endormie. Il faut savoir que cette fresque est représentée en quatre panneaux. L'information que je viens de vous donner, c'est une information qui se trouve... en bas de chaque fresque vous avez un panneau avec l'explication la fresque détaillée Cette fresque n'est pas isolée.
Si on tourne autour de la Nef, on découvre des chapelles ornées de fresques monumentales. Certaines retracent la vie de Jeanne d'Arc, d'autres la mission de Clovis, comme je vous le disais, et les hauts faits de Louis IX. Alors là, face à moi, au-dessus d'une porte, est indiqué à la mémoire du capitaine Guynemer, symbole des aspirations et des enthousiasmes de l'armée de la nation. Et ça me fait plaisir de vous faire découvrir ce lieu parce que, comme je vous dis depuis le début, je suis super contente de vous faire cette série de l'été, cimetières. Ça me permet, moi, déjà de bouger dans un premier temps et de visiter des cimetières que je n'aurais peut-être pas eu le temps de visiter. L'envie, oui, mais le temps, voilà. Et en même temps, j'espère sincèrement, mais vraiment, que cette saga vous plaît. Là, je suis devant la fresque La vie de Jeanne d'Arc par Jules Lenepveu, qui a été réalisée entre 1886 et 1890. C'est un roman graphique qui décline de droite à gauche les scènes de la vie de Jeanne d'Arc, de l'annonce de son destin par l'archange Saint-Michel, qui l'a conduit à porter assistance au roi Charles VII à sa mort sur le bûcher à Rouen. C'est pas ici que je vais trouver de la porcelaine. Je vous en ai fait une vidéo, comme je peux, parce que c'est immense, c'est très grand, et je ne fais que 1m70.
Waouh ! Alors, il y a une tapisserie devant moi qui est magnifique, et devant cette tapisserie, j'ai un monument érigé, une sculpture érigée à la mémoire des artistes dont le nom s'est perdu, par Paul Landowski, qui a été réalisé entre 1912 et 1914. Cette œuvre représente deux Atlantes agenouillées qui soutiennent sur leur tête une urne. Architectes, danseurs, sculpteurs et musiciens habitent les frises qui la composent. Sur le socle, l'inscription en latin peut se traduire ainsi « Au gardien du feu éternel dont l'œuvre est dans la gloire, dont le nom est tombé dans l'oubli » . Le monument est assez représentatif de la réflexion menée à cette époque autour de la mémoire. Un parallèle peut ainsi être fait avec « Le soldat inconnu » . qui avant d'être placée sous l'arc de triomphe a fait un passage par le Panthéon en 1920. Et donc derrière, comme je vous le disais, on a une tapisserie verticale. Elle est de couleur rouge et dorée. Il y a un lion ailé dessus. Il y a écrit Pro Patria, un héraldique il me semble. Et deux personnages avec un agneau, il me semble. Et elle se trouve entre deux fresques. Ah bah non, cette tapisserie... C'est l'ensemble d'une œuvre qui s'appelle Pro Patria, la prière et la consolation, le travail et la prospérité, la patrie et la liberté, la fraternité et l'humanité de Jacques Ferdinand Imbert qui a été réalisé entre 1886 et 1900. C'est quand même compliqué de vous prendre ces fresques en photo, je suis désolée pour la qualité des photos que vous verrez sur Instagram. Mais bon, on n'est pas venu pour les fresques. Allez, on va s'avancer un peu plus loin, on va s'aventurer, parce qu'il y a des portes ouvertes de chaque côté. Avant d'aller s'aventurer, on va parler de cette sculpture, « Vivre libre ou mourir, la Convention nationale » . « Vivre libre ou mourir » , c'est ce qui est gravé dessus. Elle a été réalisée par François Sicard entre 1912 et 1920. Huit ans ont été nécessaires pour achever cette œuvre monumentale de près de 10 mètres de long. Au centre, on a une Marianne, qui est reconnaissable par son bonnet phrygien. Elle a le visage fermé, le regard grave. et symbolise la République.
A gauche, on a des députés qui prêtent serment et à droite, des soldats républicains de tout grade. Ici, le message est direct. Il s'agit de célébrer l'avènement de la Première République. On réaffirme les valeurs, notamment la liberté, avec le vivre libre ou mourir qui est gravé. A droite, de la Convention nationale, On a une porte et au-dessus de laquelle est indiqué « Aux écrivains morts pour la France » . Ensuite, j'ai une deuxième porte qui donne sur la boutique et il y est inscrit « Aux écrivains morts pour la France » . Et on a la liste des morts au champ d'honneur et morts sous les drapeaux. On passe à la boutique de l'autre côté. On a une horloge. On a une autre porte. où il y a également écrit aux écrivains morts pour la France. Et je pense que c'est le plan de la coupole, enfin de la coupole plutôt, à la Virginie. Oui, on est à la coupole d’Helfaut, c'est le plan du Panthéon.
Qui est ce monsieur ? Il a l'air bien rustre en tout cas ce monsieur. Ah bah c'est Mirabeau, super. Donc là je suis face à la représentation de Mirabeau par Jean-Antoine Injalbert qui a été réalisé entre 1924 et 1927. Mirabeau, comte de Mirabeau, figure emblématique de la Révolution française, qui décède brutalement. Et face à lui, le général Hoche, réalisé par Jean Dalou entre 1900 et 1902. Qui était le général Hoche ? Bonne question Virginie ! Le général Hoche, c'est l'un des plus éminents représentants des armées républicaines. Il s'illustre notamment à Quiberon, en déjouant en juillet 1795 le débarquement de centaines de sympathisants royalistes, et met ainsi un terme aux guerres de Vendée. C'est un plâtre.
De l'autre côté de la boutique, on a face à la boutique une autre porte, où est indiqué aux écrivains morts pour la France. Et à l'intérieur, je peux voir la maquette de chantier du Panthéon. Cette maquette de chantier du Panthéon a été réalisée sous la direction de Jacques Germain Soufflot et de Jean Rondelet vers 1770-1790. Elle est en pierre et en plâtre. Elle est bien évidemment classée monument historique. Alors je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a des chants. Je ne sais pas si c'est toutes les demi-heures. Ouais, je pense que c'est toutes les demi-heures. Je vais quand même aller me renseigner auprès du personnel parce que je pense qu'il y a une signification à ces chants, mais je ne sais absolument pas pourquoi. Parce que bien évidemment, je suis là, on dit les tentes, mais je vais aller demander. En fait, là, je suis à la recherche d'un gardien qui pourrait m'aider. Ah bah, excusez-moi, madame, les chants qu'on entend, c'est quoi ?
C'est une commande du président d'Armée, Emmanuel Macron, qui a demandé à ce compositeur de réaliser une oeuvre musicale pour rendre hommage à ceux qui sont morts durant la Première Guerre mondiale. Et ça, c'était à l'occasion de l'entreprendement de Maurice Genevoix. Maurice Genevoix a combattu pendant la Première Guerre mondiale et ceux de 1914 témoignent de ce qui s'est passé durant la guerre. On l'entend plusieurs fois par heure, il y a des jeux par heure, des morceaux.
Je ne sais pas si ça s'est entendu parce que j'ai mis le micro le long de mon corps pour ne pas gêner madame. Le chant qu'on entend, c'est un chant qui a été commandé par le président Emmanuel Macron à la mémoire des soldats, des personnes aussi, de ceux de 14 en fait, des personnes décédées lors de la première guerre mondiale. Et on entend ce chant plusieurs fois par heure. Avant de descendre dans la crypte, on va répondre à une question. Qui peut être panthéonisé ? Depuis le décret du 4 avril 1791 qui transforme l'église Sainte-Geneviève en Panthéon des Grands Hommes, le principe reste le même. C'est le président de la République qui décide qui entre et qui n'entre pas. Cette décision se prend souvent après avis du Parlement, personnalités politiques, d'associations ou même à la suite de pétitions citoyennes. Certaines entrées sont le fruit de campagnes médiatiques longues et passionnées. Alors en théorie, le Panthéon est réservé à celles et ceux qui ont rendu des services éminents à la patrie. Mais la formule est volontairement floue selon l'époque et le président cette notion peut recouvrir. Des figures politiques et militaires, comme par exemple Jean Moulin, Lazare Carnot. Des écrivains et intellectuels, comme Victor Hugo, Émile Zola, Aimé Césaire. Des scientifiques, comme Marie Curie, Louis Braille. Ou encore des figures de la résistance ou des droits humains, comme Germaine Tillion, Simone Veil ou Joséphine Baker.
En pratique, chaque panthéonisation est un acte politique. Faire entrer quelqu'un au Panthéon, c'est envoyer un message sur les valeurs que la République veut mettre en avant à ce moment-là. L'humanisme, la résistance, l'égalité, la science, la culture, ou au contraire, éviter certains sujets qui fâchent. Je vous le disais tout à l'heure, pendant longtemps, le Panthéon a été exclusivement masculin. Oui, ma brave Micheline, il a été exclusivement masculin, blanc et issu des élites. La première femme, Marie Curie, n'y entre qu'en 1995. et il faut attendre 2021 pour qu'une femme noire... Joséphine Baker y repose, symboliquement, car son corps reste, lui, à Monaco. Les entrées féminines, comme celles de Simone Weil ou Geneviève de Gaulle-Antonioz, sont donc encore l'exception plutôt que la règle. Mais vous vous en doutez peut-être, les panthéonisations suscitent souvent polémiques et débats. Est-ce qu'il faut panthéoniser des figures encore controversées ? Est-ce qu'il y a assez de diversité ? Faut-il y faire entrer davantage de femmes ou d'artistes ? Chaque décision devient ainsi un un miroir de l'époque. Elle révèle autant les héros que la République veut célébrer que ceux qu'elle choisit d'ignorer. Allez, encore un peu de patience. Avant de descendre dans la crypte, on va parler des panthéonisés. Aujourd'hui, le Panthéon compte 81 personnes inhumées ou honorées par un scénotaphe. En parcourant la liste, on traverse plus de deux siècles d'histoire française où se côtoient écrivains, scientifiques, militaires, résistants, hommes et femmes politiques. Parmi les plus célèbres, les philosophes des Lumières, comme Voltaire, Rousseau, des écrivains, Victor Hugo, Émile Zola, Alexandre Dumas, André Malraux, des scientifiques, Marie Curie et son mari Pierre. On a également des figures de la Résistance, comme Jean Moulin, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Antonioz, Pierre Brossolette, et aussi des symboles républicains contemporains, comme Simone Veil et, je vous l'ai dit tout à l'heure, Joséphine Baker. Certaines panthéonisations sont surtout symboliques. Aimé Césaire y est honoré par une plaque, un cénotaphe, mais son corps, lui, repose en Martinique. Pareil pour Joséphine Baker, dont la dépouille est restée à Monaco. Seul un cercueil vide symbolise sa présence à Paris. Mais il y a ceux qui n'y sont pas, et dont l'absence interroge, comme par exemple Olympe de Gouges, auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Louise Michel, figure majeure de la Commune de Paris, Gisèle Halimi, avocate et militante pour le droit à l'avortement, Denis Diderot, philosophe des Lumières et père de l'Encyclopédie, bien qu'il soit représenté par une sculpture, et même Napoléon Bonaparte. Pourtant, au centre de l'histoire française, lui repose aux Invalides. Alors on l'a compris, les noms gravés au Panthéon sont ceux que la République a voulu retenir. Les absents, eux, racontent d'autres histoires. Celles des débats, des résistances et des refus politiques. Tout à l'heure, je vous disais que la première femme est entrée au Panthéon en 1995. Eh bien, transition ma Micheline, on va parler des femmes au Panthéon. Ce Panthéon, ce temple pensé pour les grands hommes comme il est gravé au fronton.
Rappelez-vous, au fronton est gravé “Aux grands hommes la patrie reconnaissante”. Pendant presque deux siècles, le Panthéon a été conçu comme un sanctuaire exclusivement masculin. Il faudra attendre 1995 pour que la République reconnaisse que les grands pouvaient être aussi des femmes. Que hommes s'écrivaient avec un grand H. Alors dans les femmes au Panthéon, on va avoir bien évidemment Marie Curie, la première à franchir les portes en 1995, soit plus de 200 ans après la création du Panthéon. Deux fois prix Nobel, ses travaux sur la radioactivité ont changé la science et la médecine. Mais il a fallu que son mari, Pierre Curie, y soit déjà inhumé depuis 1906 pour que l'idée fasse son petit chemin. Bah dis donc Jean-Michel, il y a Pierre Curie d'un côté et Marie Curie de l'autre côté, est-ce qu'on les ferait pas reposer ensemble ? C'est une bonne idée Jean-Marc ! Ensuite, on a les Résistantes, ces héroïnes de l'ombre. En 2015, quatre figures de la Résistance font leur entrée. Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Antonioz, toutes deux survivantes des camps de Ravensbrück, aux côtés de Pierre Brosselette et Jean Hazé. Et puis comment parler des femmes au Panthéon si on ne parle pas de Simone Veil ? En 2018, Simone Veil rejoint la crypte, accompagnée de son mari Antoine. Déportée à Auschwitz, magistrate, ministre, elle a fait adopter la loi légalisant l'avortement en 1975. Et puis plus récemment, en 2021, la France a panthéonisé Joséphine Baker, artiste du musical, espionne pour la résistance, militante des droits civiques. C'est la première femme noire et la première artiste de scène à entrer au Panthéon. Alors si on fait le bilan, sur 81 panthéonisés, seuls 6 sont des femmes. Et encore, certaines y sont entrées aux côtés de leur mari ou par cénotaphes symboliques. A ce rythme, il faudrait des décennies pour atteindre la parité. D'où les appels récurrents pour panthéoniser davantage de femmes. comme Gisèle Halimi, Olympe de Gouges, Louise Michel et tant d'autres. Tu sens un peu l'amertume de la femme que je suis en lisant ces lignes ? Mais bon, cet épisode n'est pas là pour ouvrir un débat. Chacun a ses propres opinions. J'ai les miennes, vous avez les vôtres. Je suis chez moi, c'est mon podcast, je m'exprime.
Et maintenant, on va partir dans la crypte. Allez, on y va ! Parce qu'on est venu pour ça. Je vous emmène avec moi descendre dans les entrailles du monument. L'entrée de la crypte se trouve derrière la nef, derrière la convention nationale. Il faut traverser toute la nef pour atteindre cet escalier. Allez, je vous emmène avec moi dans la crypte, c'est parti ! Entre deux, on croise les toilettes. Me voilà arrivée dans la crypte. Alors, a priori, il y a un sens de la visite. Je peux aller soit à droite, soit à gauche. Oh, waouh. Alors, je vais aller à droite, et là, je lis. Ici repose le cœur de Léon Gambetta, solennellement transféré au Panthéon le 11 novembre 1920, suivant la volonté nationale. Il y a une loi, a priori, qui a été érigée le 1er septembre 1920 pour que le cœur de Léon Gambetta soit transféré au Panthéon. Donc là, je suis rentrée dans la crypte, un vaste réseau de galeries voûtées en pierre, soutenues par des piliers massifs. Ici, tout est silence et sobriété. Il faut savoir que la crypte s'étend sur plus de 7000 m² et se compose de plusieurs galeries principales et latérales. Chacune mène à des caveaux où reposent les personnalités panthéonisées. Les noms sont gravés sobrement au-dessus des entrées, les cercueils sont placés derrière des grilles ou des portes fermées. Parce qu'en fait, ce lieu, ce n'est pas un spectacle, c'est un espace de recueillement. Alors ici, l'ambiance est totalement différente de la Nef. Il n'y a pas de fresques colorées ni de grandes sculptures. Ici, les murs sont nus, la pierre est claire et l'éclairage discret. Ça crée une atmosphère presque monastique. Cette crypte, c'est comme une bibliothèque du passé. C'est une bibliothèque, sauf qu'ici, on n'ouvre pas les livres, les gars. Oh, waouh. Alors ici, je suis devant la sépulture de Voltaire. Donc, j'ai ce qui s'apparente au tombeau de Voltaire et devant... une sculpture qui représente le personnage. La sculpture est en marbre et est très bien détaillée. On voit les lignes de ses mains, ses rides.
C'est vraiment très bien fait.Et juste à côté de Voltaire, on a le corps de Messire Soufflot. Et les gens, c'est rigolo parce que les gens regardent Voltaire, mais ne tournent pas la tête parce que le caveau de Monsieur Soufflot est beaucoup plus discret, beaucoup plus sobre aussi. Il est gravé dessus, ici, et le corps de Messire J.G. Soufflot, architecte de Sa Majesté et de la Nouvelle Église de Sainte-Geneviève, intendant général des bâtiments du roi. Mais les gens se... Ne se retourne pas, c'est rigolo. Alors, c'est rigolo parce que là, il y a noté « Exhumé et transporté des caveaux de sépulture des Génovés fins dans la nouvelle église de Sainte-Geneviève le 19 février. » Et après, on est sur du mille... C'est ces machins. Voilà. Je vais repasser sur mes cours d'histoire. Alors, qui se trouve en face de Voltaire ? Jean-Jacques Rousseau. Alors, ce caveau de Jean-Jacques Rousseau est en bois sculpté. C'est magnifique. En fait, il y a des personnages qui ont été... Alors, je ne sais pas si c'est sculpté dans le bois ou si ça a été sculpté et collé par-dessus après, mais c'est magnifique. Il est inscrit sur le côté. Ici repose l'homme de la nature et de la vérité. Waouh ! Je me balade dans ce couloir là, je vais vous prendre une vue parce que c'est magnifique. Mais waouh, en fait là je viens de prendre un escalier, je peux aller à droite, à gauche, j'ai tellement peur de me perdre. C'est ouf, j'ai tellement peur de ne pas trouver les choses en fait. En gros, c'est des galeries en fait. C'est des galeries. Et dans chaque galerie, vous avez un défunt. Alors, ici j'ai du coup le scénotaph de Joséphine Baker. Et Mélinée Manoukian. Nisac Manoukian aussi. Ici, je me trouve devant le scénothèque de Joséphine Baker. C'est de la pierre gravée. Et là, en fait, si je vais dans le fond, je vois qu'il y a encore de la place pour quatre autres personnes. C'est rigolo parce qu'en fait, vous rentrez dans une pièce, donc une porte fermée ou une porte ouverte, et vous voyez... C'est rigolo. J'ai l'impression de rentrer dans un salon funéraire au boulot et d'aller visiter un défunt. Sauf que là, on tape pas à la porte avant de rentrer. Il y a de la place. Il y a des... Il y a des... Oui, il y a des salons dans lesquels c'est vide. J'ai de la chance parce que les gens s'arrêtent quand je prends une photo ou une vidéo. Et du coup, vous allez avoir l'impression qu'il n'y a personne. Et c'est magnifique. Alors pourtant, il y a du monde. J'ai été médisante à l'entrée. En pensant que les gens allaient être incivilisés. Pardon. Ici, je me trouve dans le salon, je vais appeler ça des salons, ces petites pièces, où se trouve un Gaspard Monge, 1746-1718. Ici, l'abbé Henri Grégoire, 1750-1831. On a une petite croix qui est gravée dessus, de par la fonction de la personne. Ensuite, j'ai Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat de Condorcet, décédé en 1794. Je suis devant la pièce où se trouvent Marie Curie et son mari Pierre. Je viens de voir ici, on n'appelle pas ça des pièces, on appelle ça des caveaux. Dans le caveau numéro 8 se trouvent Marie Curie et son mari Pierre. Donc là je suis rentrée dans le caveau numéro 8 et je peux voir que Marie Curie est rentrée après puisqu'elle se trouve au-dessus de Pierre. Marie Curie naît Sklodowska, née en 1867, décédée en 1934. Et il y a une rose blanche en plastique posée au-dessus de sa sépulture. Alors on va se diriger sur le caveau qui est juste à côté et là j'ai Germaine Tillion. décédé en 2008 et Pierre Brossolette décédé en 1944 et dans le même caveau j'ai Jean Zé décédé en 44 et Geneviève de Gaulle-Antonioz décédé en 2002. Donc là ces personnes reposent dans le caveau numéro 9. Sérieusement, j'entends un bébé qui vient avec son bébé. Ah, ici, dans le caveau numéro 6, reposent Jean Moulin, André Malraux, René Cassin, Jean Monnet, Simone Veil et Antoine Veil. Il y a du temps, il y a du monde ici. Simone Veil repose au fond, enfin, ouais, c'est totalement au fond, entre Jean Monnet et Malraux. Alors, face à moi, j'ai annoté en lettres d'or hommage de la nation ou juste de France. Sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France dans les années d'occupation, des Lumières par milliers refusèrent de s'étendre, nommées justes parmi les nations ou restées anonymes. Des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes conditions ont sauvé des Juifs, des persécutions antisémites et des camps d'extermination, bravant les risques encourus. Ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Je ne sais absolument pas ce que le son va donner, mais alors absolument pas. Je suis désolée.
Mais bon, en même temps, j'essaie de parler le plus proche du micro possible. Alors, donc, on va continuer parce que je n'étais que sur la droite. On va continuer dans les galeries. C'est magnifique. C'est sobre. C'est... Wow. C'est une crypte, quoi. Voilà. Alors là, je suis dans une nouvelle galerie. De chaque côté de cette galerie, j'ai une sorte de tableau avec des noms. Et c'est à la mémoire des martyrs de la Révolution, tombés en 1830 et 1848 pour la défense de leurs idéaux. Alors, je fais demi-tour et je vais donc sur la droite. Ici, les dignitaires de l'Empire. Ok. Je vais croiser. Le sénateur Cabanis, sénateur Beuvière, général Beguignot, sénateur Tronchet, sénateur Saint-Christophe, pardon. J'ai le compte de Colin Cour ici. Ici, j'ai plein de sénateurs. Dans le caveau numéro 5. Je vais passer à des salons. Ce sont des caveaux. C'est rigolo, il y a des gens qui viennent de dire chut comme ça. Et donc chaque caveau est identique, c'est-à-dire qu'on a la même porte, une porte avec des petites étoiles dorées. On a un emplacement à droite pour deux sépultures, à gauche pour deux sépultures, dans le fond encore deux à droite et deux à gauche, et sur le dessus. En gros ici si je compte, là je suis dans le caveau numéro... alors attendez je vais regarder, parce qu'il n'y a personne. Je suis dans le caveau numéro 4 et ici on peut placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 4, ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut placer 11 corps.
Ici, je suis encore face à des sénateurs, membres du Sénat, conservateurs, commandants de la Légion d'honneur. Donc là, cette personne, c'est Jean-Frédéric Perregaux. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Messieurs, parce qu'ils sont pleins. Alors ici, on a le lieutenant général Frédéric-Henri Walter. colonel des grenadiers à cheval de la garde impériale, grand cordon de la légion d'honneur, commandant de la couronne de fer, né à Oberheim, département du Barin, le 20 août 1000. Et des bananes, voilà, parce que c'est écrit en chiffres romains et que j'étais pas prête. J'ai pas révisé mes chiffres romains, désolée. Mort à son quartier général, etc. Par contre, ce qui me fait sourire un petit peu, c'est que là on a plein de hauts faits. On a le nom et l'heure. par contre on avait Marie Curie et Pierre Curie bien évidemment sans leur haut fait, Josephine Baker sans ses hauts faits. Alors après c'est peut-être une volonté à l'époque parce que ces personnes ici sont décédées plus tôt que Josephine Baker, Simone Veil etc. Mais je pense que c'est une volonté aujourd'hui de ne plus mettre ce que ces personnes ont fait. Parce que pour moi, c'est quand même important, Simone Veil, Marie Curie, Joséphine Baker, de noter. Juste Joséphine Baker, femme de scène résistante, ne s'est même pas gravée dessus. Je pense que c'était plus à l'époque qu'on notait, mais je ne comprends pas pourquoi on les fait rentrer au Panthéon si on ne note pas ce qu'ils ont fait, puisque ça a été fait bien avant. Alors on va continuer. Toujours ici, des généraux. Ah, ici, la lumière est beaucoup plus claire. Des cardinaux, des comtes. Je vous la prends parce qu'elle est... très claire. Je vous la prends en photo parce que là, on peut se rendre compte. Puis en plus, elle est complète. Super. Je vous la prends en photo comme ça, vous vous rendrez compte. Enfin, je dis elle. C'est plutôt le caveau est complet. Il y a encore une galerie. Mais je vais me perdre. Non, ça va. Je ne peux pas y aller. Il y avait un petit escalier mais la porte est fermée. Je pars. Dans le caveau n°26, je vais retrouver Jean Jaurès décédé en 1914, Félix Eboué décédé en 1944, Marc Schoelcher décédé en 1832 et Victor Schoelcher décédé en 1893. Toutes les sépultures se ressemblent, elles sont en pierre, elles sont blanches, le nom est gravé. On est vraiment dans la solennité. Là, j'ai Félix Eboué, secrétaire général de la Martinique de 1932 à 1934, qui se trouve aux côtés de Jean Jaurès. Tout est pareil, en fait. On a vraiment une solennité dans la sépulture. Alors ici, je suis sur le Cénotaphe, je pense de Aimé Césaire, poète, dramaturge, homme politique martiniquais décédé en 2008, député de la Martinique et maire de Fort-de-France, inlassable artisan de la décolonisation, bâtisseur d'une négritude fondée sur l'universalité des droits de l'homme, bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, il a voulu donner au monde, par ses écrits et son action, la force de regarder demain.
Ici, au niveau du caveau 25, je vais rencontrer Louis Braille, décédé en 1852. Et Sophie Berthelot, décédée le 18 mars 1907. Et Marcelin Berthelot, décédé également le 18 mars 1907. Également se trouve à côté le buste de Louis Braille. Ici j'ai la sépulture de Paul Painlevé. Marcelin Berthelot et Sophie Berthelot aussi. En fait, quand je disais que la CRIP, c'était une bibliothèque sur l'histoire, c'est que vous allez dans un caveau, et dans ce caveau, vous allez voir une personne qui a fait l'histoire. Alors, une personne que l'État a choisi, que la République a choisi de faire rentrer au Panthéon. Et en même temps, quelque part, je trouve ça bien pour l'histoire. Mais il y a toujours un mais. C'est bien pour l'histoire, mais il ne faut pas oublier ces autres personnes qui ne sont pas au Panthéon, mais qui ont eu des hauts faits et des grandes réalisations dans leur vie. Pas où est ma Micheline. J'ai des petites réflexions comme ça. Alors ici, je vais dans un caveau très important. celui de Victor Hugo, Alexandre Dumas et Émile Zola, qui se trouve dans le caveau 24. Vous vous rappelez à Montmartre, je vous avais dit que les cendres d'Émile Zola étaient au Panthéon ? Ben, elles sont à côté de moi ! Alors la grande question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des corps à l'intérieur ? C'est une bonne question, n'est-ce pas ? Est-ce que là, dans les caveaux, dans lesquels, enfin juste à côté de moi, est-ce qu'il y a vraiment les cendres d’Emile Zola ? Est-ce qu'il y a le corps de Victor Hugo à côté de moi ? J'ai envie de vous dire, je deep-diverai plus tard, puisque pas aller au bout de mes recherches. Non, non, mais voilà, c'est une question aussi là que je me pose. Alors ici, j'ai Lazare Carnot, Marceau, la Tour d'Auvergne. Ouh là là, mais c'est bien chargé là-dedans. putain, Sadie Carnot, Baudin, Jean-Baptiste mon dieu Quand je dis c'est bien chargé, vous allez voir. Je vais vous prendre la photo. On est sur de la grosse décoration, les enfants. sur de l'hommage. Alors on ne peut pas y rentrer parce que forcément il y a pléthore de trucs à l'intérieur, mais je vous filme ça. Marie-François-Sadie Carnot. Ah bah oui, mais président de la République française aussi, tu m'étonnes qu'il y ait énormément de choses là. Ici j'ai le maréchal Lannès, duc de Montebello. Et on ne peut pas rentrer à l'intérieur bien évidemment, puisqu'on a également de la décoration, des drapeaux français. Et cette personne se trouve dans le caveau numéro 22. Alors, Jean Lannes, maréchal de France, duc de Montebello, prince de Sievert. Il est décédé en 1809 en Autriche. Il est entré au Panthéon le 6 juillet 1810. Il est devenu général de division en 1799 lors de la campagne d'Egypte. Il faut savoir aussi que lorsque vous allez vous balader dans la crypte, devant chaque... Alors, en plus d'avoir l'audio guide, devant chaque caveau... Vous avez un panneau interactif en plusieurs langues qui vous raconte très brièvement l'histoire de la personne, qui elle était et à quel moment elle est rentrée au Panthéon. Bah j'ai fait le tour, je crois ! Pardon. Vous m'entendez dire pardon parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui veulent passer, etc. Ensuite, il y a moi avec mes photos. J'ai toujours peur d'embêter les gens, en fait. Je crois que j'ai fait le tour, en fait. Bah voilà Micheline, j'ai fini, j'ai fait le tour de la cripe, vous êtes un peu frais. Mes impressions avant de vous faire la conclusion, avant qu'on se quitte, etc. Mon impression est que c'est magnifique, c'est grandiose, c'est superbe. Il y a toujours cette petite controverse de qui on fait rentrer et qui on ne fait pas rentrer au Panthéon. Mais au-delà de ça, au-delà du côté féministe de la chose et au-delà de tout ça... C'est magnifique, c'est un très bel endroit de mémoire, un très beau lieu de mémoire. Ce n'est pas émouvant parce que tout est sobre.
Comme je vous le disais, tous les caveaux sont identiques, on est dans de la pierre, etc. C'est juste émouvant de voir des femmes, c'est mon côté aussi à moi, et même des hommes aussi, comme Victor Hugo, etc. De se dire que ces grands hommes sont là, alors il y a des cénotaphes, etc. bien évidemment, mais qu'ils sont là face à moi, qu'ils ont fait de grandes choses et que c'est accessible. juste pour se souvenir et avoir une culture générale, d'où l'utilité du Panthéon aussi, de le faire visiter. Donc là, je pense que je vais rejoindre... Ouais, voilà, là, je rejoins la Nef. J'eus pensé qu'il y eut plus de monde ici, mais ça va, il n'y a pas énormément de monde non plus.
On arrive à la fin de la visite et je me rends compte que ce monument, c'est pas juste un bâtiment monumental au sommet de la montagne Sainte-Geneviève. C'est un condensé de mémoire nationale, de choix politiques, certes, et d'histoires personnelles. Chaque nom gravé ici, c'est le résultat d'une décision. Et chaque nom absent aussi raconte quelque chose de notre rapport à l'histoire. Quand on visite la crypte, qu'on lit les plaques, qu'on se rappelle ce que chacune de ces personnes a accompli, on ne peut pas s'empêcher de se demander qui mériterait d'être là demain. Quel combat mené aujourd'hui mériteront un jour d'être honorés ici ? Et c'est peut-être ça la vraie force du Panthéon. Nous pousser à réfléchir à ce que la République considère comme essentiel et à ce que nous, vivants, on veut transmettre aux générations futures. Et en même temps, là, je vais sortir de mon script, parce que ça m'interroge moi, en fait. Est-ce qu'il y a une mort qui vaut plus que les autres ? Est-ce qu'il y a une vie même qui vaut plus que les autres dans ces réalisations ? Après, effectivement, on est sur un lieu de représentation, un lieu de choix, par des personnes qui nous gouvernent, etc. Mais voilà, est-ce qu'il y a des vies qui valent plus que les autres ?
J'espère que cet épisode spécial consacré au Panthéon vous a plu et qu'il vous a donné envie de pousser, vous aussi, les portes de ce monument unique. Le Panthéon n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural, c'est un livre d'histoire à ciel fermé où chaque nom gravé raconte un combat, une idée ou un rêve de république. On peut y admirer des figures universelles, s'émouvoir devant la simplicité d'un caveau, s'interroger sur les absents et repartir avec un autre regard sur ce que la France choisit ou refuse de célébrer.
Avant de nous quitter, je vous rappelle que tout l'été, je complète chaque épisode avec des photos sur mes stories permanentes Instagram, notamment ici des photos de la nef et de la crypte. Rendez-vous sur mon compte Instagram pour une visite en images des coulisses de cet épisode. Merci d'avoir écouté Beyond the Veil. J'espère que cette exploration du Panthéon vous donnera envie de relire Hugo ou d'en savoir plus sur sa procession funéraire, de revoir les images de Simone Veil ou de fredonner un air de Joséphine Beka.
La semaine prochaine, on part pour une visite qui n'en est pas une. Allez, je vous le dis. On va rencontrer Camille Paix, l'auteur de Mère Lachaise, qui nous parlera de l'importance du matrimoine funéraire. Et puis, allez, je vous donne simplement le dernier épisode de l'été. Retenez la dame, le 27 août, je vous emmènerai explorer le Père Lachaise. Bah ouais, j'allais pas vous laisser sur votre faim. Allez, à tout vite !
Bloopers : Ah, j'ai les Avengers. Je déconne pas, c'est noté. C'est une oeuvre de Ernest Desbois qui a été réalisée entre 1910 et 1926. Ah merde, je suis pas bien moi dans ma tête. Mais bon, c'est les Avengers, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est noté. Alors en français c'est Le Vengeur.