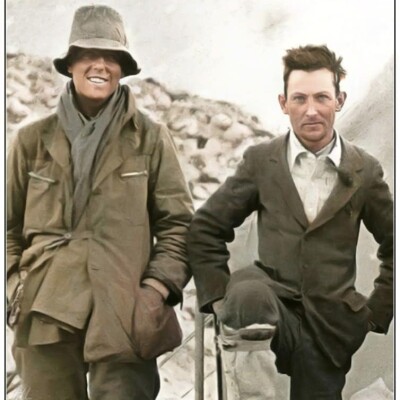Speaker #0Cette histoire ne commence pas dans un livre. Elle commence dans ces gorges étroites, où le vent s'engouffre comme un souffle ancien, où les clochers se dressent comme des paratonnerres plantés dans la brume, et où les rumeurs se propagent plus vite que la neige de février. Morzine, au XIXe siècle, n'a rien du village carte postale qu'on vante aujourd'hui aux touristes venus chercher le chalet idéal. C'est un lieu... austère, lové dans une cuvette où les hivers durent trop longtemps et où les ombres descendent plus vite que le soleil. Le bois travaille, les bêtes respirent, les cheminées fument, et dans cet écosystème de pierres et de silence, chaque cri porte loin. C'est là qu'entre 1857 et 1870, un mal étrange s'insinue dans les corps. D'abord comme un frisson, puis comme une fièvre, enfin comme une épidémie de hurlements. Un phénomène si inquiétant que les journaux s'en emparent, que l'État dépêche des médecins et que l'Église aiguise ses exorcismes. On ne sait pas encore si l'histoire que vous allez entendre appartient à la théologie, à la psychiatrie moderne ou au répertoire du fantastique rural. Ce que l'on sait, en revanche... c'est qu'elle a laissé suffisamment de rapports, de procès-verbaux et de notes médicales pour enterre encore aujourd'hui les archives savoyardes. C'est à elle que tout remonte. Perronne, la première à tomber, la première à convulser, la première à ouvrir la brèche. Les archives la nomment Perronne Tavernier, une adolescente du village, élève appliquée, d'une piété exemplaire, disent les rapports religieux. Elle n'a rien d'une figure sulfureuse, ni rebelle, ni trouble, ni fragile en apparence. Une jeune fille ordinaire, brodant, priant, avançant dans la vie avec le sérieux des montagnes. Et pourtant, c'est sur elle que la foudre tombe. Un matin de 1857, la classe vient de commencer. La sœur a rangé les encriers. Les doigts sont bleuillis, la rumeur du poil gronde. Perronne baisse la tête sur son cahier, puis s'arrête et se met à trembler. Ce n'est pas un frisson, c'est une onde. Quelque chose la traverse de part en part, comme si son corps refusait soudain la gravité. Elle se rédit, se lève d'un bloc, pousse un cri déchiré qui ne ressemble à aucune voix qu'on lui connaissait. La sœur croit à une crise de nerfs. Les élèves reculent, terrifiés. Mais le corps de Perronne se tord comme si une force l'arrachait en arrière. Ses mains se crispent, ses yeux roulent, sa voix sort brisée. Et ce qu'elle articule n'est ni du français, ni du patois savoyard, mais une sorte de grondement guttural, un cri ancien, presque animal. Les témoins parleront plus tard d'une grimace qui n'était plus la sienne, d'une voix prête à l'insulte, alors même qu'elle n'avait jamais prononcé un mot déplacé. Quand la crise s'apaise, elle retombe, pâle et à garde, et ne se rappelle de rien. La seconde crise survient quelques heures plus tard, au presbytère, où l'on a amené la jeune fille pour la bénir. Ce geste simple consiste à l'asperger d'eau bénite. Mais au premier contact, Perronne hurle, se cogne contre la table, se débat avec une violence qu'on ne lui connaissait pas. Le prêtre note, elle semblait animée d'une force supérieure à la sienne. Un commentaire que les médecins reprendront, mais en l'expliquant autrement. « La possession, disent les villageois. La maladie, diront plus tard les psychiatres. » Mais pour l'heure, Perron devient la porte d'entrée du phénomène. Les journées suivantes, d'autres adolescentes, ses camarades ou ses amis, développent des symptômes identiques. Le chef médical insiste sur ce point. C'est le cas de Perron, qui est le déclencheur observable de la vague. On ne sait pas ce qu'elle ressent vraiment. Aucune note personnelle, aucun témoignage direct ne nous est parvenu. On ne connaît Perron qu'à travers les regards qui la surplombent. Le prêtre voit Satan. Le médecin, lui, voit un foyer hystérique. Sa famille voit en elle une enfant perdue. Le village y voit un signe. Mais pourquoi Perron ? Les historiens modernes émettent plusieurs hypothèses telles que celle d'un choc émotionnel initial, non documenté mais fréquent dans les cas d'hystérie au XIXe siècle, ou d'une pression religieuse forte dans une communauté où la faute et la peur de l'enfer sont omniprésentes. Ils évoquent encore le rôle de modèle social, dans lequel la première crise devient une sorte de script involontaire pour les suivantes. La position de Perron dans le groupe, probablement appréciée, visible, centrale parmi les jeunes filles, est idéale pour catalyser un phénomène de suggestion. Rien ne permet de trancher, mais tout laisse penser qu'elle n'a pas choisi ce rôle. Par la suite, la jeune fille disparaît derrière le mythe, absorbée dans la masse des possédés. Elle n'est plus la première, mais l'une d'entre elles. Son identité se dissout dans le récit collectif, comme si le village avait besoin d'une figure inaugurale, mais pas d'un individu. Elle devient l'étincelle oubliée d'un incendie qui la dépasse. Les médecins la mentionnent encore dans leur rapport de 1861, mais comme un cas parmi d'autres. Les prêtres l'évoquent comme « celle par qui le malin s'est introduit » . Les historiens la reconnaissent comme un pivot du dossier. Mais sa voix reste absente. Perronne Tavernier n'a jamais raconté son histoire. Ce que nous savons d'elle, c'est ce que les autres ont projeté sur son corps tremblant, les peurs, les dogmes, les diagnostics et les fantasmes d'une époque. Elle est le premier cri de Morzine, et peut-être la première victime de ce que le village ne savait pas dire autrement. Le mal se répand, d'abord les élèves, puis des jeunes femmes, puis des mères de famille. Les médecins en comptent plusieurs dizaines, puis plus d'une centaine au cours de 1861. Le mâle n'a pas seulement gagné du terrain, il s'est faufilé, insidieux, d'une maison à l'autre, comme si l'air lui-même était devenu conducteur. Au début, on parle d'attaque. C'est le mot que les sœurs emploient, celui que les mères répètent en chuchotant. Puis très vite, On parle d'un vent de folie, d'un souffle sombre qui ferait tournoyer les âmes comme des feuilles mortes. Les premières jeunes filles atteintes ne retrouvent pas la paix. On les voit chanceler dans les rues du village, heurtées d'un spasme soudain, la tête rejetée en arrière, les doigts crispés comme des cerfs. Certaines poussent des cris rauques, d'autres murmurent entre leurs dents serrées des mots qu'elles disent ne pas comprendre. Plus tard... Les médecins noteront ceci. Glossolalie partielle, fragments de latin déformés et patois méconnaissables. Pourtant, les gens du village, eux, n'entendent que le langage du démon. Et ce qui n'était qu'un murmure devient bientôt un vacarme. Car les crises se multiplient, dans les maisons, dans les champs, au pied des chapelles. Certaines femmes, jeunes surtout, se roulent au sol avec une violence qu'aucun homme ne parvient à contenir. D'autres, soudain figées, livrent un regard fixe, glacial, comme si elles regardaient quelque chose derrière vous, quelque chose que vous ne verrez jamais. Et puis il y a les paroles, les plus dérangeantes, les plus inattendues. On ne rit plus, on ne se rassure plus, on se signe. Les filles atteintes se parlent entre elles. parfois même sans se regarder, comme si leurs mots traversaient la pièce avant d'être prononcés. Une crise dans une maison, semblant déclencher une autre dans la maison voisine. Les nuits deviennent un théâtre de convulsions, hurlements, chutes lourdes, objets renversés, prières hachées. Les hommes n'osent plus sortir sans raison. Les femmes montent la garde près des portes, comme si un prédateur rôdait dans l'obscurité. À ce moment-là, on compte déjà plus de 80 femmes touchées. Deux ans plus tard, Plus d'une centaine, le phénomène a dépassé la simple rumeur. Chaque souffle, chaque cri, chaque geste enflamme le suivant. Et dans l'air froid des montagnes, quelque chose circule. Pas un démon, mais un vestige collectif, un élan incontrôlable qui transforme la peur en spectacle et le spectacle en certitude. Car ici, à Morzine, en 1861, la contagion n'a pas été éliminée. pas besoin de microbes pour se propager. Il suffit d'un regard, d'un nom murmuré, d'un silence trop long. Le village n'a jamais été un lieu bruyant, mais à partir de 1861, le silence s'y brise comme une vitre. Le village se réveille plusieurs fois par nuit, au son des cris guturaux, animaux presque, de celles qu'on appelle les possédés. Les maisons deviennent des îlots étroits où l'on se calefeutre. On ferme les volets en plein jour, on laisse les lampes allumées la nuit. Et quand une crise éclate dans une maison, on entend les voisins retenir leur souffle, comme si le mal risquait d'accourir depuis l'autre côté de la rue. Les familles vivent dans la terreur de voir le mal franchir leur seuil. Les mères surveillent leurs filles comme on surveille une braise prête à s'embraser. Des enfants racontent avoir vu des silhouettes se tordre derrière les rideaux. D'autres... jurent avoir entendu des voix alors qu'il n'y avait personne dehors. Les prêtres, eux, se retrouvent submergés. Chaque maison devient un confessionnal, chaque confession une implosion de peur. Le curé Magnin, qu'on disait solide comme un roc de la vallée, note dans ses lettres que les femmes tombent en attaque à la simple vue d'un crucifix et qu'il suffit parfois d'une prière pour déclencher une nouvelle convulsion. On l'appelle des dizaines de fois dans une même journée. Il n'a pas le temps de finir ses laudes, il mange froid et dort peu. La rumeur enfle, gonfle et s'étire comme une peau trop tirée. On commence à accuser tout le monde et n'importe qui. D'abord les familles dites faibles, puis celles trop pieuses, ou pas assez, les voisins, les étrangers et même les morts, parce que les possédés continuent d'être attirés vers le cimetière. Et il y a ces traces, que l'on découvre parfois au matin sur les tombes, du gravier déplacé par des soubresauts, des cierges renversées, et parfois des mots obscènes tracés à la craie ou griffonnés avec un caillou sur les pierres tombales fraîchement nettoyées. Des insultes contre les prêtres, contre Dieu, contre les défunts. Le village entier est en tension. Une tension qui, d'après les autorités, pourrait même conduire à la violence physique si rien n'est fait. Ce n'est plus seulement une crise, c'est une crise sociale totale. Quand les premiers médecins arrivent, ils sont accueillis comme des étrangers venus d'un autre monde. Un monde où la science a remplacé les seins, où les maladies ont des noms latins plutôt que des visages cornus. Le docteur Berthier, envoyé dans le cadre des premières investigations officielles, observe avec prudence. Il note, mesure, questionne. Il ne comprend pas tout, mais il comprend une chose, ce phénomène n'est pas isolé. Les crises surviennent par grappes, comme si les corps se répondaient. Les mots prononcés, tels que les insultes ou les phrases incohérentes, reviennent d'une femme à l'autre. Les gestes, comme arquer le dos, frapper son propre torse ou se tordre les mains, se répètent à l'identique. Pour lui, ce n'est pas une possession, c'est une suggestion psychique. Une suggestion devenue si puissante qu'elle agit comme un signal nerveux collectif. Puis vient une deuxième vague d'experts, dont l'alieniste Constant, qui parle ouvertement de démonomanie épidémique, un terme alors utilisé pour décrire des phénomènes de délire partagé où les croyances religieuses amplifient les symptômes physiques. Mais le village ne veut pas entendre ce mot. Pour Morzine, c'est simple, c'est le démon. Point final. Les médecins examinent les jeunes filles pendant leur crise, et ce qu'ils voient est suffisamment spectaculaire pour troubler même des hommes habitués aux salles d'hospice. Corps glacé au toucher, souffle rapide, regard perdu, voix modifiée. Le docteur Constant mentionne que certaines malades, en plein accès, semblent insensibles à la douleur, un phénomène cohérent avec des crises hystériques profondes. Les médecins concluent à une forme d'hystérie collective, renforcée par la peur, l'isolement, les conflits, les croyances et les tensions sociales. Mais cette conclusion ne change rien sur le terrain. Les gens continuent de courir chercher le curé, et les possédés continuent d'appeler le diable par son nom. Face à l'emballement général, l'Église doit agir. Mais elle agit comme on se bat contre un feu incontrôlable, tard, vite et parfois maladroitement. Le curé magnin, d'abord seul, tente d'organiser les prières. Il impose des rosaires, multiplient les bénédictions, mais ils se heurtent à une réalité inconfortable. Ces interventions aggravent parfois les crises. Plusieurs témoins rapportent que certaines jeunes filles entrent en convulsion dès qu'ils franchissent le seuil. Comme si elles réagissaient non à l'homme, mais à l'autorité qu'ils portent. Des exorcismes privés sont tentés, discrètement d'abord, puis de plus en plus ouvertement. Certains apaisent temporairement les malades. D'autres... déclenchent des scènes d'une violence inouïe. Insultes hurlées à l'oreille du prêtre, gestes obscènes dirigés vers le crucifix, tentatives de fuir l'église à quatre pattes ou profanations verbales des sacrements. Les curés écrivent à l'évêché, suppliant. L'évêché hésite, le Vatican observe. Les autorités religieuses redoutent d'un précédent. Une épidémie de possession en Savoie, annexée depuis peu, politiquement, c'est explosif. Spirituellement, c'est un gouffre. Alors, l'Église temporise, analyse, évalue. Mais elle ne peut plus nier l'évidence. Son imprise ne suffit plus à contenir la crise. Les prêtres du village, à bout de force, reconnaissent que l'exorcisme ne peut pas être l'unique réponse. Et peu à peu, la place du sacré se réduit, laissant entrer un autre acteur, l'État. Car l'Église se retrouve dans une position paradoxale. Elle est à la fois l'un des moteurs de la psychose collective par la peur du démon et l'un des rares remparts que les villageois acceptent. Elle ne peut pas reculer, mais elle ne peut plus avancer. Le clergé finit par reconnaître une impuissance relative. C'est écrit noir sur blanc dans une correspondance de 1862. Jamais une phrase n'a autant résonné dans les montagnes. On ne peut pas comprendre Morzine sans comprendre les femmes de Morzine. Elles sont au cœur de tout, de la maison, du village et de la foi. Et pourtant, elles n'ont presque pas de place, pas de voix, pas non plus d'espace pour dire leur peur, leur colère, leur désir. À l'époque, une fille de Morzine, c'est une travailleuse infatigable. Elle coud, traie les bêtes, veille les plus jeunes, prie et surtout s'efface. Le moindre écart, social ou moral, peut faire l'objet de comérages pendant dix ans. Dans ce monde-là, leur corps ne leur appartient pas vraiment. Il appartient à la famille, à la communauté ou encore à Dieu. Alors quand ce corps explose en convulsions, en cris, en gestes interdits, c'est comme si quelque chose d'enseveli depuis longtemps brisait la coque trop serrée du quotidien. Les médecins de l'époque, malgré leurs biais, Note une chose juste, les premières possédées sont majoritairement des adolescentes et des jeunes femmes isolées, vivant sous forte pression religieuse ou familiale. Certaines étaient déjà sujettes à des malaises, d'autres étaient trop pieuses, trop ponctueuses, trop recluses. D'autres encore avaient perdu un parent ou vivaient dans la peur permanente du péché. Des terrains fragiles, des vies sous tension. À Morzine Une étincelle a suffi pour embraser tout un pan de la société. Dans ces crises soudaines, ces paroles obscènes, ces profanations, les historiens modernes voient parfois une forme d'expression impossible autrement. Une manière involontaire et tragique d'exprimer ce qui ne peut pas être dit. Le poids de la religion, des attentes, du silence. Car dans un village où on attend des femmes qu'elles soient des modèles de pudeur, Voir une jeune fille blasphémée ou hurler des insultes sexuelles, c'est un séisme. Un séisme qui révèle les failles qu'on refusait de regarder. Dans ce petit village, les femmes sont devenues le théâtre vivant d'un conflit plus vaste. Un conflit entre tradition et modernité, entre autorité religieuse et naissance de la psychologie, entre obéissance et étouffement. L'arrivée de l'État dans l'affaire de Morzine est presque un symbole. La France moderne se rend dans les montagnes pour affronter un démon que la République ne reconnaît pas. Nous sommes en 1860. Savoie vient tout juste d'être annexée. La France veut montrer qu'elle contrôle son nouveau territoire et qu'elle y apporte la raison. Alors quand les rapports se multiplient, quand les journaux parlent de femmes possédées, quand les prêtres eux-mêmes demandent de l'aide, le préfet finit par envoyer des gendarmes, puis des médecins militaires, puis des administrateurs. Des hommes venus d'ailleurs. Des hommes qui ne croient pas au diable. Le commandant Léon Besson, chargé d'enquêter, écrit que le phénomène est alimenté par l'ignorance, la terreur religieuse et l'isolement. Il décrit des scènes d'une intensité incroyable, mais il reste froid et méthodique. Pour lui, c'est clair, le mal n'est pas surnaturel, il est social. Et l'État va agir en conséquence. On tente d'interdire certains exorcismes. On impose des restrictions de rassemblement. On encourage les familles à envoyer leurs filles dans des couvents ou des maisons plus calmes. Hors du village, on demande aussi aux prêtres de cesser les discours alarmistes. Pour la première fois, le récit du démon n'est plus le seul récit possible. Les médecins de l'armée commencent à isoler certaines malades. On les sort du village. Et, surprise, hors de morzine, les crises diminuent, parfois jusqu'à disparaître. Le pouvoir civil comprend ce que l'Église refuse encore d'admettre. Le phénomène a besoin du village pour exister. de sa densité, de son regard et de ses tensions. Et peu à peu, sous la surveillance des autorités françaises, le mal commence à reculer, pas d'un coup, mais par vagues, comme une marée qui se retire, lente, lourde, mais inexorable. Il n'y a pas eu de miracle, pas de grand exorcisme final, pas de révélation bouleversante. Le mal de Morzine s'est éteint comme il est venu. par couches, par signes et par silence. Après 1863, le nombre de crises chute. Les filles les plus atteintes sont envoyées dans d'autres communes, dans des couvents, parfois dans des hospices. Certaines guérissent, d'autres rechutent, mais aucune ne déclenche plus de contagion. Les routes nouvelles jouent un rôle majeur. Plus de circulation, plus de visiteurs, plus d'observateurs extérieurs. Et forcément, moins de huis clos et donc moins de rémeurs. Moins de croyances collectives aussi. Les autorités civiles resserrent leur contrôle. Et l'Église baisse d'un ton. Elle parle moins de diable, plus de nervosité, de faiblesse, de maladie de l'esprit. Et puis, un jour, on se rend compte que les nuits sont redevenues silencieuses. Les filles ne sont plus prises de convulsions. au passage des processions. Les pierres tombales restent immobiles, intactes, sans graffiti obscène au matin. Les mères osent de nouveau laisser leurs filles aller seules puiser l'eau à la fontaine. On n'en parle plus vraiment, on ne se l'avoue pas, mais le mal est parti. Vers 1870, il ne reste plus que des souvenirs, des souvenirs lourds et embarrassants que les anciens n'aiment pas évoquer. Parce que le diable, réel ou non, a laissé des traces dans le village, des traces invisibles mais profondes. Dans les histoires que l'on raconte encore à voix basse, dans les archives où les mots « cri » , « blasphème » , « convulsion » et « obscénité » reviennent comme un refrain. Dans la mémoire des montagnes qui n'oublie jamais ce que les hommes préfèrent taire, le mal s'est éteint. Mais Morzine n'a plus jamais été tout à fait pareil. Quand la vague est retombée, Le village n'a pas retrouvé la tranquillité comme on referme une porte. Il a continué de vivre, mais avec un arrière-goût de quelque chose de non résolu. Un murmure dans le bois des maisons, une trace dans les regards. Les archives montrent un village qui s'est débattu entre deux univers. Le monde ancien, pétri de religion, de symboles et de culpabilité, et le monde moderne, celui des médecins, des administrateurs, des routes. Des diagnostics. Morzine, c'est le point de collision entre ces deux mondes. Un choc si puissant qu'il a laissé des cicatrices dans les mémoires. Pendant des décennies, les anciens évitent le sujet. On se contente de dire, c'était le mal, il est passé. Les historiens qui se penchent sur l'affaire un siècle plus tard découvrent un village où la parole s'est longtemps faite rare. Quelques fragments reviennent, ici ou là. Dans les témoignages tardifs, le souvenir d'un père qui avait peur de ses propres filles, D'une mère qui dormait la main sur le chapelet. D'une grand-mère qui jurait avoir vu le regard du démon dans les yeux d'une adolescente qu'elle connaissait depuis toujours. Il reste aussi, dans les archives de l'évêché, des courriers tremblants, des lignes effacées à la hâte, des demandes d'aide restées sans réponse, des descriptions trop précises pour être inventées. Et il reste, surtout, L'idée que ce qui s'est passé à Morzine pourrait se reproduire ailleurs, pas sous la même forme, pas avec les mêmes symboles, mais avec la même mécanique. Car ce n'est pas seulement une affaire d'hystérie, religieuse ou un épisode d'histoire locale. C'est une métaphore vivante, une parabole. Un rappel que l'humain, sous pression, peut créer ses propres monstres. Les possédés hantent encore les archives. Et parfois... Quand on lit ces documents en silence, à la lumière d'une lampe, on se surprend à imaginer les cris qui ont résonné entre ces montagnes, et on comprend pourquoi les habitants ont préféré oublier. Le diable est parti de Morzine pour une raison très simple, la route est arrivée. C'est presque banal, presque anticlimatique. Mais c'est pourtant la clé de toute cette affaire. Dans les années 1860, de nouveaux chemins carrossables relient enfin Morzine au reste du monde. La Savoie annexée est en plein aménagement. Les ingénieurs tracent, creusent, rectifient. Les convois passent, les fonctionnaires arrivent, les médecins reviennent et les gendarmes circulent. Avec cette circulation, c'est l'isolement qui se fissure. Avant, Morzine était un vase clos, un village encerclé par la montagne. Un monde autonome, un écosystème de croyances et de peurs qui tournaient sur lui-même. Les possédés vivaient sous le regard constant du village, celui de la famille, du clergé, des voisins. Un regard qui amplifiait tout. Il transformait un symptôme en spectacle, un spectacle en modèle, un modèle en contagion. La route change tout. Il y a plus de témoins et moins de démons. Les médecins extérieurs observent, décrivent, contestent les récits de possession. Leur seule présence casse le mythe. Leur rapport rationalise ce que l'on pensait irrationnel. Et le monopole de l'Église s'effrite. Avant, le curé était l'unique figure d'autorité. Maintenant, il y a aussi l'État. Et l'État ne croit pas au diable. Les filles sorties du village guérissent. C'est écrit noir sur blanc dans les rapports. Leurs crises s'espacent, s'allègent, disparaissent. La preuve pour les médecins que la maladie est sociale avant d'être physiologique. La rumeur se dissout. Une communauté trop fermée amplifie ses peurs. En s'ouvrant au reste du monde, elle ne peut plus se raconter en boucle ses histoires de démons. Et les crises cessent. Progressivement, mais sûrement. comme une fièvre qui tombe quand l'air se renouvelle. La fin de cette affaire n'est donc pas un miracle, c'est une ouverture, une bouffée d'oxygène, une circulation nouvelle qui empêche la peur de stagner. Quand la route est arrivée, les démons sont partis, ou peut-être ont-ils seulement perdu leur public. Car le mal de Morzine n'était pas un esprit venu d'en bas, c'était un reflet, le reflet d'un village enfermé dans ses murs, dans sa foi. et dans ses peurs. Un reflet qui s'est brisé le jour où les montagnes ont enfin cessé d'être une frontière. On quitte Morzine comme on quitte un lieu où l'on a entendu trop d'histoires pour être sûr de n'en emporter aucune avec soi. Le village, aujourd'hui, n'a plus rien d'un théâtre de cris. Les sapins ne frémissent que sous le vent. Les chalets sentent la résine et la pierre chaude. Les cloches sonnent pour les touristes, pas pour les exorcismes. Et les montagnes, immobiles, majestueuses et indifférentes, semblent ensevelir sous leur silence ce que les habitants ont mis un siècle à oublier. Pourtant, sous cette carte postale, quelque chose demeure, un écho, un tremblement dans la mémoire collective. L'idée qu'ici, un jour, les frontières entre la foi, la peur et la psyché humaine se sont brouillées au point de tout avaler. Les possédés de Morzine ne sont ni des héroïnes, ni des victimes d'un démon, ni des personnages fantastiques. Elles sont les témoins involontaires d'un monde... en transition. Un monde où la religion dominait tout, où les corps des femmes étaient surveillés à la loupe, où l'isolement façonnait le réel et où la science n'avait pas encore gagné. La modernité est entrée par la route dans ce petit village loin de tout. Avec elle sont arrivés les médecins, puis la raison, puis l'apaisement. Et le mal s'est éteint comme une braise privée d'oxygène. Mais ce qui fascine encore aujourd'hui, ce n'est pas la fin. C'est la possibilité que tout cela ait été vrai dans l'esprit de celles qui l'ont vécu. Que les crises aient été réelles, terribles et incontrôlables. Que les insultes, les gestes obscènes, les convulsions aient été, pour elles, aussi puissants qu'une possession authentique. Parce que le démon n'a pas besoin d'exister pour faire trembler un village, il suffit qu'on y croit. Et Morzine y a cru si fort qu'il a fini par prendre corps dans les cris de ses filles. Quand on referme les archives, on se rend compte que cette affaire n'est pas une histoire de démon. C'est une histoire humaine, une histoire de peur, de foi, d'isolement, de corps qui parlent à la place démon. Une histoire de montagne aussi, de ces lieux où les ombres tombent vite et où les rumeurs n'ont jamais besoin de route pour se propager. Et peut-être est-ce pour cela qu'elle nous hante encore, parce que, dans le fond, Morzine nous rappelle une vérité dérangeante. Ce que nous croyons peut parfois devenir plus réel que ce qui est. La neige recouvre les pierres tombales, le vent recoule au silence, et quelque part, sous les strates du temps, les cris se dissipent enfin, mais ils ne disparaissent jamais tout à fait. Il reste là, comme un souffle ancien, déposé dans les gorges étroites des montagnes, en attente de celui qui voudra bien les écouter. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire du Pire, et d'ici là, gardez la tête froide !