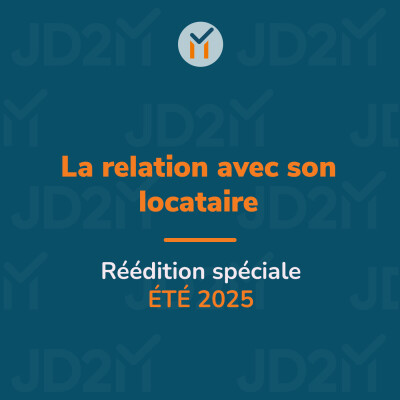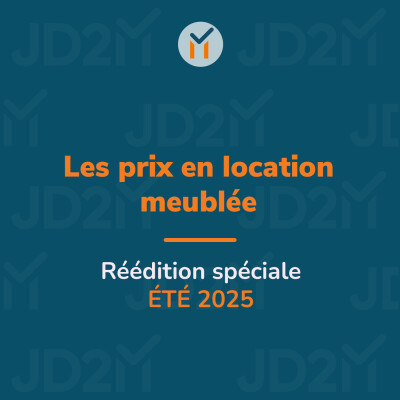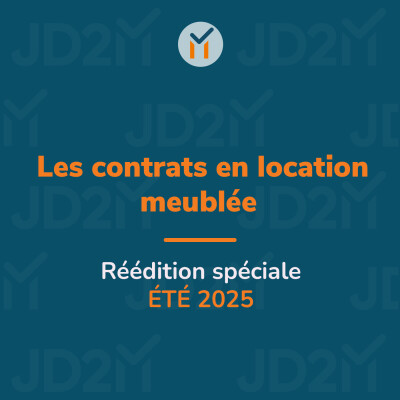Speaker #0Pendant le mois d'août, le podcast « Je découvre le monde du meublé » prend une pause et, à cette occasion, vous propose de découvrir ou redécouvrir certaines de nos séries de podcasts les plus écoutées, rééditées en version longue pour une écoute plus fluide, afin que vous puissiez profiter de l'été pour continuer à en apprendre davantage sur le monde de la location meublée. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un point central de l'activité de location meublée qui s'avère souvent à l'origine de nombreuses interrogations, celle de la relation entre propriétaire et locataire. Contenu du contrat, obligations respectives, charges et loyers ou encore entrées et sorties des lieux, suivez-nous dans cette succession d'épisodes qui vous accompagneront tout au long de votre expérience de location. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvelle série consacrée au monde de la location meublée. Série qui aura pour thème la relation avec son locataire. Point central de l'activité de location, les échanges entre bailleurs et locataires peuvent parfois être source de difficultés ou de crispations. Et si la communication et la bonne intelligence sont des clés de communication qui sont toujours à privilégier, être bien informé de ses droits est souvent également d'une aide précieuse afin de mieux encadrer et donc de vivre plus sereinement les interactions avec vos locataires. Et afin de vous aider dans ces moments parfois délicats, nous traiterons, tout au long de cette série, de différents points d'attention qu'il peut être utile de garder à l'esprit dans le cadre de vos échanges avec vos locataires pendant toute la durée du contrat de location. Pour débuter cette série, notre premier épisode se portera donc sur un procédé qui marque le début de la relation entre un bailleur et son locataire, à savoir la recherche de ce dernier et l'établissement d'un contrat de bail. Pour rechercher un locataire, tout bailleur est libre d'utiliser le moyen qui lui paraît le plus approprié. En la matière, il existe trois possibilités, à savoir utiliser votre réseau de connaissances, passer par un ou plusieurs sites internet ou plateformes de réservation, ou encore avoir recours au service d'une agence immobilière spécialisée dans la location meublée. Bien entendu, en fonction du type de location que vous pratiquez, le vecteur que vous utiliserez pour trouver un locataire s'imposera de lui-même, comme en location saisonnière, pour laquelle il est bien plus probable que vous ayez recours à une plateforme de réservation en ligne qu'aux bouches à oreilles, qui montrerait rapidement certaines limites si vous souhaitez louer régulièrement votre bien. De plus, chaque option dispose de ses avantages et de ses inconvénients. Qu'il s'agisse du coût de l'opération ou des désagréments qui peuvent émerger d'une certaine situation. En effet, il pourrait par exemple être délicat de refuser une demande de location d'une connaissance plus ou moins éloignée, faute de garantie financière. Et puisqu'il en est question, parlons maintenant des critères de choix d'un locataire. Critères qui sont extrêmement importants dans le cadre d'une location de longue durée. En premier lieu, il est important de rappeler que vous avez tout loisir d'accepter ou de refuser un locataire Merci. tant que les critères que vous retenez pour faire votre choix sont des critères objectifs et ne sont pas motivés par des préjugés qui vous conduiraient à discriminer un candidat au sens de l'article 225-1 du Code pénal. C'est la raison pour laquelle il est préférable de prendre en compte des éléments tels que la solvabilité du candidat locataire et de son éventuelle caution, ce qui nous amène à évoquer les éléments que vous êtes en droit de demander à votre futur locataire afin d'attester de ses ressources. Pour parer à certains abus, La mention d'une liste limitative des pièces qu'un bailleur est en droit de demander à son locataire a été intégrée à la loi du 6 juillet 1989 par la loi Allure du 24 mars 2014, la liste étant elle-même ensuite précisée par décret. En la matière, il est donc opportun de se référer au texte du décret du 5 novembre 2015 et à ses annexes. Les pièces exigibles permettent ainsi d'attester de l'identité du locataire, de sa domiciliation actuelle, de son activité professionnelle, et de ses ressources. A ce titre, il peut être intéressant de penser à vous prémunir d'éventuelles fraudes réalisées à l'aide de faux documents. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Direction Générale des Finances Publiques qui met à disposition des usagers un outil permettant de vérifier l'authenticité de l'avis d'imposition fourni en saisissant simplement le numéro fiscal et la référence de l'avis d'imposition du candidat ou de sa caution. Notez bien que si les pièces demandées peuvent être des copies des documents originaux, Aux besoins traduits en français et les montants convertis en euros, vous avez le droit de demander au Codila de vous présenter les pièces originales sans toutefois pouvoir les conserver. Bien évidemment, l'ensemble de ces dispositions ne valent que dans le cas d'une location meublée à titre de résidence principale ou pour un bail mobilité. Il est fortement conseillé de s'y tenir dans ces situations afin de respecter votre futur locataire et donc de favoriser une bonne relation contractuelle. Une fois votre locataire choisi, vous devrez encore vous confronter à l'étape de la rédaction du contrat de location. Il est important de savoir que la rédaction d'un contrat de location est obligatoire, quelle que soit la situation ou le type de location pratiquée. Et si la forme du contrat est libre en location saisonnière ou pour un bail du code civil, ce ne sera pas le cas pour un bail de location en résidence principale, qu'il soit de longue durée ou étudiant, ou pour un bail mobilité. Dans ces situations, le contrat devrait observer un certain formalisme en respectant les dispositions prévues par la loi du 6 juillet 1989. Pour plus de simplicité, il est donc recommandé de consulter l'annexe 2 du décret du 29 mai 2015 qui reproduit un modèle type de contrat de location de logement meublé. Il est également possible d'utiliser un modèle proposé par un spécialiste à condition de bien vérifier que ce dernier est bien à jour des dernières modifications apportées au contrat. au contenu du contrat par le décret du 18 août 2023, modifications qui prennent notamment la forme de précision sur la performance énergétique du logement. Bien que la signature du contrat de bail marque le début de la relation contractuelle, il est judicieux de penser au moment où cette dernière prendra fin et donc d'ajouter au contrat une clause de dépôt de garantie. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, elle vous permet de vous prémunir contre les risques de dégradation et d'impayé qui pourraient résulter de l'occupation des lieux par votre locataire. Attention toutefois, à bien respecter les conditions, à savoir que son montant ne peut dépasser celui de deux mois de loyer hors charge et ne peut être modifié pendant toute l'exécution du contrat, mais aussi qu'au départ du locataire, le délai pour restituer le dépôt de garantie est de deux mois et passe à un mois si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. En cas de retenue, il sera d'ailleurs capital de conserver les preuves des dégradations, comme l'état des lieux de sortie, mais également de fournir à votre locataire les documents justifiant des montants retenus qui peuvent être des factures ou uniquement des devis. Cela ne vaut toutefois que pour les baux de longue durée, car en cas de bail mobilité, le bailleur a l'interdiction de demander le versement d'un dépôt de garantie, cette interdiction devant par ailleurs être rappelée par écrit dans le bail. A ce sujet, il est vivement conseillé d'encaisser le chèque du dépôt de garantie, car ce dernier pourrait ne plus être encaissable passé un certain délai, mais également afin de vérifier que la provision sur le compte est suffisante. Il arrive parfois que les locataires ne voient pas d'un très bon oeil le fait d'encaisser le dépôt de garantie. C'est la raison pour laquelle il est important de bien communiquer avec eux, mais aussi de leur remettre un document attestant que vous avez bien reçu le dépôt, ce qui permet de mettre en place un climat de confiance mutuelle. En somme, et ce à défaut de connaître votre locataire au préalable, ce qui est plutôt rare en pratique, les premières étapes de la relation contractuelle seront déterminantes pour assurer une bonne relation avec votre locataire et installer une confiance réciproque. Et pour cela... le meilleur moyen est d'agir strictement en fonction des dispositions de la loi, car cela permet d'expliquer facilement vos actions et vos demandes au locataire, et de garantir à ce dernier que vous ne faites qu'agir sur la base du droit applicable, tout en vous protégeant. Le premier épisode de notre série consacré à la recherche d'un locataire et à l'établissement du contrat de bail touche à sa fin. Dans le prochain épisode de notre série, nous aurons l'occasion de nous concentrer sur un autre moment clé de la relation avec son locataire, à savoir l'entrée dans les lieux et le cas particulier du refus des meubles. afin que vous puissiez tout savoir de cette situation et ainsi la gérer au mieux si elle devait se présenter à vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série consacrée à la relation avec son locataire. Aujourd'hui, nous aborderons le moment de l'entrée dans les lieux du locataire et plus particulièrement tout ce qu'il convient de savoir sur l'état des lieux ainsi que sur le cas particulier du refus des meubles. Vous le savez sûrement, il existe deux catégories d'équipements en location meublée. D'une part, les 11 équipements obligatoires, dont la liste a été fixée par le décret du 31 juillet 2015 et dont la présence permet au logement d'être considéré comme meublé au regard de la définition posée par la loi Allure et ajoutée à la loi du 6 juillet 1989, et d'autre part, les équipements que l'on peut qualifier d'optionnels ou de facultatifs, allant du lave-vaisselle à la machine à café, et dont le rôle est d'apporter des services ou du confort supplémentaire aux locataires. Leur présence, si elle n'est pas obligatoire, permet bien souvent de renforcer l'attrait du bien, Et cela a plus forte raison en location saisonnière ou encore de demander un prix de location plus élevé, tout en veillant à ce que ce dernier ne dépasse pas l'éventuelle règle de plafonnement des loyers qui pourrait être en vigueur dans la commune dans le cas d'un bail meublé en résidence principale. Quoi qu'il en soit, ces équipements doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lors de l'entrée dans les lieux d'un nouveau locataire, car ils seront au centre de deux documents extrêmement importants lors de la conclusion d'un bail de résidence principale, l'état des lieux d'entrée et l'inventaire des objets et équipements du logement. L'état des lieux d'entrée et l'inventaire du mobilier et des équipements sont deux documents qu'il est obligatoire d'annexer à un contrat de location meublée. Ils ont pur but de protéger à la fois le propriétaire et le locataire en attestant de la présence des équipements et de leur état et en permettant de prouver toute dégradation ou disparition d'équipements pendant la période de location. Pour un bail de location en résidence principale ou pour un bail mobilité, l'état des lieux doit être établi conformément aux exigences posées par le décret du 30 mars 2016, tandis que dans les autres cas, sa forme est libre. L'état des lieux doit par exemple être réalisé en début de location, idéalement au moment de la remise des clés au locataire et avant qu'il n'installe ses affaires personnelles dans le logement. Il sera ensuite à nouveau réalisé dans les mêmes conditions lorsque le locataire rendra les clés, étape dont nous parlerons dans un prochain épisode. De plus, l'état des lieux doit être établi par écrit, sur support papier ou électronique, de manière contradictoire, et donc en présence du bailleur et du locataire ou de leur mandataire s'il y a lieu, ce qui peut souvent être le cas pour les bailleurs ayant recours au service d'une agence immobilière par exemple. Il devra ensuite être daté et signé par toutes les parties. Un exemplaire. devra par ailleurs être remis en main propre ou par voie dématérialisée à chaque cotitulaire du bail. Enfin, l'état des lieux doit prendre soit la forme d'un document unique sur lequel il sera possible d'inscrire à la fois l'état des lieux lors de l'entrée et de la sortie, soit la forme de deux documents distincts mais faisant l'objet d'une présentation similaire. Par ailleurs, il est important de savoir qu'une fois l'état des lieux établi, le locataire dispose d'un délai de 10 jours à compter de sa réalisation pour demander à le faire compléter. Il pourra également demander à faire compléter l'état des éléments de chauffage jusqu'à l'expiration du premier mois de la période de chauffe. En cas de refus de votre part, il lui sera possible de saisir la commission départementale de conciliation ou CDC qui interviendra gratuitement pour tenter de trouver une solution aux litiges vous opposant. En parallèle de l'état des lieux, un inventaire des meubles et objets loués devra également être annexé au contrat. Ce dernier devra lister l'ensemble des équipements présents dans le logement ainsi qu'éventuellement leur état et leur coût. Cet inventaire permet notamment de prouver que les équipements obligatoires nécessaires à la qualification de meublé étaient bien présents dans le logement lors de l'entrée dans les lieux du locataire. Attention, il est également très important de savoir que le propriétaire a l'obligation de remplacer tout équipement défectueux présent dans le logement, même s'il ne s'agit pas d'un équipement obligatoire, et à condition bien sûr que ce ne soit pas le locataire qui soit à l'origine de l'avarie. Autrement dit, tout équipement mentionné sur l'inventaire devra être remplacé s'il s'avère défectueux. Si vous ne souhaitez pas être tenu de remplacer certains équipements facultatifs, notamment s'il s'agit d'équipements d'occasion, vous pouvez choisir de ne pas les mentionner dans l'inventaire des équipements. Mais dans ce cas, vous ne pourrez pas non plus vous en prévaloir et en demander le remplacement à votre locataire lorsqu'il sortira des lieux. À ce sujet, la meilleure option étant certainement d'en discuter avec votre locataire. En matière de coût, le fait de passer par un mandataire pour établir l'état des lieux entraîne souvent une facturation de la part de ces derniers. En la matière, C'est l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 qui s'applique. Lorsque l'état des lieux est réalisé par un mandataire, les honoraires peuvent être partagés entre le bailleur et le locataire. Toutefois, des limites s'appliquent quant à la participation qu'il est possible de demander à votre locataire. Ainsi, il ne pourra jamais se voir demander de s'acquitter d'une somme supérieure à celle dont vous vous acquitterez. De plus, le montant que le locataire aura à sa charge ne pourrait être supérieur à un prix équivalent à 3 euros. par mètre carré de surface du logement. Par exemple, pour un logement de 50 mètres carrés, l'état des lieux ne pourra jamais être facturé plus de 150 euros au locataire. Pour un tel logement, si l'état des lieux coûte 200 euros, le locataire n'aura donc que 100 euros au maximum à payer, car il ne peut en aucun cas devoir s'acquitter d'une somme supérieure à celle du bailleur. Et si l'état des lieux coûte 400 euros, sa contribution ne pourra dépasser le plafond de 150 euros, laissant ainsi 250 euros à la charge du propriétaire. Notez bien que l'établissement de l'inventaire des équipements et du logement ne peut donner lieu à aucune facturation supplémentaire auprès du locataire, peu importe la personne, bailleur ou mandataire, qui le réalise. Passons maintenant à la question de savoir comment procéder en cas de refus des meubles par le locataire, situation qui peut se présenter dès l'état des lieux, si par exemple le locataire souhaite amener quelques meubles avec lui, ou au cours du bail. En tant que propriétaire, la première chose à savoir est qu'en principe, votre accord est nécessaire pour effectuer des changements relatifs aux éléments déjà présents dans le bien au moment de sa mise en location. Vous pouvez donc choisir d'accéder ou non à la requête de votre locataire, même s'il est important de noter que, dans les faits, il pourrait vous être difficile de vous rendre effectivement compte de l'éventuel déplacement ou stockage des meubles sans votre consentement. En la matière, et bien que la communication et la bonne intelligence restent à privilégier, empêcher un locataire de remplacer certains meubles n'est donc bien souvent pas possible. Pour autant, garder un certain nombre d'éléments à l'esprit Merci. peut permettre de faire face à cette situation. La première chose à savoir est que le principal risque pour vous est la requalification du bail, qui peut être prononcé par un juge si les équipements et le mobilier présents dans le logement sont insuffisants par rapport aux dispositions légales, ce qui pourrait donc advenir si le locataire retire des meubles ou éléments qui sont compris dans la liste des équipements obligatoires et souligne ensuite leur absence. Pour se garantir contre ce danger, rien de tel que de porter une attention toute particulière lors de l'établissement de l'état des lieux et de l'inventaire. Plus l'inventaire sera précis, et plus il sera difficile pour le locataire de le remettre en cause. D'autant que la qualification de meublé s'apprécie au moment de l'entrée dans les lieux, ce qui signifie, comme l'a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2011, que tout déplacement de meubles survenu postérieurement à l'entrée dans les lieux et sans l'accord du bailleur ne peut remettre en cause cette qualification. Une bonne manière de se garantir pour les bailleurs est également de ne pas procéder eux-mêmes au retrait des meubles et, en aucun cas, de réaliser ce dernier avant d'établir l'état des lieux. et l'inventaire des objets présents dans le logement. À moins bien sûr qu'il ne s'agisse pas d'un élément obligatoire. Dans ce cas, vous êtes libre de prendre la décision qui vous convient le mieux, sans crainte des éventuelles répercussions. Une autre difficulté qui peut naître de cette situation est bien évidemment les dommages qui peuvent être causés aux mobiliers déplacés. En la matière, si vous avez accepté de retirer les meubles et que vous avez procédé à leur extraction et leur stockage, vous ne pourrez tenir le locataire responsable des dommages qu'ils auraient pu subir pendant leur transport. ou leur conservation. A ce titre, sachez que si vous convenez avec le locataire d'enlever certains meubles et que vous acceptez de les stocker à votre charge, le coût engendré par cette opération pourra être déduit comme charge déductible si vous relevez du régime réel d'imposition. Au contraire, si c'est le locataire qui procède lui-même au stockage, tous les frais ou les éventuels dommages seront à sa charge, que vous ayez ou non donné votre accord, et même si les meubles ne sont pas stockés sous sa garde, comme par exemple dans un garde-meubles. Autrement dit, Si vous ne pouvez pas toujours effectivement empêcher un locataire de changer le mobilier, ce dernier devra toutefois, lors de sa sortie, vous restituer l'appartement dans le même état et avec les mêmes équipements que lors de son entrée dans les lieux. Si votre locataire ne parvient pas à le faire, tout élément manquant ou endommagé pourra faire l'objet d'une retenue sur le dépôt de garantie que nous avons abordé ensemble dans le premier épisode de cette série. Comme pour de nombreux points de la relation entre propriétaire, bailleur et locataire, Bien connaître les enjeux de l'état des lieux et les conséquences d'un éventuel refus des meubles peuvent, en plus d'une bonne communication, largement vous aider à éviter les erreurs ou tout simplement à expliquer la situation et votre éventuel refus à vos futurs locataires. Nous espérons que cet épisode vous aura ainsi donné toutes les clés pour aborder sereinement cette situation. Bonjour à toutes et à tous. Pour le troisième épisode de notre série consacrée à la relation avec son locataire, nous allons aujourd'hui nous pencher sur les différentes échéances du bail en location meublée. et notamment sur deux points importants pour les bailleurs, à savoir la révision du loyer et le congé donné par le bailleur. Afin de traiter ce sujet, il est premièrement important de préciser que nous aborderons ici uniquement le cas des logements meublés qui sont loués sur la longue durée. En effet, dans le cas d'un bail étudiant, d'un bail mobilité ou d'un bail saisonnier, le contrat prend simplement fin à l'échéance prévue, sans qu'une quelconque notion de reconduction tacite puisse s'appliquer et sans que le propriétaire du logement aient besoin de délivrer un congé. Il en est de même pour la révision du loyer, qui n'est pas possible dans ce type de contrat en raison de leur durée. Et pour un bail en résidence secondaire, ces questions doivent être directement réglées par le contrat passé entre les parties, qui est passé sur la base des dispositions du code civil, tout le fait qu'un tel type de contrat soit également appelé un bail code civil. Pour un bail meublé de longue durée, c'est comme bien souvent à la loi du 6 juillet 1989 et aux textes qui sont venus la compléter, comme la loi Allure du 24 mars 2014 qu'il faudra se référer. Ces contrats sont marqués par un mécanisme qui leur est propre, celui de la reconduction tacite. Cela veut dire qu'à l'expiration de la durée prévue par le bail, ce dernier ne prendra pas fin, mais sera au contraire reconduit dans les mêmes conditions et pour la même durée. Or, la date prévue pour l'échéance du bail joue également un rôle important pour le bailleur qui souhaite augmenter le loyer de son bien ou mettre fin au contrat de location meublée. Penchons-nous donc tour à tour sur ces deux situations. En matière d'augmentation de loyer, la loi indique qu'il est tout à fait possible de le faire pour une location meublée à titre de résidence principale du locataire. Néanmoins, certaines règles seront à respecter. La première est que l'augmentation ne sera possible qu'à condition qu'elle a été prévue dans le contrat de location meublée en y insérant une clause concernant la révision du loyer. En l'absence d'une telle clause, le loyer devra rester le même pendant toute la durée de la location. Cette clause peut prévoir le moment où la révision interviendra dans l'année, mais dans la plupart des cas, c'est la date anniversaire du bail qui est retenue. La deuxième tient au calcul de l'augmentation, qui ne peut pas être fixée librement par le propriétaire. En effet, le calcul du nouveau loyer doit être fait sur la base d'un indice, l'indice de référence des loyers, ou IRL. Cet indice, qui est publié chaque trimestre par l'INSEE ainsi qu'au journal officiel, correspond à la moyenne sur les 12 derniers mois de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyer. Si la clause de révision du contrat n'a pas prévu le trimestre de référence à prendre en compte, ce n'est pas gênant en pratique. Dans ce cas, il convient simplement de se référer à celui qui correspond au dernier indice connu à la date de signature du bail de location meublée. Pour calculer le nouveau loyer, il suffira donc de multiplier le montant du loyer hors charge par l'IRL de l'année en cours avant de diviser le résultat obtenu par l'IRL de l'année précédente et en prenant bien garde d'utiliser l'IRL du même trimestre pour l'année en cours et l'année précédente. A ce sujet, notez que si votre logement est situé en zone tendue, Des dispositions particulières s'appliqueront et vous devrez vous conformer aux règles d'encadrement des loyers. La troisième règle en matière d'augmentation du loyer concerne bien entendu l'information du locataire, qui est indispensable. En effet, l'augmentation de loyer n'est qu'une option laissée au propriétaire, et il n'est en aucun cas possible de considérer que le locataire devra lui-même procéder automatiquement à la révision chaque année, sans demande expresse de votre part. Afin d'informer votre locataire en cas d'augmentation de loyer, Vous devez donc lui adresser un courrier recommandé avec accusé de réception. Un tel type de courrier aura l'avantage de pouvoir prouver la date à laquelle l'augmentation était réclamée. Ainsi, par courtoisie, mais aussi pour éviter toute déconvenue, pensez à informer votre locataire suffisamment à l'avance, car la demande ne vaut qu'à partir du prochain mois de loyer. Si elle devait arriver après le début du mois, car vous l'avez demandé trop tard, l'augmentation ne serait donc effective que pour le mois suivant. Dernière règle très importante en matière de révision de loyer, notez bien qu'une demande d'augmentation de loyer ne peut sous aucun prétexte être rétroactive. Cela entraîne deux conséquences. La première est que si une augmentation est demandée en cours d'année, par exemple plusieurs mois après la date à laquelle elle aurait pu être demandée, elle ne vaudra que pour les mois suivants, et le propriétaire a l'interdiction formelle de demander un complément a posteriori à son locataire pour les mois qui auraient pu faire l'objet d'une augmentation. La seconde, et que si une augmentation n'est pas demandée pendant l'année où elle aurait pu avoir lieu, son propriétaire ne pourra pas s'en prévaloir ensuite. Cela veut dire qu'il lui sera bien entendu toujours possible d'augmenter le loyer pour les années suivantes, mais que l'augmentation devrait être calculée sur la base du loyer en cours et non du loyer tel qu'il aura été si une révision avait eu lieu dans les temps. Passons maintenant à une autre échéance, celle du congé donné par le bailleur, qui est encadré par l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989. La première chose à savoir est que vous ne pourrez donner congé à votre locataire qu'à certaines conditions, à savoir que votre volonté de mettre fin au bail repose sur une décision de reprendre ou de vendre le logement, ou qu'elle repose sur un motif sérieux et légitime, comme l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé devra obligatoirement mentionner le motif allégué. De plus, en cas de reprise, il devra mentionner les noms et adresses du bénéficiaire de la reprise, ainsi que la nature du lien existant. entre vous et le bénéficiaire, ce dernier ne pouvant d'ailleurs être que vous-même, votre conjoint, votre partenaire de PAX, votre concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ou bien vos ascendants, vos descendants, ou encore ceux de votre conjoint, de votre partenaire de PAX ou de votre concubin notoire. En cas de litige, la réalité du motif du congé pourra être contrôlée par un juge et un congé délivré de manière frauduleuse vous expose au paiement d'une amende. pénale dont le montant est proportionnel à la gravité des faits et qui ne peut être supérieur à 6 000 euros pour une personne physique et 30 000 euros pour une personne morale. Deuxième élément, et non des moindres, il s'agit de bien respecter les délais de préavis en matière de congé. Il existe ici une double condition. La première est que le congé ne prendra effet qu'à l'échéance du bail. La seconde est que le congé doit avoir été notifié au minimum trois mois avant la date d'échéance du bail. Le congé doit par ailleurs être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou encore remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou encore de la remise en main propre. Il est donc très important de bien le respecter, car un congé délivré hors délai resterait certes valable, mais uniquement pour l'échéance suivante. Il vaut donc mieux l'adresser le plus en avance possible. Si tout a été fait dans les règles, le locataire sera déchu de tout droit d'occupation à l'expiration du bail. Mais notez que si ce dernier quitte les lieux avant la fin du délai de préavis, il ne sera redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux. Dernier élément à prendre en compte, sachez que vous ne pouvez pas donner congé à votre locataire si celui-ci est âgé de plus de 65 ans à la date d'expiration du bail, et qu'il dispose de ressources annuelles inférieures au plafond de ressources applicables pour l'attribution des logements conventionnés, et ce, à moins de lui proposer un logement à proximité correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Ces dispositions protectrices sont également applicables lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de 65 ans vivant habituellement dans le logement si le montant cumulé de leurs ressources annuelles est inférieur au plafond de ressources applicables pour l'attribution des logements conventionnels. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si vous êtes vous-même âgé de plus de 65 ans ou si vos ressources annuelles sont inférieures à ce même plafond. L'âge du locataire ou de la personne à sa charge et le vôtre sont appréciés à la date d'échéance du contrat tandis que le montant de vos ressources respectives sont appréciées à la date de notification du congé. Pour conclure, mentionnons deux autres informations relatives aux échéances et au délai de préavis en location meublée. Si vous souhaitez modifier les conditions du contrat de bail à son expiration, la procédure sera sensiblement la même que pour un congé, à savoir que vous devrez en informer votre locataire dans un délai de trois mois et que les changements ne pourront prendre effet qu'au renouvellement du contrat. Toutefois, les changements ne seront possibles que si le locataire les accepte. En cas de litige, il est possible de passer par la commission départementale de conciliation ou par un juge en dernier recours. Mais attention, si la question n'est pas tranchée à l'échéance du bail, il sera reconduit dans les mêmes termes et sans changement. Là encore, l'anticipation est de mise. Enfin, du côté de votre locataire, ce dernier peut résilier le bail à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, et ce y compris lorsque la durée du bail est réduite à 9 mois dans le cadre d'un contrat de location étudiante. Il sera alors redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui vous a notifié le congé. Sauf si, avec votre accord, le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire. Notre épisode consacré aux échéances du contrat de bail touche à sa fin. Pour poursuivre dans le thème de la relation avec son locataire, notre prochain épisode portera sur les situations plus particulières de la location, comme la location à un membre de sa famille et le cas de la sous-location. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le quatrième épisode de notre série de podcasts consacrée à la relation avec son locataire. Quiconque a déjà pratiqué une activité de location meublée sait combien les situations particulières peuvent être nombreuses. Et s'il serait difficile de toutes les mentionner, nous avons choisi aujourd'hui d'en aborder deux parmi les plus fréquentes, à savoir le cas de la sous-location et celle de la location d'un bien meublé à un membre de sa famille. Le sujet de la sous-location revient régulièrement en location meublée, et très certainement encore plus en cette année 2024, avec la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Puisque la location meublée permet de pratiquer la location saisonnière, nombreux sont les locataires qui souhaitent profiter de l'été pour augmenter leurs revenus ou financer leurs propres congés, et donc rentabiliser leur logement pendant leur absence, tandis que d'autres souhaitent simplement pouvoir conserver leur logement sans toutefois avoir à payer de loyer le temps d'une mobilité professionnelle ou étudiante. En principe, il est possible pour un locataire ayant conclu un bail meublé de résidence principale de soulouer son logement, puisque ce dernier constitue justement sa résidence principale. Il pourra donc le faire dans les mêmes conditions qu'un propriétaire qui loue son propre logement pendant ses périodes d'absence. Toutefois, des conditions supplémentaires s'appliquent en sous-location, conditions qui sont posées par l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989. En vertu de cet article, le locataire a l'obligation de demander son accord au bailleur pour pratiquer la sous-location. Votre locataire devra donc recueillir votre consentement par écrit préalablement à toute opération de sous-location. Il est d'ailleurs prévu que l'autorisation écrite du bailleur ainsi qu'une copie du bail en cours soient transmises au sous-locataire. Notez toutefois que votre autorisation ne confère aucun droit au sous-locataire à votre encontre, notamment si vous choisissez de résilier le bail. De plus, Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat de sous-location, même si le logement est occupé à titre de résidence principale par le sous-locataire. Par ailleurs, l'accord que vous passez avec votre locataire ne doit pas seulement porter sur la sous-location en elle-même, mais également sur son prix. A ce titre, il est impératif de noter que, quelle que soit la situation, le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Malgré la loi en vigueur, il peut arriver que des locataires pratiquent la sous-location sans en avoir informé leur propriétaire ou contre son gré. Face à cette situation, la première chose à faire est de faire constater la sous-location frauduleuse par acte de commissaire de justice. Attention, une capture d'écran d'une annonce de location n'est pas considérée comme une preuve suffisante. Une fois la preuve de la sous-location frauduleuse recueillie, vous pourrez, si vous le souhaitez, demander la résiliation du bail, des dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des sommes perçues par votre locataire, car les sous-loyers perçus par le locataire sont considérés par la justice comme des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire. Ainsi, le 12 septembre 2019, deux locataires ont été condamnés à rembourser à leur bailleur l'intégralité des sommes perçues grâce à la sous-location non autorisée de leur appartement sur Airbnb. Plus récemment, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 janvier 2022, faisant suite à un jugement du Tribunal d'instance de Paris du 24 octobre 2018, a également condamné un locataire au remboursement des sommes perçues, minorées, du montant des loyers déjà versés au propriétaire, ainsi qu'à des dommages et intérêts. tout en prononçant la résiliation du bail. Notez toutefois que les conditions que nous venons de mentionner ne s'appliquent que si la location principale est soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Dans le cas où elle serait soumise uniquement aux dispositions du Code civil, ce qui est le cas pour un bail résidence secondaire, la sous-location est possible sans autorisation, sauf si le contrat de location l'interdit ou prévoit l'autorisation préalable du bailleur. Il faudra donc adresser cette question dans le contrat si vous mettez un bien en location en vertu d'un tel type de bail. D'une manière générale, il est important de bien étudier chaque situation avant de donner ou non son accord, et de prendre en compte plusieurs éléments, dont la relation de confiance avec le locataire, ainsi que sa situation. Ainsi, si la perspective de voir votre logement mis en location de nombreuses fois pendant la période estivale n'est pas toujours réjouissante, il peut toutefois être bon de prêter une oreille attentive à la situation d'un locataire qui, pour les besoins de ses études, d'un stage ou d'une formation, devrait s'absenter quelques mois tout en sachant devoir revenir et qui ne souhaiterait pas devoir se confronter à nouveau à la recherche d'un logement. Dans ces situations, n'hésitez pas à en discuter avec votre locataire, voire peut-être à demander à échanger avec le futur sous-locataire, qui a toutes les chances d'être une connaissance de votre locataire, certainement peu enclin à laisser un logement qu'il se sait devoir réintégrer entre les mains du premier venu. Passons maintenant à l'autre cas particulier de la location, celle de la location à un membre de sa famille. En premier lieu, il est important de préciser que contrairement à une idée largement répandue, il est tout à fait légal de louer un bien à un membre de sa famille, et ce, comme s'il s'agissait d'une personne extérieure. Cela vaut d'ailleurs quel que soit le lien de parenté qui vous unit avec votre locataire, ascendant, comme les parents ou les grands-parents, descendant, enfant ou petits-enfants, ou encore collatéraux, frères, sœurs, cousins ou cousines. Cependant, certains points devront susciter votre attention, et le premier est le montant du loyer. En effet, lorsque l'on pense à une location en famille, on peut imaginer un tarif préférentiel ou certains avantages. Et si cela est possible, il convient de les manier avec précaution. Comme pour toute activité de location, vous aurez effectivement l'interdiction de le fixer à un loyer trop bas, du moins si vous louez votre bien en vertu d'un bail de longue durée. Car dans ce cas, le prix de location devra correspondre au prix du marché, même si le locataire est un proche. La résolution de cette obligation, qui peut surprendre si l'on considère qu'un loueur devrait pouvoir fixer le prix souhaité, est justifié par l'administration fiscale comme une manière de ne pas abuser des avantages fiscaux liés au statut de lois remeublées non professionnelles, notamment au régime réel. Il vous faudra donc prendre garde au prix du marché sur votre zone géographique afin de ne pas courir le risque d'une sanction en cas de contrôle fiscal. Cela étant dit, ne pas fixer un loyer trop bas permet également de préparer l'avenir, notamment si vous envisagez de louer à nouveau votre bien à une autre personne au départ du membre de votre famille. En effet, Si la situation d'une location intrafamiliale profane, notamment par le départ du locataire, le bien pourra à nouveau être offert à la location. Or, s'il se situe en zone tendue, certaines règles d'encadrement des loyers s'appliqueront au moment de fixer le loyer pour le prochain locataire. Parmi elles, se trouve l'interdiction de modifier le loyer entre deux contrats de bail, ce qui veut dire que si vous avez fixé un loyer avantageux pour une personne de votre famille, vous ne pourrez pas opérer un changement à l'entrée dans les lieux d'un nouveau locataire. En la matière, ce sont les dispositions du décret du 27 juillet 2017 qui s'appliqueront. Et si elles pourront tout de même, à certaines conditions, vous permettre de procéder à une augmentation du prix de la location entre deux locataires, le fait d'avoir initialement fixé un prix peu élevé pour loger un membre de votre famille aura logiquement un impact sur le prix à la relocation. Autre information intéressante dans le cas d'une location intrafamiliale, celle relative à la possibilité de bénéficier des aides-personnalités au logement ou APL. Dans ce cas, ce sont les liens familiaux qui vous unissent avec votre locataire qui décideront de la possibilité ou non de bénéficier des APL. Ainsi, si vous avez des liens de parenté en ligne directe avec votre locataire, comme ce serait le cas avec vos enfants ou vos petits-enfants, il ne leur sera pas possible de bénéficier des APL, et ce, quelle que soit leur situation socio-professionnelle. Au contraire, si vous avez des liens de parenté en ligne collatéral, comme ce serait le cas avec des frères et sœurs ou des neveux et nièces. Il leur sera tout à fait possible de demander à bénéficier des APL si leurs conditions sont réunies pour le faire. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le cinquième épisode de notre série de podcasts consacrés à la relation avec son locataire. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur les obligations respectives qui régissent la relation entre un propriétaire et son locataire. Parfois source de conflits, il est d'autant plus important que chaque partie soit informée des obligations qui lui incombent, afin de trouver rapidement une solution à tout litige. Commençons par un tour général d'horizon de ces obligations, qui sont mentionnées à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. pour les bailleurs et à l'article 7 pour les locataires. Selon les termes de la loi, tout bailleur est ainsi tenu. Premièrement, de remettre au locataire un logement décent, à savoir ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Attention ! Les critères de performance énergétique justement cités auront un impact plus important d'ici le 1er janvier 2025 et il sera important de se conformer aux nouvelles normes afin que le logement loué soit toujours considéré comme décent. Deuxièmement, de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement. A ce sujet, sachez toutefois qu'il est possible, par une clause ajoutée au contrat de location, De prévoir que c'est le locataire qui prendra à sa charge de faire exécuter des travaux, dont le coût sera ensuite imputé sur le loyer. Attention, la clause devra donc prévoir la durée de l'imputation et les modalités de dédommagement en cas de départ anticipé du locataire. Troisièmement, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir contre les vices ou défauts de nature à y faire obstacle. Quatrièmement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Cinquièmement, de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès lors que ceci ne constitue pas une transformation de la chose louée. Et enfin, il faudra veiller à l'installation d'un détecteur de fumée dans le logement et penser, le cas échéant, à bien respecter les normes de sécurité entourant les équipements partagés, comme les piscines. En contrepartie, le locataire est tenu de payer le loyer ainsi que les charges récupérables selon la méthode convenue, charge forfaitaire ou provision sur charge, de faire un usage paisible et conforme à leur destination des locaux loués, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, d'y faire les réparations locatives qui s'imposent et, le cas échéant, de répondre des dégradations et pertes survenues pendant la location, sauf si elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qui ne l'a pas introduit dans le logement. de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration ou de maintien en état des parties communes ou privatives, de ne pas transformer les locaux équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire, et enfin de souscrire une assurance dont le bailleur a le droit de demander qu'il en justifie l'existence par la remise d'une attestation. Notez toutefois que cette obligation de souscription d'une assurance n'est valable que pour les contrats soumis à la loi du 6 juillet 1989, soit le bail longue durée et le bail étudiant, ainsi que pour le bail mobilité. Autrement dit, ce n'est pas le cas en location saisonnière et il est souvent préférable, dans cette situation, de souscrire soi-même une assurance et d'en répercuter le coût sur le prix des réservations. Penchons-nous maintenant sur le détail de plusieurs de ces obligations. La première d'entre elles, parfois au cœur de tensions entre propriétaires et locataires, concerne l'étendue des réparations qui incombe à chacun. L'article 6 et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le disent bien. Le bailleur est tenu aux réparations autres que locatives. Réparations locatives que l'article 7 met justement à la charge du locataire. Mais que sont ces réparations locatives et comment savoir ce qui est concerné ? Pour cela, il faut aller consulter l'annexe du décret n° 87712 du 26 août 1987. Ce décret a été initialement pris en application de l'article 7 de la loi du 23 décembre 1986, mais a été maintenu en application de la loi du 6 juillet 1989. En annexe de ce décret, on trouve la liste complète des réparations locatives, réparties en six grandes catégories. A savoir les parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif, les ouvertures intérieures et extérieures, les parties intérieures, les installations de plomberie, les équipements d'installation d'électricité, les autres équipements mentionnés au contrat de location. Ainsi, toute réparation mentionnée par ce décret est à la charge du locataire, dans le cas contraire, c'est au bailleur de s'en occuper. Un autre sujet de discorde peut concerner l'entretien du bien, et cela notamment dans le cas de la présence d'espèces nuisibles. Dans le cas de l'apparition de nuisibles, les frais engendrés par l'intervention de professionnels devront être supportés par la partie jugée responsable de leur apparition. Selon l'espèce en question, cela sera plus ou moins facile à déterminer, en fonction de plusieurs critères, dont la date d'entrée dans les lieux. En la matière, les cas les plus difficiles sont posés par les punaises de lit, pour lesquels il est particulièrement difficile pour les bailleurs de s'exonérer. C'est du moins ce qui ressort de l'analyse des décisions de justice, qui montre qu'une infestation déclarée peu de temps après l'entrée dans les lieux sera considérée comme de la responsabilité du propriétaire. Et pour les délais d'occupation plus longs, aucune garantie n'existe du point de vue du droit. En cas de litige, tout passage devant la justice devra, comme toujours, être d'abord précédé d'une médiation opérée par la commission départementale de conciliation. Mais, quelle que soit la situation, il est bien souvent préférable d'agir rapidement, raison pour laquelle les bailleurs peuvent avoir tout intérêt à vouloir gérer les infestations de nuisibles sans nécessairement passer un temps précieux à déterminer les responsabilités, d'autant que le coût de ces interventions est bien entendu déductible au régime réel d'imposition. En toute logique, le locataire aura de son côté l'obligation de rendre son logement accessible. pour les opérations de lutte contre les nuisibles. Passons maintenant au sujet de la jouissance du bien. Du côté du bailleur, cela se nomme la garantie d'éviction. Cette garantie d'éviction a deux conséquences pour le propriétaire. Premièrement, qu'il est tenu de garantir au locataire une jouissance paisible des lieux sans troubler lui-même sa tranquillité. C'est ce que l'on appelle la garantie du fait personnel du bailleur. Deuxièmement, qu'il doit également veiller au respect de la garantie du fait des tiers, qui le rend responsable si ses locataires subissent des dommages causés par des tiers dont la présence dans les lieux est à l'origine du bailleur ou résulte de sa faute. Ce point nécessite toutefois d'être précisé, et sont ainsi concernés les dommages causés par des tiers que le bailleur a introduits, comme des ouvriers, ou par ses autres locataires s'il loue plusieurs biens dans un même immeuble. Au contraire, s'il n'est pas responsable de la présence des tiers, sa responsabilité ne pourra pas être engagée. Du côté du locataire, on parle d'usage raisonnable du bien loué. Cette obligation regroupe à la fois la nécessité pour le locataire de s'abstenir de causer tout trouble de jouissance manifeste à ses voisins, mais aussi d'utiliser le logement selon sa destination. Ainsi, le locataire ne peut en principe pas apporter de transformation sans l'autorisation expresse et écrite du bailleur. En réalité, le locataire peut toujours apporter de légers aménagements, tant que ces derniers permettent toujours une utilisation plus rationnelle des lieux et qu'ils n'entraînent pas une modification de la distribution des pièces. Si de tels changements devaient toutefois advenir sans le consentement du bailleur, ce dernier aurait alors le choix, une fois le locataire sorti des lieux, entre demander qu'une remise en état soit faite aux frais du locataire, ou, au contraire, choisir de conserver les changements s'il les trouve intéressants, sans que le locataire puisse demander une quelconque indemnisation pour les frais engagés. Attention, la remise en état ne peut être demandée qu'à la sortie des lieux par le locataire, sauf si les modifications opérées mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Il existe cependant une exception pour les locataires en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Dans le cadre d'une location à titre de résidence principale ou d'un bail mobilité, les travaux d'aménagement nécessaires pour permettre aux locataires de se maintenir dans les lieux peuvent être réalisés à ces frais après l'envoi d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur, qui dispose d'un délai de 4 mois pour y répondre, sans quoi la demande sera considérée comme acceptée et, au départ du locataire, aucune remise en état ne pourra être exigée. Un autre sujet de discorde entre bailleurs et locataires peut résider dans le paiement des charges et leur répartition, sujet que nous traiterons justement dans le prochain épisode de notre série, qui traitera également du moment de la sortie des lieux du locataire. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le sixième épisode de notre série consacrée à la relation avec son locataire. Aujourd'hui, nous aborderons successivement la question des charges en location meublée, puis celle de la sortie des lieux du locataire. Afin d'éviter tout litige, ou de savoir comment réagir lorsque ces situations occasionnent quelques difficultés, nous vous proposons d'examiner ensemble ces deux points. Commençons par les charges locatives qui, en location meublée, sont en grande partie récupérables auprès du locataire. Or, la récupération des charges relatives à l'occupation du bien, ainsi qu'à l'entretien des parties communes, peut se faire de deux manières différentes, Ausha du bailleur, selon la méthode de la provision sur charge ou celle du forfait de charge. La provision sur charge, que l'on appelle également les charges réelles, est la méthode la plus utilisée en matière de récupération des charges locatives par le propriétaire, et son fonctionnement est prévu par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Pour faire simple, tous les mois, le locataire verse au bailleur, en plus du montant du loyer, une somme appelée la provision sur charge, le total étant souvent désigné sous l'appellation loyer-charge comprise. Le montant ainsi perçu par le propriétaire comme provision sur charge donne toutefois lieu à une régularisation annuelle. Une fois les comptes des charges définitives disponibles, Vous devrez donc communiquer le décompte par nature de charge à votre locataire, ainsi que, dans les immeubles collectifs, leur mode de répartition entre tous les locataires. En fonction du résultat de ce décompte, deux options seront alors possibles. Si le total de la provision sur charge est supérieur au montant réel des charges dont vous vous êtes acquitté, vous devrez rembourser le trop perçu au locataire, alors que si, au contraire, le coût des charges est supérieur à celui de la provision, vous pourrez lui demander de vous verser la différence. Et dans le cas d'une occupation courte ou d'une arrivée dans les lieux court d'année, ce qui est souvent le cas, le montant des charges doit être évalué au prorata du temps d'occupation avant d'être comparé au montant de la provision. Au sujet du temps d'occupation, notez qu'en cas de départ du locataire, le paiement des charges doit être réalisé pendant toute la durée du préavis et même s'il quitte le logement avant l'expiration du délai, sauf si vous parvenez à le relouer entre temps. Au contraire, si c'est vous qui avez donné congé, votre locataire ne sera redevable des charges que pour la période pendant laquelle il a effectivement occupé le logement. S'il le quitte avant l'expiration du délai de préavis, vous ne pourrez donc pas lui demander de s'acquitter de la proportion des charges correspondant au reste de la période de préavis. L'autre option possible est celle du forfait de charge, ajouté à la loi du 6 juillet 1989 sous la forme de l'alinéa 2 de l'article 25-10 par l'article 8 de la loi Allure du 24 mars 2014. Au quotidien, la différence se verra peu, car, là encore, les charges locatives seront versées tous les mois. Néanmoins, il s'agit ici d'un forfait. Cette petite différence a toute son importance, car elle implique qu'aucun complément ou régularisation ne pourra avoir lieu ultérieurement, quel que soit le décompte annuel. Locataires comme propriétaires ne pourront donc demander ni remboursement ni complément. Reste encore à éclaircir ce qui est compris dans les charges locatives, car la répartition des charges peut parfois être source de conflits entre propriétaires et locataires. La liste exacte des charges récupérables est plutôt longue et peut être consultée en annexe du décret n° 87 713 du 26 août 1987. Pour vous en donner une idée, voici les 7 catégories sous lesquelles elles sont regroupées. Ascenseur et monte-charge, eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes, installations individuelles, parties communes intérieures au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation, espaces extérieurs au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation, hygiène et enfin équipements divers du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation. Au-delà de leur répartition, c'est également sur le montant des charges ou leur régularisation que le conflit peut survenir et il est nécessaire de savoir comment réagir. Il est en effet possible qu'un litige survienne sur le montant des charges. notamment en cas de charges forfaitaires, justement parce que ce système ne donne pas lieu à une régularisation. Or, votre locataire pourrait considérer ce montant disproportionné. A ce sujet, notez qu'en matière de charges, le montant de ces dernières doit être justifié par le bailleur, qui peut prendre appui sur les dépenses des années précédentes, ou, dans le cas des charges réelles, être en mesure de fournir un décompte détaillé des dépenses au locataire, décompte qui doit d'ailleurs obligatoirement lui être transmis une fois les comptes de l'année arrêtés. Autre possibilité ? qui concerne cette fois-ci uniquement les bailleurs utilisant la méthode des charges réelles, celle de la régularisation des charges après la sortie des lieux du locataire. Il est rare que la sortie des lieux se fasse en même temps que le décompte annuel des charges, ce qui veut dire que vous ne saurez pas encore si vous devrez vous livrer à une éventuelle régularisation qu'il pourrait être difficile de demander au locataire une fois ce dernier sorti des lieux. Pour autant, il existe un moyen de se protéger contre cette éventualité. En effet, et bien que cela soit peu que nous les propriétaires, il est possible de conserver une fraction du dépôt de garantie pour payer d'éventuelles charges locatives. En principe, le montant du dépôt de garantie doit être restitué au locataire dans un délai de deux mois ou d'un mois si l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée. Toutefois, lors de la sortie, et si l'immeuble est en copropriété, le propriétaire peut fournir un arrêté des comptes provisoires sur la base duquel il peut retenir jusqu'à 20% du montant du dépôt de garantie en vue de la régularisation des charges lors du prochain décompte. Si cette méthode peut permettre au propriétaire bailleur de se protéger, elle a cependant plusieurs inconvénients. Le premier est de nature relationnelle. Ainsi, si vous avez maintenu une bonne relation avec votre locataire pour toute la durée de la location, procéder à cette retenue pourrait être interprété comme un manque de confiance de votre part. Le second tient aux formalités, car opérer à une telle retenue impose au bailleur de communiquer à l'ancien locataire un décompte provisoire qui justifie cette retenue, puis le décompte annuel une fois ce dernier établi, et de lui restituer les sommes dues, moins l'éventuel montant de la régularisation, dans un délai d'un mois. Or, si ces obligations ne sont pas respectées, Des sanctions sont à prévoir pour le bailleur. Passons maintenant à la sortie des lieux par le locataire. Lors de cette dernière, une étape sera cruciale, la comparaison de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie. Comme nous le mentionnions dans le deuxième épisode de cette série, l'état des lieux est un document joint au bail qui vise à décrire l'état du logement et de ses équipements au moment de l'entrée dans les lieux du locataire à des fins de comparaison au moment de sa sortie. Raison pour laquelle ces deux états des lieux doivent être établis sur le même document ou sur deux documents similaires. Sur le principe, le locataire doit donc rendre le logement dans le même état qu'il lui a été confié, et, de ce fait, de répondre de toute dégradation qu'il aurait commise dans le logement. Attention toutefois à ne pas confondre dégradation et usure normale des lieux, car le locataire n'a pas l'obligation de remettre le logement à neuf. Le déroulement de l'état des lieux de sortie se fait de la même manière que l'état des lieux d'entrée, en comparant les différentes mentions, raison pour laquelle il est particulièrement important d'établir l'état des lieux le plus soigneusement possible lors de l'arrivée du locataire dans le logement. De plus, les propriétaires doivent se montrer particulièrement vigilants au moment de l'état des lieux de sortie. En effet, Si lors de l'entrée dans les lieux, le locataire dispose d'un délai de 10 jours pour demander à faire compléter le document, ce n'est pas réciproque. Ainsi, une fois l'état des lieux de sortie signé par le locataire et le bailleur ou son mandataire, aucun changement ne pourra être opéré par la suite. Notez à cet effet que, si le bailleur peut déléguer la réalisation de l'état des lieux de sortie à un mandataire, aucun frais relatif à l'établissement de ce document ne pourra être facturé au locataire, sauf en cas de litige entraînant l'intervention d'un commissaire de justice. Une fois l'état des lieux établi, signé et remis aux deux parties sur support papier ou par voie dématérialisée, deux options sont alors possibles. La première est que l'état des lieux d'entrée et de sortie sont identiques. Dans ce cas, il vous faudra restituer l'ensemble du dépôt de garantie au locataire dans un délai ramené à un mois. La seconde est que les deux états des lieux ne sont pas identiques. Dans ce cas, vous disposerez d'un délai de deux mois pour restituer le dépôt de garantie et éventuellement minorer des sommes retenues pour entreprendre les réparations nécessaires. À ce sujet... sachez que toute retenue doit obligatoirement être justifiée, justification qui peut être faite sur la base d'une facture, mais aussi uniquement d'un devis. De plus, si les sommes nécessaires à la remise en état sont supérieures au montant de garantie, il est également possible de demander un complément à l'ancien locataire dont la nouvelle adresse doit figurer sur l'état des lieux de sortie, et ce afin que vous puissiez entrer en contact avec lui au besoin. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir, et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contacte-je-déclare-mon-meublé.com