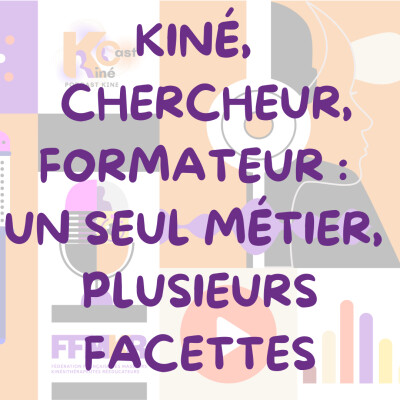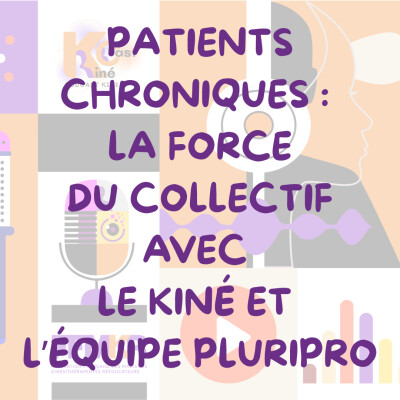- Speaker #0
Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la FEDE, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique, et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la FEDE, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute ! La médicale Un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur trois en France. Rassurant non, des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés.
- Speaker #1
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Kinecast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Jean-Philippe Deneuville, kinésithérapeute à Paris. pour explorer son parcours professionnel et aussi ses activités d'enseignement et de recherche. Bonjour Jean-Philippe.
- Speaker #2
Bonjour et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir parler de kinésithérapie, de recherche et de tout ça.
- Speaker #1
Merci à toi tout d'abord d'avoir accepté. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu es devenu kiné ? Qu'est-ce qui t'a donné envie ? On va être large.
- Speaker #2
C'est assez drôle en fait. Surtout quand on voit le parcours que j'ai après. En gros, j'ai toujours aimé les matières scientifiques. Donc au moment de choisir les orientations après le lycée, c'était soit je partais sur un parcours d'ingénieur, soit je partais sur des parcours en sciences médicales. Donc j'ai choisi plutôt l'orientation médicale. Dans la famille, il y a beaucoup de gens qui sont dans le domaine médical. Donc ça me plaisait, j'y suis allé. Et à Poitiers, on passe par l'apprentissage de médecine. Donc, à la fin de l'année, on a les choix entre médecine, sage-femme, dentaire ou kinésithérapie. Et moi, j'avais la chance d'avoir tous les choix. Et je me suis dit que je ne voulais pas forcément faire des études longues. Donc, j'ai choisi kiné, ce qui est assez marrant après, quand on voit le parcours que j'ai eu derrière. Et en fait, il y avait aussi le fait que j'aimais... Beaucoup d'activités physiques, je faisais beaucoup de sport à l'époque et je me faisais, je pense un peu comme beaucoup de jeunes, une idée du kiné qui est avec les sportifs tout le temps, etc. Donc là aussi, ça a bien changé depuis. Mais voilà, c'était un peu les deux raisons qui, au moment du choix de partir soit vers les sciences médicales, soit vers les sciences de l'éducation, j'ai choisi plutôt les sciences de l'éducation et la kiné.
- Speaker #1
Donc tu as fait ta formation initiale à Poitiers ?
- Speaker #2
Exactement. Exactement.
- Speaker #1
D'accord. Comment ta formation initiale a influencé tes débuts d'exercice de pratique clinique ?
- Speaker #2
J'ai eu deux grosses influences durant mes études initiales. La première, c'est par la personne qui deviendra plus tard mon directeur de thèse. Maintenant, c'est le professeur Philippe Rigouard, qui à l'époque était interne en neurochirurgie et qui venait nous faire les cours de neuroanatomie. Et ces cours étaient juste géniaux. Quand on passait de la P1 où on avait le... Je vais peut-être être un peu médisant, mais le prof qui venait, qui lisait le bouquin, au prof d'anat qui arrive et qui passe 5 minutes à nettoyer le tableau parce qu'il faut qu'il soit nickel, pour après dessiner tous les organes, faire les os, tourner les dessins dans l'espace pour expliquer toute la pathophysiologie, etc. C'était assez splendide. Et c'était quelqu'un qui était aussi... très férue de recherche et ça a accroché avec mon côté scientifique que j'ai toujours eu. Et donc là, on a eu beaucoup d'atomes crochus tous les deux et on a mené nos carrières un peu séparément pendant un moment, puis après on s'est retrouvés pour mon doctorat. Donc lui, ça a été une grosse, grosse influence dans le côté science et rigueur dans la pratique et dans la compréhension de la pathophysiologie. Il aura aussi une autre influence un petit peu plus tard, mais ça, on en reparlera. Et le deuxième grosse influence, c'est qu'à Poitiers, il y a eu une accroche assez rapide des kinés, mais aussi des médecins et des chirurgiens autour du système proposé par McKenzie. Et il y a eu beaucoup de kinés qui ont été formés dans la zone de Poitiers très rapidement. Et les chirurgiens, notamment les neurochirurgiens, ont eu très vite confiance aux kinés qui étaient formés comme ça. Et ils avaient tendance à envoyer, pas en systématique, mais... Quasi en systématique, les patients pour un traitement conservateur à des kinés spécialisés. Et le fait de voir ça, le fait de voir la confiance que les neurosurgiens pouvaient avoir dans les kinés pour... Traiter des patients qui étaient assez complexes, parce que c'était des potentiels candidats chirurgicaux. Évidemment, il n'y avait pas les fractures, il n'y avait pas les cancers, il n'y avait pas tout ce qui révélait de la chirurgie en première intention. Mais dès qu'il y avait une notion de traitement conservateur, c'était plutôt vers ce genre de kinéa qu'ils envoyaient. Et donc forcément, je les ai vus pratiquer, je suis allé en stage, je suis allé en observation chez eux. Et donc ça m'a beaucoup plu, et ça m'a beaucoup plu dans le côté aussi scientifique que je peux avoir, le côté algorithmique et le côté... 1 plus 1 c'est égal à 2, c'est pas égal à 3. Et on a des arbres décisionnels qui sont clairs et on sait quand est-ce qu'on fait ça, on sait quand est-ce qu'on fait ça, on sait quand est-ce que le patient doit être réadressé ou non. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Donc c'est les deux grosses influences que j'ai eues qui ont un peu façonné la suite de ma carrière.
- Speaker #1
Donc tu t'es tourné vers le domaine plutôt musculo-squelettique et plus précisément les pathologies rachidiennes.
- Speaker #2
Alors musculo-squelettique au début, je suis resté assez large. En fait, je suis resté sur le musculo-squelettique. Alors, vraiment, les 3-4 premières années de... De pratique, j'étais plutôt orienté musculoskeletique, mais je voyais aussi de la pilatrie, je voyais aussi de la kiné respiratoire. J'ai fait une formation en kiné respiratoire, mais bon bref, ce n'était pas mon dada, clairement. Et petit à petit, j'ai quand même vachement resserré autour des pathologies musculoskeletiques. Et au bout de 5-6 ans de pratique, j'ai carrément resserré sur le rachis. Et vraiment là, je vois actuellement, je pense que c'est 90% de rachis. et après c'est Ce qui n'est pas du rachis, c'est des gens qui viennent pour des indications qui pensent être le rachis, mais qui n'en sont pas. Par exemple, là, je vois aujourd'hui, j'ai eu deux dames qui sont venues, qui pensaient que c'était des problèmes de dos. En fait, c'était des problèmes de hanche. Donc, je les traite aussi. Mais j'ai quand même un gros panel de patients qui sont orientés pour du rachis.
- Speaker #1
Donc, quelles ont été les formations continues, juste en poste diplôme, qui t'ont marqué le plus et qui ont façonné ce parcours ?
- Speaker #2
Forcément il y a McKenzie, ça a été le gros truc. Et après j'ai fait, en fait j'étais très curieux, j'ai fait vraiment beaucoup de choses dans le champ musculoskeletique. Donc sur des formations on va dire plutôt techniques, j'ai fait Mulligan et Maitland. C'est surtout Mulligan que j'ai trouvé sympa. Mais après j'ai fait vraiment beaucoup de formations courtes avec, alors non, j'ai fait des formations en communication aussi, donc entretien motivationnel ça a été un truc qui m'a beaucoup marqué aussi. L'éducation thérapeutique aussi, c'est deux éléments qui se sont intégrés assez rapidement dans ma pratique aussi. Et après, c'était des formations courtes sur des points spécifiques avec des cliniciens-chercheurs qui venaient parler d'un domaine très précis. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'Anina Schmitt, qui est une kiné suisse qui travaille en Angleterre. Il me semble qu'elle est retournée en Angleterre, où elle était à l'université de Bâle à un moment, et elle était à cheval entre Oxford et Bâle. Je crois qu'elle est retournée à Oxford. Et elle, sa spécialité, c'est les neuropathies, soit périphériques, soit radiculaires. Et donc, en fait, elle est vraiment ultra pointue là-dedans. Elle voit des patients une demi ou une journée par semaine. Et tout le reste du temps, c'est sur la recherche. C'est elle qui sort toutes les publications à l'heure actuelle sur le sujet. Donc, quand elle est venue faire son cours, je suis allé la voir. Et donc, j'ai vu elle, j'ai vu Peter O'Sullivan, qui lui est plutôt spécialisé dans les lombologies chroniques. Qui c'est que j'ai vu d'autres ? J'ai vu Jeremy Lewis pour les pôles, j'en ai vu beaucoup qui venaient sur des sujets très ponctuels et très précis que je voyais vraiment un peu comme ça, sur un point de détail à vraiment peaufiner.
- Speaker #1
Profiter de leur venue en France pour les voir.
- Speaker #2
Ou à l'étranger, ça m'est arrivé. Par exemple, qui c'est que j'ai vu à l'étranger ? J'ai vu Yannick Touzino-Laflamme à l'étranger qui est un prof. un prof au Canada sur le traitement de la lombalgie. J'ai eu la chance de voir, alors là, ce n'était pas une formation, mais je me suis déplacé à l'occasion d'un voyage en Nouvelle-Zélande. J'ai pu aller voir Marc Lasselette travailler aussi. Donc, je suis allé dans son cabinet, on a vu des patients ensemble et tout. Donc, c'était très chouette. Et c'est, je pense, aussi formateur qu'une formation continue. Donc, voilà, aussi, à l'occasion de voyages ou de conférences, j'essaye aussi de voir s'il n'y a pas possibilité d'échanger avec les experts locaux sur ces sujets-là.
- Speaker #1
Et ensuite, tu es venu, enfin, je pense que ça a été concomitant sur le cursus Mackenzie.
- Speaker #2
Ah oui, alors le cursus de Mackenzie, ça a été vraiment le tout premier. Je suis sorti de l'école, je voulais faire ça, j'étais assez motivé. Donc j'ai fait ça, j'ai fait la formation initiale en Mackenzie, donc A, B, C, D et le petit examen qu'il y a à la fin. Et derrière, comme j'étais très mordu, j'ai fait la formation avancée, où là, pour le coup, il faut passer des diplômes en anglais, parce qu'on avait à l'époque, alors ça ne se fait plus comme ça maintenant, mais à l'époque, On avait un semestre de cours avec une université écossaise, où là on avait, c'était en distance, on avait des cours à distance, mais par contre on avait les rendus des écrits à faire dans le format académique de l'université, on validait des crédits universitaires, etc. Donc c'était assez chouette. Donc on avait un semestre universitaire, ça fait trois mois et demi, quatre mois à peu près, et derrière il y avait neuf semaines de stage que j'ai fait aux Etats-Unis, et derrière après il y avait l'examen, donc là c'est la formation avancée. Et après, je suis devenu enseignant. Donc là, j'ai fait vraiment tout le cursus et j'enseigne toujours au McKenzie à l'heure actuelle. Donc ça, c'est vraiment le gros cœur de ma pratique. Et par-dessus, c'est greffer ces autres formations, dont notamment, j'ai oublié de dire, une autre qui a été vraiment très marquante pour moi, c'est celle de Marc Laslet. J'en ai parlé quand je suis allé le voir, mais... la formation qu'il propose et tout ce qu'il peut proposer à côté, lui, ça a été vraiment la grosse, grosse influence en plus de Mackenzie. C'est vraiment les deux gros, avec les quelques formations en communication qui, elles aussi, ont marqué un peu la pratique que j'ai à l'heure actuelle.
- Speaker #1
Et tu as suivi ton cursus jusqu'au master en Écosse.
- Speaker #2
Après, oui, voilà. En fait, comme j'avais validé un semestre via Mackenzie, je me suis dit, bon, allez, on y va jusqu'au bout. Surtout qu'à l'époque, le master je l'ai eu en 2017, je vais peut-être dire une bêtise, il ne faut pas que je me fasse taper sur le doigt, mais à l'époque je pense qu'il n'y avait pas encore de master spécialisé kiné, peut-être Amiens commençait à faire à l'époque, mais sinon c'était que des master STAPS qu'on faisait, et des master STAPS orientés soit à performance sportive, soit biomécanique. Alors on pouvait aussi faire des master en ingénierie ou des master en sciences humaines, mais en master on va dire qui se structure autour de la pratique kiné. A ma connaissance, à l'époque, il n'y en avait pas en France. Et donc, je me suis dit, c'est un, l'occasion de faire fructifier un peu ces crédits que j'avais déjà validés. Deuxièmement, valider un diplôme, enfin un grade de master, parce que de toute façon, après, je voulais faire de la recherche, donc il fallait que je le fasse à un moment ou à un autre. Et de trois, de voir ce qui se faisait à l'étranger en termes d'enseignement, et notamment d'enseignement en kinésithérapie, parce que je savais qu'à un moment ou à un autre, ça allait venir en France, les masters. et d'ailleurs il y a des masters qui se créent. Et là, je participe à l'enseignement dans un des deux masters qui, à ma connaissance, existent en kinésithérapie à Amiens. Et le fait d'avoir vu ce qui se fait à l'étranger aussi, ça me permet de rapporter un peu des choses en France.
- Speaker #1
On s'est d'ailleurs rencontrés à Amiens lors de ce master. Alors, dans quel domaine était ce master ?
- Speaker #2
Alors, c'était assez large. Ils avaient mis un intitulé kinésithérapie musculoskeletique. Mais c'était quand même très orienté. C'est marrant parce qu'en fonction des pays, il y a vraiment des espèces de spécialités qui ressortent. Le Royaume-Uni, ils sont très orientés. Facteur psychocognitif. Ils sont très là-dedans. Éducation à la douleur. On a eu zéro patho-anatomie, zéro biomechanique, zéro pathophysiologie, rien de tout ça. C'était que de la communication, que de la manière de conduire des entretiens avec des patients, des sciences d'éducation avec des patients, comment amener les choses à un patient douloureux. C'était vraiment que autour de ça. C'était vraiment très orienté douleur chronique, plus que réellement musculoskeletique pour moi. On était vraiment au stade du patient. C'était très adapté, par exemple, pour du traitement de patients fibromyalgiques ou de patients lombalgiques chroniques, mais vraiment à un stade assez avancé. En réellérance. Voilà, en réellérance. Et sur qui, en fait, il y a vraiment eu un bilan correct qui a été fait et chez qui on n'a pas d'intérêt, en tout cas, à raisonner dans une logique paté anatomique ou mécanique avec lui. Donc, c'était très bien pour ça. Ça m'a amené plein de connaissances. En plus, c'est un peu à ce moment-là où... en France arrivait, entre guillemets, la vague des neurosciences de la douleur, où là, il y a eu des cours avec Peter O'Sullivan, avec, comme il s'appelle, Mike Stewart, etc., qui venaient. Il y avait vraiment toute cette mouvance-là, et c'était très à la mode. Donc là, à ce moment-là, ça a été parfait pour moi. J'ai vraiment creusé ce sujet-là, à ce moment-là, avant de rechanger après.
- Speaker #1
Et qu'est-ce qui t'a motivé de continuer ensuite vers le doctorat ?
- Speaker #2
Alors ça, j'avais toujours eu envie. En fait, alors... C'est pas forcément le doctorat que je voulais, j'avais toujours voulu faire de la recherche. Après, disons qu'il y a plusieurs manières de valider un doctorat, et je me suis dit tant qu'à faire, si je fais de la recherche, si je fais des publications, si je produis des choses, bon, autant valider le grade qui correspond, sachant qu'après, c'est sûr que je connais des chercheurs qui n'ont pas de doctorat, qui sont des excellents chercheurs, avec un niveau académique... bien supérieur à beaucoup de docteurs, mais ils n'ont pas les trois lettres, le PHD. Et je pense que si on n'a pas un gros gros réseau, dans ce cas de figure là, en fait les portes se ferment assez rapidement. Tandis que quand on a ces trois lettres à coller au nom, en fait ça facilite quand même beaucoup les choses. C'est un peu un label où ça veut dire qu'on a une forme de rite de passage ou de certification de connaissance ou de compétence ce qui fait que c'est beaucoup plus facile après de discuter avec d'autres doctorants. et d'autres docteurs aussi, ou d'établir des collaborations avec des laboratoires de recherche ou des choses comme ça. Donc en fait, je me suis dit, on va y aller jusqu'au bout. Et en plus, j'avais la chance d'avoir le soutien du professeur Rigoire, dont on a parlé tout à l'heure, qui lui me poussait à me dire, vas-y, là, il faut que tu y ailles. Et donc, il m'a ouvert un peu les portes de son labo et qui m'a permis de faire le doctorat dans de bonnes conditions et sur des sujets qui me plaisaient. Parce que ça aussi, c'est une autre histoire. Quand on est doctorant, on ne choisit pas forcément tout le temps son sujet.
- Speaker #1
Et alors, quel était ton sujet ?
- Speaker #2
C'est la biomécanique du disque. Donc, ça tombait bien. Alors, de base, ce n'était pas mon premier, premier choix. Ce que je voulais, moi, c'était plutôt faire un travail en recherche clinique. C'est-à-dire que je voulais tester l'efficacité d'une thérapeutique. par rapport à une autre. Donc l'idée, c'était de monter un projet qu'on allait faire financer et faire une étude où on allait comparer traitement A versus traitement B. Et c'était dans le cadre des patients qui souffrent d'hernie discale et conflit disco-radiculaire, chez qui on a une indication chirurgicale. Et donc l'idée, c'était de voir si la kiné spécifique avec les principes guidés par McKenzie était supérieure à juste faire bouger le patient comme ça. Sans trop de logique, sans trop de...
- Speaker #1
De protocoles.
- Speaker #2
Sans trop de structure. On reste dans une logique de... On le fait bouger, puis on voit ce qui se passe. Et l'idée, c'était de voir si, de cette manière-là, on arrivait à influencer le taux de chirurgie à un an. Et bon, j'ai pas eu de chance, j'ai pas été financé. Donc, je me suis rabattu sur autre chose. Et là, mon directeur de thèse, il m'a dit, en fait, tu mets la charrue avant les bœufs, en fait. Je lui dis, comment ça ? Il m'a dit, ben, en médecine. Avant de vouloir aller en recherche clinique, il faut d'abord passer par une étape fondamentale. Avant de vouloir tester ton médicament chez des gens, il faut d'abord démontrer qu'en laboratoire, ton médicament fonctionne. Donc l'étape avant, c'est d'essayer de comprendre au niveau pathophysiologie ou mécanisme, ce que vous faites réellement. Lui, il savait très bien ce que c'était que le système McKenzie, il a déjà vu des évaluations de patients, il a déjà été soigné comme ça lui d'ailleurs. Et il dit, de ce que lui on comprend, il dit vous prétendez avoir un effet spécifique, ce qui a l'air d'être le cas de ce que j'en connais, mais il faut pouvoir le démontrer d'un point de vue fondamental en fait. C'est-à-dire que, est-ce que vous faites vraiment quelque chose au disque du patient, au nerf du patient ou autre ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui change quand vous faites cette thérapeutique-là ? À partir du moment où tu as ça, là tu gagnes vachement de crédibilité pour après demander, parce qu'un essai clinique c'est... 400, 500 000 euros, donc on gagne en crédibilité pour aller après demander autant d'argent et dire voilà, on a un truc qui fonctionne quand même vachement bien en fondamental. De l'expérience des cliniciens qu'on a, on a quand même de très bons retours, donc est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de tester ça correctement, vraiment en contrôlant tous les paramètres pour vraiment voir si on a un effet ou non chez ces patients-là. Donc je suis passé à l'étape fondamentale et donc je suis allé à la biomécanique et donc j'ai fait ma thèse sur la biomécanique du disque pour essayer de comprendre un peu mieux la biomécanique du disque sain et du disque pathologique. Et ce qui est très frustrant avec un doctorat, c'est qu'on a l'impression qu'on va révolutionner le monde quand on fait un doctorat. Et en fait, on a mis un tout petit poil en plus, un tout petit millimètre en plus sur le tas de connaissances. Et qu'en fait, on repart avec plus de questions qu'en y entrant. Et donc là, maintenant, il faut continuer.
- Speaker #1
Et donc justement, alors tu tends la perche. Tu as d'autres projets en cours ?
- Speaker #2
Oui, alors là, oui. Alors là, j'ai eu ces dernières années, j'ai moins fait de recherche. J'ai plus essayé de valoriser les données que j'avais déjà, parce que j'avais plein de trucs. Et il y a un moment, c'est bien de faire la recherche, mais il y a l'étape d'après où il faut écrire les articles et les publier. C'est la finalité du travail, c'est certes de faire la recherche pour répondre à la question, mais après il faut diffuser ce savoir qu'on a créé et la réponse à la question qu'on a proposée. Donc là, j'ai eu une période, depuis un an, un an et demi, où l'objectif c'était de passer les articles sur les données que j'avais. Donc là, en trois semaines, j'en ai eu deux qui ont été acceptés. Ça faisait un an et demi que je galérais. Là, j'en ai eu deux qui ont été acceptés, donc je suis très content. J'en ai un troisième qui est en lecture. J'en ai un autre que je vais soumettre là. Et j'en ai deux autres qui sont en préparation. Donc là, il faut que ça se soit fait avant de lancer un autre cycle. Et il y a déjà des choses qui se préparent, en fait. Par exemple, il y a une collaboration qui continue avec le service du professeur Rigouard, où là, eux sont en train de développer une... Un traitement un peu spécifique sur le traitement des discopathies sur signes de modique, les discopathies actives, c'est comme ça qu'on les appelle en France, où on a de l'inflammation sur les plateaux vertébraux. Donc ça, c'est vraiment des discopathies particulières qui sont particulièrement complexes et compliquées à gérer en kiné. C'est-à-dire que souvent, ces patients-là, on les allume la plupart du temps. On est souvent un peu coincé par ces patients-là. Et donc là, ils développent des protocoles de... peu invasif parce qu'à l'heure actuelle le traitement quand vraiment le patient est en échec à qui on n'arrive pas à... où on n'arrive pas à s'en sortir, le traitement qu'on a c'est la chirurgie. Donc là, ils essaient de développer des protocoles qui sont moins invasifs. Et pour le coup, la sélection des patients, j'en sélectionne en tout cas tous les patients qui sont de l'Île-de-France, c'est moi qui vais les sélectionner, les trier pour leur envoyer. Et donc là, il va y avoir un travail autour de ça. Et j'ai deux protocoles que je suis en train de... Je n'ai pas encore commencé la rédaction, que j'ai en tête, qu'il faut que je pose sur le papier. pour aller chercher des fonds justement et pour aller lancer la recherche derrière. Et ça, ce sera dans un an, un an et demi, je pense, le temps de finir de passer les articles, le temps de rédiger les protocoles et de soumettre. Je pense que d'ici un an, un an et demi, je devrais avoir des nouveaux projets qui partiront et qui commenceront.
- Speaker #1
Comment tu arrives à organiser ce côté recherche, qui est lié à ta pratique clinique ?
- Speaker #2
J'ai beaucoup d'énergie à canaliser. Ça, c'est un truc... C'est un truc... Alors, déjà, je travaille à mi-temps au cabinet. Je fais deux jours et demi par semaine. Donc déjà, ça me dégage un peu de temps. Et après, j'ai la chance... Enfin, l'équipe Prismatics, l'équipe de recherche avec qui je collabore, ils sont très, très bien organisés. C'est des gens qui sont vraiment très, très bons dans ce qu'ils font. Et chacun a un profil vraiment très spécifique. Et en fait... ça aide vachement ça aide vachement dans la dans la ça fluidifie vachement les choses c'est à dire qu'il y en a on a une personne qui est spécialisée dans tout ce qui est gestion administrative et coordination donc tout ce qui est éthique etc il est excellent, je lui pose la question dans la journée ou trois secondes après j'ai la réponse tous les documents, tout ce qu'il faut etc c'est très bien fait on en a un qui est spécialisé dans l'écriture scientifique et quand on est dans la phase d'écriture On fait les échanges et les papiers sont hyper bien écrits. Après ça part, on a un statisticien qui est hyper fort. Enfin bref, donc le fait d'avoir une équipe qui est très bien organisée comme ça et qui est très, très bien rodée et qui me font confiance et je leur fais confiance. En fait, ça permet d'aller.
- Speaker #1
Chacun a son expertise dans son domaine.
- Speaker #2
Et ça permet d'aller beaucoup plus vite sur certains domaines. Maintenant, je commence à avoir aussi des étudiants de master que je lance sur des projets. Je ne les lâche pas dans la nature, je les encadre, mais ça aide d'avoir des gens qui font une partie du travail. Il y a ça et après, il y a le côté aussi, j'ai de l'énergie à canaliser.
- Speaker #1
D'accord. Alors, quelle est cette influence justement de la recherche sur sa pratique ?
- Speaker #2
Je pense que ça, ça vient vraiment de mon éducation. Ça, c'est le... J'ai toujours... toujours toujours toujours toujours été attiré par les matières scientifiques, c'est toujours ça que j'ai aimé quand j'étais gamin dans ma famille c'est plutôt les matières qui plaisent je sais que les jeux quand j'étais gamin c'était un microscope c'était des trucs comme ça donc j'ai toujours été un peu dans cette... j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit les maths a toujours été ma matière préférée donc voilà j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé ça donc quoi qu'il en soit je pense que Quelle que soit la carrière que j'aurais choisie, il y aurait eu un rapport à la science. Comme je dis, il y a un moment, j'ai hésité entre ingénieur et sciences de la santé. Les deux sont adossés à de la recherche. Je pense qu'il y en aurait toujours eu. Et ça se fait un peu naturellement. Je ne vois pas ma pratique sans ma recherche. Je ne vois pas ma recherche sans ma pratique. C'est les deux.
- Speaker #1
D'accord. Et au sein de ton cabinet, c'est plutôt monopro, il n'y a que des kinés ? Comment ça se déroule, comment ça s'organise ?
- Speaker #2
On n'a que des kinés, on est assez nombreux, on est sur deux sites différents. On a un site qui est plutôt orienté rachis, douleurs chroniques, membres sup, et un site qui est plutôt orienté traumatomes, membrinfes, kinés du sport. On est assez nombreux, mais il y a beaucoup de gens passionnés dedans. C'est un peu une fourmilière, une pépinière dans tous les sens d'idées, etc. Et c'est que des kinés.
- Speaker #1
D'accord. Et donc, tu as des contacts, je présume, beaucoup avec les chiens, avec radiologues. Comment ça se déroule ?
- Speaker #2
En effet. Alors, à partir du moment... Alors, moi, j'ai quand même vachement spécialisé ma pratique. J'ai beaucoup de problèmes de rachis. Et c'est marrant parce que dans ma patientèle, j'ai vraiment... Enfin, on pourrait croire que j'ai que des cas compliqués. En fait, non, j'ai vraiment tout. et J'ai des gens qui me voient par exemple sur internet sur des émissions ou des choses comme ça et donc ils viennent et en fait ils veulent juste être rassurés, avoir le coup de tampon du gars qui est passé à la télé. Donc bon, c'est sympa mais voilà. Et après j'ai aussi des, et ça va de ce type de patients là aux patients qui sont dans des états pas possibles, opérés trois fois, enfin vraiment où ça va pas. Et donc... quand on a ce type de patient-là, travailler seul, c'est impossible. Enfin, c'est illusoire de vouloir penser qu'en kiné, on va sauver ces patients-là. Il y a une obligation de travailler à plusieurs. Et donc là, pour le coup, j'ai commencé à me créer un espèce de réseau par C'est vraiment du relationnel. C'est des médecins avec qui j'ai échangé lors de soirées, lors de conférences, lors de... On s'est envoyé des patients, ils ont vu que ça fonctionnait bien, donc maintenant il y a un échange qui se fait. Donc j'ai des contacts avec deux radiologues avec qui j'envoie. C'est des radiologues interventionnistes qui font les infiltrations guidées, les blocs diagnostiques, ce genre de choses-là. C'est très très utile. Par exemple, le dernier patient que j'ai vu ce midi, c'est un patient que j'envoie faire une infiltration. Un bloc diagnostic et une infiltration sur une zygapophys parce que je pense que c'est ça qui lui pose problème. Et en fait, disons que moi, je n'ai pas grand chose à lui apporter. On a une arthropathie inflammatoire sur cette articulation-là. Ça se voit à l'IRM, ça se voit dans son tableau clinique. Et en fait, moi, en tant qu'iné, le truc que je peux lui apporter, ce n'est pas du traitement, c'est l'orientation vers le bon professionnel. Et ça, on pourrait y revenir parce que ça, je pense que dans les pathologies du rachis, celui qui allait... Celui qui a les meilleurs outils pour faire ça, c'est le kiné. C'est vraiment, on peut être au cœur avec, en apprenant bien comme il faut, à poser son raisonnement, en ayant un peu de connaissances en lecture d'imagerie, en ayant une idée de comment structurer un peu un examen clinique spécifique au diagnostic patho-anatomique. On peut avoir vraiment, on peut être des gros, gros aiguilleurs sur des patients comme ça et éviter de les faire errer trop longtemps. Donc voilà, j'ai mes deux radiologues à qui j'envoie assez souvent pour infiltration, que ce soit sur zigapophie, sur sacroiliac, sur une épidurale, si le patient a une grosse sciatique ou une grosse NCB qu'on n'arrive pas à gérer. Bref, j'ai ces patients-là. J'ai un neurochirurgien avec qui je m'entends très très bien et à qui à chaque fois qu'il y a un avis chirurgical à avoir, je lui envoie à lui. Je m'entends très bien avec lui pour plusieurs raisons. Déjà, il d'une, quand je lui écris une lettre et que je mets des choses dedans, il le lit et il en prend compte. Et ça, ça change. Les deux radiologues aussi, d'ailleurs. C'est aussi en partie pour ça que je bosse avec eux. Et aussi, c'est parce que, peut-être faire rigoler, mais ce n'est pas un chirurgien avec le bistouri entre les dents. C'est-à-dire que quand le patient, il vient, son objectif, c'est de ne pas l'opérer. Si on ne peut pas faire autrement, ça ira à la chirurgie. Mais son objectif premier, c'est de faire en sorte que le patient ne soit pas opéré. Et ça, c'est un certain confort, surtout quand le patient est là avec une demande très, très forte de chirurgie, où on sait que ça va être une mauvaise idée. En plus, il est assez réputé. Je l'envoie voir ce chirurgien-là. Et généralement, il dit non, tu retournes voir le kiné. Et ça fait un... Il maximise l'effet de la kiné derrière. Et après, quand il y a besoin, parce qu'évidemment, il y a des cas où il y a besoin, c'est un très bon technicien. Il fait très bien les choses. Et il envoie les patients rapidement en kiné derrière. Enfin bref. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme ça. Je suis allé le voir repérer plusieurs fois. Je suis allé le voir en consultation aussi. J'ai un chirurgien et mes radiologues avec qui je bosse beaucoup. Les généralistes aussi du coin, j'échange assez souvent, ceux qui m'envoient les patients. Après, voilà un peu mon réseau. Il me manquerait psychologue, psychiatre pour pouvoir gérer certains problèmes plus d'ordre psy avec certains patients. mais Je ne les espère pas, j'en aurai de chance. On s'en appelle. Après, j'ai un collègue qui a des contacts, donc si j'ai besoin, je lui demande.
- Speaker #1
Tu sais. Tu sais à qui demander. Voilà,
- Speaker #2
exactement.
- Speaker #1
Tu as développé des compétences en lecture d'imagerie.
- Speaker #2
Oui. Alors, ça, ça s'est fait de plusieurs manières. Alors déjà, ça a été...
- Speaker #0
Le premier truc que j'ai fait, c'est qu'il y a des échelles. Pour dire qu'un disque qui est dégénéré, il doit avoir tel critère, tel critère, tel critère. Un disque qui a une urne discale, c'est tel critère, tel critère, tel critère. Donc j'ai pris les échelles, je les ai appris, j'ai pris les images et j'ai regardé. Et surtout, j'ai fait un truc qui a beaucoup changé. Et ça maintenant, quand je fais des TP, je fais des TP avec les étudiants, je fais des TP au cours de conférences. Il y a un truc qui change la donne avec l'imagerie. C'est qu'on prend le CD, on le met dans l'ordinateur. on le regarde dans le logiciel, et bien ça fait une grosse grosse différence parce qu'on a les orientations des coupes, on peut se repérer dans l'espace, on peut faire des zooms on peut jouer sur les contrastes et ça change vraiment tout donc à partir du moment où j'ai commencé à faire ça j'ai commencé à acquérir un peu de compétences et après j'ai fait beaucoup de consultations avec des chiens en fait, je suis allé les voir assez régulièrement en fait et donc il n'y a pas, il y a l'imagerie et donc là je pose des questions et ils m'expliquent et puis à force on se fait l'oeil et ça vient je suis allé voir des conférences avec des radiologues aussi Merci. Donc, je retiens ce qu'il propose et j'essaye de revoir derrière. Et ce n'est pas si compliqué que ça. On s'en fait un monde, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Après, ça demande quand même un peu de travail et un peu de... Enfin, c'est une vraie compétence à développer. Et je ne dis pas que je suis expert. Je pense qu'un radiologue a mieux l'œil que moi. Mais je me développe.
- Speaker #1
Oui. Et d'ailleurs, on a un peu parfois le discours un peu inverse, où justement, quand un patient arrive qui nous tend les imageries, on les met sur le côté, justement, pas de corrélation entre l'imagerie, les signaux cliniques, voilà. Et en fait, ça vient un petit peu à contre-courant, presque.
- Speaker #0
Alors oui, disons que, sachant que j'ai tenu ce discours-là pendant longtemps, jusqu'à temps que je sache lire une imagerie, que je sache l'interpréter, en fait. En gros, c'est, il y a, en fait... Dans les pratiques, souvent on a des tendances à aller d'une position extrême à une autre position. C'est-à-dire que pendant un temps, il y avait une urne discale ou il y avait de l'arthrose, c'était la cata, on ne pouvait rien faire. Et c'était la panique, etc. Il y a eu ça pendant un moment. Et ça, c'est-à-dire qu'on se basait uniquement sur l'imagerie pour déterminer la pathologie du patient. Ça, c'est faux. Ça, ça ne marche pas. Et c'est même contre-productif et c'est même souvent une erreur à faire. Par contre, l'autre extrême... qui est arrivé et que j'ai défendu pendant un moment, de dire que l'imagerie, ça ne sert à rien, de toute façon, c'est que l'expérience du patient qui compte, que la clinique, etc. C'est aussi une erreur. C'est-à-dire qu'il y a une position plus centrale entre ces deux extrêmes qui est là. C'est-à-dire que l'imagerie, ce n'est pas quelque chose qui va nous donner le diagnostic. Ça, c'est un truc... Alors, ça dépend des images et ça dépend des pathologies. En fait, je vais peut-être nuancer encore. En gros, il faut vraiment voir le processus de diagnostic sur lequel on va identifier une pathologie. C'est un processus qui est probabiliste, en fait. C'est-à-dire que mon patient, quand il arrive, mettons, on imagine qu'on a cinq maladies, A, B, C et D, il a une probabilité d'avoir ces maladies-là. Et toutes les informations qu'on va récupérer au cours de nos échanges qu'on va avoir avec lui, les tests cliniques qu'on va faire, des examens médicaux, ça peut être l'imagerie, mais ça peut être aussi des biologies, ça peut être aussi un ectromiogramme ou ce genre d'examen. Tous ces éléments-là vont servir à faire fluctuer les probabilités, en fait, jusqu'à temps qu'on ait une maladie qui se dégage avec une probabilité qui est vraiment très élevée parce qu'il y a beaucoup de signes qui convergent vers cette maladie-là. Et en fait, l'imagerie, c'est ni plus ni moins qu'un des éléments qui va aider à faire fluctuer cette probabilité-là. En gros, c'est quelque chose qui peut avoir plus ou moins de poids en fonction du type de pathologie, mais c'est un élément de la même manière qu'un examen neurologique positif est un élément, que de la même manière qu'un EMG est un élément, et c'est tous ces éléments-là qui vont converger. Sachant que l'imagerie n'est pas parfaite, et ça, je l'ai bien compris dans ma thèse, parce que j'ai beaucoup utilisé l'IRM dans ma thèse, et c'est aussi un des moments où j'ai beaucoup appris à lire les imageries. J'ai eu tout un chapitre sur l'IRM dans ma thèse, et c'est là aussi que j'ai pu comprendre les limites qu'il y a derrière. Un truc tout bête, tout simple. Pour la colonne, déjà, les IRM se font allonger. Et les patients allongés, souvent, c'est les positions ontalgiques. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà un changement. Et le peu de recherche qu'il y a qui compare, par exemple, des largeurs de canal entre de la charge et de la décharge, on a des grosses différences qui peuvent arriver. Donc en fait, il faut bien avoir conscience que c'est un outil qui nous montre des choses, mais qui est imparfait et qui est à prendre dans un contexte complet. Par exemple, je vais prendre un cas tout simple. Un patient qui arrive et qui présente un tableau de douleurs radiculaires qui partent dans la jambe avec des paresthésies sur le bord externe du pied, il a du mal à monter sur la pointe du pied. Il s'est déclenché ça en ramassant quelque chose au sol un peu lourd. Il a senti un poc dans le dos. Il avait mal au dos avant. Le mal au dos a disparu. maintenant c'est dans la jambe L'aernie qu'il y a sur l'IRM, c'est ça qui pose problème. Faut pas... Enfin, c'est ça. Par contre, le patient qui arrive, qui a 70 ans, qui présente des signes de canal lombaire étroit et qui te dit « je suis vachement mieux quand je marche et je suis pire quand je suis assis » , c'est pas le canal lombaire étroit qui pose problème. C'est là où il faut l'interpréter dans un contexte et c'est pas aussi simple que « ça sert à rien » ou « on se base que sur ça » . et Je trouve ça à la fois, disons que ça ne peut pas nous conforter dans une paresse intellectuelle parce qu'on va être obligé de réfléchir, mais c'est aussi très valorisant parce que justement, il va falloir réfléchir et comprendre la pathologie qu'on est en train d'essayer de chercher, quels signes cliniques on doit avoir, à quoi ressemble la clinique, à quoi ressemble ce que raconte le patient, à quoi ressemble l'imagerie et c'est l'ensemble qui va nous orienter plutôt vers ça ou plutôt vers ça.
- Speaker #1
Vraiment une pondération de... C'est différent par métaux.
- Speaker #0
Exactement. Et là, on est vraiment dans une logique de raisonnement où on intègre les différents éléments, où on ne se base pas que sur l'imagerie. Typiquement, c'est des exemples que j'ai souvent, mais des patients qui me disent, j'ai un docteur qui veut m'opérer, il m'a dit de lui envoyer le CD de l'imagerie, je lui ai envoyé, et là, il me dit qu'il veut m'opérer. Je lui dis, non, ça ne faut pas. C'est clairement là, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait... Il faut qu'il y ait la clinique. Et d'ailleurs, les chirurgiens avec qui je travaille, le patient, il a un examen clinique peut-être pas aussi poussé que ce qu'on pourrait faire en kiné, mais il a un examen clinique avec examen neuro, avec les mobilités, les amplitudes. Le patient, il a le temps de raconter son histoire. Je vois par exemple le professeur Igoire, quand il est en consultation, ils sont six en consultation. Il ne prend jamais une décision tout seul. Il y a lui, le neurochir, mais il y a aussi le médecin algologue. Il y a aussi le psychologue, le psychiatre, il y a l'assistant social et il y a l'infirmière de bloc, infirmière de bloc, infirmière de l'anesthésiste qui est là avec lui. Et ils ont tout ça. Et après, une fois que le patient est parti, il y a une concertation pour déterminer s'ils opèrent ou pas. Après, c'est des patients particuliers. Lui, il a vraiment des patients douloureux. C'est vraiment du fin de parcours. Mais clairement, le discours qu'il a, lui aussi, c'est la même. S'il n'y a pas un examen, s'il n'y a pas de la discussion avec le patient, non, c'est pas possible. Donc voilà, il faut voir les choses un peu comme ça.
- Speaker #1
On va parler maintenant de ton activité d'enseignement. Donc tu enseignes en formation initiale, mais aussi continue, je pense.
- Speaker #0
Oui, je fais les deux, oui.
- Speaker #1
Dans quel cours, alors, tu dispenses ?
- Speaker #0
En continue, je fais pour Mackenzie. Et c'est essentiellement ce que je fais. Et en formation initiale... Alors, il y a initiale pour les étudiants et initiale en master. Donc, enfin, master à Amiens, par exemple. Donc là, à Amiens, je fais les cours... plutôt musculo-squelettique. Donc là, maintenant, cette année, je vais faire... Il y a les cours de communication, il y a les cours sur les pathologies du rachis, les ateliers de résolution de cas complexes, et je sais plus, j'en ai un autre encore, mais je m'en rappelle plus. Et en formation initiale, je fais essentiellement les pathologies du rachis, communication aussi. Et là, je vais commencer aussi les statistiques avec une autre équipe sur une école. On a un module sur les statistiques à faire, donc je vais être là-dedans aussi.
- Speaker #1
D'accord. Tu aurais des formations, justement, à conseiller au kiné ? Par hasard.
- Speaker #0
Je n'ai pas du tout à me dire. Je vais vous dire McKenzie, fortement. Non, non. Alors, il faut le prendre vraiment avec la modération qui convient, étant donné que je suis formateur McKenzie, donc j'ai forcément un lien d'intérêt. Donc, je dirais McKenzie. Après, il y en a d'autres qui sont vraiment très bien. Il y a la formation, les formations d'entretien motivationnel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la pratique. Enfin, je dirais pas que l'entretien motivationnel, la communication au sens large. Donc, les formations en communication, ça peut être aussi la communication violente. Ça, je ne l'ai pas fait, mais c'est un truc que j'aimerais bien faire. Ou l'éducation thérapeutique. tout ce qui va nous aider à mieux communiquer avec le patient, à mieux lui expliquer les choses, à mieux extraire les informations. Enfin, ce n'est pas extraire les informations, c'est... Faire en sorte qu'il puisse nous donner toutes les informations qui nous sont importantes et utiles, et pas seulement des informations sur le niveau de douleur ou sur la neuro, c'est comment est-ce qu'il vit son problème, comment ça se passe à la maison avec son problème, parce que tout ça c'est des éléments qui peuvent être assez déterminants dans la gestion des patients et qui peuvent vraiment orienter les choses et c'est pas toujours évident en fait à aborder. On peut prendre des exemples tout bêtes, la question du... Du sexe après la chirurgie, c'est pas toujours un truc qui est abordé, or... C'est un sujet important dans un couple et il faut le poser à un moment. Savoir aborder ces choses-là, savoir en discuter avec les patients. Quand on a un patient qui ne va pas bien et qui se met à fondre en larmes, comment est-ce qu'on gère ces aspects-là ? Comment repérer les signes de dépression aussi ? Parce qu'il y a des patients, clairement, quand ils arrivent, et qu'ils ont mal depuis 8-9 mois, et que ça traîne, et qu'ils ne sont plus capables de faire quoi que ce soit. Il y a des signes de dépression qui arrivent. Et là, la dépression, c'est... On a des choses à proposer, nous, en kiné. Mais avant toute chose, la dépression, il y a un traitement, un médicament, deux en psychothérapie à faire. Et donc, comment est-ce qu'on amène les choses au patient pour lui dire, bon, ce serait bien qu'on fasse des choses en plus de la kiné. Et comment est-ce qu'on aborde les choses ? Donc, toutes ces choses-là, là, vraiment, le côté communication, c'est un truc qui est important. Et je pense qu'on n'est jamais assez formé à ça. donc ça c'est un truc auquel on pense pas forcément mais qu'on peut rajouter et après J'ai envie de dire, il y a des choses qui sont vraiment chouettes, que de plus en plus, moi, je me forme comme ça. C'est sur des conférences et des congrès, en fait, où là, on a vraiment tout le panel, en fait. C'est-à-dire qu'on va voir des gens qui sont pointus dans un domaine. Et quand on veut approfondir un sujet, on va voir tel chercheur spécialisé dans ce domaine-là. Enfin, tel chercheur. Cliniciens-chercheurs. Parce que que chercheurs, c'est intéressant pour les chercheurs. Et cliniciens-chercheurs, c'est intéressant pour les cliniciens, en fait. et qui va approfondir vraiment ce domaine et on va pouvoir retirer des informations très ponctuelles et très précises pour certains cas de figure et qui permettent d'avancer. Donc ça, je trouve ça bien. Après, vraiment, je trouve, et après tu pourras peut-être donner ton avis toi aussi, mais l'idée de faire un master, c'est aussi une manière de, de sortir de sa zone de confort parce qu'on retourne sur les bancs de la fac et il y a des partiels à valider et pour valider un partiel, il faut réviser. Et pour réviser, il faut réouvrir ses cours. Et donc, il y a vraiment le fait de se mettre en difficulté fait qu'on va apprendre plus.
- Speaker #1
Et 20 ans après, ce n'est pas facile.
- Speaker #0
Et de deux, c'est que maintenant, il commence à y avoir des choses vraiment chouettes qui sont en train d'arriver en master. Pendant une certaine époque, c'était vraiment très orienté recherche. Maintenant, il commence à y avoir des choses qui commencent à sortir plutôt orientées pratiques. Je vois Amien en train de faire des modifications pour qu'il y ait vraiment un... Une vraie plus-value pour les cliniciens qui vont faire ça. Alors, il y aura forcément un aspect méthodologique, savoir lire un article, savoir écrire, etc. Ça fait partie des compétences de la personne qui validera un Master 2, mais il va y avoir aussi des compétences un peu plus cliniques qu'on va essayer de mettre en place, notamment de raisonnement, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le côté probabiliste. Ça, c'est des choses qu'on va vraiment plus creuser maintenant.
- Speaker #1
Quel conseil tu donnerais à un kiné qui souhaite justement allier pratiques cliniques, se lancer en recherche ? Quelles seraient les premières étapes pour lui ?
- Speaker #0
La première étape, c'est faire un master. C'est le premier socle de la pyramide. Deuxième étape, et c'est important pour ne pas faire de conneries, c'est que la recherche est très réglementée. Il y a vraiment une législation, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. notamment au niveau de la protection des données, notamment au niveau de la modification du parcours de soins qu'on va induire aux patients, etc. Donc, ne pas se lancer tout seul, ça, ce serait une vraie erreur. Et si on a vraiment envie de bosser, de faire de la recherche, c'est de se rapprocher d'une équipe de recherche. Et déjà, il y a un master, forcément, donc ces aspects-là, on en discute et on en voit. Et de toute façon, la plupart des masters, il y a un stage à faire. Donc potentiellement, si on a vraiment envie de faire de la recherche, allez le faire dans une équipe de recherche. Et là, pour voir de l'intérieur comment ça se passe, et voir justement, par exemple, le rôle du, par exemple, nous, de la personne qui s'occupe des aspects légaux, il va vérifier que le protocole, dans quelle catégorie de protocole il se place, est-ce que les demandes ont été faites correctement, etc. Ça peut paraître hyper chiant à faire, mais c'est indispensable, sinon tout le monde va en prison. On ne peut pas faire des choses comme ça. Donc, en fait, il ne faut pas se lancer tout seul. Il faut aller voir, il faut se rapprocher de gens qui savent faire. Pour le coup, moi, les aspects légaux, c'est moins mon truc. Je sais vaguement les choses. Mais quand j'ai une question, je contacte la personne. Il me dit, tu fais ci, ça, ci, ça, ci, ça et ce sera bon. Donc, voilà. Donc, un, le master pour commencer à avoir les premières compétences et voir un peu ce que ça représente, voir un peu ce que c'est. Et si dans le master, vous avez l'occasion de faire un stage dans une équipe de recherche, là, vous voyez vraiment de l'intérieur ce que c'est que la recherche. Parce qu'il y a des fois, il y a ce qu'on s'imagine et ce que c'est réellement. Ce n'est pas toujours pareil. Et une fois qu'il y a ça, se rapprocher d'une équipe de recherche, proposer des projets. Je vois que nous, par exemple, à Prismatics, il y a la possibilité de soumettre des projets. Et donc, on présente un petit PowerPoint, on explique ce qu'on veut faire, etc. Donc, ils ont ouvert ça essentiellement pour les... pour les internes de chirurgie du CHU de Poitiers, mais je sais qu'il y a des paramedicaux qui peuvent venir proposer un projet. Et donc, ils voient, s'ils pensent que c'est intéressant et viable, potentiellement, ils peuvent proposer un encadrement et voir comment faire, quel financement aller chercher, comment structurer les choses, etc. Mais il y a quand même pas mal d'aspects légaux et structurels à avoir en tête et ça, ça ne s'invente pas.
- Speaker #1
Qu'est-ce que c'est alors Prismatics ?
- Speaker #0
C'est le nom de l'équipe de recherche à laquelle je suis rattaché, qui est sur le CHU de Poitiers. Ils n'ont pas encore le statut de laboratoire de recherche, ou ils vont l'avoir, je ne sais plus. Parce qu'après, dans la nomenclature, il y a laboratoire de recherche, il y a équipe de recherche, et il y a encore d'autres. Et eux, je crois qu'ils sont équipe de recherche, et ils vont passer laboratoire de recherche. Il y a des certifications. C'est ça, c'est des histoires de certification, et de numéros, et de choses à valider.
- Speaker #1
Ok, un grand merci Jean-Philippe. De rien.
- Speaker #0
Merci encore de m'avoir invité.
- Speaker #1
Je t'en prie, avec plaisir. Et puis peut-être à bientôt.
- Speaker #0
Peut-être à bientôt. Merci,
- Speaker #1
au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes. et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur trois en France. Rassurant non ? Des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés.