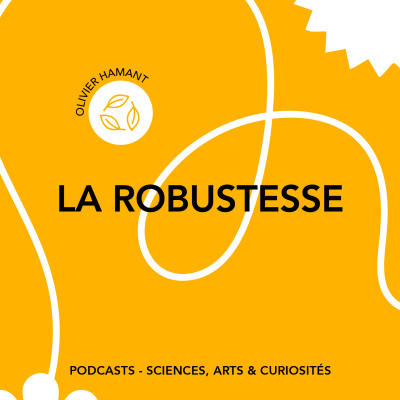- Speaker #0
Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
- Speaker #1
Ce qui place votre zone d'atterrissage à 5,0667 degrés de latitude nord et 77,3333 de longitude ouest.
- Speaker #0
Rien de tout ça, Néré. Qu'est-ce que le réel ?
- Speaker #1
La seule variable constante est l'inattendu.
- Speaker #2
On ne peut pas la contrôler. Je crois que vous êtes encore pire que ces créatures. Elle, elle n'essaie pas de se massacrer entre elles pour tirer le plus gros paquet de fric.
- Speaker #0
Voyons si une capacité de poussée de 10% permet le décollage. Et 3, 2, 1...
- Speaker #3
Chère auditrice, cher auditeur, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment moi qui accueille mon invité, mais bien l'inverse. En effet, je suis dans le bureau de mon invité, dans le département Science, Philosophie et Société, au sein de la faculté de Philosophie. et lettres de l'Université de Namur. Alors, ce podcast est un peu spécial à mes yeux. Pendant une heure aujourd'hui, nous allons aborder les thématiques détaillées dans le film Don't Look Up. Pour rappel, ce film, avec entre autres Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, est sorti en 2021. Je refais très rapidement le pitch. Le film évoque la chute prochaine d'une grande comète qui va complètement ravager la Terre et tuer tous ses habitants. et la difficulté que rencontrent les scientifiques qui l'ont découverte pour prévenir le monde face à la désinformation, au déni et au sarcasme du monde médiatique et politique comme du grand public. Et bien entendu, ils font face aussi à la cupidité et à l'inaction de la présidente des Etats-Unis sous la coupe du puissant créateur d'une grande entreprise technologique. Bien entendu, tout parallèle avec une situation que nous connaissons et que nous vivons peut-être potentiellement à l'heure actuelle, est bien entendu voulue et assumée. Alors, quand le film est sorti, je me suis dit que je devrais absolument faire un épisode autour des thématiques abordées, mais je ne trouvais pas d'angle d'attaque qui viendrait compléter le propos du film. Et après, de mon côté, c'est un petit peu tombé dans l'oubli. Et il y a quelque temps, j'ai pu assister à une conférence de mon invité du jour. Et dans la foulée, je lui ai demandé s'il n'était pas d'accord de faire un épisode autour de ce film, donc d'un look-up. Ça tombait bien parce que de son côté, il avait aussi travaillé sur le film. Et entre-temps, la situation est devenue celle que l'on connaît aujourd'hui, un président américain qui censure l'utilisation de certains termes, qui est climato-sceptique, qui décide de ne plus financer des universités et qui adapte la vérité selon ses propres désirs. Alors ce podcast, je trouve qu'aujourd'hui, et ce n'est pas plus mal en fait qu'il ait pris un peu de temps à sortir, plus de 4 ans, ce podcast, je trouve qu'il prend tout son sens. Et aujourd'hui, je vais enfin révéler le nom de mon invité, je ne l'ai pas encore fait, je suis accueilli par... Olivier Sartenard de l'Université de Namur. Bonjour Olivier.
- Speaker #4
Bonjour.
- Speaker #3
Comment vas-tu ?
- Speaker #4
Très bien, merci.
- Speaker #3
Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire qui est Olivier Sartenard ?
- Speaker #4
Olivier Sartenard, c'est en fait un professeur en philosophie des sciences et ce qu'on appelle aussi parfois improprement l'épistémologie, donc la théorie de la connaissance, ici à l'Université de Namur, où j'enseigne. J'enseigne essentiellement en faculté des sciences. Donc des cours de philosophie, de philosophie des sciences, d'histoire des sciences, de logique, d'argumentation, donc tout ce qui est ressorti un peu aux sciences humaines, on va dire. Je suis un peu le représentant de sciences humaines dans la faculté des sciences. Et en parallèle, comme la plupart des professeurs, j'effectue des recherches également dans le champ de la philosophie des sciences essentiellement.
- Speaker #3
C'est clairement le sujet qui va nous occuper pendant une heure aujourd'hui. L'idée de ce podcast, c'est d'essayer de remettre un peu l'Église au milieu du village au final, de revenir sur des concepts basique mais important pour comprendre ce qu'est la science, comment elle se construit, comment elle s'insère dans le débat médiatique et dans le débat sociétal. Et on le sait, avec la crise sanitaire, on a traversé beaucoup de turbulences par rapport à ce corpus de connaissances face aux médias. Et donc voilà, l'idée c'est un petit peu de partir sur tous ces thèmes, d'aborder comment la science se construit, je l'ai dit, comment elle est perçue et comment elle doit au final mieux s'intégrer. dans le débat public que c'est le cas pour l'instant. Première question que je voudrais te poser, c'est au final, quand t'as vu le film, ça date, mais quand t'as vu le film, comment t'as réagi en fait ? Qu'est-ce que tu t'es dit en voyant Don't Look Up ?
- Speaker #4
Je pense que j'ai assez vite évolué d'une situation où je me suis dit, je pense que c'est une réaction assez naturelle, c'est quand même un peu gros, cette question d'une comète, on refuse même de lever les yeux au ciel pour la voir, ça me paraît un peu gros. Et puis en réalisant en fait et en avançant progressivement dans le film, je me suis dit en fait c'est... Pas si éloigné de la réalité, c'est assez bien vu, ça met en place pas mal de ressorts qui, comme ça a été dit en introduction, en fait, on les observe. Il ne faut pas être un feint observateur pour voir que dans le monde médiatique actuel et dans le monde fondamentalement de comment les sciences sont traitées sur la place publique et comment les scientifiques sont traités sur la place publique, on reconnaît quand même des moments d'un look-up. D'ailleurs, il y a eu beaucoup après de moments médiatiques qui ont été décortiqués comme ça. On nous aurait regardé, c'est exactement comme ça que ça se passe dans le film. Et le trait n'est pas si exagéré que ça en réalité.
- Speaker #3
En sachant que le film parle d'une comète, mais que le problème qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas une comète, spoiler alert, c'est tous les enjeux socio-écologiques et ce qu'on a tendance à mettre à l'heure actuelle derrière le réchauffement climatique, en sachant que le problème est plus large que celui-là. Alors, la science, elle se base sur des théories, sur des hypothèses. Comment tout ça, en fait, se construit ? Quelle est la différence entre une hypothèse, une théorie et un fait scientifique ?
- Speaker #4
Ou alors là, c'est des notions assez... complexes et en fait elles ont de complexité non pas tant liées au fait qu'elles sont étudiées en philosophie selon différents aspects que ce sont aussi des notions de la vie de tous les jours c'est des notions linguistiques qu'on manipule quotidiennement donc sont fortement connotés c'est parfois difficile justement d'éliminer des connotations classiques or je crois que si on veut revenir un peu à la racine je pense qu'une notion élémentaire à aborder avant peut-être de rentrer dans la question de l'hypothèse c'est la notion élémentaire de l'épistémologie qu'elle ne sont de croyances mais croyance justement c'est de nouveau un terme assez compliqué parce qu'évidemment il est connoté quand on dit croyance on pense souvent croyance religieuse croyance idéologique, donc quelque chose de très spéculatif, mais en fait, en épistémologie, une croyance, c'est quelque chose de beaucoup plus basique et banal que ça. Une croyance, c'est simplement une disposition à tenir quelque chose pour vrai. Donc par exemple, moi, je crois que je m'appelle Olivier, je crois que nous sommes en train ici de discuter à l'unamur dans mon bureau, et je crois éventuellement, j'ai le dos tourné par rapport à la fenêtre, qu'il pleut, et là, je me retourne et je dis « Ah, ben cette croyance est fausse, mais ça n'empêche peut-être que pendant un instant, j'ai entretenu cette croyance. » Donc une croyance, c'est quelque chose d'assez basique comme cela, et il me semble qu'une hypothèse, pour revenir maintenant à la question, une hypothèse c'est d'abord un type de croyance. Donc c'est en fait simplement une... quelque chose qu'on va tenir pour vrai. Et généralement, on va utiliser le mot hypothèse pour catégoriser, gérer une sous-catégorie de ces croyances, pour dire que c'est éventuellement une croyance dont on va pour le moment supposer qu'elle est vraie, mais on aimerait bien la mettre en test. C'est-à-dire qu'on aimerait bien savoir si, en définitive, ce qu'on prend comme une hypothèse, une sorte de conjecture, faisons l'hypothèse que c'est vrai, regardons à quoi ça devrait ressembler le monde si cette hypothèse était vraie, et mettons en place du coup une enquête, une enquête scientifique, pour la tester, pour finalement conclure, tiens, finalement, l'hypothèse de départ, elle était vraie, ou au contraire, elle était fausse. D'accord, donc c'est, on va dire, une sorte de croyance temporaire dont on ne sait pas encore très bien si elle est vraie ou fausse, mais qu'on aimerait bien élaborer une enquête pour la tester. Je crois que c'est une manière assez canonique de comprendre ce qu'une hypothèse peut vouloir dire. Maintenant, tu as également parlé de théorie, mais la théorie c'est généralement quelque chose de beaucoup plus large. Quand on parle d'une théorie scientifique, on va dire la théorie de l'évolution, lorsqu'on parle d'une théorie, je ne sais pas, géologique, la théorie de la dérive des continents, ben ça c'est un ensemble de beaucoup de choses, dont des hypothèses, Donc des choses qui sont tenues pour vraies jusqu'à preuve d'être éventuellement établies, ou au contraire. rejetée, mais il y a beaucoup d'autres choses dans des théories. Il y a des phrases, il y a des équations, il y a des modèles. Donc, grosso modo, on va dire qu'une théorie, pour simplifier, c'est un ensemble de représentations du monde. Un ensemble de représentations du monde qui va être plus ou moins correct, plus ou moins adéquat à la réalité. Une théorie sera bonne si la manière dont elle représente le monde est assez correcte, correspond à la réalité. Au contraire, elle ne sera pas bonne. D'ailleurs, elle pourrait être abandonnée si on réalise qu'en fait, elle n'est pas raccord à la réalité. Et je pense que le dernier élément que tu as mentionné c'est un fait scientifique tout à fait Ça, c'est vraiment une expression qui me dérange beaucoup, moi, le fait scientifique, parce qu'il y a déjà dans les termes quelque chose d'assez contradictoire de parler de fait et de scientifique, mais en même temps, il y a une connotation du langage naturel que je comprends. Alors, je vais peut-être commencer par la première partie. Je n'aime pas tellement parler de fait scientifique parce que, en fait, pour un philosophe, mais pour moi de manière générale, les faits, c'est simplement relatif non pas à nos représentations du monde, aux théories, à la façon dont on construit, je dirais, des phrases, des modèles, des représentations. Le fait, c'est ce qui est dans la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, le fait que je m'appelle Olivier, ça, ça ne dépend pas de moi. C'est mes parents qui ont décidé de m'appeler Olivier. Et je peux croire que je m'appelle Olivier ou ne pas croire que je m'appelle Olivier, mais ça ne changera rien à ce fait. Le fait qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil, ça ne dépend pas de moi. Le fait que les continents dérivent pour revenir à la science, ça ne dépend pas nécessairement de moi. Et j'ai du mal avec l'idée que certains faits soient scientifiques et d'autres pas. Je prends l'exemple de la Terre est ronde. Est-ce que c'est un fait scientifique ou est-ce que c'est simplement un fait ? Tout simplement, l'épithète scientifique sur les faits, ça me dérange un petit peu. Mais je comprends ce qu'on veut dire, parce que généralement, quand on utilise l'expression de fait scientifique, on veut dire quelque chose de béton. de bien établi, quelque chose qui est par exemple le fait de l'évolution, ça c'est un fait scientifique, on veut dire par là, je pense, quand on utilise cette expression un peu improprement, de dire, ben là c'est quelque chose qui a été suffisamment bien établi pour qu'on n'en doute plus. Mais le problème, à mon sens, c'est qu'alors, c'est pas un fait, c'est une théorie. C'est-à-dire qu'en fait, dans la science, on ne sort jamais des représentations. Bien sûr, le but des représentations est de s'arrimer aux faits, et de coller aux faits qui sont extérieurs à la science, mais on reste toujours dans le champ des représentations. et je sais qu'il y a un enjeu très fort et je peux prendre ça comme exemple qui cristallise cette difficulté autour de la terminologie entre fait scientifique et théorie scientifique, lorsqu'il est question de pseudosciences, et en particulier, je peux prendre l'exemple de la controverse entre les évolutionnistes qui vont dire « grosso modo, les espèces évoluent par sélection naturelle ou autre mécanisme, et donc l'humain viendrait d'espèces préexistantes, notamment singes » , versus les créationnistes, qui sont une forme de pseudosciences qui défendent que non, toutes les espèces ont été créées, on va dire, spontanément, comme ça, par Dieu, il y a 6000 ans, ou selon les récits, ça dépend un petit peu. Mais généralement, les créationnistes vont dire aux évolutionnistes ... Ben non, ce n'est pas un fait l'évolution, c'est une théorie. Et ça c'est un piège argumentatif, et les évolutionnistes, et j'en connais beaucoup, qui tombent dans ce piège, me disent « mais non, c'est pas une théorie, c'est un fait ! » et ils tombent précisément dans le piège, parce que bien sûr c'est une théorie, ce qu'il faut répondre c'est « non, évidemment, la théorie de l'évolution, c'est une théorie comme toutes les autres théories scientifiques, mais c'est une bonne théorie. C'est une théorie qui est tellement bien justifiée aujourd'hui, qu'on ne peut plus raisonnablement en douter, au contraire de la théorie créationniste, ce qui est une mauvaise théorie, qui est une théorie pseudo-scientifique, qui est une théorie qui n'a pas de justification. Mais devoir se sentir obligé d'en venir au fait en disant non, non. La théorie de l'évolution, c'est un fait. Non, non, il y a un fait de l'évolution éventuellement dans le monde. Je crois qu'il y a un fait de l'évolution. Mais ce que font les biologistes, c'est d'essayer de s'arrimer à ce fait en le décrivant, en le représentant dans ce qui est bien une théorie. Il ne faut pas prendre comme une insulte le fait que c'est une théorie. On sent bien que ce que les créationnistes veulent dire par là, c'est, quand ils disent « ce n'est qu'une théorie » , ils veulent dire « ce n'est qu'une opinion » . Mais c'est sur ce plan-là qu'il faut les attraper et se dire « Mais non, non, c'est pas qu'une opinion. Une théorie, ça peut être une théorie qui n'est pas qu'une opinion, c'est une connaissance. »
- Speaker #3
Une théorie peut être démontrée, validée. sans devenir un fait scientifique. Non, il ne devient pas fait pour autant. Ça reste une théorie. Composée de modèles, d'équations, etc. Mais parce que le terme théorie, quand on l'utilise, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas complètement vrai. On ne sait pas vraiment. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Une théorie peut être à 99,99% démontrée. Tout à fait.
- Speaker #4
D'où la difficulté que je mentionnais au début, en disant que c'est le problème des connotations de ces termes. Parce qu'effectivement, le terme théorie peut être connoté quand on dit à quelqu'un que ce n'est qu'une théorie. ça veut dire en gros c'est spéculatif, c'est de l'opinion. Alors qu'en fait non, le terme théorie peut tout à fait être compatible avec le fait comme... Tu viens de le dire, qu'il existe des théories qui sont tellement bien établies que c'est irrationnel de ne pas y croire. Et c'est probablement le cas de la théorie de l'évolution. Mais c'est sur ce plan-là qu'il faut argumenter, plutôt que de dire, non, c'est quelque chose d'autre. Complètement ressortir du registre de la science pour dire, c'est un fait. Non, la biologie, ce n'est pas un fait. Ça vise à représenter les faits.
- Speaker #3
Je trouve que c'est déjà des notions qui sont hyper importantes, parce qu'elles sont subtiles. Et pouvoir poser des définitions comme tu le fais là sur ces éléments, ça permet d'éclairer aussi le débat scientifique, en l'occurrence. d'une autre façon.
- Speaker #4
Et je pense que si on ne le fait pas en amont, même si ça peut paraître parfois un peu couper les cheveux en quatre, on nous dit, nous les philosophes, on aime bien couper les cheveux en quatre, on est très à cheval sur les concepts. Je pense que tous les scientifiques sont à cheval sur les concepts, les confondre, vitesse et accélération, poids et masse, ADN, ARN. Donc bien sûr, il faut être précis sur les concepts, mais c'est surtout qu'après, ça va polluer les débats. Si on n'a pas pris le temps de bien poser les choses, effectivement, quand on avance dans le débat, on risque de se retrouver avec des connotations qu'on n'a pas voulu embrigader dans les termes.
- Speaker #3
Alors un autre élément qui me paraît important dans cette démarche scientifique, c'est le doute. Comment ce doute... peut coexister avec une certitude ? Comment le scientifique, en étant toujours dans une démarche de doute, à un moment doit avoir une posture de « oui, mais cette théorie est valable à 99,99% » , comment tout ça est conciliable, et c'est quoi au final le doute dans la démarche scientifique ?
- Speaker #4
Oui, alors ça c'est une très bonne question, parce qu'en fait c'est la question fondamentale de toute l'épistémologie depuis les origines, c'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on fait pour sécuriser l'idée qu'il existe des choses dont on ne doute plus vraiment, dont il ne serait plus rationnel de douter, en dépit du fait que le doute existe toujours. Donc il y a une première chose que je rappelle toujours à mes étudiants, c'est important de garder à l'esprit que la science, c'est bien le lieu du doute, ce n'est pas le lieu de la certitude, mais ce n'est pas le lieu de n'importe quel doute, ce n'est pas le lieu de douter de tout, tout le temps, pour le plaisir, ce n'est pas le lieu du doute, comme on dit parfois, sceptique ou hyperbolique, le fait de même douter que la Terre est ronde ou ce genre de choses, bien sûr. Donc il faut toujours garder à l'esprit que la science, c'est le lieu du doute, que sans doute, la science, elle se dogmatise et elle meurt. En fait, une science qui ne doute plus, c'est une science qui n'est plus une science. Ça fait partie de la définition de ce qu'est de la science, pour le dire autrement que la science doute. Mais ceci ne doit pas rendre impossible... Le fait qu'il y ait des choses dont on ne doute plus vraiment, et ça c'est ça qui est toujours difficile à voir, ce qui fait que le scientifique est toujours sur une ligne de craie très inconfortable. Parce qu'aussitôt qu'on garde ouverte la fenêtre du doute, ce qui je pense est important, c'est la fenêtre par laquelle tous les, on va dire, anti-sciences, pseudo-sciences, conspirationnistes, vont rentrer en disant « puisque vous doutez, du coup ce que vous dites ce ne sont que des opinions » . Mais non, il faut pouvoir résister à ça en disant « mais oui, même si la fenêtre du doute reste ouverte, même si par exemple il y a des choses qu'on pense savoir à 99,99% Même s'il subsiste donc un 0,001% de doute, ça n'empêche que, rationnellement, si on pense le savoir à 99,99% de chance, que ce soit exact, on doit parier dessus, on doit faire comme si c'était vrai, toujours jusqu'à preuve du contraire. Garder le doute ouvert, c'est toujours garder ouverte la porte du jusqu'à preuve du contraire. Et ça peut paraître déroutant sur des cas caricaturaux quand on dit « la terre est ronde » , on doit dire « oui, jusqu'à preuve du contraire » , en même temps on se doute bien que le contraire n'arrivera pas, c'est-à-dire qu'on est tellement établi par un faisceau de preuves, je dirais, indépendantes. de la rotondité approximative de la Terre, qu'il est très peu probable qu'un jour on réalise qu'en fait, pendant tout ce temps, elle était carrée, elle était cubique, pardon, ou elle était plate. Mais il n'empêche qu'il faut toujours conceptuellement maintenir ouverte la possibilité qu'effectivement, parce qu'elle existe, la possibilité que la Terre ne soit pas ronde, elle est tellement frivole, cette possibilité est tellement éloignée qu'il n'est pas rationnel de la considérer, simplement pour continuer à faire de la science. Mais évidemment, cette porte ouverte aux doutes permanents... Elle est beaucoup plus cruciale sur, évidemment, des questions de recherche contemporaine, où là, le doute est encore permis à des niveaux beaucoup plus importants.
- Speaker #3
Un exemple concret que j'aime bien citer par rapport à ça, c'est la théorie de la relativité, restreinte et générale, est toujours testée à l'heure actuelle. Donc, il y a des mesures qui sont prises pour vérifier l'adéquation de la théorie avec la réalité. Alors, il y a deux choses assez intéressantes par rapport à cette théorie de la relativité. C'est d'une part, ce n'est pas pour autant qu'on n'enseigne plus Newton.
- Speaker #4
Exactement.
- Speaker #3
Donc la théorie de Newton dans un cadre défini reste toujours valable. Et d'autre part, cette théorie de la relativité englobe la théorie de Newton, mais plus largement tient compte de concepts supplémentaires.
- Speaker #4
Oui, tout à fait. Alors là, il y a deux choses, parce qu'il y a évidemment l'enjeu de la science dans la pédagogie, c'est-à-dire comment on enseigne la science. Et ça, on a montré, mais ça c'est de la didactique. On peut enseigner des choses fausses, d'accord ? Pour autant que, parce que Newton, en fait, littéralement, c'est faux. La représentation du monde de Newton, elle est littéralement fausse. Mais en fait, probablement... comme toute science, en fait, mais ça on va un peu discuter, la question de la vérité, et la relativité est problématique à cet égard, parce qu'on sait qu'elle est incompatible avec la mécanique quantique, donc on sait qu'il y a des anomalies. Et en fait, toute théorie scientifique naît avec des anomalies, avec ses propres réfutations, mais ce qui n'empêche qu'elles, jusqu'à preuve du contraire, elles peuvent demeurer la meilleure représentation qu'on ait à intenter de ce qu'elles montrent. Mais c'est toujours important, et ça je reviens sur la question du doute, ne pas maintenir ouverte la question du doute, même sur la question de la relativité, comme tu l'as dit, on continue de la tester parce que le doute toujours subsiste, peut-être pas sur le cœur de la théorie, mais sur des éléments. plus périphériques, parce qu'une théorie, c'est un élément assez complexe. Mais le fait que le doute subsiste, c'est ce qui permet aussi de comprendre l'histoire des sciences et le fait qu'en fait, à toute époque, on a cru qu'on savait, pour réaliser après la révolution suivante, qu'en fait, on ne savait pas tout à fait. Et je crois qu'il faut garder à l'esprit que dans le présent actuel de nos meilleures théories, il faut garder une certaine humilité quant au fait que probablement, dans un siècle, les théories qu'on aura seront quand même différentes, alors pas complètement différentes, on englobera très certainement des choses qui seront conservées. Ce qui sera d'ailleurs le lieu de la vérité aujourd'hui. On pourra parler de vérité dans les sciences comme le cœur conservé au travers des transformations. Mais il serait présomptueux de notre part de penser que nous sommes dans un état de science complètement final et arrêté. Sinon, ce serait, comme je le disais tout à l'heure, la fin de la science.
- Speaker #3
Par rapport à ce doute, il y a un concept qui me semble aussi important d'aborder avec toi, c'est la validation par les pairs. Justement, c'est deux choses qui me semblent connectées, puisque ce doute ne peut que coexister avec une confrontation par d'autres scientifiques pour dire « ok, là on part dans cette direction-là, ça semble ok » ou « ça ne semble pas ok » . C'est quoi cette validation par les pairs ? Comment de ce fait-là se forme ce qu'on appelle le consensus scientifique ? Et quels sont les critères qui permettent d'arriver à ce consensus ?
- Speaker #4
Disons qu'à l'échelle vraiment générale, la validation par les pairs, c'est l'institutionnalisation même de cette pratique du doute. Donc c'est pour ne pas rester dans les beaux discours et dire « oui, la science, c'est le lieu du doute » . Non, non, dans la pratique, l'institution scientifique, elle a construit toute une série de dispositifs pour douter, pour rendre le doute opératoire, pour rendre le doute opérant, pour construire les connaissances et progresser. Et la validation par les pairs, c'est un mécanisme parmi beaucoup d'autres qui a été constitué, c'est assez... précoce dans l'histoire des sciences, dans les sciences modernes, parce qu'on parle plutôt du XVIIe, XVIIIe siècle, l'apparition de la validation par les pairs, donc c'est quand même relativement ancien au regard de l'histoire des sciences, comme une mécanique qui a été mise en place pour mettre sous pression, toujours, ce n'est pas très confortable, mais c'est comme ça que ça marche quand on veut connaître, les connaissances, ou en tout cas les propositions de connaissances, c'est-à-dire les hypothèses qui sont mises sur la place du marché scientifique. Le but du jeu, elles ne doivent pas simplement être là et puis on décrète qu'elles sont vraies, ou on décrète qu'elles sont bonnes, et on décrète qu'elles sont acceptables. Non, non, elles ne seront finalement acceptées. que lorsqu'elles auront passé l'épreuve du feu, que lorsqu'on les aura mises suffisamment sous pression pour les tester, les tester, les tester, les tester encore, et la confiance ne viendra, donc la confiance dans le fait qu'elles sont de qualité, c'est-à-dire que la qualité de leur justification ne viendra, elle n'est pas posée d'emblée, elle ne viendra qu'au terme d'un processus de mise sous pression auquel les hypothèses les plus résilientes vont résister, c'est-à-dire que celles qui restent à la fin du processus, c'est un peu un filtre, une sélection darwinienne, Celles qui vont subsister, c'est celles qui auront été mises à l'épreuve du doute. Donc l'épreuve de la validation par les pairs, notamment, est une des modalités de cette épreuve du doute. Et moi, j'aime bien présenter comme ça à mes étudiants une définition relativement générale de la science. La science, elle a, je dirais, comme marque de fabrique, cette mise sous pression constante et elle procède par élimination des possibilités de se tromper. C'est-à-dire qu'à force de douter, on va éliminer les possibilités d'erreur, on va éliminer les possibilités que l'hypothèse qu'on a établie ou qu'on a posée à la base. soit fausse, et la pression par les pairs, c'est une de ces modalités d'élimination des possibilités d'erreur, notamment des erreurs qui seraient liées par exemple à des biais des chercheurs qui ont proposé l'hypothèse, à des biais d'instruments, à des biais de localisation de leur propre méthode de validation, expérience. Le fait par exemple que des pairs aillent reproduire l'expérience ailleurs, que ce soit d'autres personnes qui la reproduisent avec d'autres instruments en d'autres lieux, ça va éliminer les possibilités que des erreurs soient apparues dans ce qui serait des biais personnels, des biais d'instruments ou ce genre de choses. donc vraiment la pression par les pairs, c'est une modalité d'élimination de possibilités de se tromper. Et donc, quand on passe ce filtre, s'il y a moins de possibilités qu'on se soit trompé, ça veut dire que par effet de levier, on a plus de possibilités d'être dans le juste, en tout cas dans ce qui tend, on va dire, vers quelque chose qui serait le vrai.
- Speaker #3
Alors, ça pose une question de temporalité, tout ça. Et c'est d'ailleurs cette temporalité, je pense, qui a posé problème durant la crise sanitaire il y a quelques années. C'est que la science prend du temps, enfin, la théorie prend du temps à se construire. Donc, la... La connaissance prend du temps à être validée, testée par les pairs. Et donc, comment on concilie au final cette temporalité du scientifique et cette temporalité du média qui veut une information claire, rapide, tout de suite ?
- Speaker #4
Exactement. Je pense que la réponse courte, c'est que ça se concilie très mal. C'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire d'un décalage dans les temporalités. Donc, effectivement, la science opère sur un temps long. Alors, c'est toujours difficile de dire, oui, mais long, qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment, tout dépend si on met... Tous les scientifiques du monde auront un même problème au temps T, ça va sans doute aller vite. Oui, c'est probablement proportionné au moyen, mais il n'empêche qu'on ne peut pas écraser ce temps à l'infini. Et ce n'est pas simplement le temps que ça prend pour tester, c'est aussi le temps de la créativité scientifique. C'est-à-dire que le temps, quand on est face à une voie de garage, il faut des nouvelles hypothèses, il faut envisager des nouvelles voies. Et ça, c'est un processus qui ne se commande pas, c'est surtout ça. Donc on pourrait écraser un peu ce temps, on va dire, très sur raison, les scientifiques comme des citrons dans une logique très productiviste. Et ils vont peut-être recracher des idées plus vite, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne vraiment comme ça, la créativité.
- Speaker #3
J'y vais aussi à 12.
- Speaker #4
Et donc, il y a quelque part un irréductible, c'est-à-dire que oui, effectivement, il y a un temps plus ou moins long, mais il y a un temps nécessaire et qui s'accommode assez mal, effectivement, de la demande sociétale, on va dire, médiatique, d'une certaine immédiateté qui est légitime et qui se comprend dans des situations de crise. On parle de la crise sanitaire, là, il valait mieux que ça aille vite que pas vite. Donc, c'est clair que là, les moyens ont été mis pour faire en sorte que la vitesse de la science ou que le tempo de la science soit plus rapide. Et je pense qu'en fait, le tempo de la science a été incroyablement rapide quand on voit à quelle vitesse il y a des dispositifs, où par exemple on parle des vaccins à ARN qui ont été mis sur pied de façon extrêmement rapide. Donc je pense que la science peut s'accélérer quand on en met les moyens, mais ça, ce n'est pas viable sur le long terme. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça que fondamentalement, on peut espérer faire en sorte de produire une bonne science. Surtout qu'en plus, l'accélération ou la mise sous pression de la science, on sait que ça accouche de toute une série de fraudes, de déviances, parfois sincères, parfois pas sincères. c'est-à-dire que fondamentalement on peut c'est une machine à produire de la mauvaise science.
- Speaker #3
Un autre concept qui me semble important, c'est la démocratie en science. Étienne Klein, entre autres, le dit, la science n'est pas démocratique, il faut en prendre conscience. Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase, en fait ?
- Speaker #4
Je ne sais pas exactement ce qu'il avait derrière la tête, mais je crois comprendre. Pour moi, il y a des égards sous lesquels la science est démocratique, et il y a des égards sous lesquels elle ne l'est pas. La science est démocratique, d'abord, parce qu'elle s'ouvre à tout le monde. La connaissance est un bien commun, et toute personne peut être scientifique. C'est-à-dire que c'est une question souvent de moyens. de compétences qui sont liées aux moyens. C'est-à-dire que tout le monde peut se former, s'éduquer, étant donné le contexte qu'il a autour de lui. J'entends bien qu'il y a des contextes qui font que ce n'est pas possible. Mais je veux dire, la connaissance scientifique n'appartient à personne, pour le dire comme ça, et toute personne peut prétendre être un futur ou une future scientifique géniale. Donc à cet égard, je pense qu'elle est démocratique, elle n'est pas privatisée d'ailleurs. Dans les composantes de l'éthos scientifique de la sociologie des sciences de Merton originellement, je pense qu'il y a quelque chose comme l'absence de privatisation de la science. Donc à cet égard, elle est démocratique. Par contre, je pense peut-être que ce qu'il a voulu dire par là, c'est qu'il y a une tyrannie dans la science et il reste quelque chose de l'ordre de l'absoluté qui est en fait fondamentalement les faits qu'on va connecter à la vérité. C'est-à-dire que la vérité, c'est une relation entre les faits et nos représentations. Si ça colle, on va dire que les représentations sont vraies. Si ça ne colle pas, on va dire qu'elles sont fausses. Mais ultimement, la vérité, ou donc comment est le monde, ça, ça ne dépend pas de nous. C'est-à-dire qu'on parlait de dérèglement climatique ou plus largement de crise de la biodiversité ou autre. ça qu'on le veuille ou non, il y a un fait qui correspond à ça ou pas. Et donc nos théories sur le dérèglement climatique, la crise de la biodiversité vont être vraies ou fausses, qu'on en ait envie ou pas, que ça nous dérange ou pas. Et là, à certains égards...
- Speaker #3
60% des gens qui disent ça c'est vrai et ça c'est faux n'a aucun sens.
- Speaker #4
Et c'est pour ça que le débat scientifique n'est pas un débat d'opinion, et c'est pour ça que le débat scientifique n'est pas tout à fait la même chose qu'un débat politique. Alors un débat d'opinion n'est pas nécessairement arbitraire, Il y a des opinions, je pense, qui intrinsèquement, notamment en moralité, peuvent être meilleures que d'autres. En moralité, on va dire la torture d'innocents, je pense qu'il n'y a pas d'une société dans laquelle on peut considérer que c'est désirable, donc ce n'est pas complètement arbitraire, ce n'est pas complètement subjectif, mais ça n'empêche que c'est ouvert à un certain débat, ouvert à certaines conventions, ça évolue avec le temps, etc. Pour ce qui est de la rotondité approximative de la Terre, ça, ça ne va pas changer, enfin, ça peut changer au cours du temps si la Terre change de forme, on s'entend bien, mais je veux dire, ça ne va pas changer au gré des avis, des opinions et surtout de nos représentations, c'est-à-dire que nos représentations sont plutôt la nature de comment est le monde, ne dépend pas, en tout cas le monde, on va dire, naturel, ne dépend pas de comment on le représente et de la nature de notre pays. représentation. Et ça peut-être qu'à cet égard, effectivement, il y a une sorte de tyran, de non-démocratie dans la science qui est fondamentalement la résistance que le monde oppose à nos représentations.
- Speaker #3
L'impression qu'on peut en avoir, le « on » étant indéfini, je parle du « on » , l'opinion publique, je vais dire, c'est que la crise sanitaire, ça a vraiment été un moment de bascule sur la perception de la science. Comment, justement, à ton avis, cette crise sanitaire a fait évoluer cette perception ?
- Speaker #4
Alors moi, je ne sais pas si vraiment on peut dire que la perception des gens évolue, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des retours, parce qu'on étudie encore beaucoup la crise sanitaire comme un vrai laboratoire, effectivement, de comment la science s'est donnée au public. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la science a été mise sous le feu des projecteurs d'une manière pas tout à fait inédite, parce qu'évidemment, il y avait déjà eu des crises préalables, il y avait déjà eu des moments qui ressemblaient à celles-là, mais avec une ampleur quand même assez forte. Et donc, c'est clair que là, je pense qu'on peut dire, et c'est vrai que j'ai des échoques selon lesquelles ça a été dit, qu'effectivement, sont apparus des décalages entre la manière dont les personnes profanes, toi et moi, mais tout le monde sur les différents sujets, si on n'est pas virologue, ou en tout cas sur la manière dont on se représentait la science, qui à mon avis est une manière assez généralement erronée, et ce n'est pas de la faute des gens, c'est simplement qu'on leur a présenté la science par l'éducation, par les médias, d'une manière qui n'est pas nécessairement une bonne représentation de comment elle se fait réellement. Et lorsque la science, un peu comme elle se fait, et surtout la composante recherche de la science, la science en action, a été mise sur la place publique et qu'on a commencé à voir des chercheurs qui faisaient presque une sorte de controverse scientifique en plateau télé, là, je pense qu'il y a eu une réalisation que, tiens, la science telle qu'on l'a vendue pendant toutes ces années, éventuellement pendant mes cours, un cours de science, on imagine, Newton a dit que ceci, voici ces trois lois, on a présenté un peu la science comme un compendium de vérité établie qu'il s'agit d'apprendre et puis après d'appliquer. Ça, fondamentalement, quand on voit la recherche telle qu'elle se fait, ce n'est pas comme ça. La science, c'est le doute, précisément, c'est la controverse. C'est l'incertitude, c'est la temporalité longue, c'est éventuellement des conflits d'intérêts, parce qu'il y a de la politique sous le doigt cachée là-derrière. Quand on a vu tout ça apparaître sur la sphère publique, c'est assez légitime qu'il y ait eu une incompréhension de la part des personnes qui avaient éventuellement une idée un peu fantasmée, un peu image d'épinal de la science, mais qui n'est pas, je pense, une idée illégitime qu'ils aient, et je pense qu'elle leur a été imposée, par le fait que la science est représentée comme ça, socialement, dans l'éducation, dans les médias, en temps normal.
- Speaker #3
Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres éléments ? qui, selon toi, interviendrait dans cette sensation d'imperméabilité du débat public à la science ? C'est-à-dire un peu cette coupure entre les deux en disant le débat public, c'est celui-là où la politique vient se joindre, où l'opinion vient se joindre. Le débat scientifique, c'est un autre. Et entre les deux, il y a une espèce de cloison et pas de connexion.
- Speaker #4
Je pense qu'il y a une cloison parce que dans les faits, c'est des débats qui ont des codes et des modes de fonctionnement très différents. On pourrait faire l'expérience, ce serait amusant, mais je suis presque sûr sans être devin du résultat. Prenons un débat scientifique tel qu'il s'opère dans les cénacles scientifiques, on va dire une conférence de spécialistes. ou dans la littérature, et transposons-le, on va dire, comme une sorte de télé-réalité. Ça va embêter les gens au bout de cinq minutes, et c'est normal, parce que fondamentalement, les codes, je dirais, de la science, ce n'est pas du divertissement, ce n'est pas du spectaculaire, c'est d'abord et avant tout technique, et c'est essayer, au fond des choses, de faire avancer la connaissance, en fait. Et ça, quelque part, ça essaie d'éliminer toutes les composantes qui pourraient être amusantes, on va le dire comme ça, bien quand on peut s'amuser en conférence, je ne dis pas le contraire. Mais donc, je crois que c'est parce que ça obéit à des codes très différents, alors qu'à l'inverse, je pense que le code du débat public... Malheureusement, et ça on peut le regretter, c'est le spectacle, c'est le buzz, c'est la temporalité courte, c'est les émotions, c'est la réaction, c'est le point sur le plateau télé qui est écrasé avec le clash, c'est la polémique, il y a toute une série de choses. Et je pense qu'on peut le regretter, et tout le débat public n'est pas sous cette forme-là, mais on pense que c'est ce qui marche mieux. Et c'est ce qui, du coup, va orienter la manière dont le débat va être donné dans les différents types de médias. Et donc, comme les codes sont assez différents, ça se met assez mal l'un avec l'autre. Ce qui fait que quand on veut effectivement faire de la science dans le débat public, ou quand on veut discuter de science dans le débat public, il faut adapter.
- Speaker #0
les codes. C'est-à-dire que soit c'est le monde médiatique qui doit adapter ces codes en autorisant un temps plus long, en autorisant peut-être moins de spectacles, en autorisant la controverse entre experts qui vont pouvoir se lancer des arguments, des contre-arguments qu'on ne va pas couper, on ne va pas les laisser se couper la parole et s'envoyer des arguments fallacieux comme on pourrait dans une émission de divertissement par exemple. Donc par exemple, pour prendre des exemples concrets, si on veut prendre un débat sur les enjeux climatiques ou les enjeux de la crise sanitaire, il ne faut pas le faire chez Hanouna par exemple. L'un c'est une émission de divertissement, l'objectif c'est pas d'instruire, l'objectif c'est pas de présenter de l'information. L'objectif, c'est une sorte de rigolade. Alors, on rigole ou on rigole pas, moi j'aime pas ça, mais l'objectif n'est pas là. Et donc, soit il y a une adaptation du dispositif, bon, l'exemple que j'ai pris, je crois pas qu'on va l'adapter pour ça, il est juste pas fait pour ça, mais il existe, du coup, dans les médias, des dispositifs qui se sont adaptés. Il y a des émissions, ici, moi, je pense au Paysage Belge, le podcast qu'on est en train de faire est exactement ce genre de dispositif où on autorise le temps long, où on autorise à décortiquer les concepts, où on autorise à rentrer dans quelque chose de plus profond, dont l'objectif, j'espère que ce sera divertissant, Mais l'objectif est d'abord culturel, éducatif. Et donc là, on a fait un travail d'adaptation. Et je pense que le travail d'adaptation peut venir des scientifiques aussi. C'est-à-dire qu'ils doivent aussi apprendre de leur côté, mais ça, on va peut-être en parler après, à voir comment être capable de rendre plus en phase avec les codes médiatiques du moment un message qui, dans leur conférence, fonctionne très bien, mais sur la sphère publique, doit être adapté parce que le lieu n'est pas le même, l'audience n'est pas la même.
- Speaker #1
Donc, si je synthétise un petit peu, fondamentalement, les deux débats ne peuvent pas coexister au même endroit. et il doit y avoir un changement, peut-être, possiblement des deux côtés, pour converger vers une nouvelle forme de débat, où les sciences pourraient être intégrées dans, justement, le débat public.
- Speaker #0
Oui, mais je pense qu'il existe de tels lieux. Ça existe, il y a des tables rondes, des conférences, des podcasts, certaines émissions de télé et des chaînes YouTube. Donc, il y a des dispositifs médiatiques qui osent cette rencontre. Je pense qu'elle n'est pas facile et je pense que pour qu'elle fonctionne, les personnes qui sont aux manettes de ces dispositifs ont dû bien réfléchir. Ça ne s'improvise pas. Et du coup, il y a des résultats qui sont excellents. Et donc je pense qu'il y a des lieux de rencontre où la science s'invite dans le débat public, où ça fonctionne. Je pense qu'il y a beaucoup de cas où ça ne fonctionne pas du tout. Faire venir un scientifique chez Hanouna pour reprendre un exemple, ça, ça ne marche pas. Ou essayer de rendre spectaculaire une conférence de cosmologie, ça ne va pas marcher non plus. Donc je pense que ça doit être réfléchi. Et là, je pense qu'il y a des professionnels de la médiation, j'en ai un face à moi, dont c'est le métier, qui ont les compétences. Et ces compétences ne sont peut-être pas du côté des scientifiques. donc je pense que là il faut un peu les aider aussi à certains égards.
- Speaker #1
Tout ça m'évoque aussi des propos... tenu régulièrement par Aurélien Barraud, qui explique que, je vais prendre le cas de la crise environnementale, il indique que ce n'est pas un problème scientifique, que c'est un problème politique, que c'est un problème éthique, que c'est un problème dont la science est aussi responsable et peut apporter des réponses, mais c'est multifactoriel. Donc que la science n'a pas toutes les solutions, qu'elle n'a pas toutes les réponses, et que ça dépend de plein d'autres choses. Donc quelle est la place de la science, au-delà de comment elle vient s'insérer dans le débat public ? Hierarchiquement, si tu veux, ma question, c'est quelle est la place de la science par rapport à tous les autres pouvoirs en place ?
- Speaker #0
D'accord. Alors d'abord, je le rejoins tout à fait sur cet aspect-là. Il faut bien distinguer les questions de science et la science comme productrice de connaissances, dans ces cénacles, je dirais, un peu réservés, de la science en société, où là, il est effectivement question d'abord et avant tout de politique. C'est évident pour moi que le problème du dérèglement climatique que tu as mentionné, mais le problème de la crise sanitaire, c'est la même chose. Le problème de la 5G, c'est la même chose. Ce sont des problèmes... politique. Ça doit être traité dans le débat public avec des acteurs politiques qui ont une légitimité démocratique. Mais bien sûr, dire cela n'empêche pas que ce sont des problèmes qui ont une teneur scientifique, parce qu'effectivement, il y a une dimension technique à ces problèmes, il y a une dimension qui est, pour prendre de bonnes décisions politiques, il faut avoir une information fiable, et ça, jusqu'à preuve de contraire, l'information fiable sur des questions à teneur scientifique, c'est les scientifiques qui les détiennent. Et donc, ça veut dire que les scientifiques doivent être partie prenante de toute discussion politique qui doit avoir lieu sur qu'est-ce qu'on fait par rapport à la 5G, qu'est-ce qu'on fait par rapport au vaccin ? au dérèglement climatique. Comment est-ce qu'on agit ? L'agir public, c'est d'abord une question démocratique. Donc ça, je le rejoins, c'est une question politique. Maintenant, pour la question de la hiérarchie, je n'ai pas moi de réponse. De fait, je pense que les scientifiques doivent faire partie des débats, déjà parce qu'ils sont citoyens aussi, mais d'abord aussi parce qu'ils ont cette expertise technique qui doit être apportée dans le débat. Je pense que le débat ne pourrait pas être sain sur des bases scientifiques malsaines parce que pour pouvoir simplement, je pense que ça, j'enfonce une porte ouverte, mais pour pouvoir prendre des actions efficaces, ça marche mieux sur des fondements qui sont plus vraisemblables J'essaie d'éviter vrai, mais sur des fondements, on va dire pour caricaturer, vrai que faux. C'est-à-dire que si on veut lutter contre le changement climatique, il faut avoir une bonne représentation de quels sont les bons leviers causaux qui permettraient de faire des actions qui auraient un impact significatif plutôt que pas d'impact, où il faut déjà être d'accord sur les causes du problème et ce genre de choses. Donc je pense que, inévitablement, les scientifiques... doivent être présents dans les discussions, et ils le sont, je pense qu'il n'y a pas de question là-dessus, mais qu'après, la hiérarchisation de quelles sont les actions à prendre en premier, quels sont les coûts qu'on va mettre, parce qu'une action ça vient avec des coûts, quels sont les coûts qu'on peut consentir pour faire cette action, quelle va être la charge sur les épaules des citoyens, ça c'est une question politique. Et là je pense que le scientifique, il ne doit peut-être pas s'effacer, parce qu'il est aussi l'acteur de la cité, mais là c'est les personnes qui ont une légitimité démocratique qui doivent s'emparer de ces questions-là, à commencer par les citoyens. Donc c'est d'abord et avant tout une question... citoyenne plus que technique. Et moi, je suis toujours assez fort mal à l'aise quand on a ces discussions-là. Par exemple, j'avais un peu suivi, mais d'assez loin, le dossier 5G, alors je ne comprends pas nécessairement les attitudes anti-5G, complotistes, avec le Covid qui a été transmis, ou la 5G a transmis le Covid, tout ce genre de choses. Mais je comprends qu'il y a eu une sorte de perte, ou en tout cas une sorte d'insatisfaction, dans le sens où ça a été un peu imposé comme une sorte de solution technique, alors qu'on sait qu'elle a des conséquences, notamment environnementales, très fortes, sans qu'il y ait eu vraiment lieu. pour les citoyens de se dire, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et là, je pense que se dire, en fait, c'est les scientifiques qui décident, c'est que purement technique. Là, je pense que c'est un mensonge. Ce n'est pas purement technique, c'est aussi politique. Les scientifiques ont bien sûr leur mot à dire, mais les citoyens, au bout du compte, c'est eux, par leurs représentants dans une démocratie, c'est eux qui ont leur mot à dire sur, est-ce qu'on en a envie ? Est-ce que c'est désirable ? Est-ce qu'on est prêt à payer ce coût ? Est-ce qu'on est prêt à endosser ce risque ? Parce qu'il y a des risques, évidemment, et ce genre de choses. L'exemple de la 5 journées, il y en a plein d'autres, et ça se reporte comme ça sur tous les...
- Speaker #1
Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu dis les scientifiques... C'est les scientifiques qui ont respecté tous les process dont on a parlé plus tôt dans le podcast. Donc, ce n'est pas un scientifique qui a un discours qui arrange le monde politique, c'est avoir un corpus de connaissances qui est validé par les pairs, qui a passé les épreuves du doute, etc.
- Speaker #0
Alors là, ça double évidemment le problème, parce qu'on va dire, oui, les scientifiques doivent être conviés comme expertise technique, notamment pour avoir exactement, on va dire, les représentations les plus fiables pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Évidemment, on sait bien que le bloc scientifique n'est pas un bloc unique. Il y a bien sûr des dissensions. Et du coup, évidemment, ça c'est très dangereux, parce qu'évidemment, quand le politique va s'en mêler, il va aller chercher les éléments qui l'intéressent. S'il y a un scientifique climato-sceptique, il y en a très peu, mais ça existe encore, malheureusement, il va aller dire « Ah ben regardez, tel scientifique pourtant assez connu a dit que ceci » . Donc là, il va y avoir des jeux de récupération, et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, l'enjeu du consensus est important, parce que quand on va chercher l'expertise scientifique, et qu'on va chercher les représentations scientifiques les plus vraisemblables, je pense qu'il y a quand même de fortes chances. que ce qui est de l'ordre du consensus à une époque donnée est ce qui est de l'ordre du plus vraisemblable. Et donc, il faudrait faire bien attention à éviter la récupération, ce qui est en fait une sorte de biais de confirmation magnifié, de se dire d'aller chercher ce qu'une voix marginale de la communauté scientifique va aller dire pour sauter dessus, pour légitimer une manœuvre politique. Je pense que c'est une sorte de manœuvre très malhonnête, en fait.
- Speaker #1
Ou une manœuvre médiatique pour justement créer de l'émulsion, de la vue, etc. On l'a vu pendant la crise sanitaire. certains scientifiques qui étaient interviewés ne faisaient pas consensus, mais pourtant étaient très présents sur les plateaux télé. Mais là,
- Speaker #0
en même temps, c'est une difficulté. On reboucle à ce qu'on discutait au début. Comme le doute est toujours présent en science, comme on ne peut jamais complètement l'éteindre, évidemment, il y a toujours une porte ouverte pour se dire que le consensus se trompe, même si c'est assez improbable. Et ça, il y a des études en épistémologie assez récentes qui ont quand même montré, des études croisées avec de l'histoire des sciences, qui montrent qu'en fait, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des sciences, que lorsqu'un consensus d'une certaine qualité qui satisfait certains critères Merci. a émergé, alors il y a des chiffres qualitatifs, tandis que lorsqu'il y a un consensus à plus de 95% de la communauté scientifique, dans un cadre, je dirais, où il y a beaucoup de scientifiques, des milliers avec des sociétés, il y a certaines conditions qui sont remplies, on n'est jamais revenu en arrière. C'est-à-dire qu'évidemment, on sait que, je dis ça parce qu'on sait qu'on entend parfois dire « oui, mais il y a peut-être un génie incompris, vous savez, peut-être, je prends l'exemple de Raoult, en fait, c'est peut-être que le consensus médical se trompe et Raoult, c'est une sorte de génie solitaire qui va en fait triompher au fur et à mesure. Et comme le doute est toujours permis en séance, on ne peut pas complètement écarter la possibilité qu'il a peut-être raison, en fait, vous voyez. et que le consensus se trompe. Mais en fait, c'est très improbable. Voir, en fait, l'histoire montrer que ça n'est jamais arrivé. Du coup, c'est très irrationnel de miser sur un cheval dont il est très improbable qu'il ait la vérité de son côté. C'est ça, en fait, l'enjeu. L'enjeu, c'est plutôt un enjeu de rationalité, de calcul, de coût-bénéfice, qu'un enjeu de vérité. C'est-à-dire que, oui, peut-être, puisque le doute est toujours permis, Raoult a raison. En l'occurrence, il a l'air d'avoir tort, je rétablis ici. Mais peut-être qu'il a raison, c'est toujours la voix du doute qui parle, mais ce serait très irrationnel de parier sur lui, étant donné... tout ce qu'on sait par ailleurs. et là je pense que quand on mène une politique publique Il faut aller du côté de ce qui est plus rationnel de penser, dans un calcul, je dirais, coût-bénéfice, qui a l'air d'être massivement du côté opposé à celui de Didier Raoult, en l'occurrence.
- Speaker #1
Alors, généralement, ce que je vais appeler les sceptiques, ce que je mets derrière sceptique, c'est je ne crois pas que la Terre est ronde, je ne crois pas qu'il y ait un problème climatique, etc. Donc les sceptiques vont dire, oui, mais quand il y a eu le modèle de la Terre qui tourne autour du Soleil, il était seul contre tous, et pourtant, il avait raison.
- Speaker #0
Oui, alors ça c'est une... très mauvaise lecture de l'histoire des sciences. C'est pour ça que je l'appelle. Oui, oui, je sais. C'est la lecture des sceptiques, je ne te la mettais pas sur les épaules. Mais c'est la lecture, peut-être, Syllabie ou c'est la lecture Wikipédia. Enfin, et j'adore Wikipédia, je ne veux pas. C'est une ressource absolument précieuse. C'est la lecture, en tout cas, de cette espèce d'histoire des idées triomphantes qu'on nous sert, parce que c'est la manière, c'est très trivial poursuite, pour le dire encore autrement, c'est les référents culturels. Quand on creuse, déjà, il y avait beaucoup de précurseurs au fait que, je rebondis sur l'exemple que tu prends, que le soleil était au centre ou que la Terre était mobile ou que l'univers était infini. Et au-delà de ça, on était dans la préhistoire de la science, ce qui fait qu'on n'est certainement pas dans le contexte d'un consensus tel qu'on le décrit aujourd'hui. Et pour rebondir sur ton exemple, ça je vois ça en cours d'histoire des sciences avec mes étudiants, parce qu'ils l'ignorent et c'est quelque chose d'important. Entre la période dont tu parles, on va dire, grosso modo, autour de la révolution copernicienne au XVIe siècle, et même avant, parce que le modèle héliocentrique, c'est depuis Aristote, 2000 ans pendant que ce modèle a été établi. Le nombre de savants, on ne parlait pas de scientifiques, ça n'existait pas le métier de scientifique, il n'y avait pas de science professionnelle, donc il faut déjà garder à l'esprit qu'il n'y a pas de société savante, il n'y a pas de publication, il n'y a pas de peer review, il n'y a pas de scientifique professionnel, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'article. C'est essentiellement des amateurs, c'est des médecins, des astrologues qui font de la science sur le côté. Donc il n'y a pas de métier de scientifique, ça il faut déjà le garder à l'esprit. Mais surtout le nombre de savants, de séparation, dans des séparations géographiques qui fait qu'ils ne savent pas communiquer, alors qu'aujourd'hui, on est, le dernier chiffre, 8 millions de scientifiques professionnels dans un monde où ils peuvent communiquer à la seconde, par e-mail. Donc, en fait, c'est sans commune mesure, la science de cette époque, ce n'est pas la science d'aujourd'hui, et tous les standards de consensus étaient simplement inexistants. Le peer review n'existait pas, ce genre de choses. Donc, ce genre d'exemple, on peut le déconstruire très facilement. Donc, oui, il y a eu des cas où, seuls contre tous, on peut imaginer que, mais ça, c'est surtout des reconstructions historiques qui ne prennent pas le contexte autour. Pour le dire autrement, un Copernic aujourd'hui, un Raoult qui serait le Copernic où ça ne tient pas la route du tout sur le plan de la reconstruction.
- Speaker #1
Alors tu le disais, le citoyen a un rôle à jouer dans ce débat public. Il a donc d'une certaine façon des connaissances et des informations scientifiques à intégrer pour pouvoir prendre ou orienter la meilleure décision possible. Et donc il y a un transfert de connaissances du monde scientifique vers le citoyen qui doit se produire. et donc Quels sont les principaux obstacles, selon toi, à la compréhension de la science par le grand public et donc le citoyen ?
- Speaker #0
Il y a d'abord deux choses. D'une part, sur l'idée même, je ne suis pas 100% d'accord. Je ne suis pas convaincu que le citoyen ait besoin d'avoir une sorte de sous-ensemble des connaissances qu'ont les experts pour pouvoir prendre des décisions. On va dire qu'un expert, c'est quelqu'un... Prenons un exemple. Un expert en virologie, il a dans son corpus de croyances, beaucoup de croyances de virologie qu'on va considérer comme vraies, pour l'exemple. Et le but, ce n'est pas d'essayer d'en transférer un maximum aux profanes pour qu'ils soient une sorte de virologues amateurs, pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Ça peut se faire, ça se fait, et c'est sans doute un levier sur lequel il faut miser. Mais ce n'est pas le seul. Je crois que ce n'est pas simplement en transmettant des connaissances comme un pipeline, que quelque part, avec des connaissances élémentaires de virologie un peu mal maîtrisées, on va prendre des meilleures décisions. Je pense qu'il y a aussi un enjeu de culture scientifique qui passe par une sagacité, un discernement, une faculté de discerner ce qui est... la bonne virologie de la mauvaise, ou les bons virologues. C'est un esprit critique, alors ? Exactement, ce serait une sorte d'esprit de faculté de discernement, de se dire, en fait, ce dont j'ai besoin, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout connaître, on est une société où il y a beaucoup trop d'informations, on ne peut pas être expert en tout, c'est peut-être plus rentable de se dire, j'ai en moi les outils pour pouvoir discerner et déléguer mon travail cognitif de connaissances que je ne peux pas avoir, je ne dois pas être un apprenti virologue, je ne dois pas être un apprenti climatologue, Je ne dois pas être un apprenti électromécanicien ou je ne sais pas comment on dit pour la 5G. Je ne dois pas être un apprenti de tout ça pour prendre des décisions. Je dois plutôt avoir une faculté d'arriver à discerner, dans le débat public, quels sont les experts à qui je peux déléguer ce travail. Je leur fais confiance. Ils m'ont l'air sincère, ils m'ont l'air honnête, ils m'ont l'air de bien travailler, ils ont l'air de ne pas avoir de conflit d'intérêt. Et donc, je vais leur faire confiance. Et ça, ça va me permettre de prendre les bonnes décisions. Ça, ça me paraît aussi être un levier. Évidemment, ça pose toute la question de comment on distingue un bon expert d'un charlatan. mais ça ça demande du coup des compétences plutôt d'épistémo en fait sans vouloir prêcher pour ma chapelle ou d'analyse des médias ou en tout cas d'esprit critique au sens plus large plutôt que simplement des connaissances scientifiques. Donc je pense qu'évidemment, la communication scientifique doit transmettre des connaissances scientifiques. Il ne faut pas gommer complètement ça. Si on veut prendre une décision éclairée sur la vaccination, avoir des rudiments de comment ça marche, c'est pas mal. Mais je pense surtout qu'il faut pouvoir distinguer entre les sites de fake news et l'OMS, par exemple, pour prendre un exemple un peu caricatural. Alors, il y avait une deuxième partie dans ta question qui était sur les obstacles. Évidemment, il y a des obstacles dans cette question de la transmission, que ce soit la transmission des connaissances ou la transmission de la grille de lecture, comme ça, de la transmission de l'esprit. des critères de jugement pour distinguer ce qui serait des bons experts, des mauvais experts, ou des bonnes connaissances, ou des mauvaises connaissances. Un obstacle premier, à mon sens, c'est nous. C'est nous, mais j'aime pas moi culpabiliser les gens, c'est-à-dire c'est nous, mais c'est nous parce que... Qui nous, c'est qui nous ? Non, les profanes, pardon, vous et moi, les personnes qui s'intéressent à ces questions-là, parce que simplement souvent on n'a pas le temps, on n'a pas envie, on n'a pas la motivation, et c'est faux de penser que si on veut vraiment prendre une décision éclairée, si on veut vraiment exercer son esprit critique, c'est un processus actif. Ça demande du travail, ça demande de la curiosité, ça demande de s'informer, ça demande de réfléchir, ça demande de confronter, ça demande quelque chose d'assez inconfortable, c'est de sortir de sa zone de confort, de se décentrer, ça c'est ce qu'on fait en philosophie. apprendre à questionner ses propres présupposés, parce que si on est esclave de ses propres présupposés, on ne progresse pas. Ça, c'est inconfortable. Et je n'aime pas culpabiliser les gens en disant « apprenez à vous décentrer » . On vit dans un temps où, malheureusement, on n'est pas encouragé à le faire. On vit dans une société de l'immédiateté, on est sous pression tous, on n'a pas le temps, on a du travail, on a des enfants, on a des choses à gérer, ce qui fait que, malheureusement, on n'est pas dans des dispositions très favorables pour exercer son esprit critique. Donc moi, je n'aime pas juste dire aux gens, apprenez à exercer un peu mieux votre esprit critique. Il faut aussi des dispositions et un cadre qui le permet. Un cadre avec des ressources, il faut avoir accès aux informations, il faut que l'éducation nous y aide, ce qui n'est pas toujours le cas dans la manière dont elle est pensée. Il faut qu'on ait le temps, alors qu'on vit tous à 100 à l'heure, avec parfois dans des situations difficiles, où vraiment c'est un luxe d'exercer son esprit critique. Il y a d'abord des gens qui pensent à leur survie et au bien-être de leur famille avant de penser à se dire « tiens, je vais prendre le temps de confronter mes sources, etc. » Donc je pense que là, il y a un contexte malheureusement sociétal, qui est pas, chez nous ça va encore, ça dépend pour qui, mais qui n'est pas globalement favorable à exercer malheureusement. Cet esprit critique, ça je pense que c'est un des premiers freins, un des premiers blocages, qui est donc du coup un blocage qui doit être désamorcé au niveau politique de nouveau, je pense que c'est vraiment à cet enjeu-là. Il ne suffit pas de dire aux gens, moi je ne suis pas partie prenante, de dire « soyez un peu moins bêtes, soyez un peu plus critiques, prenez un petit peu le temps » . Il y a un travail à faire, évidemment des gens, il faut la motivation, il faut faire un peu d'efforts, mais il y a un travail du secteur de l'éducation qui doit encourager à ça, de la médiation, et puis aussi un travail des scientifiques et un travail des médias, parce que ça moi je mets beaucoup de responsabilité sur le dos des médias, parce que je pense que les médias n'ont pas forcément un intérêt à ce que les gens soient plus éduqués scientifiquement, parce que ça va en mieux des médias plus spectaculaires. Et puis alors enfin, je pense que le dernier obstacle majeur, c'est le monde économique. On sait bien que notre société est surtout conduite par la rentabilité et le profit, et on voit bien aujourd'hui qu'il y a énormément d'acteurs économiques majeurs, je pense aux GAFAM, mais pas qu'eux, je veux dire, c'est à tous les niveaux, le monde de l'édition c'est pareil, qui n'ont pas du tout intérêt. ou plutôt qui ont un intérêt à vendre des salades, à vendre de la désinformation, à vendre de la fake news, et donc qui créent des environnements dans lesquels les citoyens sont piégés, dans un monde où la désinformation les envahit, on a beau j'ai de leur dire « soyez plus critiques » , mais non, il faut d'abord purifier ces environnements, parce qu'ils sont conduits par une dynamique purement marchande, qui n'a pas à cœur de simplement créer un… Vous savez, l'exemple classique, je prends Facebook en particulier, je ne veux pas taper sur Facebook… C'était censé être une sorte de marketplace des idées ouvertes et super, une belle utopie. Dans les faits, c'est une machine à des informations. Et je pense que les gens qui ont son manette le savent bien et ça ne les dérange pas parce que l'enjeu, pour eux, on sait bien que ce n'est pas de rendre le monde meilleur.
- Speaker #1
Un des axes que je voudrais un peu explorer avec toi, c'est l'éducation à l'esprit critique. Est-ce que ça doit prendre une place dans la formation, je vais dire, en primaire, en secondaire ? Est-ce qu'à l'université, ça prend une place ? Est-ce qu'elle est suffisante, etc. ? C'est une question qui paraît assez...
- Speaker #0
La réponse courte, c'est oui. C'est crucial, l'esprit critique doit être favorisé. Dire ça, c'est rien dire en même temps. Et tout le monde est d'accord, l'esprit critique, c'est bien. Un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de penser qu'on le fait déjà, parce que quelque part, dans tous les cours qu'on donne déjà, que ce soit l'université, dans le secondaire, dans les cours de sciences, dans les cours de français, dans les cours d'histoire, on fait déjà de l'esprit critique. Et c'est vrai, à certains égards, tous les cours, tous les dispositifs éducatifs... il l'intègre, une composante d'esprit critique. Il ne peut pas donner un cours d'histoire, ce n'est pas une critique des sources.
- Speaker #1
Sans le formaliser nécessairement. C'est ça,
- Speaker #0
sans le formaliser. On a un peu ce piège de penser que ça va découler rapidement. Ce que j'appelle parfois, dans la conférence dont tu parlais, mais peut-être pas la fausse idée de la percolation. Ça va percoler gratuitement. Donnez des cours de science, donnez Newton, et les gens vont comprendre l'esprit scientifique, vont comprendre comment on valide. Mais ça, ce n'est pas vrai. ça n'empêche que des profs de sciences peuvent le faire par ailleurs il y a des profs de sciences qui sont très forts pour faire ça mais si on s'en tient à juste transmettre Si on sentait un modèle de l'éducation qui est juste une transmission de connaissances un peu verticale, je pense que là, on loupe un peu le coche de l'esprit critique. Et je ne pense pas que notre modèle éducatif ne fonctionne que comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs d'éducation qui ne fonctionnent pas que comme ça. Mais il y a une injonction un peu à fonctionner. Donc je pense qu'il faut, en fait, et ça, il y a un rapport français qui a publié il y a quelques années, pas si longtemps, sur l'éducation à l'esprit critique, qui dit cela précisément. Il faut des moments dédiés à l'esprit critique, pas simplement cinq minutes à la fin du cours de français pour faire un cinq minutes d'esprit critique. Il faut des moments dédiés, ça peut prendre la forme d'un cours d'esprit critique, mais ça doit être un cours qui est en connivence avec les autres, ça n'a pas de sens, un cours vide d'esprit critique. Il faudrait que ce soit en collaboration avec le cours de sciences, avec le cours de français, mais ça ce n'est pas évidemment quelque chose d'évident à faire, et moi je ne suis pas didacticien ou pédagogue, donc je ne vais pas dire aux pédagogues comment ils doivent faire, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une idée de dire oui, il faut instaurer... de la reconnaissance de l'important vers l'esprit critique comme tel, et très tôt. En fait, il y a des gens qui disent dès la maternelle, il y a déjà des cours de philosophie en maternelle, et ça marche très bien, il y a une demande, c'est faux de penser que les petits n'ont pas cette appétence. En fait, ils l'ont, elle est un peu opprimée par l'école et par la manière dont on s'est pensé. Classiquement, on me dit que je pense au plus tôt au mieux, et en tout cas, ce qu'il faut cultiver, c'est la curiosité intellectuelle. Et ça, malheureusement, je ne dis pas que c'est facile, pouvoir créer des ateliers dans la nature. C'est facile de dire qu'il suffit de faire des trucs comme ça, mais concrètement, ce n'est pas facile à mettre en place. Mais c'est clair qu'un des enjeux, ce n'est pas juste de transmettre du savoir, c'est de transmettre une curiosité, transmettre une démarche, et transmettre une sorte d'appétence pour le fait qu'il y a quelque chose d'amusant dans l'enquête. En fait, fondamentalement, l'esprit critique, et la science en particulier, c'est un dispositif d'enquête, c'est une investigation. Et je pense qu'en enseignant la science comme un réceptacle de vérités éculées, dit par des vieux barbus il y a longtemps, et qu'il faut les apprendre et les restituer, ça ne rend pas la science... déjà ça ne rend pas justice à ce qu'elle est, mais ça ne la rend pas intéressante. Je pense qu'il faut rendre intéressante. C'est facile à dire comme ça, après, concrètement, comment on fait. Mais je pense qu'un des enjeux, c'est très tôt, dans le dispositif éducatif, de montrer qu'il y a un côté chasse au trésor. Je pense que si tu interviews beaucoup de scientifiques, ils vont dire que c'est sans doute ça qui les a attirés vers la science. Ce n'est pas la gloire et l'argent, c'est le fait qu'ils avaient une sorte de disposition pour l'enquête, l'énigme, la résolution d'une énigme. et ça je crois qu'on peut accrocher beaucoup de jeunes, d'enfants très tôt par le fait qu'il y a quelque chose d'amusant et d'enrichissant à la démarche d'enquête.
- Speaker #1
Je me permets de partager une ressource que moi je trouve intéressante, si tu la connais n'hésite pas à donner ton avis. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle L'Esprit Critique, avec cette personne avec toujours une chemise bleue et une cravate rouge, qui fait des shorts en fait de 3-4 minutes, une tous les jours ou une tous les deux jours, en analysant le discours politique et en venant dire ok, si on utilise l'esprit critique, l'analyse rhétorique etc, voilà ce qu'on voit à ce moment là et je trouve que c'est super intéressant d'utiliser en fait ce médium pour sensibiliser et donner des outils d'esprit critique.
- Speaker #0
Exactement. Je connais un petit peu cette chaîne-là et je me tiens un peu au courant de loin de toutes ces entreprises. Il n'y a à boire et à manger dans ces entreprises. À la fois, je salue l'initiative qui consiste à dire investissons un lieu où il y a un vide, peut-être qu'il y a un manque de formation à l'esprit critique et donc proposons... Et YouTube a été une vraie pouponnière, a été et encore un peu aujourd'hui, même ça a un peu changé. de chaînes, de formations, d'éducation aux sciences, d'asepticisme scientifique, d'esprit critique, d'autodéfense intellectuelle et ce genre de choses. Et ça, je salue quelque part, parce que quelque part, ça peut remplir un vide et ça peut aider des gens. Mais en même temps, je suis assez critique sur certaines, la chaîne Esprit Critique en particulier, mais d'autres aussi, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien ce qui est caché là derrière. On ne sait pas très bien qui sont ces gens. On ne sait pas très bien ce qu'ils racontent. Et en plus, et là en particulier pour celle que tu mentionnes, elle est monnayée, elle est payante. Ce qui peut avoir un sens. Il faut pouvoir payer les gens qui travaillent. Je ne suis pas contre le fait qu'il peut y avoir un salaire. Et le fait qu'en particulier, il faut savoir ce qui est caché à l'envers du décor, surtout si on fait de l'analyse politique, parce que ce n'est jamais tout à fait neutre et on voit exactement ce qui est dit. Donc, sur l'esprit, je suis assez partant. Il faut voir au cas par cas de comment c'est fait. Et j'aurais tendance à penser qu'il vaudrait mieux, dans un monde idéal, que ça se fasse par des professionnels, dans des cadres reconnus, de façon démocratiquement organisée, si possible gratuite, dans un système de l'enseignement OUYAD. manœuvres de contrôle, pour voir ce qui est fait quand même, plutôt que de laisser... C'est-à-dire qu'aussitôt qu'il y a un marché qui n'est pas du tout régulé, il peut y avoir des super qualités, et il y en a, et il peut y avoir des choses très dangereuses, et il y en a. Et c'est très difficile pour quelqu'un, une personne lambda qui va se dire, moi j'aimerais bien me former à Esprit Critique, je vais taper Esprit Critique sur YouTube et on va tomber sur probablement cette chaîne-là, mais probablement plein d'autres, parce qu'il y en a des tonnes, ça foisonne, et maintenant il y en a plein autogénérés par IA qui vendent des espèces de salades en boucle. Il y a beaucoup de spam en fait dans ce genre de choses. Et ça va reporter le problème sur quelle chaîne d'esprit critique ils vont choisir et quels sont les outils qu'on va leur apporter, ce qui peut être dangereux. Donc je dis juste simplement qu'il y a des dangers potentiels.
- Speaker #1
C'est pour ça que j'amenais cet exemple-là, parce que moi, c'est un exemple que je regarde régulièrement pour essayer de former mon esprit critique. Mais comme tu le dis, il y a des biais constants et il faut en être conscient et donc pouvoir discuter aussi avec d'autres personnes.
- Speaker #0
La meilleure chose à dire, c'est d'être critique à l'égard de cela. Malheureusement, c'est un peu le serpent qui mord la queue, parce que si on y va, c'est pour se doter d'outils. Et c'est difficile d'appliquer ces outils aux dispositifs éducatifs qu'on est en train de voir. Donc, ce que je conseille aux gens, c'est, oui, oui, consommer ce genre de contenu, probablement plutôt qu'un Oona, pour revenir à ça, je n'en sais rien, enfin, si vous voulez vous divertir, mais si vous voulez vraiment vous former, mais multipliez-les, allez regarder ailleurs, et oubliez pas d'être critique par rapport à ce que vous êtes en train d'entendre et d'écouter.
- Speaker #1
Et donc là, on arrive justement sur la place de ces fake news dans la société. Au final, est-ce qu'avec toutes tes connaissances toutes tes discussions que tu as pu avoir, tu as une réponse un petit peu claire à pourquoi une fake news est plus convaincante que la réalité.
- Speaker #0
Oui, ça j'entends souvent. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait vrai, alors ça va dépendre sans doute de dans certains cas. C'est-à-dire qu'on entend souvent dire que le faux convainc plus facilement que le vrai. Mais ça, je n'en suis pas 100% convaincu. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple de la rotondité approximative de la Terre. La majorité des gens sont globalement convaincus. Je sais qu'il existe quelques platistes irréductibles, mais ça a été montré que c'est surtout une manœuvre politique. C'est plutôt une revendication anti-système que vraiment une croyance profondément ancrée. Donc je pense que la vérité se défend, dans beaucoup de cas, pas dans tous, assez bien tout seul, ou plutôt... que ce qui est convaincant, parce qu'il y a deux registres différents, il y a le vrai et le faux, il y a le convaincant et le pas convaincant, et les deux coïncident pas tout à fait, c'est la source du problème. On entend parfois dire que la vérité ne se défend pas toute seule, ça c'est vrai, la vérité n'est pas suffisante pour être convaincant. On peut avoir quelque chose de vrai pas convaincant et quelque chose de faux très convaincant, je pense que c'est ça l'enjeu de ta question. Je sais pas dans quelle mesure il est plus ou moins, je crois qu'il n'y a pas de règle générale, mais il y a des cas. et alors ça il y a des cas effectivement où le faux convainc mieux mais pas parce qu'il est faux je crois que ça n'a rien à voir avec le vrai ou le faux parce qu'en fait ça nous arrange c'est ça l'enjeu par exemple le fait que la terre est plate ou qu'elle soit ronde Pour le dire autrement, dans notre vie de tous les jours, tout le monde s'en fout. Ça ne fait pas de différence. Sauf si vous êtes astronome ou vous travaillez dans une compagnie de GPS, ça ne fait pas de différence. Et donc, vous n'avez pas un enjeu, et donc vous allez vous associer au consensus, parce que fondamentalement, être platiste, c'est vous marginaliser, ça a un coût très fort social. Donc ça, ce n'est pas le vrai ou le faux qui se défend, c'est ce qui vous arrange. Dans le cas, par exemple, où on dit souvent que les fake news se vendent mieux, c'est dans des cas très limités, qui touche à des thématiques identitaires très fortes. Ça va être l'alimentation, ça va être le climat. Ça va être la vaccination, ça va être des choses qui sont liées aux religieux. Donc ça va être fondamentalement des choses qui vont avoir un impact sur nos vies. Typiquement, prenons l'exemple du changement climatique, c'est souvent dit, le climato-scepticisme, ou plus largement que la question du climat, l'anti-dérèglement climatique se vend mieux, c'est parce qu'en fait ça arrange. C'est-à-dire que les gens que ça arrange, c'est-à-dire la plupart des climato-sceptiques ou des gens qui freinent des cas de fer pour mettre en place des manœuvres de limitation du problème, c'est parce que c'est des gens qui veulent s'enrichir ou qui veulent pas qu'ils aient des contraintes trop fortes. C'est des gens qui ont une vision de l'économie particulière, c'est des gens qui sont plutôt à droite, plutôt conservateurs. C'est des gens que la vision du monde qu'ils ont ne s'accommode pas du fait qu'il y a un dérèglement climatique. Et c'est ça le problème, c'est plutôt que ça ne les arrange pas. Et ça va être pareil avec les créationnistes versus les évolutionnistes. Ce n'est pas une question de vérité. Les créationnistes, ils ne sont pas là pour dire le fait que la vérité soit d'un côté ou de l'autre. Le problème, c'est que ça ne les arrange pas de penser que l'humain descend du singe entre guillemets d'accord le problème c'est que dans leur vision du monde il faut qu'ils aient dieu qui les créent Et donc, c'est ça l'enjeu, en fait, fondamentalement. Donc, c'est plutôt cadrer à partir de quand une connaissance scientifique vous dérange dans le sens où elle vous oblige à soit réviser ce que vous faites, à soit pas forcément faire une action même. Elle chamboule votre vision du monde.
- Speaker #1
Vos croyances.
- Speaker #0
C'est ça, elle chamboule vos croyances. Et ce n'est pas confortable d'être chamboulé dans ses croyances. C'est normal, on doit tous se réajuster. Tous les enfants, on le sait bien, sont néplatistes ou pensent que la Terre est immobile parce qu'en fait, elle a l'air d'être immobile. Si vous regardez par la fenêtre, on ne voit pas les choses qui bougent. Ils sont désarçonnés, ils vont résister, vous le savez, si vous le dites à un enfant, « Tiens, tu sais qu'en fait la Terre bouge ? » Ils vont dire « Ben non, on verrait les arbres bouger. » Et ils vont repasser par toute l'histoire des sciences, on a eu exactement les mêmes arguments, et fondamentalement ça va être inconfortable pour eux, et il va falloir qu'ils réalisent que quelque part, ils doivent intégrer la croyance en le fait que la Terre bouge, d'accord ? Et ça va se faire fondamentalement, là en l'occurrence parce que c'est vrai, et que du coup, puisque c'est vrai, on a d'excellents trésors de penser que ça l'est. Mais donc, ce n'est pas confortable d'être challengé dans ses croyances. Et je crois que du coup, quand on dit les fake news convainquent mieux que les vérités... C'est parce que, surtout, c'est les fake news qui cadrent avec vos croyances préétablies. Et dernier point, on dit souvent que la fiction est plus intéressante que la science, mais moi je pense que c'est faux. La science a souvent été en avant de la science-fiction, il y a des rapports un peu dans les deux sens entre les deux, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire sentir aussi, parfois quand j'ai plutôt des conférences en grand public, le monde tel que décrit par les sciences, il est beaucoup plus merveilleux que ce qu'on imagine, et il y a beaucoup de choses qui nous ont désarçonnés, qui ont défié l'imagination. On n'imaginait pas les choses de la mécanique quantique, de la relativité, mais le monde biologique, c'est incroyable. On n'imagine pas toutes les merveilles, toutes les choses complètement dingues, et complètement paradoxales, et complètement contre-intuitives qui existent dans le monde biologique. Et donc parfois, il faut aussi pouvoir se dire que dans le vrai, il y a quelque chose aussi de merveilleux. Parce qu'on dit parfois que les fécnus se vendent mieux parce qu'elles nous vendent du rêve. Je pense qu'il y a du rêve dans la vérité aussi, pour le dire autrement.
- Speaker #1
Et c'est aussi l'objectif du podcast. Là, il y a eu un épisode avec Audrey Dussutour sur les champignons et on voit que c'est... complètement dingue. Avec Fleur, on a fait un podcast sur le merveilleux scientifique. Donc ce courant au 17, 18, 19e siècle qui met ce merveilleux au cœur de la science et des récits scientifiques.
- Speaker #0
Je pense que c'est faux de dire que la science désenchante un peu le monde comme on l'entend parfois. Elle désenchante peut-être certaines versions du monde. Elle met à mal certaines croyances, c'est sûr, mais elle réenchante énormément. Je crois qu'on apprend à connaître le monde qui est beaucoup plus merveilleux que ce qu'on pourrait penser.
- Speaker #1
Alors, je voudrais prendre tout ce qu'on a raconté jusqu'ici. et faire un petit point sur mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis ?
- Speaker #0
Oui. Donc, le podcast, il est enregistré le 25 juin. Je ne sais pas comment évoluera la situation. Il sera diffusé dans quelques semaines, voire quelques mois. Donc, la situation aura certainement évolué. Mais à l'heure actuelle, par rapport à tout ce qu'on connaît, qu'est-ce qui est en train de se passer par rapport à la relation entre la politique et la science, comment elle doit se construire aux États-Unis ? Est-ce qu'on peut craindre qu'en Europe, ça commence ? même de façon différente, à arriver. Et j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, qu'il y a des signes qui font qu'en Europe, on vient aussi titiller le process scientifique pour l'ajuster sur des enjeux qui sont autres que la construction saine d'un savoir. Je voudrais un petit peu ton avis sur tout ça.
- Speaker #1
Je crois que d'abord, ce que tu expliques aux États-Unis, ou la situation actuelle aux États-Unis, ça illustre exactement ce dont on vient de discuter. C'est-à-dire que ce qui ne convainc pas, c'est ce qui n'est pas raccord avec notre vision du monde. Et là, je pense que simplement, on a une vision du monde, alors on va dire dominante, on peut se poser les questions, est-ce que ça a été vraiment démocratique ou pas, mais jusqu'à preuve du contraire, Trump a été élu démocratiquement. Mais donc, on a clairement un pouvoir aux États-Unis qui s'associe à une vision du monde, j'entends monde au sens large, c'est pas monde naturel, c'est monde social aussi, qui a une certaine forme, qui a un certain réceptacle ou un certain ensemble de croyances, qui est clairement en conflit avec beaucoup d'enseignements de la science. Ça, c'est clair. Ce qui est étonnant, c'est que c'est clair sur des questions même de sciences naturelles, où là on se dit que le conflit est beaucoup plus difficile. Là, je dirais de manière générale, quand on est en conflit avec les sciences naturelles, on peut moins facilement arranger les choses. Donc par exemple, sur la question du dérèglement climatique, c'est assez catastrophique. Mais pas que, la question de la vaccination maintenant aussi, la question de biologie. Ils ont moins de problèmes avec la cosmologie, par exemple, parce que justement, il n'y a pas de problème d'arrangement avec leur réseau de croyances. Mais évidemment que les sciences humaines aussi, fortement, avec la reconstruction de l'histoire. avec tous les mouvements fondamentalement militants et tout ce qui est recherche en sciences sociales, qui ne sont pas nécessairement militantes, mais qui sont associés à des questions de justice sociale, qui sont des sciences également, ce n'est pas parce que ce sont des sciences sociales que ce ne sont pas des sciences, et qui donc portent aussi des représentations qui sont probablement plus du côté du vrai que du faux, et qui sont riches d'enseignements sur des politiques à mener, des recommandations à faire. Et là, je pense qu'on a un laboratoire parfait qui montre comment, quand une vision du monde particulière prend le pouvoir, là, on va dire démocratiquement, elle peut du coup se retourner contre la science. en disant maintenant on n'est quand même pas tout à fait satisfait de ce que la science dit parce que ça ne colle pas tout à fait avec ce qu'on veut et avec les politiques qu'on veut mener et donc on va écraser la science et donc on va rentrer en guerre contre la science. Là je pense qu'on peut parler d'une guerre, pas une guerre avec des armes, mais une certaine forme d'arme. Une guerre complètement idéologique et puis une guerre qui en vient avec des batailles et des manœuvres et des coups comme des coupures de financement, des mots interdits, des censures, des blocages de scientifiques à la frontière. Donc il y a clairement des manœuvres vraiment la physique, des destructions de bases de données. Donc c'est assez dramatique ce qui est en train de se passer, et globalement c'est le monde universitaire qui est attaqué, parce que le monde universitaire de nouveau représente un état global de consensus, bien qu'il y ait des dissensus en son sein, mais en tout cas représente une vision du monde qui simplement ne colle pas sur certains points, de nouveau j'insiste, il y a plein de points sur la physique, des particules, il n'y a pas de problème, mais sur certains points particuliers, on va dire, bon ben là comme ça ne nous arrange pas, ces points-là on va les mettre en doute.
- Speaker #0
Et en Europe, justement, comment cela se traduit ?
- Speaker #1
Alors moi, je ne suis pas du tout optimiste quant au fait qu'on est vraiment tout à fait protégé en Europe. Alors on est quand même, je tempère quand même mon propos pour dire, là, on est quand même pas mal lotis. Je parle en tout cas du contexte belge. On a une liberté de recherche encore. Les universités sont assez indépendantes, globalement indépendantes. Et donc moi, par exemple, à titre personnel, je ne me sens pas du tout contraint dans mes orientations de recherche. Je ne me sens pas du tout opprimé. Et je pense être chanceux à cet égard. Il n'y a pas beaucoup de scientifiques dans le monde qui peuvent. Donc je pense qu'on est assez protégé. pour le moment, mais il existe des signes ou des signaux de trumpisme. On voit bien que le trumpisme a dépassé Trump, ça commence à faire tâche d'huile un peu partout, donc on a mis sous ce mot trumpisme, je ne veux pas simplement dire Trump, la personne et sa politique, mais on voit qu'il y a des éléments de cette...
- Speaker #0
Mécanique.
- Speaker #1
Oui, c'est ça, une sorte de guerre idéologique qui arrive. Par exemple, je prends le cas en France, j'ai beaucoup de collègues français avec qui je discute, ils le voient bien, c'est-à-dire que là, il y a clairement au niveau de l'exécutif et du gouvernement des manœuvres de rendre silencieuses des pans de recherche, de disqualifier certaines recherches, pour le moment souvent dans les sciences sociales. Il y a eu des questions sur l'islamophobie, on a parlé d'islamo-gauchisme, toute la thématique sur le wokisme en est encore un exemple, où là, fondamentalement, on voit qu'il y a clairement, je dirais, des voix politiques qui tentent de faire pression, et qui font effectivement pression, notamment par des moyens, mais également dans le débat public, sur des pans entiers de recherche qui sont disqualifiés, pour le moment, symboliquement, mais pas que. On n'en est pas encore à Trump qui interdit des mots, qui interdit... Mais je pense que si on n'y prend pas garde, c'est clairement vers ça qu'on s'oriente. Encore récemment, je lisais, alors je ne sais plus très bien pour ne pas dire de bêtises, mais une tribune d'un ancien directeur du CNRS ou quoi, et ça c'est encore un début de trumpisme, c'est de dire, grosso modo, il faudrait couper tous les financements des sciences humaines, ça par exemple, ce ne sont pas des sciences très productives, mais là on est déjà dans un peu une manœuvre qui va exactement dans ce sens-là.
- Speaker #0
Comment on peut lutter contre ça ? Parce que quand on voit la vitesse à laquelle ça s'est passé aux Etats-Unis, les scientifiques n'ont pas pu se mobiliser avant que ça se produise. Ici, tu le dis, il y a des petits signaux. Comment les scientifiques peuvent ou doivent se mobiliser pour empêcher que cela arrive ?
- Speaker #1
Je pense que là, ils doivent d'abord faire bloc, ça c'est sûr.
- Speaker #0
Quand tu dis qu'il y a un gars du CNRS qui écrit... Oui,
- Speaker #1
mais il faut garder à esprit que les scientifiques, ce n'est pas un bloc. Au-delà d'abord de l'idée du contenu de la science, il peut y avoir des dissensus, mais même si on met, parce que là c'est plutôt de la politique, il y a des scientifiques qui sont de tout bord politique, ils sont de tout bord idéologique. Il y a peut-être des tendances, mais grosso modo, ils sont de tout bord idéologique. Et donc, ce serait vain d'imaginer que sur des questions plutôt d'ordre politique, sur des questions de justice sociale, sur des questions de société, ils vont faire bloc. Mais il n'empêche qu'ils doivent au moins se rassembler sur des... éléments, je dirais, qui sont constitutifs de ce qui fait communauté scientifique, à savoir la liberté de la recherche, à savoir l'indépendance des chercheurs. L'indépendance des chercheurs, c'est aussi l'indépendance du politique, c'est-à-dire typiquement avoir aussi encore des sources de financement qui sont attribuées par des agences indépendantes, qui ne sont pas politisées, dans lesquelles le monde politique ne peut pas mettre son nez, bien qu'il peut y avoir, et ça moi je suis assez partisan, sur le fait qu'il peut y avoir des recherches téléguidées par le politique et par la société, parce qu'il peut y avoir des champs de recherche qui sont des besoins sociaux, et on peut avoir... peut penser qu'il y a de la recherche qui est aussi comme ça, mais il faut garder bien sûr une recherche indépendante. Donc c'est faire bloc dans le sens de faire bloc pour protéger l'institution de la science indépendamment des bords politiques. Mais ça c'est bien sûr difficile, parce que ça va, on transporte tous nos croyances politiques avec nous, mais une des grosses difficultés évidemment c'est que c'est un débat politique, et que pour pouvoir lutter, pour pouvoir s'opposer à ça, c'est difficile quand les personnes au pouvoir ont été élues démocratiquement avec un programme qui est celui de faire taire certains pans de la science. Aujourd'hui, et ces temps-ci en France, c'est encore très fort. Le climato-scepticisme, pour reprendre ce terme générique au sens large, en tout cas toute entreprise de freiner tout effort visant à lutter contre le dérèglement climatique, a de beaux jours devant lui. Quand on voit qu'il y a des partis entiers qui font programme sur ça et qui ont des succès électoraux sur ça, ça veut dire que la base sociétale le souhaite. Et donc là, je ne suis pas du tout confiant quant au fait qu'on va dans la direction de plus écouter le consensus scientifique, quand je vois qu'au niveau politique, le message qui est le plus porteur, c'est un message qui va à l'encontre. des messages, et je comprends le désespoir de mes collègues scientifiques, c'est ce qui revient à Don Lookup, il y a un vrai désespoir de se dire, on crie sur tous les toits et on vient même nous accuser de devenir militants parce qu'à un moment, quand on a tout crié sur tous les sens, on commence à faire des actions, parce que nous, on est conscients de l'urgence, parce qu'on est aux premières loges, on a confiance parce que c'est nos propres travaux, on voit le drame qui est en train d'arriver et quand on voit le degré de cynisme sociétal qui se cristallise autour de ces questions-là, et que dans les urnes, ça se manifeste par des... Je comprends le désespoir, mais je comprends que je ne réponds pas vraiment à la question. C'est d'abord politique, il faut se mobiliser pour réinstiller ces messages. Je vois que ces messages, on les crie depuis 40 ans, voire plus. Je n'ai pas de solution, malheureusement, toute faite sur comment on pourrait renverser cette tendance.
- Speaker #0
J'ai l'impression aussi qu'il y a une forme de... On ne pourra pas l'éviter, en fait, parce que le politique est la structure sociale. qui est censé donner les directions. Et donc, s'ils sous-agissent cette direction-là, on aura beau danser sur notre tête, on sera bloqué.
- Speaker #1
Ils ont légitimité pour le faire, donc c'est délicat après de leur dire, sauf en repassant par les urnes, par après, on peut sanctionner, évidemment. Mais alors, évidemment, peut-être, quand même, je reviens sur la question de quelles seraient les solutions. J'ai un collègue épistémologue qui lui propose, alors ce n'est pas forcément une théorie, je ne la connais pas encore très bien, mais il dit qu'un des moyens, c'est de dépolluer l'espace public, de dépolluer l'espace médiatique de la désinformation. un des effets de tout ça c'est que le débat public n'est pas sain. En tout cas, l'environnement n'est pas sain. On a parlé des réseaux sociaux qui ont des modes de fonctionnement particuliers. On a parlé d'une très grosse polarisation des médias. Je pense qu'on est encore assez épargné en Belgique quand on voit la polarisation des médias en France, sans même parler des États-Unis. La manière dont est construit le débat public n'est pas saine. Et je pense que ça accouche de ces effets politiques en aval. Et réassainir l'espace médiatique, alors comment ? Je pense qu'il y a des procédures ou des dispositifs qui se mettent en place, notamment au niveau européen, pour réguler la manière dont les algorithmes fonctionnent sur les réseaux sociaux, pour lutter contre la désinformation. Je pense que ça doit aussi venir de là, parce que j'ai quand même la conviction que... Moi, je suis assez optimiste, j'ai tendance à penser que les gens sont plutôt de bon sens, par défaut, mais qui peuvent être trompés. Et j'ai l'impression que si l'espace médiatique est si pollué, c'est facile de se faire tromper, c'est facile de se faire embrigader dans des messages contre-productifs, pas parce que simplement on est trop bête ou on manque d'esprit critique, parce que simplement... On est piégé dans un espace médiatique pollué. Je pense que ça, dépolluer cet espace médiatique, c'est sans doute un levier parmi beaucoup d'autres. Il y a l'éducation, il y a plein d'autres choses qui doivent rentrer en ligne de compte, qui serait peut-être quelque chose d'assez salutaire.
- Speaker #0
Et peut-être pour conclure, donc on a parlé de l'esprit critique pour le citoyen, c'est le citoyen qui vote. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour sensibiliser le citoyen à tous ces enjeux dont on a parlé, puisque au final, le prochain vote, c'est lui qui le fera. Et s'il voit que dans le programme, il y a... éliminer le CNRS par exemple, H-Caricature ou le FNRS, il se dira non, là il y a un truc qui ne va pas, c'est pas vers ça que je dois aller
- Speaker #1
Je n'ai pas de recette miracle. Je pense qu'on a passé le cap de bien informer. Ça fait très longtemps qu'on dit qu'on donne toute l'information possible aux citoyens. Les programmes de tous les partis politiques sont de plus en plus longs. Ils sont disponibles. On fait des émissions télé. Heureusement qu'on les fait pendant les périodes de campagne où chaque parti va présenter des débats contradictoires. Je pense que l'information est donnée, elle est disponible. J'ai l'impression que le problème, c'est qu'elle est diluée. en fait, elle est diluée dans un espace informationnel pollué, où même, en fait, elle va être simplement disqualifiée en disant, oui, oui, en fait, toute cette information est disponible, mais je vais même pas aller la regarder, je vais plutôt me renseigner sur X ou sur Twitter et je vais me laisser embrigader dans un fil, ou je vais plutôt aller regarder telle chaîne YouTube et je vais me laisser embrigader. Donc, il y a un peu cet enjeu-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus profond que simplement comment on va transmettre l'information. C'est comment est-ce qu'on va donner aux gens la motivation de s'informer correctement et de faire l'effort de le faire. Et je pense que tant qu'il y a tellement de distractions, je pense que quand il y a tellement d'argent qui est investi dans La captation de leur attention, parce que c'est ça en fait, on est détourné de ce qui est important, de ce qui est plus, à mon avis, ce qui est plus intéressant, par des messages qui font le buzz, par maintenant l'IA qui spam des trucs qui font le buzz, et donc on est noyé dans un cortège de vide, et ça dilue la bonne information dans tout ça. Je crois qu'il y a un peu, donc c'est de nouveau de cette logique de dépolluer l'espace informationnel. Je pense que ça, c'est un des enjeux de l'époque, en fait, fondamentalement. Je ne suis pas du tout optimiste avec ce qui est en train de se passer avec les nouvelles technologies, comme j'ai pu le sentir avec les quelques... C'est l'allusion sur le fait que je crois que ça participe du bruit ambiant et ça participe de cette logique générale d'il faut absolument capter l'attention, la conserver, la monétiser et du coup, la détourner de ce qui est vraiment important. Et là, je crois que quand on est piégé là-dedans, on peut faire tous les travails d'information, tous les excellents podcasts qu'on veut. Si les gens n'ont pas la motivation d'aller les écouter, s'ils ne les voient même pas parce qu'ils sont dilués, s'ils n'y ont pas accès parce que c'est noyé dans un cortège de vidéos de Ausha faites par IA, pour caricaturer,
- Speaker #0
et c'est sur cette conclue oui c'est très optimiste pour revenir à Don Lookup et on va boucler comme ça dans Don Lookup moi le sentiment que j'ai à un moment c'est à chaque fois il y a des petites opportunités où on peut se dire ah là ça va c'est bon ça va aller et en fait non et j'ai l'impression qu'on est en train de vivre ça à chaque fois des petites opportunités et pour finir on passe à côté et donc est-ce qu'on peut conclure sur au final on va quand même un peu dans le mur
- Speaker #1
Don Lookup sans spoiler la fin c'est très pessimiste parce que ça finit pas bien Merci. on est d'accord et je pense que si Don't Look Up est une bonne observation de ce qu'on est en train de vivre j'espère que la fin va quand même pas être celle du film et je crois que t'as bien mis le doigt sur ce fait toutes ces petites fenêtres d'opportunités et je crois qu'un des beaux messages du film en tout cas moi ce que j'ai vraiment apprécié parmi toute autre chose et des choses que j'ai moins bien aimé etc on peut en discuter mais un des beaux messages c'est de se dire ouais on a un peu caricaturé les foules un peu idiotes qui se laissent embrigader mais en fait non je crois que c'est pas vrai. En fait, ce qu'on a bien montré, c'est que les foules, elles sont prêtes à saisir l'opportunité. Il y en a qui lèvent les yeux à un moment, ils disent, mais en fait... Non, on m'a trompé, mais systématiquement, les puissants les réécrasent. En fait, ce que ça montre bien, c'est le fait qu'ils sont piégés. Je trouve que la belle métaphore ici, c'est de se dire que ce n'est pas que les masses sont bêtes ou manquent d'esprit critique, c'est que les masses ont des opportunités à certains moments de sortir la tête, mais le système leur replonge la tête dedans, système politique et économique, cette espèce de technocratie pour la... C'est nouveau un peu, la pas du gain et la pas du pouvoir, qui sont en fait les deux moteurs, qui systématiquement ont créé un système qui empêche et qui tire systématiquement les citoyens vers le bas. en les réattirant à chaque fois dans le mensonge et dans l'imposture, là où effectivement, il y a moyen. Et je pense que ce qui désespère les scientifiques, c'est ça en fait. C'est pas le fait que les gens ne les écoutent pas, parce que je crois que les gens pourraient les écouter, mais les gens sont empêchés de les écouter. C'est assez clair avec ce dispositif médiatique où à chaque fois on essaye de dire, mais c'est la présentatrice qui elle-même empêche que ça se dise. Donc c'est désamorcer, donc le message est bloqué avant même qu'il arrive aux oreilles des gens. Et ça, je crois que c'est un beau message du film.
- Speaker #0
Et donc peut-être aussi... Ça, c'est peut-être un message plus personnel, c'est la lutte n'est pas quelque chose de négatif pour peu qu'elle respecte une série de cadres qui peut être...
- Speaker #1
Exactement. Une fois qu'on a dit tout ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le système qui est vicié. Et donc, ça veut dire qu'il faut... Alors moi, je ne suis pas révolutionnaire, il faut renverser le système. En tout cas, il faut repenser le système. Et donc, du coup, ça ne passe pas que par de l'éducation à esprit critique. Ça ne passe pas que par multiplier les entreprises de vulgarisation et de communication scientifique, même si c'est important de le faire. Ça fait partie de l'équation. Mais il faut aussi repenser la façon dont le système informationnel est construit.
- Speaker #0
Je te propose de finir là-dessus. En tout cas, c'est un film qui mérite, dans le contexte actuel, d'être revu. Après le podcast, je t'invite vraiment, cher auditeur, chère auditrice, à revoir le film. Parce que justement, il y a plein de parties du film qui sont éclairées par rapport à ce qu'on a dit et à confronter un petit peu cette réalité que l'on vit à l'heure actuelle à ce qui se passe dans le film. Et je pense aussi à se dire, non, ce n'est pas inévitable. Il peut y avoir des choses qui sont mises en place, mais ça nécessite une mobilisation. globale de nous, citoyens, qui pouvons encore changer les choses pour peu qu'on arrive à converger vers quelque chose de plus grand et qui nous dépasse. Olivier, merci beaucoup pour cet échange et j'espère qu'on pourra à l'occasion refaire quelque chose pour les prochaines saisons. A très très bientôt.
- Speaker #1
A bientôt, merci.
- Speaker #0
Cher auditeur, cher auditrice, je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode de Science, Art et Curiosité. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons, et franchement j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujets ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du Mumons. Musique Musique



![[Trailer] Épisode 127 - Les samuraïs | Feat. Nota Bene cover](https://image.ausha.co/AW1pCHnmztcqBKVJYrdlg8UJoGppeV7f6InqXiU4_400x400.jpeg)
![[Trailer] Épisode 126 - Don't look up cover](https://image.ausha.co/mohXXgD9uqv1B20On1Ju3i98QiisWCcr1FvRpuCw_400x400.jpeg)