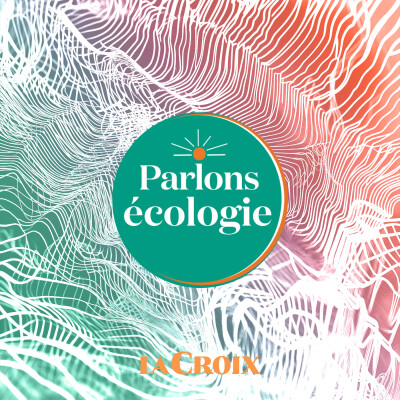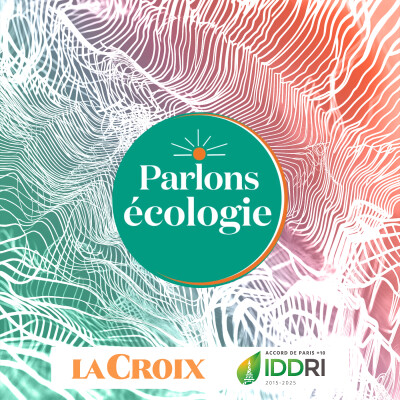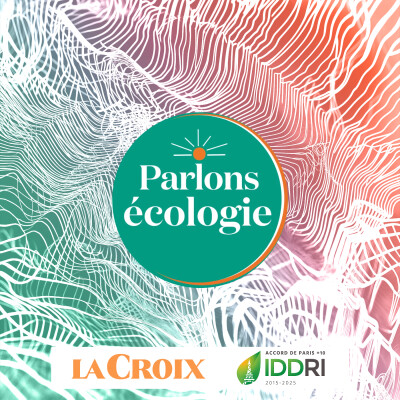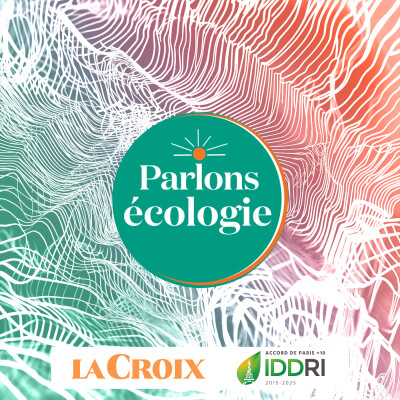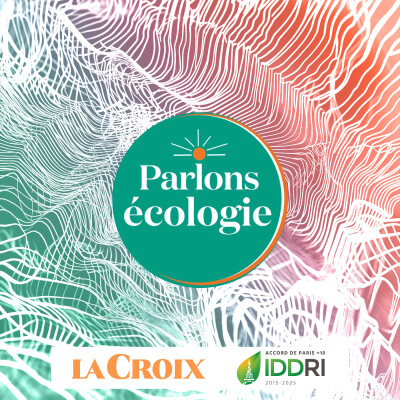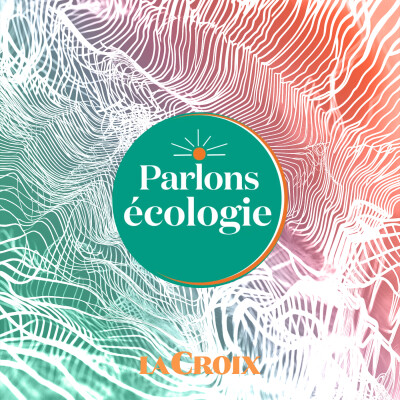- Speaker #0
Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
- Speaker #1
Un petit coup de marteau, entrée dans l'histoire. Ce 12 décembre 2015, 196 partis, des pays riches, pauvres, petits ou grands, se mettaient d'accord pour limiter le réchauffement planétaire et coopérer pour s'adapter aux effets du changement climatique. Ce podcast donne la parole à des acteurs clés de la transition pour explorer, dix ans plus tard, ce que le monde a fait de cet accord fondateur et comment la prochaine décennie pourrait être celle des changements en profondeur.
- Speaker #0
Urgence climatique, dix ans pour agir,
- Speaker #2
promesses et réalités de l'accord de Paris.
- Speaker #1
Un podcast de l'IDRI, l'Institut du développement durable.
- Speaker #0
et des relations internationales coproduites par La Croix avec la participation de RFI.
- Speaker #1
Épisode 1, dans les coulisses d'un accord historique.
- Speaker #0
Alors vous l'avez fait. Vous avez réussi là où il y avait eu l'échec il y a 6 ans. Nous entrons dans l'ère du bas carbone. C'est un mouvement puissant et irréversible. Savoir que la prochaine génération ira mieux grâce à ce que nous faisons ici, peut-on imaginer meilleure récompense ? Au travail ! C'est un moment historique parce que ce n'était pas facile. Et cela crée un nouvel espoir. Quand il y a un accord, il y a forcément des gagnants et des perdants, mais en fait, je pense que finalement,
- Speaker #1
tout le monde est gagnant et tout le monde est un peu perdant.
- Speaker #0
Tout à coup, tout le monde a commencé à parler en une une façon,
- Speaker #2
en disant très clairement
- Speaker #0
« Ceci est le meilleur accord pour l'humanité, ceci est le meilleur accord pour le business, ceci est le meilleur accord pour la planète. » Toutes les exigences n'ont pas été satisfaites, mais on ne sera pas jugé sur un mot, mais sur un acte. Pas sur un jour, mais sur un siècle.
- Speaker #2
Quand je revois, on revoit de temps en temps les images, et ça provoque exactement la même impression. Incroyable, c'est-à-dire, c'est pas possible, on est arrivé.
- Speaker #1
Elle, c'est Laurence Tubiana, économiste et négociatrice en chef de la COP21 pour la France.
- Speaker #2
Nos amis chinois, à chaque fois qu'on a des réunions avec eux, ils projettent ce film. Et chaque fois, ça fait la même émotion. Elle reste intacte.
- Speaker #0
Pas grande distance qui sépare un succès d'un échec.
- Speaker #1
Lui, c'est Laurent Fabius. En 2015, il est ministre français des Affaires étrangères et préside la COP de Paris.
- Speaker #0
J'ai frappé qu'on marteau vers la fin de la matinée, au début de l'après-midi, mais le matin, quand je me suis levé après une nuit blanche, je n'étais pas du tout sûr que ça allait fonctionner, parce qu'il y avait encore des pays qui étaient réticents. Après, bon, ça a été le moment d'une très grande joie. Là, vous aviez le monde entier, des ministres, des chefs d'État, etc. Et souvent, c'est des crocodiles, quoi. Et là, il y avait des gens qui pleuraient dans tous les coins parce qu'ils avaient travaillé pendant des années et des années et tout d'un coup, ça devenait possible.
- Speaker #1
Aux côtés de ces deux acteurs clés français de l'accord de Paris, parmi les délégations, on croisait souvent Todd Stern. Lui, c'était le négociateur américain. Et ce 12 décembre, comme tout le monde, il venait de passer une nuit blanche.
- Speaker #0
Il y a eu un moment plus tôt, peut-être vers midi, Fabius a appelé tout le monde dans la grande salle plénière et il nous a annoncé le programme du jour. Il nous envoyait le texte final et on revenait tous en plénière. Personne n'avait vu la dernière version du texte depuis deux jours et pourtant, tout le monde applaudissait debout. Je pense que l'impulsion politique a créé le sentiment que c'était inévitable et que c'était en train d'aboutir.
- Speaker #1
Inévitable, un mot qui permet de mesurer le chemin parcouru. Car deux ans avant, quand la France est désignée par acclamation pour organiser la COP21 en 2015, plus grand monde n'y croit, se rappelle Laurence Tubiana. qui a quitté l'IDRI qu'elle avait cofondée pour se lancer dans cette bataille diplomatique aux côtés de Laurent Fabius.
- Speaker #2
D'abord, c'était l'apprentissage de ce qui n'avait pas marché. Parce que cet accord de Paris, il faut reconnaître qu'il intervient très tard, après de multiples essais et erreurs. On a essayé, notamment à Copenhague, puisque c'était ça, notamment en 2009, l'objectif, d'avoir un accord global. De 2009 à 2015, ça a donné quand même du temps pour y réfléchir. La France s'est décidée assez tôt mais assez tard aussi pour candidater pour cette COP avec aucun autre candidat puisque tout le monde avait évidemment peur de la répétition de l'échec.
- Speaker #1
Les Français ont très vite la conviction qu'il faut faire exister le débat dans chaque pays du monde. Elles mettent en place une méthode et une équipe, et activent notamment un atout, son réseau diplomatique, l'un des plus étendus au monde.
- Speaker #2
La première réunion qu'il y a eu sur le climat, peut-être une des seules, qui a eu lieu au Pakistan, ça a été à l'ambassade de France au Pakistan. Et du coup, les ambassadeurs se sont transformés en des facilitateurs de débat, parlant avec les parlementaires, les ONG, les journalistes, les industriels. parfois les militaires, leur ambassade devenant le lieu où on discutait climat. Et ça, ça a été extraordinaire parce que d'abord ils l'ont tous fait, avec énormément de talent, et puis Laurent Fabius leur demandait de toutes les semaines d'envoyer le rapport de ce qu'ils avaient fait.
- Speaker #1
Deux années de diplomatie à 360 degrés et en moyenne un tour du monde par mois pour Laurent Fabius et ses équipes, avec la volonté de tisser des liens de confiance avec tous, aussi bien les pays riches d'y développer qu'avec les grands émergents et avec les pays en développement, jusqu'aux plus vulnérables face au dérèglement du climat, notamment les petites îles.
- Speaker #0
Ce qui est très important, c'est de bâtir la confiance. C'est-à-dire que les délégués qui sont là, n'aient pas le sentiment que vous avez un texte tout près dans votre poche et qu'au fond, les 15 jours sont là pour amuser la galerie et que le dernier jour, vous allez sortir le texte que vous avez fait auparavant. Non, donc c'est une co-production, une co-construction. Le problème n'est pas... D'être sûr d'avoir raison, de dire je suis le plus fort, je suis le meilleur, on a raison. Il faut comprendre le point de vue de l'autre. Et c'est là qu'intervient la diplomatie, les dialogues. Il faut écouter chacun.
- Speaker #1
Écoute et confiance, voilà pour la méthode qui se révèle précieuse jusqu'au dernier moment, quand après une nuit d'ultime tractation, le texte final est distribué et que un mot peut faire tout capoter.
- Speaker #0
Un certain nombre de passages devaient comporter le terme « should » , ce qui, en termes juridiques, signifie non pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. C'est-à-dire que tous les pays s'engageaient à fournir leur meilleur effort, mais ne pouvaient pas s'engager d'une manière internationalement décisive. Et donc, il y avait le mot « should » à plusieurs reprises utilisé. Et puis, patatras, lorsque le texte sort à la photocopie, Il était traduit en cinq langues, les langues de l'ONU. Le chou avait été remplacé par châle. Et châle, c'est une obligation de résultat. J'ai attrapé le texte qui sortait de la photocopieuse, puisque c'était mon job. Je voulais le lire en premier et j'ai été le premier à voir cette erreur, en fait. Et dès que j'ai vu ça, je suis allé rejoindre John Kerry et notre meilleur juriste, Soubignas. La dégagation américaine qui était conduite par mon ami John Kerry. Viens me voir et John me dit, écoute Laurent, je suis désolé, on a travaillé ensemble, mais ça c'est pas possible, parce que si c'est une obligation de résultat, ça doit passer par le Congrès américain, et le Congrès américain, compte tenu de ses traditions, n'acceptera jamais. Je pense que quelqu'un, et je ne sais pas qui, s'est dit, rendons ça un peu plus solide. Chal, ça sonne mieux, sauf que ça a provoqué un désastre.
- Speaker #1
Le diable se cache dans les détails. « Shall » a une valeur de futur et « agir » devient alors une obligation formelle. Alors que « should » , c'est du conditionnel, « agir » est seulement une recommandation. Cette différence, mince mais cruciale, traçait des lignes rouges posées entre autres par les Américains.
- Speaker #0
Nous voulions un accord qui soit en partie juridiquement contraignant, mais pas entièrement. Et s'il avait été contraignant sur les objectifs de réduction des missions auxquelles les pays s'engageaient, cela dépassait les limites. Cela aurait aussi dépassé les limites s'il y avait eu une obligation contraignante de fournir un certain montant d'aide financière. Si ça avait été du genre « vous devrez donner telle somme d'argent » , ça n'aurait pas marché non plus. Donc la ligne rouge fondamentale, c'était qu'on ne pouvait pas approuver un accord qui, aux Etats-Unis, serait rejeté par le Sénat.
- Speaker #1
Suspension de séance, ultime gestion de crise, le temps pour Laurent Fabius et ses équipes d'aller réexpliquer. à ceux qui étaient ravis que soit apparu un mot plus contraignant que c'était une erreur.
- Speaker #0
J'ai eu une conversation longue, en particulier avec ce qu'on appelle les 77, c'est-à-dire les représentants des pays en développement, avec notamment la délégation africaine qui conduisait la délégation. Et j'ai fini par les convaincre que c'était une simple erreur de plume. Et on a corrigé cette erreur.
- Speaker #1
Petit retour sur les conditions de cette négociation. Pour réussir, il fallait donc mettre d'accord 196 délégations aux intérêts, revendications et lignes rouges parfois très éloignées. Avec un premier point très positif, sur lequel l'équipe de Laurent Fabius et Laurence Tubianas savaient pouvoir compter, le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, la Chine, avait décidé de monter dans le bateau de la transition.
- Speaker #2
Entre Copenhague et Paris, il s'était passé déjà beaucoup de choses. Et notamment, évidemment, l'évolution de la position chinoise sur ce qu'elle voyait comme évolution de l'économie mondiale et sa place dans cette économie mondiale. Et le Paris fait, avant tous les autres, avant l'Europe, avant les États-Unis, sur le fait que les technologies vertes allaient être la manière pour elles de rentrer comme premier, si possible, comme première économique mondiale.
- Speaker #1
Parmi les meilleurs observateurs chinois à l'époque, Il y avait Li Shuo, aujourd'hui directeur du programme Climat en Chine à l'Ajian Society Policy Institute, un think-tank américain. Il se rappelle très bien l'effervescence diplomatique qui a précédé la COP21.
- Speaker #0
Je travaillais pour Greenpeace en 2015. J'étais chef de notre délégation. Et pendant le sommet Climat de Paris, j'étais bien sûr sur place. Je couvrais toute la conférence, les deux semaines. Cette année-là, un mois avant la COP climat de Paris, le président français est allé en Chine. Il a rencontré son homologue et il a sollicité le soutien chinois pour que le sommet climat de Paris soit un succès.
- Speaker #1
Deuxième atout déterminant, bien en amont du rendez-vous de Paris, le rapprochement sur les questions climatiques des deux plus gros émetteurs au monde, les Etats-Unis et la Chine, l'un ne voulant pas être à la traîne de l'autre. Todd Stern, le négociateur américain, était au cœur des discussions.
- Speaker #0
J'ai commencé à travailler de manière très concertée avec la Chine, déjà en 2009. J'ai rencontré Xi Zhenhua, mon homologue à Washington, et lors de cette première rencontre, je lui ai dit « Je crois que vous et moi pouvons essayer de faire du changement climatique un pilier de notre relation. » Et Xi était ouvert à ça. Ça n'a pas donné grand-chose. La première année, en 2009, la Chine était toujours dans l'affrontement avec nous. Mais on a vraiment progressé quand Xi Jinping est arrivé au début du second mandat du président Obama. Ils ont commencé à se parler et le moment le plus connu et le plus important de cette relation s'est produit début 2014, quand on leur a proposé de se rencontrer pour annoncer conjointement leurs objectifs pour Paris. En d'autres termes, de travailler ensemble pour être sûr d'aboutir à un accord. Ça a été neuf mois de négociations secrètes. Et il fallait que ce soit secret, parce qu'on ne pouvait pas laisser le président Obama se présenter devant le président Xi dans le Grand Palais du Peuple sans être sûr que ce que les Chinois proposaient était acceptable.
- Speaker #1
C'est finalement en novembre 2014, un an avant la COP, que les présidents chinois et américains annoncent avoir décidé de gommer leurs principaux différents d'ici le rendez-vous de Paris. Si les derniers points de désaccord n'ont finalement été réglés que dans les tout derniers jours de la COP, selon Li Shuo, l'impulsion donnée par cette entente entre Chine et Etats-Unis a été décisive pour convaincre les autres pays.
- Speaker #0
Cela a donné lieu à une série de déclarations conjointes de haut niveau sur le climat. Et toutes étaient vraiment novatrices. Elles ont véritablement préparé le terrain pour l'accord de Paris. Certains éléments de ces déclarations ont finalement été intégrés à l'accord de Paris. C'est un exemple très clair de la manière dont les deux plus grandes économies et plus grands émetteurs du monde ont travaillé ensemble, sont parvenus à des accords et ont montré la voie au reste du monde. En quelque sorte, ils ont fixé les règles. sur la manière de réduire les émissions, sur l'objectif global de réduction des émissions. Comment garantir que les pays, lorsqu'ils réduisent leurs émissions, fassent preuve de transparence en rendant compte aux autres de leurs émissions ? Tous ces éléments ont pu être obtenus, je crois, en grande partie, grâce à l'accord États-Unis-Chine qui a précédé l'accord de Paris.
- Speaker #1
Voilà pour les bonnes nouvelles, mais cette entente ne réglait pas tout, évidemment. Dans la feuille de route que s'était donnée l'équipe française à la manœuvre, il y avait notamment une ambition capitale, faire de l'accord de Paris un processus de très long terme. Laurence Tubiana.
- Speaker #2
Chinois et Américains pensaient qu'ils allaient faire un accord au maximum pour dix ans. Et donc on allait renégocier l'accord dix ans après. Ça, c'était l'obstacle majeur, parce que, vu les difficultés de négocier des accords et les incertitudes... le signal économique était quasiment mort. Donc première chose, obtenir d'abord des Chinois, puis des Américains, que c'était un accord pour toujours et qu'il y aurait des clauses de révision. Donc ça a été beaucoup ce premier travail de convaincre, non, on ne va pas recommencer Kyoto, on ne va pas rediscuter sans arrêt. Il nous faut quelque chose qui tienne le coup pour longtemps, c'est-à-dire pas de clause de fin, mais en revanche, qu'on s'adapte aux évolutions technologiques, économiques, y compris en... en comprenant qu'il peut y avoir des crises et des allers-retours sur une trajectoire qui doit être quand même assez claire.
- Speaker #1
Autre difficulté à surmonter, convaincre les pays émergents qui, selon les mots de Laurence Tubiana, n'en avaient pas grand-chose à faire.
- Speaker #2
Le mauvais moment, ça a été le G20 en Turquie, juste avant Paris. Si on s'en était tenu aux conclusions du G20, ce n'était pas la peine de venir. C'était tellement négatif. Ils ne voulaient pas parler de climat, ils ne voulaient pas parler d'accords globales. Il n'y avait aucune raison qu'il y ait des engagements de réduction des émissions des pays dits émergents. On est sortis là assez essorés en se disant, bon, oui, les Saoudiens, tous les autres, là, ils ne veulent pas. Et c'est vrai que si on lisait les 20 pays, les 20 économies les plus importantes, on n'aurait pas pu avoir l'accord de Paris.
- Speaker #1
Ça avait l'air plutôt mal parti. Alors qu'est-ce qui a bien pu convaincre les grandes économies émergentes d'approuver finalement l'accord de Paris ? On a demandé à l'un des tout meilleurs connaisseurs des questions climat en Inde. Arunabha Ghosh a fondé et dirige le Council on Energy, Environment and Water, le CEEW, l'une des principales institutions de recherche politique d'Asie sur ces sujets. A l'entendre, ce qui a décidé un pays comme l'Inde, c'est la nouvelle philosophie de cet accord, passé de « top-down » à « bottom-up » comme on dit dans les négociations. Ce qui veut dire que désormais, ce n'est plus la communauté internationale qui dit à chaque pays ce qu'il doit faire, mais plutôt chaque pays qui propose... ce qu'il est en capacité de faire pour participer à l'effort commun. Et ça change tout, nous a expliqué Haruna Bagosh.
- Speaker #0
Ce qui a changé, c'est qu'au cours des 20 années qui ont suivi la signature de la Convention de l'ONU sur le changement climatique, il était devenu évident que la manière dont les protocoles avaient été pensés, du haut vers le bas, ne produisait pas les résultats permettant d'éviter les pires impacts du changement climatique. les mauvais impacts du changement climatique. Autre chose assez évidente, les pays comme le mien reconnaissaient qu'il y avait là l'opportunité de faire un bond en avant technologique, un bond en avant systémique grâce à ce qui se passait dans le monde entier. Et troisièmement, les négociations internationales étaient le reflet de ce qui était déjà en cours chez nous. Et ça, souvent, ça n'est pas reconnu. Il était très clair que les pays en développement tentaient d'exploiter les ressources à leur disposition. Ces trois éléments ont donc amené l'Inde et de nombreux autres pays en développement à la table des négociations, car ils ont pensé que cette approche qui partait des pays méritait d'être essayée.
- Speaker #1
Et de ce côté-là aussi, la diplomatie a été intense pour s'assurer que les grands pays émergents ne feraient pas obstacle. Le dernier week-end avant la COP, achevant de plomber son bilan carbone, Laurent Fabius est allé voir le Premier ministre indien, le président d'Afrique du Sud et la présidente du Brésil. Enfin, dans cette négociation de Paris, il y a les pays en développement, c'est-à-dire... plus pauvres et qui aspirent à augmenter leur niveau de vie. Beaucoup sont du continent africain et la plupart subissent déjà de plein fouet les conséquences des changements climatiques, alors qu'ils n'en sont que très peu responsables. C'est un groupe de pays hétéroclites mais qui, globalement, espère obtenir à Paris un accord ambitieux le plus contraignant possible. Nisrine El Saïm est soudanaise, très impliquée aujourd'hui dans les négociations pour l'Afrique. En 2015, alors étudiante, Elle était à Paris pour la conférence des jeunes pour le climat et se rappelle ses sentiments mêlés, espoir et déception.
- Speaker #2
On était très déçus à la fin, pour être honnête, en tant que pays du Sud et défenseur des pays en développement.
- Speaker #0
Parce que la plupart du contenu de l'accord reposait sur des engagements volontaires.
- Speaker #2
Déjà,
- Speaker #0
on savait que les pays ne s'engageraient pas, alors là, sur la base du volontariat,
- Speaker #1
ça allait être pire.
- Speaker #0
On pourrait juste leur faire honte publiquement,
- Speaker #2
mais sans force juridique.
- Speaker #1
Ces pays en développement ont bataillé jusqu'au bout. Ils auraient aimé plus de châles et moins de choudes dans le texte final, qu'ils ont tout de même accepté. Michel Colombier nous explique ce choix. Il est cofondateur et directeur scientifique de l'IDRI et membre du Haut Conseil pour le Climat en France.
- Speaker #0
Ça, c'est quelque chose qui m'avait été ramené par un négociateur qui m'avait dit, nous, dans cet accord, on ne trouve pas forcément encore tout ce dont on a besoin. Et donc, il va falloir qu'on continue à négocier sur l'aide qui nous sera apportée, sur le financement, etc. Mais il y a deux points qui nous ont semblé absolument importants et qui font qu'on ne pouvait pas être les parties bloquantes de cet accord. La première, c'est que fondamentalement, si cet accord ne se faisait pas, si l'action climatique n'accélérait pas, nous en serions les premières victimes. Et donc là, en tant que négociateur, on a une responsabilité fondamentale vis-à-vis de nos pays. Et le deuxième, c'est que cet accord... présente la transition climatique, la transition écologique, comme la mise en place d'une socio-économie nouvelle. Et en tant que pays en développement, il faut qu'on soit dedans.
- Speaker #1
Et puis il y a les pays les plus vulnérables. Depuis longtemps dans les COP, ce sont eux les plus ambitieux. Et on comprend pourquoi. Il s'agit notamment des petites îles du groupe AOSIS, acronyme anglais pour Alliance des Petits États Insulaires. Alexandre Magnan étudie ces territoires depuis 20 ans, leur fragilité et surtout l'adaptation des populations au changement climatique. Il est géographe, ancien de Lidry, aujourd'hui chercheur en Nouvelle-Zélande et auteur du GIEC.
- Speaker #0
Leur argument de base depuis très longtemps, depuis la fin des années 80, c'est de dire que nous, petites îles, nous serons les premiers affectés par le changement climatique, en l'occurrence notamment l'élévation du niveau de la mer. Nos territoires sont petits, les espaces vitaux pour nos territoires sont situés à basse altitude sur le littoral, et donc le risque qu'on encourt, c'est tout simplement une disparition de certains de nos territoires et des impacts majeurs sur l'autre partie des territoires qu'on occupe sur le littoral. Et ça, c'est un argument émotionnel assez fort, dont les médias se sont fait le relais, évidemment. C'est la question des risques existentiels. posée par le changement climatique sur les sociétés humaines. Et ça, ça a été un argument de poids pour les petites villes, pour pousser notamment à ce que l'accord de Paris acte le fait que plus 1,5 degré de réchauffement planétaire à l'horizon 2100 par rapport à la période prince-du-ciel était l'objectif clé à l'échelle du monde entier.
- Speaker #1
La formulation, arbitrée in extremis à Paris, retient précisément que les pays signataires visent une limitation de la hausse de la température bien en deçà de 2 degrés Celsius en faisant tous les efforts pour la maintenir à 1,5 degré. En séance plénière, l'intervention du ministre de l'Environnement des îles Marshall dans le Pacifique avait bouleversé tout le monde. Cathy Jetnil-Kijiner a un souvenir très précis de ce moment. Aujourd'hui, elle est négociatrice pour son pays, mais il y a dix ans, juste aux portes de l'enceinte de la COP, elle militait avec la jeunesse marshalaise pour le climat.
- Speaker #0
J'étais une activiste en marge des négociations. J'interprétais de la poésie pendant la COP 21 de Paris. Et ceux qui étaient à l'intérieur me disaient qu'il n'y avait aucune chance qu'on arrive à imposer la limite d'un degré et demi dans cet accord. Mais vu l'impact climatique déjà subi par les îles Marshall, on avait un coup à jouer avec notre ministre de l'Environnement de l'époque, Tony de Broome. Voir la façon dont il a réussi à négocier ce résultat, pour assurer notre sécurité, ça a été énorme. 1.5, pour moi, c'était un enjeu très personnel. Je crois que ça a été une opportunité incroyable de protéger les pays vulnérables. Est-ce que c'est parfait ? Non, pas du tout. Mais je crois que c'était un grand pas en avant.
- Speaker #1
La COP21 à Paris, c'est aussi la première fois qu'autant d'autres acteurs non étatiques s'impliquent dans une réunion aussi importante pour le climat. Laurence Tubiana se souvient d'une émulation. communicative.
- Speaker #2
Il y a eu plein de soutien, une discussion permanente avec les ONG nationales ou internationales, une mobilisation des scientifiques qui a été quand même vraiment exceptionnelle, et donc un espèce d'effort collectif qui était avec à la fois la crainte de chacun de l'échec, qui a été extraordinairement fort jusqu'à la dernière minute, vraiment jusqu'à la dernière minute, et en même temps, quand même une mobilisation très très large. Et peut-être la particularité de cette... « Diplomatie 360 degrés, comme je l'appelle, ça a été de se dire, bon, il faut ouvrir toutes les portes. »
- Speaker #1
Des ONG, des scientifiques, mais aussi des collectivités, des villes, des associations, et aussi le secteur privé, des entreprises convaincues que la transformation de l'économie était en marche. Pour Sébastien Treyer, le directeur général de l'IDRI, cet engagement-là, hors de la sphère politique de négociation, a joué un rôle très important.
- Speaker #0
C'est sûr qu'il y avait en 2015 une énorme... pression, j'allais dire, par les acteurs économiques qui disaient à leur gouvernement « Nous, on est prêts à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, donc vous pouvez être plus ambitieux que ce que vous déclarez généralement en ayant peur de nous froisser, nous, milieu économique, ou de nous empêcher d'avoir notre croissance économique. » Et donc cette pression était très forte et les acteurs économiques, la société civile, les collectivités ont pris des engagements et donc il y avait une dynamique collective en dehors du cercle formel de la négociation diplomatique qui créait à la fois des effets sur les États, pour leur mettre la pression. et qui prenaient aussi la pression des États pour qu'eux avancent.
- Speaker #1
C'est à ce moment-là qu'émergent un certain nombre de grandes coalitions sectorielles, dont l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction. Emmanuel Normand se souvient de cette impulsion. Il est directeur du développement durable de Saint-Gobain, un gros acteur de la construction présent dans 80 pays du monde.
- Speaker #0
C'est au moment de la COP21 qu'a été décidé de créer une coalition. s'appelait la Global Alliance for Building and Construction, qui est aujourd'hui une des plateformes clés dans le monde du bâtiment, qui regroupe plus de 250 organisations, des États, des gouvernements, et toutes sortes d'acteurs non étatiques, des entreprises, des villes, des ONG, des think tanks, et qui ont décidé de travailler en collectif pour comprendre ce qu'il fallait faire pour transformer le monde du bâtiment. Et c'est le début du moment où le... le sujet est passé des mains des experts à une prise en compte plus générale.
- Speaker #1
Bilan de cette mobilisation extrêmement large, un accord de Paris souvent qualifié d'historique. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que ce texte marque un tournant dans la lutte pour le climat ? Faisons un tour de quelques points clés avec les experts de l'IDRI. Premier élément de réponse avec Sébastien Treyer.
- Speaker #0
Pour moi, il y a deux aspects historiques. Le premier, c'est qu'il était universel, c'est-à-dire que l'ensemble des pays de la planète ont dit « oui, je m'engage à faire des choses pour protéger le climat » . Et bien juste pour m'adapter mais vraiment pour protéger le climat et ça c'est complètement nouveau que ça soit aussi universel. La deuxième chose est plus subtile, c'est qu'on est dans un accord bottom-up par opposition à des choses qui sont top-down, qui tomberaient d'en haut. C'est cette négociation-là qui ne marchait pas auparavant. Là on repart dans un processus qui est les pays disent ce qu'ils peuvent faire avec leur politique nationale, on regarde tous les cinq ans si ça suffit et on essaye d'augmenter ensemble l'ambition. Ça, ça ne marcherait pas. On l'a vu dans d'autres cas, comme sur la biodiversité ou la sécurité alimentaire mondiale, si on n'avait pas cet objectif collectif de 1,5°C ou 2°C. Parce que là, ça veut dire que régulièrement, on peut se dire qu'on n'y est pas, et on peut mesurer l'écart à l'objectif.
- Speaker #1
Ces ambitions affichées par chaque pays, leur plan climat en fait, c'est ce qu'on appelle les CDN, pour Contribution Déterminée au Niveau National. On parle souvent de NDC, c'est l'acronyme anglais. Et ça, c'est un outil nouveau et essentiel dans l'accord de Paris. Laurence Tubiana.
- Speaker #2
Si on regarde ce qui se passait dix ans avant, personne n'avait de plan climat dans peut-être 150 pays. Il y en avait peut-être quoi ? 30, 40. Ça a été ça, la grande innovation d'abord. C'est-à-dire que les gens se sont dit, ah oui, il faut faire un plan climat. Les premières NDC qui ont été posées en 2015, elles étaient très incomplètes. Et puis, notamment quand on est arrivé en 2021 finalement, puisque c'était le moment où elles devaient donner les définitives. Déjà, les pays avaient commencé à comprendre qu'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus sérieux, qui ne pouvait pas être fait par des consultants dans un coin. Et il y a eu un apprentissage pendant ces cinq ans.
- Speaker #1
Des plans climat qui doivent être mis en œuvre par les pays ont toute transparence en déclarant leurs émissions de gaz à effet de serre et les progrès accomplis dans l'atténuation. Tous ont accepté cette transparence et c'est un point important de l'accord de Paris. L'esprit de ce texte, nous explique le directeur scientifique de l'IDRI, Michel Colombier. c'est d'introduire des changements profonds.
- Speaker #0
L'accord de Paris a essayé de trouver une place pour l'ensemble des pays dans un cadre commun, alors que les accords précédents avaient tendance à diviser le monde en différentes parties, avec une partie et un rôle pour chaque groupe de pays. Et on comprend bien que des accords comme ça, en fait, dans le temps, ne fonctionnent pas, puisque les situations des pays évoluent, les pays émergents, qui étaient avant des pays en développement, etc. La deuxième chose qui me semble super importante dans l'accord de Paris, c'est qu'il positionne cet accord environnemental comme étant un accord qui participe à la gouvernance du climat sans prétendre que l'ensemble de la gouvernance va pouvoir se faire par l'accord de Paris. Et donc, il ne met pas simplement en place des règles que les pays doivent suivre, mais il met en place tout un certain nombre d'éléments qui peuvent être repris ensuite dans d'autres lieux de gouvernance, gouvernance financière, gouvernance commerciale, gouvernance sur les normes, du privé, etc. et qui vont donner des directions sur l'action des acteurs, indépendamment de la mise en place stricto sensu des règles et des modalités qui sont prévues par l'accord de Paris. Un dernier point sur une critique souvent entendue. L'accord de Paris ne serait pas contraignant dans la mesure où il n'impose pas à chaque pays des objectifs obligatoires de réduction de gaz à effet de serre. Et bien, comme souvent, ce n'est pas si simple. Sébastien Trier.
- Speaker #1
Pour prendre une image, il n'y a pas de gouvernement mondial. Un gouvernement, ça permet d'avoir une police. Quand on n'a pas de gouvernement, on n'a pas de mécanisme de sanction qui soit aussi clair. Donc dans aucun accord sur l'environnement, on a de mécanisme de sanction qui soit autre. que la pression entre pairs, entre gouvernements, de se dire en fait est-ce qu'on veut perdre sa réputation vis-à-vis des autres gouvernements ou vis-à-vis de la société civile, des experts, des entreprises, etc. Néanmoins, cet accord, il est contraignant sur le fait de devoir régulièrement présenter de nouveau un certain nombre de politiques climatiques ajustées par rapport à ce qu'on comprend de l'état des technologies. Et les technologies ont avancé de manière massive, notamment la baisse du prix des énergies renouvelables, ça a changé le contexte en dix ans. et donc de voir régulièrement. remettre sur la table une politique climatique. Ça, c'est un engagement qui est normalement contraignant. Et si ce n'était pas un petit peu contraignant, il n'y aurait pas autant de batailles, notamment des pays producteurs de pétrole, pour essayer de minimiser le contenu de ce qui se discute dans cette enceinte de la Convention climat.
- Speaker #0
Tout n'est pas parfait, loin de là, mais l'accord de Paris a créé un espace politique et juridique fondé sur quatre piliers qui restent la boussole de l'action climatique mondiale. 1. C'est un accord universel et tous les pays ont la responsabilité d'agir, mais chacun selon ses capacités. 2. Il propose une nouvelle vision de l'économie, transformée, décarbonée, pour retrouver un monde plus résilient. 3. C'est un accord sans fin, sans date d'expiration. qui trace un horizon et une action à long terme. Et enfin, quatrième pilier, c'est le caractère transversal et systémique de l'accord de Paris, dont les objectifs doivent être déclinés et répercutés partout, dans toutes les sphères de l'économie et de la société. L'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5°C semble aujourd'hui bien fragile, mais est-il inatteignable, comme une étude de climatologue l'a suggéré au printemps 2025 ? On sait que chaque dixième de degré fait une différence, Et ces objectifs de Paris restent la boussole qui guide les efforts. Nous verrons tout cela dans les épisodes suivants de ce podcast. Et je laisse les mots de la fin à l'expert chinois Li Shuo et à Laurent Fabius.
- Speaker #2
Je dirais sans hésiter que l'accord de Paris a changé la donne. Il a véritablement permis d'attirer l'attention politique de tous les pays du monde sur l'agenda du climat. Depuis l'accord. Quand des dirigeants du monde se rencontrent, le changement climatique est devenu un sujet de discussion incontournable.
- Speaker #3
On peut dire, en résumé, que si l'accord de Paris a été extrêmement positif, la situation que nous vivons aujourd'hui, néanmoins, n'est pas bonne, et que l'action doit donc non seulement être poursuivie, mais amplifiée. Donc le problème, c'est l'application, la concrétisation. Ça, le travail est encore devant nous.