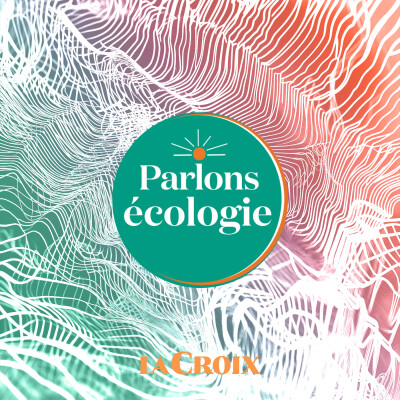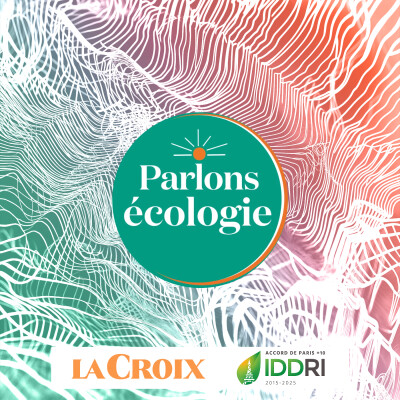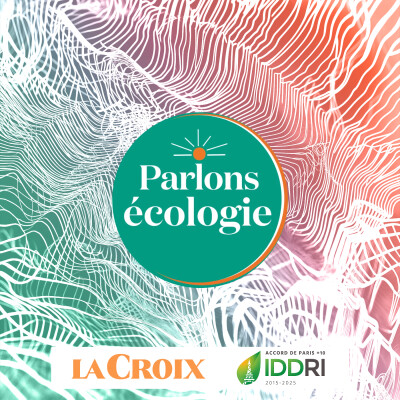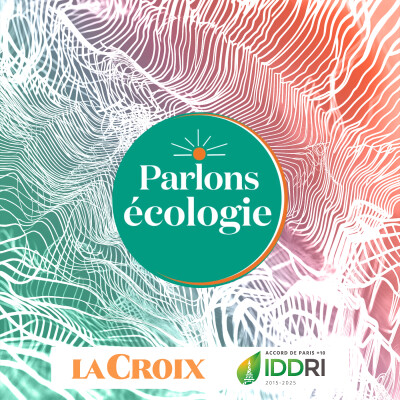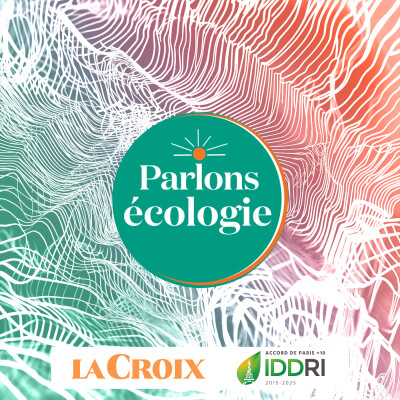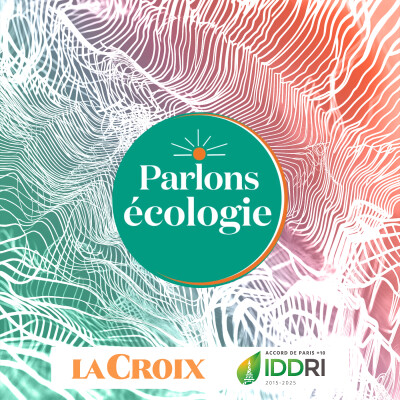- Speaker #0
Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
- Speaker #1
Un petit coup de marteau entrait dans l'histoire. Ce 12 décembre 2015, 196 partis, des pays riches, pauvres, petits ou grands, se mettaient d'accord pour limiter le réchauffement planétaire et coopérer pour s'adapter aux effets du changement climatique. Ce podcast donne la parole à des acteurs clés de la transition pour explorer, dix ans plus tard, ce que le monde a fait de cet accord fondateur et comment la prochaine décennie pourrait être celle des changements en profondeur.
- Speaker #0
Urgence climatique, dix ans pour agir,
- Speaker #1
promesses et réalités de l'accord de Paris. Un podcast de l'IDRI, l'Institut du développement durable. et des relations internationales, coproduits par La Croix,
- Speaker #0
avec la participation de RFI. Épisode 3, l'énergie, la clé du succès. Il n'y a plus de chasse ni de pêche comme avant. Les animaux se sont éloignés à cause du bruit et de l'odeur du gaz.
- Speaker #1
Et ça atteint aussi l'agriculture.
- Speaker #0
La pollution des torches monte au ciel et redescend avec la pluie. L'eau et la terre sont contaminées.
- Speaker #1
Les énergies fossiles, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Ils veulent toujours être là. Ils se battent tous les jours.
- Speaker #0
Mon administration met fin à la guerre contre le charbon. On va avoir du charbon propre,
- Speaker #1
vraiment propre. On entend parfois ce discours, il y aurait un avenir sans renoncer aux énergies fossiles. On sait que ce serait un futur avec 4 ou 5 degrés en plus. Qui veut de ce futur-là ?
- Speaker #0
Aucun pays au monde n'a atteint un niveau de développement humain élevé sans augmenter sa consommation d'énergie. Donc on va utiliser toujours plus d'énergie. Le tout, c'est de savoir laquelle.
- Speaker #1
Au commencement était le feu, puis l'eau, la vapeur, le charbon, le gaz, le pétrole, l'atome, et puis le vent et le soleil. Energia, en latin comme en grec, c'est une force en action, une force qui nous permet de nous développer donc, nous, humains. Et avec le temps et avec l'aide de la science, On a compris que toutes les énergies ne se valaient pas, que certaines abîmaient notre planète. Mais voilà, on est de plus en plus nombreux, certains dans des pays en plein développement, d'autres arcs boutés pour préserver leur mode de vie sans rien changer. Et au cœur de l'équation qu'il nous faut résoudre vite, pour éviter que notre Terre ne devienne un four à ciel ouvert, invivable, il y a donc nos choix d'énergie. Et c'est le thème de ce troisième épisode. Les éléments de l'équation, c'est Michel Colombier, le directeur scientifique de l'IDRI, qui les pose ici.
- Speaker #0
On a à peu près deux tiers de l'origine des émissions qui sont dues à la façon dont nous produisons et consommons de l'énergie, et à peu près un tiers qui sont liés à la façon dont nous utilisons la nature, notamment pour l'agriculture ou pour la production forestière. Donc c'est clair que la transition énergétique est au cœur du problème. Elle l'est pour deux raisons. La première, c'est qu'on a construit une économie et une industrie fondamentalement sur l'utilisation des énergies fossiles. Et c'est les énergies fossiles qui sont à l'origine du déstockage de carbone qui crée le changement climatique. Et la deuxième raison, c'est que le monde se développe, et ça c'est une bonne nouvelle, mais pour l'instant il se développe sur un modèle que nous avons mis en place dans nos propres pays, qui est extrêmement énergivore, et donc la consommation d'énergie du monde. croît à une vitesse extrêmement rapide.
- Speaker #1
C'est bien simple, la consommation d'énergie dans le monde a doublé depuis 1980 et la courbe continue à grimper, tirée notamment par une explosion de la consommation en Asie. Ce qu'on utilise le plus, ce sont les énergies fossiles, donc charbon, gaz, pétrole, qu'on va chercher sous terre ou sous mer. Leur part baisse dans le mix énergétique mondial, mais constitue encore 66% de notre consommation d'énergie primaire. Et le dernier tiers ? Ce sont les énergies bas carbone, c'est-à-dire le nucléaire, et les énergies renouvelables, hydrauliques, biomasse, géothermie, solaire et éolien. Le but, c'est donc de remplacer le plus vite possible les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Spoiler, ça avance vraiment bien, mais vraiment pas assez vite. C'est ça qu'on vous raconte maintenant. Commençons par un coup de projecteur sur le nucléaire. En 2023, le parc nucléaire mondial a généré environ 9% de l'ensemble de l'électricité produite dans le monde. 60 nouveaux réacteurs sont en construction dans 15 pays du monde, beaucoup d'autres sont planifiés, et le nucléaire fait partie des solutions pour atteindre la neutralité carbone. Pour autant, il n'apparaît pas comme la solution idéale dans le monde entier, car cette énergie-là n'est pas à la portée de tous, m'a expliqué Sébastien Treyer, le directeur de l'IDRI.
- Speaker #0
En fait, le nucléaire suppose des coûts d'investissement très forts au moment où on construit les centrales nucléaires et puis aussi tout au long de leur vie et même au moment où on les décommissionne, à la sortie avec toute la gestion des déchets nucléaires. Et donc, c'est très intensif en capital. Et puis, des questions de gouvernance, de la sécurité nucléaire aussi, qui sont très importantes. Donc, il y a beaucoup de pays pour qui se payer le coût du nucléaire n'est pas la solution à court terme avec le peu de capital qu'ils ont aujourd'hui. Et donc les pays du Sud qui ont un besoin très urgent... d'accéder à l'énergie, d'accéder à l'électricité pour leur population, mais aussi pour l'industrialisation et donc pour développer leur économie. Puisque c'est urgent, ils ont tout à fait intérêt à miser sur d'autres solutions et notamment les énergies renouvelables ont plein d'avantages, notamment parce que ça permet d'amener l'électricité plus rapidement là où on a besoin de développer l'économie.
- Speaker #1
Dans un pays comme la France, dont les deux tiers de l'électricité est nucléaire, certains sont tentés de poser la question. pourquoi développer des parcs d'éoliennes ou des panneaux solaires alors que nous, on a nos réacteurs ? Eh bien, c'est plutôt un faux débat.
- Speaker #0
C'est important de ne pas opposer les énergies renouvelables et le nucléaire, même en France. Le temps de déploiement de nouvelles centrales nucléaires est un temps de très long terme. Et nous, on a besoin, pour pouvoir remplacer la dépendance au gaz russe, d'avoir une solution à très court terme qui nous permette de faire face à ça. Et donc, à court terme, il faut les renouvelables. quelles que soient les décisions de redéploiement du nucléaire qu'on peut avoir.
- Speaker #1
Les énergies renouvelables, qu'on appelle souvent ENR pour aller plus vite, elle est là la révolution de cette dernière décennie. Des ressources infinies, le soleil, le vent, la force des fleuves, et des technologies qui se déploient rapidement, même dans les coins reculés, les zones rurales ou difficiles d'accès. Au cœur de l'été 2025, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, saluait leur succès.
- Speaker #0
L'année dernière, 2000 milliards de dollars ont été investis dans les énergies propres. C'est 800 milliards de dollars de plus que pour les énergies fossiles. Et cela représente une hausse de près de 70% en 10 ans. Et de nouvelles données publiées aujourd'hui montrent que l'énergie solaire, qui était 4 fois plus chère que les énergies fossiles il y a peu de temps encore, est aujourd'hui 41% moins chère. L'éolien en mer, 53% moins cher. Et le coût de l'électricité produite par plus de 90% des nouvelles énergies renouvelables dans le monde est inférieur au coût du nouveau combustible fossile le moins cher. C'est un tournant, non seulement sur le plan énergétique, mais aussi du point de vue des possibilités qui s'offrent à nous.
- Speaker #1
En 2024, un tiers de la production électrique mondiale a été générée par les renouvelables, 40% si on compte le nucléaire. Une transition spectaculaire, mais pas équitable, dit aussi le patron de l'ONU. Car pour 100 installations d'énergie renouvelable dans le monde, 80 sont dans les pays riches et la Chine, 10 sont au Brésil et en Inde, et en Afrique même pas deux, alors que la plupart des personnes qui n'ont toujours pas le courant sont justement là, en Afrique subsaharienne. L'enjeu, c'est de leur donner accès à des énergies décarbonées pour s'électrifier. Sambafal est responsable climat et transition systémique Merci. Pour l'antenne sénégalaise d'une ONG internationale, ENDA, et ce qu'il voit dans son pays confirme les statistiques, il reste beaucoup à faire pour réduire la fracture énergétique qui frappe encore 4 Africains sur 10. On continue d'utiliser toujours le bois énergique pour faire la cuisson. Et on sait que pour la santé de la mer, ce n'est pas bon. Pour l'écosystème forestier, ce n'est pas bon. Donc on est encore loin de l'accès universel aux services énergétiques. On peut dire que quand même en milieu rural il y a eu des progrès parce qu'on est passé de l'ordre de 42 en 2018 à 65%. Donc on peut dire que les deux tiers du monde rural ont accès à l'électricité. Mais on sait que par rapport au contexte actuel de l'exploitation du pétrole et du gaz, le Sénégal peut mieux faire et doit beaucoup faire. Mais aussi ça ce n'est pas le seul problème. au Sénégal Les industriels ont du mal à prospérer parce que souvent le coût de l'électricité est important. Le Sénégal est dans cette dynamique d'introduire le gaz parce qu'on a beaucoup de gaz et donc il va falloir que le gaz soit bien introduit dans le tissu industriel. Aïe, du gaz, du pétrole et donc de nouvelles émissions de gaz à effet de serre. Mais quand on a ces ressources fossiles chez soi et qu'on veut permettre le développement de son pays, ça peut être compliqué de faire autrement. Pour aider le Sénégal à un développement vert, un partenariat a été conclu en 2023 avec un groupe de Pays du Nord. C'est une nouvelle forme de collaboration. Vous entendrez peut-être ce nom de JETP. Ce sont les initiales en anglais pour Partenariat pour une Transition Énergétique Juste. Les pays du Nord financent au Sénégal la transition énergétique avec un objectif de 40% d'ENR en 2030. L'Afrique, c'est le continent qui pourrait connaître les plus grandes transformations dans les années à venir. Sergio Gusmao Sushodolsky est un Brésilien, expert de la finance internationale du développement durable. Il est envoyé spécial du Sommet Finance en Commun qui rassemble les banques publiques de développement et sa conviction c'est que l'Afrique a les atouts pour être un acteur majeur de la transition.
- Speaker #0
L'Afrique, notamment à cause de ses richesses naturelles, du fait que c'est le continent qui va porter les grands bonus démographiques, sa position stratégique très proche de l'Europe et de l'Asie, sa recherche culturelle, c'est vraiment le space stratégique. qui va attirer beaucoup d'investissements dans les prochaines décennies. Ce mouvement a déjà commencé. On voit des pays africains qui adoptent de nouvelles technologies et ça leur donne une situation d'être vraiment dans l'avant-garde de l'utilisation de la technologie comme solution pour le développement, pour la création d'opportunités dans différents... pays en Afrique qui ont devenu une espèce de laboratoire d'innovation.
- Speaker #1
L'Agence internationale de l'énergie estime que le potentiel du continent africain est tel qu'il pourrait produire en 2040 dix fois plus d'électricité que ses besoins uniquement grâce aux renouvelables. De fait, le développement de ces énergies vertes s'accélère en Afrique avec un partenaire clé, la Chine, qui collabore avec 40 pays africains dans ce domaine. Les importations africaines de... panneaux solaires chinois bondissent sur le continent. Car il est là le grand champion des énergies propres qui a émergé ces dix dernières années. La Chine s'est lancée dans la fabrication massive des nouvelles technologies, provoquant du même coup une surproduction qui la rend incontournable sur le marché mondial, mais aussi, nous dit le chercheur chinois Li Shuo, une baisse importante des coûts.
- Speaker #0
L'une des grandes réussites mondiales, c'est la baisse rapide du coût des énergies renouvelables. et autres technologies propres. Ça se traduit par le déploiement rapide de l'éolien, du solaire, des véhicules électriques et des batteries de stockage. Et la Chine, là-dessus, a une longueur d'avance. À elle seule, elle produit environ 80% des panneaux solaires du monde, 70% des éoliennes et 60% des véhicules électriques. Et je crois que c'est la capacité de production chinoise de biens et services à faible teneur carbone qui aidera le reste du monde à se décarboner.
- Speaker #1
Dans le reste du monde, il y a surtout les pays en développement qui devraient concentrer l'énorme majorité de la nouvelle demande d'électricité dans les 20 ans à venir. L'enjeu, c'est que cette nouvelle production électrique soit propre, non émettrice. En tête du peloton de ce groupe hétéroclite, on trouve les pays émergents dont les économies sont extrêmement dynamiques. Et ce que constate l'Indien Arunabha Ghosh, qui dirige le CEEW, un institut de recherche sur le climat, c'est que beaucoup de ces pays misent sur les renouvelables pour se développer.
- Speaker #0
Prenez le Vietnam. Ce n'est pas l'économie la plus puissante d'Asie du Sud-Est, mais c'est déjà le plus important déploiement d'énergie renouvelable dans la région. Prenez la Namibie. La part de renouvelables dans son mix énergétique est bien plus élevée que dans beaucoup de pays développés. Prenez l'Uruguay en Amérique du Sud, pareil. Donc il faut reconnaître d'abord qu'un changement majeur est en cours dans les systèmes énergétiques et que ça se produit en particulier dans les pays en développement. Il en va de leur propre intérêt économique et s'ils ratent ce bus, ils ratent le bus technologique et celui de la productivité.
- Speaker #1
Parlons de l'Inde justement, qui comme la Chine, mais à une moindre échelle, a beaucoup développé et exporte des technologies renouvelables. Eh bien, chez elle, à la maison, l'électricité est... encore majoritairement produites par les centrales à charbon. Mais les renouvelables gagnent du terrain, notamment grâce au déploiement extrêmement rapide ces dernières années du solaire.
- Speaker #0
En Inde, on est passé de moins de 20 MW de solaire en 2010 à plus de 100 000 MW aujourd'hui, et plus de 200 000 MW de capacité d'électricité non fossile. Donc désormais, on est presque à 50% de la capacité déployée provenant de sources non fossiles. Et ça s'est produit alors que la demande d'énergie était à la hausse. Donc la demande... augmente et malgré ça, la part d'énergie propre augmente. Ce qui veut dire que le rythme de déploiement est très rapide.
- Speaker #1
Et le gouvernement indien a notamment déployé des millions de pompes solaires dans les zones agricoles pour remplacer celles qui fonctionnent au diesel, réduisant du même coup drastiquement les coûts d'irrigation et incitant au passage les cultivateurs à se convertir à la micro-irrigation, au goutte-à-goutte, pour préserver les nappes phréatiques. Autre évolution positive à mettre au crédit de l'Inde, explique Arunabh Agos, la réduction de la fracture énergétique en raccordant des millions de foyers à l'électricité. L'équation est bien différente pour les pays développés, ces pays devenus riches grâce au charbon puis au pétrole depuis 150 ans. Là, l'enjeu est vraiment de changer de logiciel énergétique. Et si la transition est loin d'être achevée, c'est l'Europe qui s'en sort le mieux. Écoutez les précisions d'Antoine Auger de l'Institut IEEP.
- Speaker #0
Clairement, les énergies, et par les énergies je dis la transition depuis des énergies fossiles vers des énergies renouvelables, c'est à la base du succès européen sur les questions climatiques. À la base. C'était de très loin le secteur le plus émetteur d'émissions, il y a dix ans, de très loin. On était à près de 40% si je ne dis pas de bêtises. On est maintenant en dessous de 20%. Et c'est le seul secteur, de loin, mais encore une fois, qui baisse de manière aussi drastique. C'est à la base des progrès climatiques européens.
- Speaker #1
paye le secteur de l'énergie propre à contribuer pour un tiers à la croissance de l'Union européenne en 2023. Sans surprise, ceux qui tirent cette transition en Europe, ce sont l'Espagne, le Portugal, les pays de la mer du Nord comme le Danemark et même la France et l'Allemagne. Plus inattendu, la Pologne où le solaire et l'éolien font une remontada spectaculaire dans le mix énergétique. En juin 2025, pour la première fois, les énergies renouvelables ont dépassé le charbon.
- Speaker #0
La ministre de l'environnement polonaise nous a confirmé que la Pologne devrait atteindre ses objectifs climatiques pour 2030. Ce qui n'était pas du tout gagné, notamment à cause du système énergétique, étant donné qu'ils avaient une production d'énergie surtout basée sur le charbon. Ils sont en train de transitionner vers les énergies renouvelables.
- Speaker #1
Les plus optimistes estiment même que le charbon pourrait bien disparaître du mix énergétique polonais à l'horizon 2035. Fin de notre petit tour du globe, où l'on remarque au passage que contrairement à une centrale à charbon ou au gaz, partout dans le monde, les technologies renouvelables se déclinent sous une multitude de formes et l'outil de production s'invite aussi directement chez les gens. Arunabh Agosh le constate, notamment en Inde.
- Speaker #0
C'est une histoire qui va être beaucoup plus dispatchée et décentralisée. Les toits solaires, l'irrigation solaire, l'agro-photovoltaïque, quand vous cultivez et vous produisez de l'électricité, cette façon de pouvoir recharger son véhicule électrique partout, il y a plein de manières de commencer à déployer des énergies renouvelables, sans passer par d'énormes projets. Je crois que ça contribue à démocratiser l'accès à l'électricité, mais aussi la nature même des projets conçus et mis en œuvre.
- Speaker #1
Alors, tout ça est très enthousiasmant, mais évidemment, il reste de nombreux défis à surmonter. Notamment, électrifier 750 millions de personnes, encore à la bougie, au feu de bois ou au générateur au fioul. Investir davantage aussi dans les réseaux de câbles qui transportent l'électricité, car ça ne suit pas le rythme. Et puis, le secrétaire général des Nations Unies dénonce la gloutonnerie de l'intelligence artificielle qui se développe à vitesse grand V. Un centre de données classique consomme autant d'électricité que 100 000 foyers. Merci. Les plus grands centres à l'avenir consommeront 20 fois plus. L'ONU demande au secteur de la tech de passer elle aussi aux énergies renouvelables. En tout cas, cette nouvelle économie que promettait l'accord de Paris il y a 10 ans est aujourd'hui bien réelle. Le secteur emploie 35 millions de personnes. C'est plus désormais que celui des énergies fossiles. Signe de ce bon sens économique, l'adhésion d'une partie du secteur privé. En tout cas, très clairement, ces chefs d'entreprise, sondée par Women Business. La coalition que dirige Maria Mendi-Luce.
- Speaker #0
On a fait une étude qui a montré que 97%
- Speaker #1
des chefs d'entreprise voudraient abandonner les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. De fait, certains d'entre eux, plus de 60%
- Speaker #0
je crois, sont prêts à changer de pays. S'ils sont dans un pays où ils n'ont pas accès aux renouvelables,
- Speaker #1
ils songent à construire leur usine ailleurs. Donc oui, je crois que les entreprises font des choix, elles ne le font pas pour des raisons morales, elles le font dans l'intérêt de leur business.
- Speaker #0
Et bien sûr, c'est aussi bon pour la planète,
- Speaker #1
mais le fait que ce soit utile économiquement motive leurs décisions d'investissement. Et là, avec toutes ces bonnes nouvelles, vous vous dites, les planètes ont l'air bien alignées pour terrasser le changement climatique. Mais l'ancien monde n'a pas dit son dernier mot, même chez les champions des technologies vertes. La Chine vise la neutralité carbone en 2060, l'Inde en 2070. Et donc, les énergies fossiles font de la résistance. Commençons par le charbon, qui est encore l'énergie la plus utilisée au monde. C'est aussi la plus émettrice de carbone, donc celle à arrêter le plus vite. L'Inde, dont on se réjouissait il y a un instant qu'elle développe l'énergie solaire si vite, est en train de construire plusieurs nouvelles centrales à charbon. Et 70% de sa production électrique est toujours issue du charbon. Mais le premier producteur, importateur et consommateur de charbon, c'est la Chine. Le charbon génère encore 60% de son électricité. et on se demande Pourquoi ? Puisque le pays est si performant pour vendre du renouvelable au monde entier. J'ai posé la question à Lee Chuo du think tank américain ASPI, Asia Society Policy Institute.
- Speaker #0
Le charbon, c'est le roi, à bien des égards. Depuis que l'économie a décollé, il y a 40 ans, le charbon a vraiment joué un rôle très important en fournissant l'énergie dont la croissance du pays avait besoin. Et les centrales à charbon sont vraiment... ancré dans le système énergétique et économique de la Chine. Le lobby du charbon, les groupes d'intérêt ont aussi beaucoup de pouvoirs politiques. Ça représente un défi très compliqué pour la transition climatique de la Chine. Le véritable défi pour son action climatique est de savoir dans quelle mesure et à quelle vitesse le pays peut réduire sa consommation de charbon. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a toujours pas vu de signal politique clair et décisif. de la part des dirigeants chinois pour abandonner le charbon.
- Speaker #1
En Afrique du Sud, en revanche, il y a bien eu un signal des dirigeants. Ils ont demandé aux pays plus riches de les aider à sortir du charbon en évitant la casse sociale. 90 000 personnes travaillent dans les mines et les 14 centrales du pays. Là-bas, 70% du mix énergétique, c'est le charbon. Il y a donc cette volonté affichée d'en sortir. Des études ont été faites par ailleurs qui montrent que ces immenses ressources naturelles de vent, de soleil, lui permettrait d'effectuer cette transition vers les renouvelables. Et pourtant, des résistances intrinsèques sont toujours fortes. Un pas en avant, un pas en arrière, nous raconte Hilton Trollip de l'Université du Cap en Afrique du Sud.
- Speaker #0
On a fait une offre au monde en disant, on fermera nos centrales à charbon plus rapidement, si vous nous donnez 8 milliards et demi de dollars. Et le monde a dit oui. C'était en 2019. En 2025, où en est-on ? Je ne critique pas. Ça montre juste les difficultés. En réalité, on a ralenti le démantèlement de nos centrales à charbon. On le fait plus lentement, à cause de la résistance fondamentale du lobby du charbon, de la communauté du charbon, à la fermeture de ces centrales, et par conséquent, leur résistance aux énergies renouvelables. Notre ministre des Mines et de l'Énergie a dit publiquement quelque chose du genre « On ne va pas sacrifier la mine juste pour avoir de l'air frais » . C'est ce qu'il a dit. C'était un héros de la lutte pour la libération, il était au syndicat des mineurs. Il a 70 ans aujourd'hui, c'est un héros et il défend ses mineurs. Et ce n'est pas un homme de science, donc lui opposer des arguments technologiques n'y changerait rien. C'est politique.
- Speaker #1
C'est politique et c'est aussi un sujet très sensible, car après la fin de l'apartheid, les immenses ressources de charbon avaient été transférées, rendues, à de nouveaux propriétaires noirs sud-africains. Les déposséder à nouveau de ce bien, en quelque sorte, en fermant les mines et les centrales, c'est évidemment très mal perçu. L'Europe, quant à elle, est en bonne voie pour sortir du charbon. On a parlé tout à l'heure de la Pologne. L'Allemagne s'est fixée une échéance à 2030. C'est fait pour le Royaume-Uni qui a fermé sa dernière centrale en 2024. Quant à l'Espagne, elle est souvent citée en exemple sur la manière dont elle a géré, sur une vingtaine d'années, la reconversion de ses sites miniers. Écoutez Anna Perez-Catala, dont les recherches à l'IDRI portent sur la gouvernance climatique internationale. On ne peut pas comparer avec les pays en développement parce que la consommation de charbon en Espagne baissait,
- Speaker #0
baissait jusqu'à ce qu'on ferme les mines. Mais c'est vrai que c'est une réussite et que l'Espagne a vraiment fait ce qu'il fallait pour ça. Donc l'Espagne a créé au sein du gouvernement un service de la transition juste qui a regardé quels étaient les emplois en jeu,
- Speaker #1
qui vivait là. Et peu à peu,
- Speaker #0
ils ont fermé les différentes centrales. Mais ce qui est intéressant,
- Speaker #1
c'est qu'ils ont créé de nouveaux emplois dans la même région. Donc un mineur qui vivait dans le nord de l'Espagne n'a pas eu besoin d'aller à Madrid pour retrouver un travail.
- Speaker #0
Ils ont créé des emplois là où vivait la communauté des mineurs.
- Speaker #1
Et la dernière centrale est convertie au gaz depuis août 2025, marquant vraiment la fin du charbon en Espagne. Parlons un peu du gaz et du pétrole, justement. Il est légitime de se demander pourquoi certains pays lancent encore de nouvelles exploitations d'hydrocarbures. On sait que c'est une énergie dont l'extraction et l'utilisation ne font qu'aggraver les changements climatiques. On a compris que ça devenait nettement moins rentable aussi, vu la chute spectaculaire des coûts des renouvelables. Alors pourquoi est-ce si dur de tourner le dos aux énergies fossiles ?
- Speaker #0
En France, vous avez essayé et vous avez eu les gilets jaunes.
- Speaker #1
Anna Thony, la patronne de la COP de Belém au Brésil.
- Speaker #0
Donc je crois que la transition vers la sortie des énergies fossiles est vraiment délicate. Et dans chaque pays, on aura des pressions de différents acteurs. Essayons de comprendre pourquoi certains gouvernements continuent à exploiter malgré tout les hydrocarbures. Première raison, la plus évidente, la plus courante sans doute aussi, c'est le besoin de se développer et de sortir de la pauvreté. Laurent Fabius, l'un des pères de l'accord de Paris, l'évoque à travers une anecdote.
- Speaker #1
Lorsque j'ai présidé l'accord de Paris, j'ai fait le tour des capitales africaines notamment. Et dans la plupart des pays, les présidents ou les premiers ministres me disaient, écoutez, je suis Fabius. Oui, nous, on est tout à fait d'accord pour ne pas produire, utiliser pétrole, gaz, etc. Mais il faut nous financer et il faut nous donner les technologies. Si je retourne les voir dix ans après, il m'a dit « Monsieur Fabius, on est très content de vous revoir, mais en attendant, les technologies ne sont pas trop disponibles, il faut les payer, et surtout, les financements, ils ne sont pas là. » Donc, moi, j'ai sous mes pieds du gaz, du pétrole. Comment voulez-vous, ma population est pauvre, je ne peux pas dire, on m'a demandé deux, je ne fais rien.
- Speaker #0
Autre situation avec un argument financier cette fois. Nous sommes avec Emilio Lebrey Larrovere, professeur à l'université de Rio où il dirige le centre climat. Le Brésil est donc, on se rappelle, champion des renouvelables, avec 90% de son électricité décarbonée. Mais il est aussi le premier producteur de pétrole d'Amérique latine. Et d'immenses nouvelles concessions ont été mises aux enchères. et vendu en juin 2025 à quelques mois seulement de leur propre COP. Le Brésil joue-t-il discrètement un double jeu ? Pas du tout, me répond Emilio Lebrela-Roveré. C'est un problème macroéconomique. Pour équilibrer la balance des paiements et surtout avoir des fonds publics, le pétrole joue un rôle essentiel au Brésil aujourd'hui. On a un endettement public de 70% du PNB. donc si on a Pas les recettes de pétrole pour subventionner les finances publiques, c'est impensable en futur économique quelconque. Et surtout pour la transition énergétique qui demande beaucoup d'investissements à court terme. Et cette manne financière doit aussi être mobilisée pour lutter contre la pauvreté au Brésil, cet immense pays en proie à de très fortes inégalités. Sur le même continent, le Mexique a sa propre histoire avec le pétrole. Une histoire ancienne que nous raconte ici Daniel Buira, qui dirige l'institut de recherche mexicain Tempus Analytica, où l'on comprend que lorsqu'on grandit grâce à un tuteur, il est difficile de songer à s'en passer. L'industrie pétrolière mexicaine a été nationalisée en 1938. Ça a été important dans l'histoire du Mexique, et aussi pour l'histoire du pétrole. C'était la première nationalisation majeure qui a changé le monde. On suivit le Venezuela, puis l'Arabie Saoudite et puis d'autres, mais c'est vraiment considéré comme l'étape finale de la décolonisation du Mexique. Et donc, l'industrie pétrolière suscite une grande fierté nationale. Et elle a été un véritable moteur de croissance. À mesure que l'industrie pétrolière s'est développée et que le pays s'est enrichi, nous avons grandi avec notre compagnie pétrolière. Daniel Buira évoque pour le Mexique un syndrome de « lock-in » . Le pays s'est enfermé dans un modèle unique qui est devenu contraignant budgétairement. contraignant pour les investisseurs et qui fige la structure du marché. Les consommateurs, particuliers ou entreprises n'ont pas trop le choix. En gros, c'est pétrole ou gaz. Autre continent, autre géant, l'Inde a ouvert plus d'un million de kilomètres carrés en mer à l'exploration pétrolière. Elle a même modifié sa législation pour attirer les investisseurs internationaux. Pourquoi ? Sécurité énergétique, m'a répondu Arunabh Aghosh. Toujours extrêmement dépendante des importations d'hydrocarbures qu'elle consomme, l'Inde ne veut pas faire une croix sur ses propres ressources. Mais la sécurité énergétique est visiblement un concept à géométrie variable. Écoutez ce qu'en disait, en cet été 2025, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les combustibles fossiles constituent aujourd'hui la plus grande menace pour la sécurité énergétique. Il laisse les économies et les populations à la merci des variations de prix, des ruptures d'approvisionnement et des turbulences géopolitiques. Les économies modernes et compétitives ont besoin d'un approvisionnement énergétique stable à un prix abordable. Les énergies renouvelables offrent les deux. Il n'y a pas de flambée de prix pour la lumière du soleil, pas d'embargo pour le vent. Les énergies renouvelables peuvent mettre le pouvoir entre les mains des citoyens et des États. Restons un moment sur l'Inde, qui choisit donc de... continuer à extraire des hydrocarbures au nom de la sécurité énergétique et aussi pour faire face à la croissance très rapide de son économie. C'est ce qu'on pourrait appeler la zone grise, un entre-deux pas toujours bien compris, d'autant que l'Inde et son Premier ministre, Narendra Modi, se positionnent volontiers en porte-parole des pays en développement. Ils auraient justement un rôle très singulier à jouer, explique Martha Torres-Gunfaus, qui dirige le programme Climat à l'IDRI. Comment jouent-ils ce rôle de leader que Modi et beaucoup d'autres acteurs en Inde revendiquent ? Ce sont eux qui vont pouvoir montrer qu'il ne s'agit pas seulement de réduire les combustibles fossiles, mais aussi de se développer. Parce qu'au sein du G20, l'Inde a une position très singulière. Ses émissions par habitant sont très faibles comparées à tous les autres. Donc, il faut que l'Inde démontre pour beaucoup d'autres, il y a plus de 100 pays qui la regardent, comment on se développe. sans les émissions des énergies fossiles. Enfin, dans la famille des accros aux fossiles, je demande les États-Unis, ou plutôt l'Amérique de Trump, car l'impulsion politique venue d'en haut en cette année 2025 a fait un virage remarqué à 180 degrés sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'action climatique. Donald Trump, qui avait donc inventé le charbon « really clean » , vraiment propre à son premier mandat, encourage désormais l'industrie pétrolière à forer, drill baby, drill. Pour dire quoi au reste du monde en fait ? J'ai posé la question à Sonia Klinsky, professeure à l'Université d'État d'Arizona où elle enseigne à l'École du Développement Durable. Cette administration déploie un langage de pouvoir, de domination. Le désir profond de voir les États-Unis comme une puissance dominante est très fort. Cette nostalgie de l'idée d'une Amérique superpuissante est très forte. Et l'administration Trump et d'autres qui sont derrière l'industrie des combustibles fossiles utilisent délibérément ces sentiments pour affirmer que exploiter plus d'énergie fossile en Amérique,
- Speaker #1
ça montre notre force et notre pouvoir.
- Speaker #0
J'étais à une réunion à l'étranger et on y parlait du besoin de coopérer et comment on pourrait bâtir une coopération internationale. Et je rentre chez moi. Et le premier panneau que je vois, c'est une énorme publicité qui dit faire des États-Unis une puissance énergétique dominante. Et c'est ça le but. Pour la première fois fin 2023, lors de la COP de Dubaï, une sortie progressive des énergies fossiles est officiellement évoquée. Le début de la fin d'une ère, se réjouissent certains. Même si la résistance se fera sentir jusqu'au bout, souligne Laurence Tubiana, celle qui avait négocié l'accord de Paris il y a dix ans et qui dirige aujourd'hui la Fondation Européenne du Climat. Les pays pétroliers et les entreprises pétrolières ont été très bonnes pour la désinformation sur le climat, comme on sait, ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils ont été efficaces. À la dernière réunion des grands pétroliers du gaz qui a eu lieu à Houston il y a quelques mois, l'idée c'était qu'il faut être climat réaliste, qu'il y ait un nouvel concept, disons que vous savez, on ne peut pas faire tant que ça. Donc il faut qu'on admette qu'on va encore augmenter les émissions. Donc ça va jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où, d'une part, les anticipations économiques se retournent, c'est-à-dire au fond, est-ce qu'on fait tellement d'argent avec ce secteur ? C'est plus rentable, le fracking américain, c'est plus rentable le fracking canadien. Donc bon, on réfléchit il y a deux fois en se disant, est-ce qu'il ne faut pas rediversifier ? En Corée du Sud ou en Chine, d'investir sur ces secteurs verts, c'est peut-être plus rentable. Et c'est vrai qu'on voit... Aujourd'hui, les données économiques de ces secteurs, elles sont plus positives. Le cycle va s'inverser, je pense. Mais là, on est vraiment au plus bas. Mais il va s'inverser de fait. C'est la bataille de communication entre l'Agence internationale de l'énergie et les pétroliers. L'agence dit, on est dans la décennie où vraiment on va avoir la descente de la demande pétrolière. Ils n'en mettent jamais. C'est pour ça qu'ils insistent tellement sur les plastiques, qui sont quand même une catastrophe. Au bout du compte, malgré l'essor spectaculaire des technologies renouvelables, Les émissions de carbone liées à l'énergie continuent à battre des records. Michel Colombier, le directeur scientifique de l'IDRI, complète l'équation qu'il posait au début de cet épisode.
- Speaker #1
Quand on regarde l'ensemble du système énergétique mondial, pour l'instant, et comme ça a été le cas historiquement avec d'autres innovations énergétiques, ce développement des renouvelables vient plus s'ajouter au socle fossile que nous avons jusque-là, qu'il ne vient le remplacer. Donc ça, c'est une vraie question. Et ça montre bien qu'on ne peut pas compter uniquement sur le développement d'une offre décarbonée, mais que se pose aussi la question de la demande d'énergie et de comment la demande d'énergie peut s'orienter vers cette offre décarbonée.
- Speaker #0
Réfléchir à la demande, c'est se poser ces questions. Comment utilise-t-on l'énergie et en quelle quantité ? En creux, ce sont nos modes de vie qui sont finalement questionnés autour de deux notions centrales, l'efficacité et la sobriété. L'efficacité, par exemple, des voitures électriques qui mettent en jeu nos usages, nos besoins réels. Illustration en Inde.
- Speaker #1
Quel genre de véhicules électriques l'Inde vend-elle ? Pas des Tesla, elle vend des deux-roues, des trois-roues, des bus. Ça, c'est plus de 95% des véhicules électriques. Donc ce n'est pas juste une transition de source d'énergie, de l'essence à l'électricité, c'est aussi une bascule vers des modes de transport plus vertueux.
- Speaker #0
Efficacité et sobriété dans nos usages d'énergie, ces questions sont peu abordées finalement. Les scientifiques disent qu'elles sont pourtant incontournables pour atteindre la neutralité carbone. Michel Colombier.
- Speaker #1
La question de, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette énergie ? Jusqu'où on en a besoin ? Est-ce qu'on ne peut pas s'organiser différemment et parfois s'organiser mieux pour moins consommer d'énergie va devenir essentiel si on ne veut pas que cette transition énergétique soit un coût insupportable pour une certaine partie de la population. Donc ces questions d'efficacité et de sobriété deviennent centrales. On ramène ça souvent au mode de vie, à dire c'est une question de choix. Il faut peut-être convaincre les gens de vivre différemment. En fait, on se rend compte que les deux sont très liés à nos organisations collectives. La sobriété, c'est notre rapport à la mobilité. Mais ce rapport à la mobilité, il est complètement dépendant des structures de réseau, des services que l'on a. Réseau aérien, réseau ferré, réseau de transport en commun, mobilité de courte distance, mais facilité ou pas par des infrastructures, place de l'automobile. Donc ça n'est pas juste une question individuelle, c'est bien une question de politique publique. Alors ça ne veut pas forcément dire dégrader nos modes de vie, ça veut dire les imaginer autrement.
- Speaker #0
Imaginez autrement nos déplacements, l'organisation du travail, le logement, pavillon individuel éloigné ou immeuble collectif en centre-ville. Questionner notre façon de consommer de l'énergie ouvre de multiples chantiers sur la manière d'habiter les villes, les campagnes, de produire, de manger, de consommer. Il va bien falloir aussi tenir compte de ce climat de plus en plus perturbé entre canicule, inondation, incendies et ouragans. En un mot, s'adapter au changement climatique. Et ça, c'est le thème du prochain épisode de ce podcast. D'ici là, n'hésitez pas, vous aussi, à imaginer la transition du monde.
- Speaker #1
Je pense que partout dans le monde, l'un des plus grands obstacles, c'est le manque d'imagination. Il faut considérer la transition bas carbone comme une transformation économique, reconnaître qu'il s'agit d'une nouvelle forme de révolution industrielle, que nous avons le privilège de vivre, aussi difficile soit-elle. Imaginez-vous en 1750, au tout début de la révolution industrielle. Vous ne sauriez pas à quoi ressemblerait le monde 200 ans plus tard. C'est un peu ça là. Ayez à chacun son état d'esprit, selon que l'on veut être haut commande ou simple spectateur.