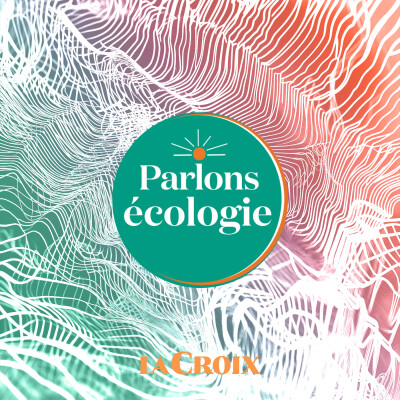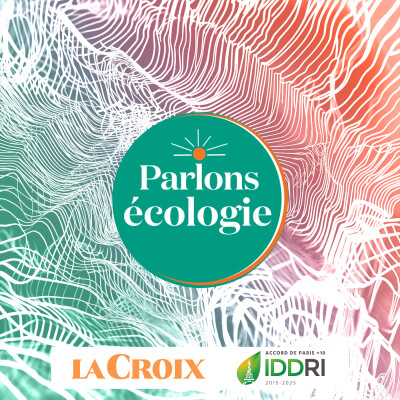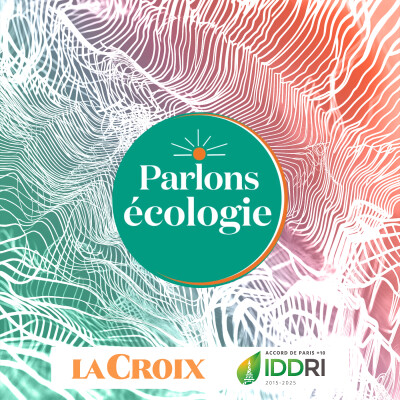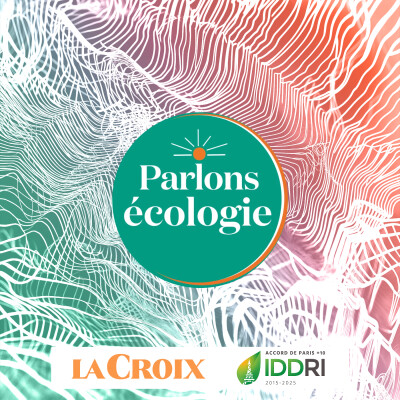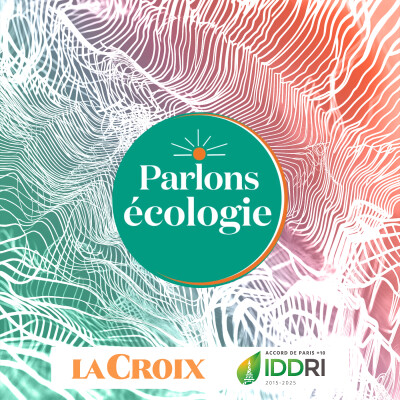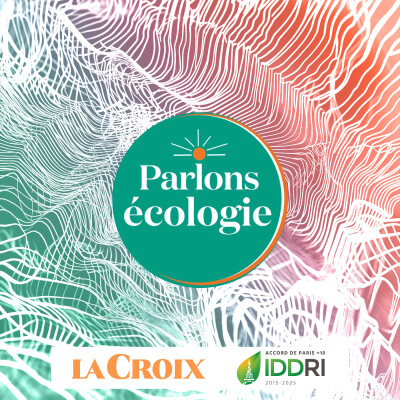Speaker #0Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Un petit coup de marteau, entrée dans l'histoire. Ce 12 décembre 2015, 196 partis, des pays riches, pauvres, petits ou grands, se mettaient d'accord pour limiter le réchauffement planétaire et coopérer pour s'adapter aux effets du changement climatique. Ce podcast donne la parole à des acteurs clés de la transition pour explorer, dix ans plus tard, ce que le monde a fait de cet accord fondateur et comment la prochaine décennie pourrait être celle des changements en profondeur. Urgence climatique, dix ans pour agir, promesses et réalités de l'accord de Paris. Un podcast de l'IDRI, l'Institut du développement durable. et des relations internationales, coproduits par La Croix, avec la participation de RFI. Épisode 2, la chasse au carbone. Nous, on le voit déjà dans les îles Marshall, mais tout le monde, partout, subit des pertes. 1,5 degré, c'est vraiment la limite de sécurité. Et chaque dixième de degré au-dessus fait une énorme différence. Les énergies solaires et éoliennes permettent d'ores et déjà d'éviter au niveau mondial des émissions de carbone presque équivalentes aux émissions annuelles de l'Union européenne. Pour l'industrie de l'acier, beaucoup de gens se demandent s'il existera un moyen viable de la décarboner. On a montré que c'est possible. Techniquement, c'est possible. Dix ans sont passés depuis l'adoption de l'accord de Paris, le premier accord universel invitant tous les pays à adopter une feuille de route pour décarboner leur économie. Dix ans, cela permet de faire un premier bilan. A-t-on réussi à infléchir les émissions de gaz à effet de serre, ces émissions dont nos modes de vie sont responsables ? C'est l'objet de ce deuxième épisode. Pour stabiliser la température, on n'a pas 36 000 fois, on en a qu'un. Ça s'appelle la neutralité carbone, c'est le net zéro. Il ne faut plus qu'aucune molécule de CO2 ne s'accumule dans l'atmosphère. Lui, c'est Christophe Cassou. Il est climatologue et chercheur au laboratoire de météorologie dynamique à l'ENS, l'École nationale supérieure. En deux phrases, il vient de nous expliquer que les températures sont directement liées à nos émissions de gaz à effet de serre. Or, nous venons de vivre la décennie la plus chaude jamais enregistrée. En 2024, pour la première fois, la température moyenne a même affiché 1,52 degré de plus que la moyenne de l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire la fin du XIXe siècle. Et oui, c'est au-delà de l'objectif le plus ambitieux acquis de Haute-Lutte à Paris en 2015. Pour autant, on ne considère pas que l'objectif de 1,5 degré est dépassé, car les climatologues travaillent sur un temps long, 20 ans, pour lisser les fluctuations de température. La hausse retenue aujourd'hui est donc, à l'échelle mondiale, de 1,2 degré. Mais tant qu'on continuera à émettre des molécules de CO2 qui fileront vers l'atmosphère, les températures continueront à augmenter. J'ai demandé à Christophe Cassou de nous expliquer un peu tout ça. On gagne à peu près par décennie 0,3 degré de réchauffement dû aux activités humaines. On ne voit pas de ralentissement, voire une légère accélération sur la dernière décennie. La température va continuer à augmenter parce que le net zéro n'est pas atteint. Par contre, la trajectoire pour arriver à ce net zéro compte également parce que ce qui détermine le niveau de réchauffement, C'est le... cumule des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Ce ne sont pas les émissions d'aujourd'hui, mais le cumul des émissions depuis le début de l'ère pré-industrielle. Pour ne rien arranger, l'efficacité des puits de carbone se réduit. Les puits de carbone, ce sont les forêts, les sols, les océans, ces écosystèmes qui captent du CO2 et donc limitent un peu les effets de nos émissions. Mais ces espaces naturels sont eux-mêmes fragilisés par le réchauffement de la planète. Les sécheresses, par exemple, affectent la croissance des forêts, qui captent donc moins de carbone. En France, l'efficacité des puits de carbone a diminué de moitié en 15 ans. Pire, en République tchèque, la forêt est carrément devenue émettrice de carbone. Elle en relâche plus qu'elle n'en capte. Alors évidemment, on se pose cette question. Combien de temps reste-t-il avant d'atteindre plus 1,5 degré ? Autre manière d'interroger l'échéance, quel est notre budget carbone avant d'être dans le rouge vif ? Aujourd'hui, ce budget carbone est considérablement réduit et au rythme des émissions actuelles, c'est-à-dire à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère chaque année, 50 quelques milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce budget carbone est consommé en trois ans. En effet, si rien ne change très vite dans les politiques mises en œuvre, dans trois ans, on n'aura plus qu'une chance sur deux de parvenir à rester sous ce seuil de 1,5 degré. Un seuil qui fait déjà courir des risques existentiels aux plus vulnérables, comme les petites îles. 1,5 degré pour les politiques au chevet du climat, c'est quoi qu'il en soit l'objectif stratégique limite à ne pas dépasser, pour que les plans d'action soient les plus ambitieux possibles, à la hauteur de l'enjeu. Et voilà donc le contexte dans lequel on regarde ce qui a changé depuis dix ans. L'accord de Paris, on en a parlé dans le premier épisode, a validé une méthode pour... pour permettre aux pays de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Avec un outil principal, l'élaboration de plans climat, dans lesquels chacun définit ses propres objectifs nationaux et la manière de les atteindre. Ce sont les fameuses contributions déterminées au niveau national, ou CDN. En anglais, vous vous rappelez, on parle de NDC. Tous les cinq ans, il faut présenter un nouveau plan, forcément plus ambitieux que le précédent. Et l'idée, c'est que tout cela est transparent, et que chaque année, au moment des COP, il y ait une pression politique. collective pour avancer plus vite. Alors qu'en est-il justement ? Est-ce que tout cela donne des résultats ? Indéniablement, m'ont répondu Sébastien Treyer et Anna Pérez-Catala de l'IDRI. La pression politique et les plans climat ont été utiles. Ils ont permis de limiter la hauteur du mur que dessinait la courbe du réchauffement de la planète pour 2100. Petit à petit, ce qu'on a vu en dix ans, c'est vraiment une amélioration, palier par palier, marche par marche, où on a quand même fait changer. l'état des projections de l'augmentation de température liée aux effets des gaz à effet de serre. Et donc, on aurait pu être à plus 6 degrés, tel que le GIEC nous le disait au début du siècle, en 2000. Et puis aujourd'hui, on voit qu'on a réussi à contenir ça. Désormais, grâce à ces politiques, on se dirige plutôt vers un mur de 2 degrés ou 2 et quelques. Mais ça, évidemment, c'est si tout est mis en œuvre. Pour élaborer leur plan climat, les gouvernants peuvent notamment s'appuyer sur les travaux du GIEC. En 2021 par exemple, ces scientifiques ont publié 5 scénarii d'évolution possible des températures d'ici 2100, 5 courbes qui racontent 5 futurs, du plus optimiste au plus pessimiste, tout dépend des actions concrètes qui sont mises en œuvre. Il y a une autre personnalité qui mesure également les progrès réalisés depuis 10 ans, c'est Anna Thony, la patronne de la COP de cette année 2025. On s'est parlé dans la dernière ligne droite de la préparation du rendez-vous de Belém au Brésil, au moment où justement tous les pays sont censés envoyer leurs nouvelles contributions nationales. Et Anatoly est formel, rien à voir avec les précédentes. Dans les premières contributions, les CDN, beaucoup de pays fixaient un objectif, bon ou mauvais, mais ce n'était qu'un objectif. Alors que maintenant, avec le deuxième cycle de contributions, on constate qu'on a des CDN de bien meilleure qualité. Avec des plans sectoriels, des objectifs économiques et qui concernent tous les gaz à effet de serre. Désormais, c'est évident que les CDN deviennent bien meilleurs au niveau de l'ambition nécessaire et aussi en qualité. Et au cœur de l'été 2025, la pression politique est venue cette fois du plus haut niveau. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dessiné les contours de ce que devraient être de bons plans climat. Ces plans doivent couvrir toutes les émissions dans tous les secteurs de l'économie, ne pas dépasser la limite de 1,5°C, intégrer les priorités liées à l'énergie, au climat et au développement durable dans une vision cohérente et tenir les promesses qui ont été faites au niveau mondial, à savoir multiplier par deux l'efficacité énergétique et par trois les capacités en énergie renouvelable d'ici à 2030 et accélérer l'abandon progressif des combustibles fossiles. Regardons maintenant un peu plus dans le détail. Qui réussit à baisser ses émissions de carbone ? Qui est sur la bonne voie ? Qui ne le fait pas et pourquoi ? Et pourquoi aussi on ne va pas assez vite ? Globalement, on le sait, les émissions continuent à augmenter. Mais il y a des pays ou des groupes de pays qui ont avancé dans le bon sens depuis une trentaine d'années et surtout dans la foulée de l'accord de Paris. Commençons par ceux-là. On regarde en particulier les pays ou régions du G20, car ce sont les plus riches et les plus grands, certains développés depuis longtemps, d'autres... en pleine croissance. Ce sont eux, principalement, qui émettent des gaz à effet de serre. Parmi ceux-là, 10 ont atteint leur pic d'émission. Et c'est un signal important, car ça signifie que leurs émissions désormais diminuent. La courbe s'est inversée, elle descend. Petit tour du globe avec Sébastien Treyère, puis Christophe Cassou. Pour moi, un des éléments les plus frappants de ce qui a marché, c'était autour des années 2019-2020, quand un gros ensemble de grandes économies de la planète, et notamment celles qui donnent un peu le ton de qu'est-ce que c'est que l'innovation, ont commencé à prendre des objectifs très ambitieux de neutralité en matière climatique. Je parle de l'Europe avec son Green Deal, et même s'il a été pas mal bousculé, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont toujours en place. Je parle de la Chine, je parle du Japon, je parle de la Corée du Sud. Et donc l'effet d'émulation collective a vraiment marché à ce moment-là, avec des politiques immédiates dont on commençait à avoir vraiment les effets, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de ces économies. Il y a entre 23 et 25 pays qui, aujourd'hui, ont des émissions qui ont diminué par rapport au début du XXIe siècle. L'Europe des 27 a diminué ses émissions de gaz à effet de serre. Les États-Unis... Contrairement à ce qu'on peut penser, on diminuait ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2005. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que sur la dernière année, les tendances des émissions chinoises sont également fortement réduites. Pour le premier trimestre de cette année 2025, on a une baisse des émissions de la République populaire de Chine, et c'est la première fois depuis les accords de Paris. Allez, on va zoomer sur quelques-uns de ces « plutôt bons élèves » . Pour l'Union européenne, c'est donc l'adoption du Pacte vert en 2019 qui a mis les 27 sur une bonne trajectoire. Antoine Auger précise un peu le tableau. Il est directeur exécutif de l'IEEP, Institute for European Environmental Policy. On est sur à peu près un tiers de réduction des émissions au niveau européen. On est également en bonne voie pour atteindre nos objectifs pour 2030, qui sont de 55% de réduction. Même si effectivement ça demandera aux États membres de l'Union européenne de mettre en œuvre toutes les politiques climatiques qu'ils ont pu adopter récemment. Il n'y a pas beaucoup d'autres blocs qui ont une telle réduction en termes d'émissions sur les dix dernières années. Il y a un vrai leadership européen. Un autre type de leadership est en train d'épater tout le monde, c'est celui de la Chine. Tirée par un pouvoir fort et une stabilité politique inébranlable, son évolution ces dix dernières années est spectaculaire. Et celui qui nous en parle, c'est Li Shuo. directeur du programme Climat en Chine à l'Asian Society Policy Institute, un think-tank américain. On est à un moment très intéressant et critique. La Chine envisageait d'arriver à un pic de ses émissions aux alentours de 2030, mais désormais beaucoup d'observateurs estiment que 2025 pourrait marquer le pic des émissions chinoises. Et si c'est le cas, je pense que ce serait une très bonne nouvelle pour l'effort climatique mondial. Vous savez, la Chine est devenue la superpuissance des technologies propres dans le monde. C'est le plus gros investisseur, fabricant et utilisateur de vent, soleil et autres technologies. Ça a aidé à stabiliser les émissions de la Chine. Une bascule dont se réjouissent tous ceux qui guettent les progrès. A commencer par Anatoly, la directrice de la COP30 au Brésil. Elle est économiste de formation et regarde avec attention l'évolution du géant chinois. On vient d'apprendre que les émissions chinoises baissent pour la première fois, de 1,3% je crois. C'est une nouvelle absolument incroyable. Et donc, même si certains préfèrent le taire, les choses se font, la transition est en cours. Alors évidemment, c'est une transition qui est lente et encore très ambivalente, surtout pour un mastodonte comme la Chine. Sébastien Treyer. C'est assez impressionnant de voir comment une économie qui est encore très dépendante de son propre charbon, important pour sa souveraineté énergétique, est quand même en train de basculer vers autre chose. On ne s'attendait pas forcément en 2015 à voir des évolutions de ce type-là. Il y a un autre mastodonte dont le mix énergétique est vraiment entre deux mondes, c'est l'Inde. Très dynamique pour développer des technologies renouvelables, mais ses besoins en énergie sont tels, à cause de son rythme de développement, que les émissions de l'Inde ne baissent pas. Écoutez Arunabh Agosh, il a fondé et dirige l'une des principales institutions de recherche politique sur le climat d'Asie, le Council on Energy, Environment and Water. On est là à un stade intéressant, où progressivement, davantage d'énergies renouvelables seront déployées, c'est certain. Mais le secteur historique du charbon va perdurer. Nous estimons donc que vers le début des années 2040 environ, les émissions du secteur de l'énergie atteindront un pic, puis commenceront à diminuer. Et pour l'instant, 70% de la production d'électricité en Inde provient toujours du charbon. Alors qu'au Brésil, 90% de l'électricité est déjà décarbonée. Et l'a toujours été grâce à l'énergie des fleuves, l'énergie hydraulique. Pour ce géant d'Amérique du Sud, le problème est ailleurs. Ses émissions de gaz à effet de serre proviennent essentiellement de deux sources. Les élevages démesurés de bovins. Il y a plus de têtes de bétail que d'habitants au Brésil. Ça finit par faire pas mal d'émissions de méthane. Et bien sûr, la déforestation de l'Amazonie, pour faire paître des troupeaux ou cultiver toujours plus de soja. Et sur ce terrain-là, le Brésil a montré le meilleur et le pire. C'est ce que m'a expliqué Emilio Lebrela Rovere, professeur à l'Université fédérale de Rio, où il dirige le Centre Climat. Entre 2004 et 2010, dans une période de six ans donc, on a réussi à couper un milliard de tonnes de CO2 équivalent. par an grâce à une chute à un cinquième de ce qui était la déforestation annuelle. Et quand il y a eu le gouvernement Bolsonaro récemment, 2019 à 2022, ça a réparti à une hausse très importante, mais désormais il y a Lula de nouveau au pouvoir, un autre courant politique, et donc dans deux ans, le taux annuel a chuté. 40% par rapport à 2020. Donc, ça dépend de la politique et ça peut changer très vite. La volonté politique, parlons-en un peu justement. Cet exemple de la protection de la forêt brésilienne à la merci de l'alternance politique pose la question de la gouvernance mise en place par un pays pour guider son action climatique et de sa capacité à voir loin, d'avoir une stratégie à long terme. pour aligner finalement ces politiques de court et moyen terme sans perdre de vue l'objectif final qu'est la neutralité carbone. Ces objectifs de long terme auront bien plus de chances d'être respectés si une gouvernance solide permet de programmer l'action climatique. Anna Perez-Katala, qui travaille sur la gouvernance climatique internationale à l'IDRI, me donne l'exemple de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'est dotée d'une commission présidentielle sur le climat. Donc c'est une instance qui parle de climat de façon transversale dans l'ensemble du gouvernement et qui siège auprès du président. Cela crée une capacité institutionnelle très solide. On n'a pas ça dans beaucoup de pays européens. Et cet exemple montre au passage que ceux qui mettent en place les moyens de réussir sur le long terme ne sont pas forcément les bons élèves d'aujourd'hui. L'Afrique du Sud se débat avec des infrastructures de production d'électricité à bout de souffle. s'accroche à son charbon et pourtant, me confirme Hilton Trollip, chercheur à l'université du Cap, le pays s'est vraiment mis sur de bons rails. Jusqu'à présent, les succès sont principalement d'ordre institutionnel et de capacité de mise en œuvre. Un projet de loi sur le changement climatique, une loi nationale a été soumise au Parlement en 2018. Elle a été adoptée en 2024 et promulguée cette année. Bonne joie. Donc les progrès sont lents, mais ça se fait étape par étape dans nos institutions démocratiques. Cette loi sur le changement climatique nous permet d'être en capacité d'atteindre nos objectifs d'atténuation et d'adaptation, aussi difficiles qu'il faut-il. Nous mettons donc en place les institutions, les capacités et la réglementation nécessaires. Et nous avançons lentement, mais sûrement. Un autre exemple très différent, bien qu'il ait pris aussi du temps, c'est celui du Chili. qui a choisi de passer par un processus interne très inclusif pour définir son plan climat, ce qui l'a rendu solide. Anna Perez-Catala. Ils ont suivi un processus participatif très long. Ils ont beaucoup consulté et ont même élaboré une sorte de budget carbone indiquant les émissions maximum du pays par rapport à ce que nous devons faire à l'échelle mondiale. Ça a créé comme un alignement et ça a fait sens dans le pays. Et aujourd'hui, bien des années plus tard, ils ont toujours cette politique très forte. Même si les gouvernements changent, elle est moins contestée qu'ailleurs. Donc ça a créé ce processus interne qui aujourd'hui, disons, est plus difficile à détruire. Quelques 70 pays ont adopté des stratégies de long terme et 145 ont pris des engagements de neutralité carbone. Voilà pour ce qui s'est plutôt bien enclenché depuis l'accord de Paris. Mais vous l'avez compris, les émissions continuent à augmenter et la bascule vers une économie décarbonée se fait trop lentement. Pourquoi ? Eh bien en gros parce que ça n'est pas facile, que les pays ont beaucoup de défis à affronter en même temps. Et puis aussi parce que certains ont les deux pieds sur le frein. Pas facile par exemple de convaincre les pays émergents qu'ils peuvent faire grandir leur économie en se passant des énergies fossiles. Martha Torres-Gunfaus, la directrice du programme Climat de l'IDRI, est confrontée à ces doutes exprimés par exemple. par des acteurs indonésiens ou indiens. Est-il possible de vraiment se développer autrement que l'on fait les pays riches ? Est-ce qu'on peut vraiment le faire sans les énergies fossiles ? Et comment faire ? On y arrive à très petite échelle, mais ce qui nous échappe, c'est comment le faire à grande échelle. Il ne s'agit pas seulement de reproduire en plus grand, mais aussi de s'adapter à des contextes, à des territoires différents, avec des ressources et des situations de départ très différentes. Et on n'a pas encore prouvé qu'on pouvait développer ce modèle à l'échelle voulue. Plus globalement, au-delà des doutes bien légitimes, les acteurs du climat s'inquiètent de cette tendance de certains décideurs politiques à lever le pied quand il faudrait justement accélérer. Écoutez le climatologue Christophe Cassou. Dans un contexte de backlash climatique, il faut déjà maintenir les objectifs qui n'étaient pas assez ambitieux. C'est quand même bien. Assez triste à dire, mais on serait aujourd'hui satisfait de l'insatisfaisant. Parce qu'il y a une menace forte de régression sur les politiques climatiques. Évidemment, on pense à Donald Trump, le seul à avoir décidé de retirer son pays, les États-Unis, de l'accord de Paris. Mais cette menace de régression, on la retrouve aussi ailleurs. Et même chez la bonne élève Europe, souligne Antoine Auger de l'Institut for European Environmental Policy. 2019 le Green Deal, c'est une conséquence directe de l'accord de Paris, mais également de l'élection au Parlement européen, avec la fameuse vague verte, avec les fameuses manifestations pour le climat, qui ont mobilisé énormément, notamment la jeunesse. Ça a mis beaucoup de pression politique à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Ce dynamisme a largement disparu aujourd'hui. Les dernières élections européennes, en juin 2024, ont vu un fort progrès des forces conservatrices et d'extrême droite au parlement européen et ça se rend très retranscrit directement dans l'ambition climatique des politiques qui sont menées. On est encore dans une phase de décru des émissions, mais la plupart des chiffres et des tendances montrent que cette décrue va ralentir. Ce ralentissement est toujours compatible, disons, avec l'objectif de 2030, mais il n'est pas du tout compatible avec l'objectif suivant de 90% de réduction en 2040 et de net zéro en 2050. Autre difficulté, changer de modèle économique bouscule forcément le quotidien. La mobilité, l'alimentation, le travail parfois aussi, par exemple pour les employés du secteur minier. La dimension sociale du changement nécessaire est un sujet partout, alerte Sébastien Treyer. En fait, dans tous les pays, on voit vraiment émerger, notamment depuis 2019-2020, les freins sociaux. C'est-à-dire en fait tous les gens qui perdent à la transition vers une économie décarbonée. et il va falloir négocier un certain nombre de choses et ça c'est difficile sachant que La crise est aussi liée à d'autres choses, le Covid, la guerre en Ukraine, etc. Donc ça, c'est un point qui existe dans tous les pays et qui freine de manière assez notable. Une discussion compliquée par un autre facteur clé, l'honnêteté de l'information pas toujours au rendez-vous. Christophe Cassou. Il faut mettre un focus fort sur l'efficacité des solutions, qui aujourd'hui est contestée. On le voit bien sur la voiture électrique où la désinformation est flagrante. pour montrer que cette solution n'est pas efficace alors que l'effet scientifique montre qu'elle l'est par rapport aux véhicules thermiques. Cette désinformation que dénonce le climatologue est bien souvent alimentée en sous-main par ceux qui ont le plus à perdre, au premier rang desquels bien sûr les entreprises et pays pétroliers. Pour tenir les objectifs de l'accord de Paris, il faudrait n'ouvrir plus aucune nouvelle exploitation d'énergie fossile. Et ce n'est pas ce qui se passe, nous dit Sébastien Treyer. Et cela fragilise le combat climatique, nous dit Martha Torres-Gunfaus. Le secteur des énergies fossiles est extrêmement présent et de plus en plus présent même dans les COP pour expliquer à quel point on ne peut pas sortir facilement d'une économie à base de pétrole. On voit beaucoup d'acteurs économiques de ce secteur qui continuent à investir énormément dans des nouveaux champs pétroliers ou gaziers en même temps qu'ils investissent aussi dans les renouvelables. courir pour être Ceux qui vont utiliser jusqu'à la dernière minute les énergies fossiles et en même temps être les premiers aussi en termes de massification des énergies renouvelables. Ça, quand on ajoute le fossile et les renouvelables, ce n'est pas ça qu'on appelle la transition énergétique. Et donc ça, c'est un frein aussi assez important. On entend dire que les énergies fossiles ont un avenir. Si ce discours prend le dessus, il se répand, l'accord de Paris deviendra très fragile et son universalité sera brisée. Les pays ne verraient plus l'intérêt de mener la transition, car c'est une lutte, ça exige des efforts. Une résistance du secteur des énergies fossiles qui bénéficie même d'un sérieux coup de pouce de la part des États, les subventions au charbon, au pétrole et au gaz sont neuf fois plus importantes qu'au secteur des énergies renouvelables. D'autres secteurs qui s'estiment perdants de la transition font aussi de la résistance, mais parfois de façon sournoise, cachée, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Et c'est Laurent Fabius, l'un des pères de l'accord de Paris, qui lâche le mot. Un certain nombre de secteurs, évidemment, ne sont pas disposés à mettre à bas leurs objectifs. Le greenwashing, ça existe. Et ces secteurs économiques sont très très puissants, y compris financièrement. Même si, je dois à l'honnêteté dire, qu'il y a énormément d'entreprises qui, heureusement, travaillent et même travaillent très très bien dans le bon sens. Et merci M. Fabius pour la transition, car on ne pouvait pas boucler cet épisode sans se demander comment le secteur privé s'est engagé dans cette transformation. C'est lui qui constitue le tissu économique invité à se réinventer. Maria Mendy-Lucey fait partie de ces personnes qui, depuis 25 ans, font rimer business et développement durable. Elle est aujourd'hui PDG de la coalition Women Business. Et très clairement, dans le monde des affaires, elle identifie bien deux camps qui ne tirent pas dans le même sens. Cet oiseau, On voit bien l'effet d'entraînement des deux côtés, de ceux qui avancent comme de ceux qui traînent des pieds. Je me souviens par exemple des entreprises du ciment en 2014-2015 qui disaient « pas question, c'est impossible pour nous » . Et au même moment, on a créé la coalition Women Business pour envoyer un signal aux décideurs politiques que le business était partant parce que c'était bon pour les affaires et que la transition était inarrêtable. À l'époque de la COP21 à Paris, elle avait rassemblé 150 entreprises favorables à la transition pour envoyer ce signal au monde politique. Dix ans après, Women Business est devenue une très grosse coalition, parmi d'autres initiatives qui fédèrent aussi les entreprises engagées. Cette croissance montre un changement d'échelle très significatif.