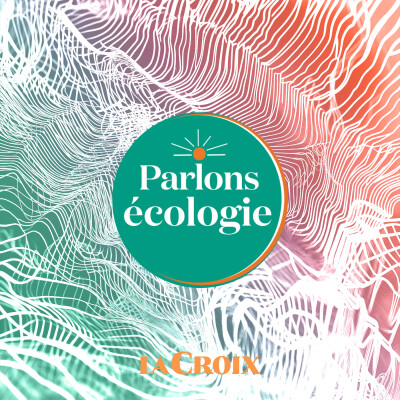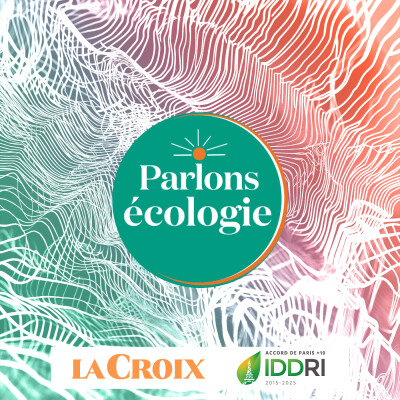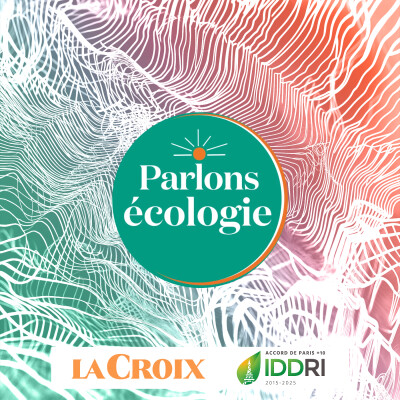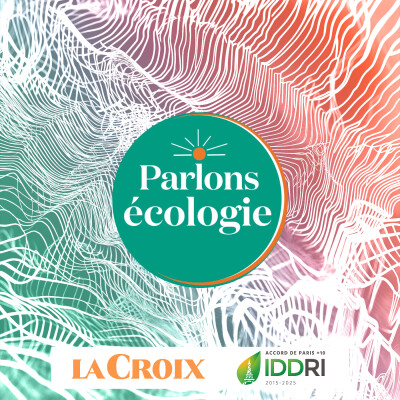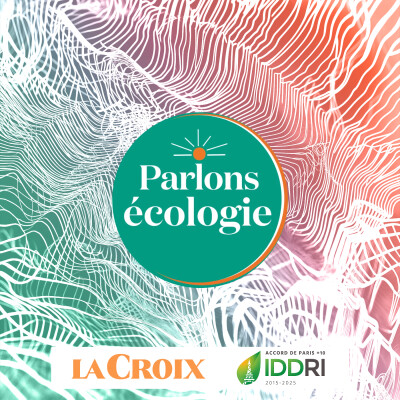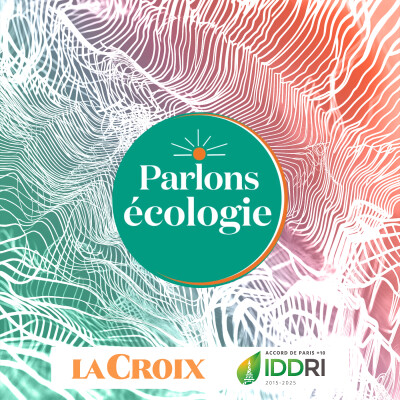Description
Comment financer la transformation écologique de la planète sans creuser les inégalités ? Dix ans après l’Accord de Paris, les promesses d’aide n’ont pas tenu leurs ambitions : les pays développés ont bien mobilisé 100 milliards de dollars par an au tournant des années 2020, mais l’objectif est désormais porté à 300 milliards - tandis que les besoins réels sont évalués à plus de 1 300 milliards annuels.
Dans les pays du Sud, la colère gronde. « Les plans climat restent des bouts de papier s’ils ne sont pas financés », déplore la militante soudanaise Nisreen Elsaim. Les chiffres donnent raison à son amertume : 80% des financements climat prennent la forme de prêts, aggravant la dette des États les plus fragiles. Pourtant, des signes d’espoir émergent. Le modèle du « Just Energy Transition Partnership », ou JETP, combine aides publiques et capitaux privés pour accompagner la transition énergétique en intégrant la dimension sociale : par exemple, en Afrique du Sud, la sortie du charbon tout en protégeant les salariés.
Mais les blocages demeurent. L’énergie solaire en Afrique, qui représente 60% du potentiel mondial, ne reçoit que 2% des investissements. En Inde, l'économiste Arunabha Ghosh rappelle l’enjeu : « Sans garanties publiques, le coût du capital reste prohibitif pour les pays émergents. » D’où le rôle crucial des banques publiques de développement, qui représentent 10% du capital mondial mobilisable et peuvent « dé-risquer » les projets les plus fragiles.
La mise en place du Fonds pour les pertes et préjudices, décidée lors de la COP28 à Dubaï, fut saluée comme une victoire historique pour les pays du Sud. Mais son financement demeure incertain : moins d’un milliard de dollars engagés à ce jour. Les critiques s’accumulent face à une architecture lourde, dominée par la Banque mondiale et le FMI, accusés d’être « les banques du vieux monde ». Pour des acteurs comme Mia Mottley, Première ministre de la Barbade, il faut un « nouveau Bretton Woods », une refondation radicale des règles du jeu financier.
De nouvelles institutions incarnent déjà ce basculement : la Banque asiatique d’investissement et la Nouvelle Banque de Développement des BRICS, installées à Pékin et Shanghai, portent une autre gouvernance, moins dépendante du Nord. En parallèle, certaines voix, comme celle de Laurence Tubiana, plaident pour des « taxes de solidarité mondiale » : sur les billets d’avion, le baril de pétrole ou les cryptomonnaies. « Un dollar sur chaque baril, et l’on récolte 500 milliards par an », rappelle-t-elle.
Face à l’urgence climatique, la finance n’est plus une question technique : elle est devenue une question politique et morale. Trouver l’argent pour sauver la planète, voilà désormais le vrai cœur du sujet.
“Urgence climatique, dix ans pour agir : promesses et réalités de l’Accord de Paris” est un podcast de l’IDDRI, coproduit par La Croix, réalisé par Sophie Larmoyer, et avec la participation de RFI.
---
CRÉDITS - Conception écriture et réalisation : Sophie Larmoyer. Conception et direction éditoriale : Brigitte Béjean (IDDRI). Réalisation : Théo Boulenger. Production : Célestine Albert-Steward (La Croix). Rédaction en chef : Paul de Coustin et Jean-Christophe Ploquin (La Croix). Partenariat : Sandrine Verdelhan (La Croix). Archives sonores : RFI, "C'est pas du vent".
PODCAST LA CROIX - 2025
Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.