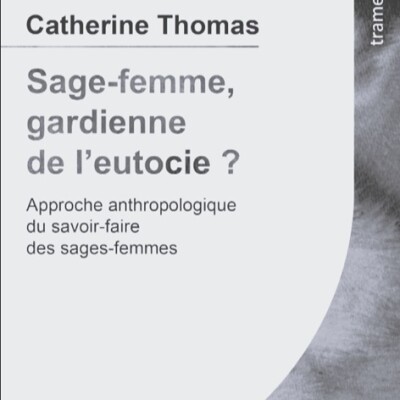Speaker #1Bonjour à toutes et à tous. Pour me présenter, c'est suffisant. Je suis principalement anthropologue de la santé, j'enseigne les sciences humaines et sociales. l'anthropologie de la santé dans différentes formations de soignants. Et donc ce livre, « Sache-femme, gardienne de l'autocie » , est en fait issu de ma thèse de doctorat qui s'intitulait « Accoucher en France aujourd'hui, les enjeux de la profession sage-femme et le positionnement des femmes face à la naissance médicalisée » . Le choix de ce sujet, comment j'en suis arrivée à travailler sur cette question ? Tout simplement par ma propre expérience en fait. puisque lors de ma première grossesse, j'ai rencontré une sage-femme libérale qui pratiquait des accouchements, et que j'ai bénéficié d'un accompagnement global avec cette sage-femme. Et que suite à mon expérience d'un accouchement que j'ai trouvé simple, facile, rapide, sans complications, je me suis beaucoup questionnée sur la question de la chance ou du choix, parce que j'ai beaucoup entendu... Tu as eu de la chance d'avoir un accouchement aussi facile, sans complications. Et je me suis posé la question quand même de savoir, mais est-ce que c'est parce que j'avais de la chance ? Donc, entre guillemets, est-ce qu'il y a des femmes qui, effectivement, ont un accouchement particulièrement simple, facile, rapide, et que c'est un peu un hasard de la biologie ou de la physiologie ? Ou est-ce que c'était dû Ausha que j'avais fait de ce type d'accompagnement ? avec quand même ce questionnement de départ et puis ce fil rouge un peu de me dire finalement qu'est ce qui se joue dans ce choix de l'accompagnement global qu'est ce qui se joue dans la relation femmes sages femmes et qui fait que la plupart des témoignages que j'avais recueillis d'autres femmes qui avaient choisi l'accompagnement global était assez similaire au mien finalement et venait un peu contrebalancer les les témoignages que j'avais eus dans mes études de master sur l'accompagnement médicalisé. J'avais envie de comprendre un peu ce qui se jouait dans ces différents types d'accompagnement. J'ai fait le choix de vous présenter trois points qui sont dans ce livre. Un premier point sur l'histoire de l'accompagnement global de l'accouchement. Un second sur la relation entre les parturiantes et le corps médical. plus particulièrement en abordant les représentations autour des femmes qui se positionnent en faveur d'un accouchement physiologique. Et en troisième point, un peu en conséquence, on va dire, la place des arguments médicaux et juridiques dans les demandes de diversification de l'offre de soins, qui pour moi sont des arguments qui restent importants. Donc voilà, je développerai ces trois points. Tout d'abord, le premier point sur l'accompagnement global. J'ai travaillé sur ce thème-là avec un regard effectivement historique, en lien avec aussi les luttes syndicales des sages-femmes depuis le début du XXIe siècle, puisque j'ai travaillé aussi sur des archives de syndicats de sages-femmes. Et puis j'ai essayé de comprendre d'où venait en fait ce type d'accompagnement dans l'histoire de la profession. Je pense que tout le monde connaît ici un peu ce que c'est que l'accompagnement global. C'est le suivi le plus complet qu'une sage-femme, de par sa formation, puisse proposer à ses patientes avant, pendant et après l'accouchement. Et en fait, ce type d'accompagnement a été relativement accessible sur tout le territoire en France jusque dans les années 70, notamment grâce à la présence de sage-femmes dans ce qu'on appelait les cliniques ouvertes. puisque jusque dans les années 70, en fait, dans les grandes villes, dans les grands hôpitaux, il y avait principalement des sages-femmes hospitalières et il y avait très peu de sages-femmes qui pratiquaient en libéral. C'est-à-dire que le rôle de la sage-femme libérale, comme on le connaît aujourd'hui, qui va faire uniquement du suivi de grossesse et des suites de couches, rééducation périnéale, etc., ça n'existait pas en fait. Il y avait principalement des sages-femmes hospitalières dans les grandes villes. Et dans les départements, il y avait au contraire très peu de sages-femmes hospitalières. Il y avait principalement des sages-femmes libérales qui pratiquaient des accouchements dans les maternités et dans ce qu'on appelait les cliniques ouvertes, où elles avaient accès à des cliniques pour faire les accouchements de leurs patientes. Il faut comprendre aussi que la pratique s'inscrivait jusque dans les années 70. Et donc cette configuration… de travail leur permettait d'allier le suivi pré et post natal, comme le proposent aujourd'hui les sages-femmes libérales, avec l'accompagnement de l'accouchement au sein d'une structure médicalisée pour les femmes qu'ils souhaitaient, avec cette facilité de regrouper tous les accouchements de leurs patientes dans un même lieu. Parce qu'il faut comprendre que dans cette période-là, les sages-femmes qui travaillaient dans les cliniques ouvertes, elles accompagnaient des centaines d'accouchements par an. Pendant les années 70, les cliniques ouvertes ont commencé à fermer l'accès aux sages-femmes libérales, en même temps qu'il y a eu les premières fermetures des petites maternités. Les cliniques commencent à fermer l'accès aux sages-femmes libérales avec un outil très simple, c'est que les cliniques proposent aux sages-femmes libérales qui font des accouchements de devenir salariées de leur structure, avec des conditions de travail. des meilleurs revenus avec des conditions salariées. Et donc, la plupart des sages-femmes vont, entre guillemets, céder au chantage du salariat et accepter de devenir salariées des structures dans ce cadre-là. Et donc, c'est une première attaque envers les sages-femmes libérales praticiennes. Enfin, moi, j'appelle les sages-femmes libérales praticiennes celles qui pratiquent des accouchements. Donc, en fait… contre la loi, puisque la loi à la base autorisait la présence des sages-femmes comme la présence de n'importe quel praticien de santé au sein des hôpitaux pour accompagner leurs patients. Et donc ces sages-femmes ont été contraintes à n'avoir plus que comme seul lieu d'exercice le domicile de leurs patientes, avec une réduction très importante de leur patientèle puisqu'elles ne pouvaient pas justement répondre à toutes les demandes et être tout le temps sur la route. Et ensuite… Donc, c'est à partir de cette situation-là, où on leur retire leur outil d'exercice, puisqu'on leur retire la possibilité de garder leur patientèle comme elle l'avait auparavant, qu'elles vont créer, en tout cas un petit nombre de sages-femmes libérales, vont créer l'Association nationale des sages-femmes libérales en 1983. Et c'est elles, en fait, qui vont les premières parler d'accompagnement global. C'est-à-dire que… Face à cette situation, elles vont déclarer, le premier courrier qu'elles vont faire, en fait, elles vont déclarer « pour préserver l'accompagnement global de nos patientes, nous avons choisi de rester sages-femmes libérales » . Parce qu'elles savaient très bien qu'en devenant salariées, elles ne pourraient plus suivre leurs patientes du début à la fin. Donc l'accompagnement global, c'était vraiment le premier combat de l'Association nationale des sages-femmes. Et ça correspondait à une définition de leur pratique qu'elle défendait et qui était donc, je cite, « le suivi humain et médical de la mère et de sa famille pendant sa grossesse, son accouchement, ses suites de couches par une seule et même sage-femme » . Donc à cette époque, Jeannette Bessonard, qui était sage-femme hospitalière, a soutenu Madame Françoise Olive, la première présidente de l'association. Et c'était exprimé dans une tribune libre sur ses inquiétudes de voir ce concept d'accompagnement global galvaudé ou récupéré. Elle rappelait que défendre l'accompagnement global de la naissance et les moyens de le réussir n'excluait pas toutes les autres formes de pratiques professionnelles, donc salariées ou libérales, et que pour elle, défendre l'accompagnement global, c'était mettre l'accent sur un concept fondamental de la profession. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'accompagnement global n'était pas synonyme d'accouchement à domicile. Ce qu'elle défendait, c'était vraiment un type d'accompagnement, c'est-à-dire une sage-femme qui… qui connaît sa patiente, qui lui fait confiance, la femme fait confiance à la sage-femme, elles se connaissent, elles suivent tout du début à la fin et c'était vraiment ça le cœur de leur bataille au départ. Pendant les années 80, les sages-femmes libérales réunies autour de cette association se sont battues pour que leur travail soit reconnu, pour qu'il leur soit possible de proposer au couple qui les sollicite un accompagnement des naissances dans un lieu autre que le domicile. permettant d'assurer des conditions favorables au moment de l'accouchement. Donc c'est important de comprendre aussi pourquoi elles se battaient pour avoir la possibilité d'accoucher leurs patientes pas uniquement à domicile, c'est-à-dire qu'elles le faisaient à domicile si la patiente le souhaitait ou si c'était possible, mais la raison pour laquelle elles se battaient pour conserver un accès aux hôpitaux, un accès aux maternités, c'est qu'à cette époque-là, les sages-femmes pratiquaient un grand nombre d'accouchements. qu'elles n'auraient pas pu ou qu'elles n'auraient pas envisagé d'accompagner à domicile. Alors que toute l'histoire de ces sages-femmes montre qu'on a tout fait pour les éloigner de la pratique de l'accouchement. Et finalement, leur formation, vu que la formation se cale sur la pratique hospitalière, moins elles ont pratiqué d'accouchement difficile en milieu hospitalier. Et moi, elles ont été formées à ça et donc après ça fait un peu boule de neige. Grâce aux nombreuses démarches de l'Association nationale des sages-femmes libérales, à l'époque en tout cas, les sages-femmes libérales pourront appuyer leur demande d'accès au plateau technique puisqu'elles ont réussi à obtenir la loi hospitalière 91-748 qui a été obtenue le 31 juillet 91 et qui prévoit que les médecins et autres professionnels de santé non hospitaliers, donc sous-entendu également les sages-femmes libérales, peuvent être associés au fonctionnement des établissements assurant le service public hospitalier et qu'ils peuvent par contrat recourir à leur plateau technique afin d'en optimiser l'utilisation. Donc cette loi acte clairement, légalement, l'accès au plateau technique pour les sages-femmes libérales. Malgré cela, et donc malgré leur souhait de collaborer avec le service public, et d'ailleurs elles avaient l'appui du ministère de la Santé, elles ont pu en grand nombre témoigner des réticences de la part des chefs de service et des directeurs d'hôpitaux qui opposaient des arguments juridiques, de non-clarté des responsabilités, etc. Ce qu'on peut constater, c'est que l'accompagnement global tel qu'il a été défini et revendiqué à la création de l'Association nationale des sages-femmes libérales, à sa création donc en 1983, est encore aujourd'hui très mal connue des professionnels de santé, puisque pour avoir fait des entretiens avec des cadres notamment, dans les propos il y a clairement une confusion en fait dans le terme d'accompagnement global, où certains cadres m'ont dit oui oui, mais nous aussi on fait de l'accompagnement global, puisqu'on fait de l'accompagnement physique, émotionnel, social des patientes, etc. J'ai été obligée de leur expliquer que non, en fait, global, c'est dans le sens, dans le temps, de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches. Et parmi les femmes, beaucoup aussi ignorent la possibilité même d'un accompagnement global. C'est-à-dire qu'énormément de femmes ignorent qu'elles peuvent accoucher, tout simplement, avec une sage-femme libérale et pensent que la seule solution possible est l'accouchement en structure. Et puis même au niveau des étudiants de sages-femmes, alors ça, ça commence à changer un peu avec notamment l'expérimentation des maisons de naissance. Les étudiants de sages-femmes se dirigent un peu vers ça, se questionnent, etc. On entend parler. Donc l'accompagnement global pour les sages-femmes qui le pratiquent, c'est un accompagnement dans le temps, avec un suivi de la grossesse, un suivi gynéco, une préparation de leur patiente, des conseils tout au long de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Également l'établissement d'un lien de confiance. qui est indispensable au bon déroulement de l'accouchement et une bonne connaissance de la patiente qui est nécessaire, indispensable également au bon déroulement de l'accouchement et au fait de pouvoir justement... prévenir d'éventuelles pathologies ou d'hystocytes. Donc la proximité, l'humanité, la relation de confiance, qui étaient quand même les objectifs fixés par le dernier plan de périnatalité, sont totalement effectifs dans les principes du suivi global. Les sages-femmes, les nombreuses sages-femmes que j'ai rencontrées qui font de l'accompagnement global, reconnaissent que les femmes qu'elles suivent s'attachent en fait à l'assurance qu'elles ont été bien comprises dans leur souhait, dans leur souhait de condition d'accouchement, qu'elles ont été entendues et qu'on va surtout leur donner toutes les possibilités pour bien accoucher, c'est-à-dire vivre une expérience positive de l'accouchement et que surtout on va tout faire pour leur éviter des complications. Et c'est aussi pour ça que certaines femmes font le choix d'un accompagnement global. de la volonté, par exemple, de rester chez soi ou d'être dans l'intimité, il y a quand même cette envie d'être préservée des effets iatrogènes des pratiques hospitalières. Donc la continuité des soins, qui est un mot qu'on trouve partout maintenant, dans tous les documents par rapport aux politiques de santé publique, on entend tout le temps l'importance de la continuité des soins, etc. D'ailleurs, on va créer… des rôles de sages-femmes référentes dans les hôpitaux, ou même des sages-femmes libérales qui seraient référentes de la patiente pour assurer la continuité de soins, etc. Donc cette continuité de soins, c'est une part importante de la sécurité qui est apportée par la sage-femme, en ce sens qu'elle implique un engagement professionnel et moral envers la patiente et une prise en compte objective de la qualité du suivi sur le déroulement de l'accouchement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, c'est-à-dire que la sage-femme s'implique dans le suivi de grossesse parce qu'elle sait qu'elle va être présente et qu'elle va être responsable non seulement de la grossesse, mais également de l'accouchement, et donc elles vont faire en sorte, par leurs conseils, par leurs préparations, par les choses qu'elles vont mettre en place, elles vont tenter de prévenir un maximum les complications qu'il pourrait y avoir lors de l'accouchement, et donc elles ont une véritable logique. d'accompagner la santé de la femme pendant sa grossesse pour simplifier son accouchement, qu'elle ait un accouchement le plus facile possible. Et puis pour les femmes, l'accompagnement global, c'est reconnaître les compétences de leur sage-femme et notamment des compétences qui ne vont pas être restreintes par des protocoles hospitaliers. Donc certaines femmes ont dit par exemple, pour moi ce qui représente la sécurité lors d'un accouchement, c'est la sage-femme. Et si vraiment je ne pouvais pas accoucher chez moi, je crois que j'accepterais le plateau technique pour avoir la sage-femme. Et elle ajoute, je parle de nos sages-femmes bien sûr. Et puis donc la compagnon globale favorise aussi la confiance de la femme en ses propres capacités à mettre au monde son enfant et sa confiance dans le bon déroulement du travail. Donc ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu aussi dans les entretiens, dans le sens où la femme se fait confiance, fait confiance à la sage-femme. et c'est qu'elle peut gérer elle-même son accouchement et que la sage-femme va avoir un œil dessus et sera en mesure de lui dire s'il y a un problème dans le déroulement. Et puis, avant tout, surtout la compétence globale, comme je le disais, rassure les femmes sur le fait qu'aucune intervention ne sera décidée de manière inutile ou arbitraire. La question de l'épisiotomie, par exemple, ou de la césarienne revient souvent dans le sens où Les femmes me disaient, s'il doit y avoir une épisiotomie, je sais que la sage-femme, si elle fait ce geste-là, c'est vraiment qu'elle n'aura pas eu de choix, c'est vraiment que ce geste sera utile et qu'en aucun cas elle ne touchera à quoi que ce soit s'il n'y en a pas besoin. Et de la même manière, si ça doit finir en césarienne, je sais que j'aurai tout tenté et que ça ne sera pas dû à un engrenage ou à une suite d'actes. iatrogènes qui auront amené à ça. Donc évidemment dans les arguments des femmes pour l'accompagnement global, il y a aussi tout ce qui touche au respect de l'intimité, à la volonté d'accueillir son enfant dans son foyer, le fait aussi de permettre la présence des aînés dès les premiers instants, même parfois dès le moment de l'accouchement auprès de la mère et du petit, etc. Donc il y a il y a aussi beaucoup de choses qui vont être des arguments. pour les femmes, pour choisir l'accompagnement global et notamment l'accompagnement, du coup, l'accouchement accompagné à domicile, dans le sens où on va mettre un accent important sur le fait d'être chez soi, d'être dans son environnement, de se sentir dans son intimité, respecter avec son conjoint, etc. Je mets en avant volontairement les arguments sécuritaires et les arguments liés aux compétences des sages-femmes. Et donc je vais y venir, pourquoi je mets le doigt sur ces arguments-là ? Parce que je pense que dans l'opposition des représentations et des discours auxquels on a à faire face, je pense que ce sont ces arguments… qui ont le plus de poids. Par rapport à l'accompagnement global et à cette notion du risque, ensuite, on le sait, il y a des freins à l'accompagnement global qui sont importants. Déjà, le 30 mai 2013, le ministère des Affaires sociales et de la Santé, alerté par la Cour des comptes, avait décidé de saisir l'ordre des sages-femmes sur les risques encourus du fait d'un défaut de souscription d'assurance, responsabilité civile professionnelle par les sages-femmes libérales qui pratiquent des accouchements à domicile. Les conseils départementaux ont été invités à adresser un courrier aux sages-femmes libérales, leur demandant expressément de fournir une attestation d'assurance en cas de pratique à domicile, en leur rappelant les risques encourus par cette situation illégale. Or, depuis 2001, aucune assurance abordable ne leur est proposée. Donc, malgré l'absence de soutien, celui-ci n'est pas sans ignorer la position délicate des sages-femmes face à la demande grandissante des couples. pour un accompagnement global. À l'époque, déjà, j'avais relevé que dans la revue Contact sage-femme, éditée par le Conseil de l'Ordre, le numéro du 20 juillet 2009, la revue présentait les résultats d'une enquête nationale sur la pratique des sages-femmes libérales. Et les résultats indiquaient qu'en 2008, environ 4 500 demandes n'ont pu être satisfaites, contre 3 900 en 2007, donc il y avait déjà une augmentation des demandes d'accompagnement global, auprès de 930 sages-femmes. soit 60% des sages-femmes ayant répondu à l'enquête. En 2008, seuls 4,4% des sages-femmes libérales avaient accès à un plateau technique. Pour celles qui n'avaient pas d'accès, 390 sages-femmes avaient été sollicitées pour 5 140 demandes de parents en 2007 et il y avait eu 6 691 demandes en 2008, ce qui représentait une augmentation significative. Donc le Conseil de l'Ordre a très bien connaissance de tous ces chiffres. Et d'ailleurs, pendant la période Covid, il y a des chiffres aussi qui sont sortis et les demandes ont également explosé. Donc, en conclusion de son article, le Conseil national de l'ordre des sages-femmes note le souhait des professionnels qui avaient répondu à l'enquête que l'ouverture des plateaux techniques soit facilitée, car cela représente une bonne alternative entre l'accouchement accompagné à domicile et l'accouchement médicalisé en établissement de santé. Et elle demandait aussi que le regard des approbateurs des hospitaliers, donc sages-femmes et médecins, puissent disparaître et se positionnent en faveur d'une diversification de l'offre de soins pour le bien-être et le respect des parents ainsi que des nouveau-nés, tout en permettant l'épanouissement professionnel des sages-femmes. Donc ça, c'est ce qui était écrit dans la revue du Conseil de l'Ordre. Et comme je le disais, aujourd'hui encore, les sages-femmes sont en mesure d'affirmer que la demande est croissante. Alors évidemment, dans les autres freins à l'accompagnement global, Il y a l'engagement, la disponibilité, avec l'idée quand même que favoriser des binômes entre sages-femmes peut être une bonne solution, on va dire, pour soulager, un peu alléger les contraintes dues à l'accompagnement global et de la disponibilité. Et d'ailleurs, la plupart des sages-femmes que j'ai rencontrées qui témoignaient du fait de travailler en binôme, que ça fonctionnait plutôt bien en fait, puisque les patientes ont l'occasion de rencontrer les deux sages-femmes à un moment donné de leur suivi. Un autre frein, évidemment, c'est la rémunération, puisque le forfait accouchement n'a pas été revu depuis extrêmement longtemps et ne prend pas en considération tout le temps de disponibilité que ça demande, avec ce qui entraîne aussi une inégalité d'accès à l'accompagnement global, puisqu'il y a énormément de dépassements d'honoraires. Et puis, un autre frein important, c'est quand même la difficulté d'entente avec les structures, que ce soit pour l'accès au plateau technique ou pour le transfert des patientes. Et ça, c'est quand même un problème sur lequel il faut travailler, puisqu'effectivement, il y a des gros soucis de compréhension et de jugement et de très mauvaise entente parfois entre les sages-femmes libérales praticiennes et les structures, ce qui fait qu'en cas de transfert, c'est compliqué pour les sages-femmes d'accompagner déjà leurs patientes au sein de la maternité et avec parfois des retards de transfert. ou des patientes qui sont laissées devant la maternité, et ce qui va d'ailleurs être reproché après aux sages-femmes. Également, ce que l'étude a montré, c'est donc une ignorance des praticiens hospitaliers sur l'exercice du suivi global, avec cette réticence notamment des collègues sages-femmes hospitalières qui n'apprécient pas, alors je cite certaines sages-femmes, que les sages-femmes libérales travaillent dans leurs coins et ne les sollicitent qu'en cas de problème. Et donc j'ai entendu des choses aussi comme… Les sages-femmes libérales qui font des accouchements, c'est bien sympa, mais c'est nous qui ramassons toutes les merdes de l'accouchement à domicile. Autrement dit, dès qu'il y a un souci, dès que ça ne va pas, c'est à l'hôpital que les femmes arrivent et c'est nous qui devons prendre en charge ces patientes alors qu'on n'a pas de dossier, alors qu'on n'a pas commencé l'accouchement, etc. Donc je vais revenir aussi sur ce point qui est aussi un point intéressant à discuter. Et puis, il y a une opposition très nette des médecins, mais ça, comme je le disais, c'est historique. Une opposition très nette des médecins qui invoque des problèmes de responsabilité médico-légale, des démarches administratives trop complexes, ça c'est pour les plateaux techniques, des pédiatres aussi qui s'opposent beaucoup, notamment aux sorties précoces ou aux accouchements qui n'ont pas lieu en structure, puisqu'ils ne peuvent pas voir les bébés et les suivre et savoir exactement comment ils vont. Et puis des cadres sages-femmes qui n'acceptent pas l'idée que des sages-femmes libérales travaillent dans la structure sans être soumises au protocole. Au centre de ces tensions, il y a aussi des questions de représentation autour des femmes qui se positionnent en faveur de l'accouchement physiologique. Et ça, c'est lié aussi à l'évolution des conditions d'accouchement en France, c'est lié aussi à des questions féministes. Pour cette question-là, je vais l'aborder, mais… Rapidement, ce que je peux dire, c'est que dans ces représentations, il y a des questions de jugement, d'incompréhension, on pourrait même dire de jalousie, parfois entre femmes. Il y a des jugements très forts entre les femmes, puisque les femmes qui ont eu des accouchements parfois difficiles en milieu hospitalier, mais qui n'envisageraient pas la possibilité d'accoucher à domicile, ce qui s'entend. vont avoir un regard sur les femmes qui accouchent, notamment à la maison, comme je le disais au début, sur le fait que oui, mais c'est parce que ton accouchement… C'est comme si c'était toujours a posteriori, c'est-à-dire oui, mais c'est parce que tu accouches facilement ou c'est parce que ton accouchement était facile que tu as pu accoucher à la maison. Il y a un souci au niveau de la réflexion cause-conséquence. Donc, c'est toujours… Parce que l'accouchement était facile, heureusement, tu as eu de la chance. Donc, c'est la question de la chance. Il y a la question de la morphologie aussi. Donc, j'ai pu entendre des fois, oui, mais c'est parce que toi, tu as une morphologie qui est bien adaptée. Voilà. Et puis, il y a la question un peu écolo, c'est-à-dire l'image de la femme un peu écologiste, proche de la nature. Donc, j'ai entendu des choses comme, oui, mais toi, tu es une costaud de la campagne. C'est le truc, ça fait plaisir aussi. Et donc, c'est pour ça que tu es attachée à l'accouchement à domicile. Et puis avec l'argument incontournable de « moi, si j'avais accouché à la maison, je serais morte parce qu'il y a eu telle et telle complication » . Donc d'où l'importance des fois de renverser cette…
Speaker #0réflexion cause-conséquence en se demandant si ce n'est pas plutôt l'inverse, c'est-à-dire si ce n'est pas plutôt le type d'accouchement choisi qui fait que l'accouchement va être plus simple et moins compliqué. Donc, dans les témoignages, il y a également énormément de jugements et d'agressivité de la part des professionnels de santé qui sont très attachés à la prévalence du modèle hospitalier. Donc ça, c'est incontournable aussi et je pense que ça ne changera pas, dans le sens où... Il y aura toujours des médecins et des gynécologues obstétriciens qui seront tout à fait ouverts à comprendre comment fonctionne l'accompagnement global et à comprendre ses bénéfices. Mais il y aura toujours une grosse partie du corps médical qui restera très réticent par rapport à ça, avec cette idée toujours que, je cite un obstétricien qui dit à sa patiente, oui, les suivis par les sages-femmes, c'est bien gentil, mais après, elle nous les renvoie dès qu'il y a un problème. Donc moi, je trouve que les sages-femmes, c'est bien pour les consultations, à la limite jusqu'à 7 mois, mais quand même, les suivis, ça devrait être nouveau. Alors, dans la plupart de ces remarques, il y a une contradiction importante, et je pense que c'est important de mettre le doigt dessus, entre la formation effective des sages-femmes, qui est en fait de suivre les grossesses physiologiques, et de transférer les patientes vers un médecin en cas de pathologie. Je veux dire, leur code de déontologie, c'est ça. C'est leur code de déontologie, c'est-à-dire qu'elles suivent la grossesse tant qu'elle est normale, l'accouchement est autosique, et en cas de pathologie, elles doivent transférer. C'est la limite de leurs compétences, de leurs pratiques. Or là, c'est ce qu'on va leur reprocher. On va leur reprocher de transférer en cas de problème. C'est quand même incroyable, puisque c'est à la base même de leur métier, ce qu'elles font d'ailleurs en milieu hospitalier. Et ce genre de discours sous-entend aussi… que le suivi de la grossesse n'est efficace que s'il est effectué par un médecin. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi, notamment beaucoup autour de l'accouchement. Et c'est d'ailleurs le cœur du rapport, le dernier rapport du professeur Ville. C'est-à-dire que les maternités de niveau 1 de moins de 1000 accouchements par an doivent ne plus… Alors, pas fermer, il est gentil, on ne ferme pas. On laisse le suivi de la grossesse, on laisse les suites de couche. Par contre, pour le moment de l'accouchement, il faut aller. C'est formidable, pour la continuité du soin, c'est formidable. Et surtout, on est toujours dans cette représentation que sans la présence d'un médecin, d'un anesthésiste et d'un pédiatre, si possible aussi, l'accouchement par la sage-femme n'est pas sécure. Donc moi, j'aimerais bien quand même demander à M. Ville, quitte des maisons de naissance alors, puisqu'on vient d'accepter l'ouverture des maisons de naissance. Mais à côté de ça, une maternité qui pratique 999... accouchement par an, ce n'est pas possible. Autre argument qui revient, c'est la question de la douleur et la question des combats féministes. Alors ça, on entend aussi beaucoup le fait que souhaiter un accouchement physiologique, ça serait, je cite une personne qui dit, c'est bafouer tous les combats féministes de nos mères qui ont enfin réussi à vaincre la douleur, et toi tu craches sur tout ça, et tu veux souffrir lors de ton accouchement. Donc ça, c'est le témoignage via une patiente, en fait. de la part d'une de ses collègues, qui était d'ailleurs professionnelle de santé, donc c'est sa collègue qui lui a dit ça. Et puis donc des anesthésistes, beaucoup aussi qui ont ce type de discours sur le fait que la femme qui souhaite un accouchement physiologique, même en maternité, parfois c'est même des consultations avec des anesthésistes où les femmes ne parlent pas de leur projet d'accouchement à domicile, se présentent comme envisageant de s'inscrire à la maternité pour accoucher à la maternité, et vont avoir... parce qu'elles disent qu'à priori elles ne souhaitent pas de péridurale, vont avoir des discours sur la dangerosité d'un accouchement sans péridurale. Donc là c'est quand même questionnant, voire grave, puisque j'ai eu des témoignages d'anesthésistes qui vont dire par exemple à leurs patientes « mais vous savez, c'est quand même mieux d'avoir une péridurale, parce qu'en cas de problème, vous allez éviter l'anesthésie générale » . Donc ça c'est quand même… énorme, je trouve. Et ça pose quand même vraiment question, enfin voilà, sur aussi les conséquences d'une anesthésie, enfin les conséquences même de la péridurale. En fait, a priori, c'est même pas a posteriori que vous auriez dû la prendre, c'est a priori que vous devriez la prendre pour faciliter votre accouchement. Avec, par exemple, une patiente qui me dit, mon gynécologue, moi quand on lui a dit qu'on avait un projet d'accouchement à domicile, Merci. il nous a dit si ça vous amuse de rouler en sens inverse dans le brouillard sur l'autoroute, allez-y. Et donc elle a changé de gynécologue et elle a bien fait je pense. D'ailleurs, certaines sages-femmes libérales préfèrent conseiller à leurs patientes de ne pas parler du tout de leur projet lorsqu'elles s'inscrivent à la maternité pour éviter ce genre de discours. Et si elles souhaitent accoucher à la maternité, de ne pas parler non plus de leur projet. Ça va loin quand même. C'est-à-dire qu'elles leur conseillent de ne pas parler de leur projet d'accoucher sans péridural, de ne rien dire, mais plutôt de refuser les propositions qui vont leur être faites. et repousser jusqu'à ce que ce ne soit plus nécessaire. Et puis avec la question du transfert aussi, autour de cette question de la péridurale qui est quand même un peu centrale, même si quand on en discute avec les sages-femmes, ils ont l'air de dire que oui, ce n'est pas si central que ça, mais dans les entretiens avec les femmes, c'est des choses qui reviennent quand même beaucoup. Par exemple, un extrait d'entretien d'une femme à qui l'obstétricien, lors d'une visite, en fait pour l'inscription à la maternité, lui avait dit « Oui, oui, on verra quand vous viendrez nous voir et quand vous viendrez chercher une péridurale. » Et cette femme-là a commencé son accouchement à domicile et lorsqu'elle a commencé à perdre les os, le liquide était teinté. Donc la sage-femme a préféré aller à la maternité et elle a eu la chance de recroiser ce monsieur qui lui a dit « Mais je vous l'avais bien dit que vous viendrez nous voir. » Et puis d'autres qui vont dire aussi par rapport à la péridurale on verra quand vous gueulerez et vous serez bien contentes qu'on soit là pour vous soulager. Comme si finalement la présence du corps médical était là uniquement pour soulager les patientes de leur douleur et que c'était un peu ça leur baguette magique, qu'on ne pouvait pas se passer d'eux pour ça. Et puis plus grave, enfin ce qui va plus loin, C'est les témoignages de patientes qui ont eu des examens complémentaires, par exemple, avec suspicion d'un poids trop important du bébé ou des choses comme ça, alors que ce n'était pas le cas du tout, parce qu'elles avaient parlé de leur projet d'accouchement à domicile, avec finalement des fois des accouchements qui vont, des grossesses qui vont dépasser largement le terme, parce que certainement la femme est angoissée aussi par tous ces examens. et finalement on a on lui annonce un bébé gigantesque et quand il naît, il fait moins de 3 kg et il va très bien. Et ce type d'histoire n'est pas isolée du tout, puisque une sage-femme m'a parlé par exemple du cas d'une patiente qui avait subi une échographie assez violente, qui pourrait être selon la sage-femme la cause de son accouchement prématuré. Une autre sage-femme qui me raconte le cas d'un transfert À cause d'un ralentissement du travail, elle a préféré transférer la patiente, mais en se disant, c'est par sécurité, et pour moi aussi, pour ma sécurité, mais je pense que l'accouchement va se dérouler très bien. Et finalement, une césarienne est décidée dès l'arrivée de la patiente, sans même examen complémentaire, etc. Et donc, elle parlera de césarienne punition. Et voilà, ce type de témoignage, il y en a beaucoup. Donc, pour finir... sur la diversification de l'offre de soins qui est nécessaire, qui est indispensable. Et l'importance, je pense, mais après on va en discuter, ce n'est qu'un point de vue, l'importance des arguments médicaux et juridiques dans cette bataille pour la diversification de l'offre de soins. Puisqu'en France, déjà, les politiques de santé publique ont toujours misé sur la médicalisation pour assurer la sécurité de l'accouchement. Malgré cela, les résultats périnataux, même s'ils sont un peu améliorés, ne sont pas au niveau européen, on est loin d'être au top. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, je pense, de toute façon c'est une réalité, c'est qu'en France, la majorité des femmes souhaitent accoucher en milieu hospitalier. Et ça, monsieur Ville, par exemple, l'a très bien noté dans son rapport également, la plupart des femmes souhaitent accoucher en milieu hospitalier, souhaitent se sentir sécurisées par… un personnel hospitalier compétent, par la présence de la technique, etc. C'est une réalité. Après, on peut analyser les raisons du choix. Par contre, le fait d'acter que c'est un fait, qu'il y a quand même une majorité des femmes qui souhaitent cet accouchement en milieu hospitalier, et d'ailleurs un obstétricien, une fois, avait répondu à une… d'ailleurs à la présidente de l'Association nationale des sages-femmes libérales, on ne va quand même pas changer. tout un système de soins pour 1% des femmes qui veulent autre chose. Et c'est une réalité, c'est-à-dire que le système de soins en lui-même n'est pas prêt de changer, on le voit puisqu'ils vont encore fermer des maternités. Donc l'accouchement accompagné à domicile sera toujours minoritaire, même si ça augmente, ça sera forcément une minorité. Donc il faut garder quand même en tête qu'on est dans une lutte de pouvoir, un rapport de force qui est très très déséquilibré. que les femmes qui font ce choix-là considérés comme une minorité, voire comme des inconscients, des irresponsables. Alors évidemment, les choses changent et notamment grâce au travail d'information comme fait le CDAD ou la PAD, ce qui est indispensable parce que je pense qu'entre le moment où j'ai fait mon enquête sur plusieurs années et jusqu'à aujourd'hui, les représentations ont quand même beaucoup changé. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. L'accouchement à domicile, domicile. et reste quand même à l'opposé des pratiques hospitalières et à l'opposé de l'idéologie dominante en termes de sécurité médicale. Et donc, à ce titre-là, il y aura toujours un soupçon sur ce type d'accouchement. Et donc, l'idée, c'est de comprendre cette inégalité des discours et cette lutte de pouvoir qui est inégale, déjà parce que les rapports de pouvoir entre les sages-femmes et les médecins sont inégales. On le voit, puisque les sages-femmes ont toujours utilisé des arguments juridiques, des arguments de santé publique, de statistiques, et malgré ça, elles se sont fait quand même largement écraser dans leurs pratiques. On imagine bien qu'entre des femmes qui veulent accoucher chez elles, faire ce qu'elles veulent, dans le sens où c'est comme ça qu'elles sont perçues par une partie du corps médical, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui ont envie de faire ce qu'elles veulent, un peu comme des enfants capricieux, sans parler de... toutes les représentations autour de la femme, bobos, écolos, etc. Une maternité qui ne pratique pas des actes techniques et des actes médicaux, au final, n'aura plus de financement. Enfin, je veux dire, et c'est aussi pour ça qu'il y a des petites maternités qui ne fonctionnent plus. Il y a un directeur, on va dire, d'hôpital qui souhaite que sa maternité fonctionne. Il faut qu'il y ait des actes. Il faut qu'il y ait des actes techniques, il faut qu'il y ait des actes... médicaux, médicamenteux, etc. C'est une réalité. Cette lutte de pouvoir sans même inégal, pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que les arguments qui doivent être utilisés pour demander, réclamer une diversification de l'offre de soins, doivent être des arguments qui sont basés sur ces mêmes indices, c'est-à-dire des indices de santé publique, des indices, comme d'ailleurs l'APAD a fait ce travail statistique en fait. Et ça, c'est vraiment un travail qui est très important, plutôt que de se focaliser sur les notions de liberté, d'autonomie, d'empowerment, etc. Puisque c'est justement sur ces arguments-là que les femmes qui font ce choix vont se faire directement attaquer, en fait. Travailler sur l'argument de la sécurité, de l'accompagnement en lui-même, plutôt que du lieu, si vous voulez. J'entends bien et je soutiens, je suis membre de… du CDAD et je soutiens à fond tout ce que vous faites et tout ça. Mais je profitais là de cette discussion un peu pour faire un peu débat aussi, d'expliquer pourquoi c'est important d'avoir des arguments autour de la question de la sécurité au niveau des décisions politiques. C'est ça qui va avoir du poids. Ce qui va avoir du poids, ce n'est pas la femme qui va dire « mais moi, en fait, j'ai envie qu'on me reconnaisse dans mes compétences » . de femme et que je suis capable d'accoucher et que j'ai le droit de choisir qui je veux, etc. Mais qu'il faut avoir des arguments à la fois juridiques, scientifiques, médicaux, en termes de sécurité, puisque ce sont sur ces points-là qu'on va être attaqué directement. Parler d'accompagnement global plutôt que d'accouchement à domicile, c'est aussi mettre le doigt sur ces arguments juridiques, c'est-à-dire le choix de choisir son praticien. Peu importe le lieu de l'accouchement, c'est-à-dire même de se dire, je peux décider d'accoucher. Aujourd'hui, avec la fermeture des maternités, clairement, il y a des femmes qui vont accoucher sur le bord de la route. Tant qu'à faire, je peux accoucher n'importe où, que ce soit en structure, en maison de naissance. chez moi ou peu importe, mais ne pas se focaliser dans le discours sur le lieu, mais plutôt sur le type d'accompagnement et pourquoi cet accompagnement-là répond tout simplement au droit. C'est-à-dire que dans le droit, nous avons le droit de choisir librement notre praticien et d'ailleurs tout praticien de santé doit faciliter l'exercice de ce droit et c'est dans le Code de la santé publique. Le Code de déontologie rappelle ça également, le Code de déontologie des sages-femmes, puisque la sage-femme doit respecter le droit qu'on possède toute personne. de choisir son praticien, de choisir le lieu de son accouchement. Et puis, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi, à la surveillance des situations non pathologiques, au dépistage de la pathologie, etc. En fait, tout est écrit déjà, que ce soit dans le Code de la santé publique ou dans le Code de déontologie. Le droit est là, en fait. Et donc, je pense que c'est important de s'appuyer sur ce droit. et dans le droit, on ne parle pas du lieu. de l'accouchement, mais on parle des conditions d'exercice des sages-femmes. Et je pense que c'est important de travailler sur ça aussi, c'est-à-dire de travailler sur préserver les conditions d'exercice des sages-femmes pour le bien-être de leurs patients.