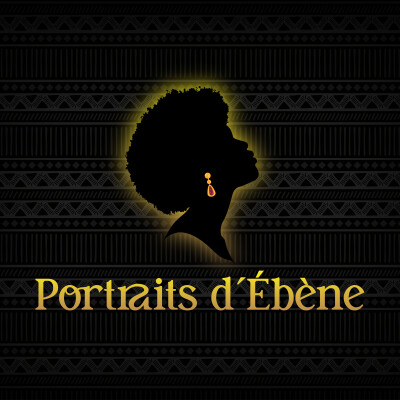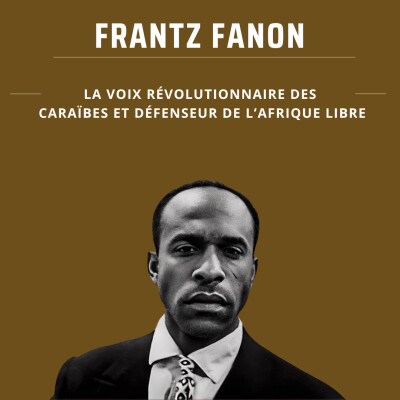Speaker #0Tiens maman, un Nègre ! Pour cet enfant, ce n'est qu'un constat innocent. Mais pour Frantz Fanon, assis sur ce siège, ses mots frappent comme un coup de tonnerre. Lui, ce jeune homme martiniquais qui a risqué sa vie pour la France en tant que soldat, se rend compte à cet instant qu'il n'est qu'un noir dans le regard des autres. Pas un individu, pas un héros, juste une couleur. C'est ainsi que commence le cheminement d'un homme qui transforme cette douleur intime en une pensée révolutionnaire. Bienvenue dans Portrait d'Ebène. Aujourd'hui nous plongeons dans l'histoire de Frantz Fanon, psychiatre, écrivain et révolutionnaire. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui se sont abonnés. Votre soutien me permet de continuer à raconter ces histoires essentielles. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant ensemble, portons ces voix encore plus loin. Frantz Fanon voit le jour le 20 juillet 1925 à Fort-de-France en Martinique. Il grandit dans une famille de la petite bourgeoisie martiniquaise. A cette époque, la hiérarchie raciale était omniprésente. Les blancs formaient une minorité contrôlant l'économie et détenant les postes de pouvoir. Les mulâtres, descendants de colons et d'esclaves affranchis, eux occupaient une position intermédiaire, jouissant de certains privilèges sociaux et économiques. Enfin, les noirs, descendants des esclaves, constituaient la majorité mais restait confiné aux marches de la société, souvent assigné à des travaux les plus durs. Cette classification raciale façonne chaque aspect de la vie quotidienne. Dans ce contexte, le jeune François NON reçoit une éducation profondément marquée par les idéaux de la République française. Liberté, égalité, fraternité. Il se considère comme français, un citoyen loyal de l'empire colonial. A l'école, il récite fièrement Nos ancêtres les Gaulois Pourtant, Les réalités sociales et raciales qu'il observe autour de lui sèment déjà en lui les premières graines de doute. La seconde guerre mondiale éclate et la Martinique devient un territoire stratégique pour l'Empire français. L'armée de soldats tirailleurs sénégalais envoyés pour maintenir l'ordre bouleverse le jeune France. Ces hommes noirs comme lui sont traités avec un mépris flagrant. Ils sont logés dans des conditions déplorables, tenus à l'écart, réduits à des fonctions subalternes. France Fanon, fasciné par leur prestance et leur dignité malgré les humiliations, commence à percevoir l'ampleur. de l'injustice coloniale. En 1943, à seulement 18 ans, il fait un choix qui changera le cours de sa vie. Il décide de quitter la Martinique pour rejoindre les forces françaises libres. A l'époque, la France libre de Charles de Gaulle représente une lueur d'espoir face à l'occupation nazie et à l'effondrement des valeurs républicaines sous le régime de Vichy. Pour Frantz Fanon, cet engagement est bien plus qu'un acte patriotique, c'est une façon de défendre les idéaux auxquels il croit profondément. Il est envoyé sur les fronts les plus difficiles, notamment en Alsace. Là-bas, il fait face non seulement aux horreurs de la guerre, mais aussi au racisme institutionnel de l'armée française. Les soldats noirs sont systématiquement relégués aux tâches les plus ingrates, malgré leur bravoure. Frantz Fanon, blessé au combat, reçoit la croix de guerre militaire pour son courage, une distinction qui souligne son engagement. Mais cette médaille n'efface pas l'humiliation quotidienne qu'il subit en tant que soldat noir dans une armée blanche. Au fil des mois, un paradoxe déchirant s'impose à lui. Il se bat pour la liberté, mais cette liberté ne lui est pas accordée. Il commence à comprendre que le racisme, loin d'être une aberration, est au cœur même de la société française qu'il défend. Cette prise de conscience, née dans les tranchées et les champs militaires, marquera le début de son cheminement intellectuel et politique. Quand la guerre prend fin, il est découré comme un héros, mais revient en France avec un sentiment d'amertume. Les idéaux de liberté et de justice pour lesquels il a risqué sa vie semblent inaccessibles pour lui et pour des millions d'autres colonisés. Ce retour à la réalité... nourrit en lui une colère sourde, une révolte intérieure qui ne trouvera son expression que bien plus tard, dans ses écrits et dans son engagement révolutionnaire. En 1945, après avoir risqué sa vie pour la liberté de la France et avoir été décoré pour son courage, Frantz Fanon retourne en métropole, mais cette fois, ce n'est pas en tant que soldat qui pose le pied sur le sol français. Il revient comme étudiant et s'inscrit à la faculté de médecine de Lyon où il se spécialise en psychiatrie. Il est décrit comme un étudiant brillant, toujours en quête de savoir. Mais derrière ce parcours académique exemplaire se cache une tension profonde, une douleur sourde. Malgré ses accomplissements, il reste confronté à un racisme insidieux, subtil mais omniprésent. Les regards qu'on lui adresse dans les amphithéâtres ou les rues ne sont pas ceux que mérite un héros de guerre. Lorsqu'il parle avec éloquence, certains s'étonnent. Un professeur, apprécié par sa manière de raisonner, lui lance un jour. Vous êtes noir, mais vous pensez comme un blanc. Pour Frantz Fanon, c'est une preuve supplémentaire que peu importe ses efforts ou ses succès, il ne sera jamais vu comme un individu à part entière. Sa couleur de peau semble être une barrière infranchissable dans le regard des autres, un filtre à travers lequel tout ce qu'il fait est interprété. En parallèle de ses études, il continue à travailler avec des ouvriers immigrés, notamment des travailleurs maghrébins dans les quartiers pauvres de Lyon. Ces hommes, souvent exploités et méprisés, lui confient leurs souffrances. Il parle de douleurs qu'il n'arrive pas à nommer, des mots qu'aucun médecin ne semble prendre au sérieux. Ce sont des blessures. invisibles, profondes, nées de leurs conditions de coloniser dans un pays qui refuse de les reconnaître pleinement. Ces expériences enrichissent sa réflexion et nourrissent en lui une révolte silencieuse. A travers ses études, il commence à mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il observe. Il ne s'agit plus seulement de comprendre le fonctionnement du cerveau humain, mais aussi de déchiffrer les mécanismes de domination qui brisent les esprits. C'est dans cette tension, entre colère et détermination, que germe l'idée d'écrire Peau Noire, Masque Blanc. Un livre qui sera le premier livre de l'histoire. le premier cri de sa révolte contre l'oppression. En 1952, François Don publie son premier ouvrage, Peau noire, masque blanc. Ce livre, à la fois puissant et poétique, est bien plus qu'une simple analyse. C'est un cri, un appel à la libération mentale et émotionnelle des colonisés. Pourtant, ce n'est pas dans un climat de reconnaissance ou de sérénité qu'il voit le jour. Son projet initial était d'en faire une thèse pour valider ses études de médecine. Mais son texte est rejeté par le directeur de thèse, qui le juge trop polémique, trop engagé politiquement. Déterminé, Frantz Fanon décide de le publier sous la forme d'un essai. Ce rejet renforce en lui l'idée que la science, comme la société, est également imprégnée de beaucoup de racisme et de colonialisme. Dans Peau Noire Masque Blanc, il analyse les blessures invisibles laissées par des siècles de colonialisme. Il explore comment les colonisés intériorisent leur infériorité, non pas seulement parce qu'ils sont convaincus de leur infériorité naturelle, mais parce que le système colonial les y oblige. L'un des aspects les plus frappants du livre est son analyse de la quête d'assimilation. En effet, il décrit comment les colonisés exposés à des siècles de domination, cherchent souvent à ressembler aux colons. Croyant que cela leur apportera une forme de reconnaissance, ils adoptent leurs coutumes, leur mode de vie et surtout leur langue. Mais cette assimilation n'est qu'illusion. Même en adoptant tous les codes du colonisateur, le colonisé restera toujours l'autre. Cette quête d'acceptation est un piège qui alimente l'aliénation. En 1953, Franz Fanon quitte la France pour devenir médecin-chef à l'hôpital psychiatrique de Blida en Algérie, alors colonie française. Ce départ marque un tournant dans sa vie. A Blida, il découvre une réalité glaçante. L'hôpital psychiatrique, censé soigner les souffrances mentales, est lui-même un outil du système colonial. Les patients algériens, victimes de tortures, de traumatismes, liés à la répression ou simplement de la misère de leurs conditions, sont traités comme des cas désespérés. Pour beaucoup de psychiatres de l'époque, leur aliénation n'est pas liée aux conditions coloniales, mais à l'infériorité supposée en tant que peuple. Frantz Fanon refusant cette approche, transforme l'hôpital. Il met en place des thérapies innovantes cherchant à comprendre les causes profondes de leurs troubles. Il organise des ateliers de groupe où les patients peuvent parler, se reconstruire et retrouver un semblant de dignité. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de traiter les individus mais de soigner une société blessée par des décennies de violence et d'humiliation. Face à cette réalité, François Donne comprend que son rôle ne peut se limiter à celui de médecin. Il ne peut guérir des patients sans s'attaquer aux causes profondes de leur souffrance. Le colonialisme lui-même. En 1956, écoeuré, il démissionne de son poste à l'hôpital. Peu après, il rejoint le Front de Libération Nationale, le FLN, où il devient un acteur de la lutte pour l'indépendance algérienne. Il soigne les blessés des maquis, rédige des textes politiques et aide à structurer le mouvement. Cependant, son engagement au FLN n'est pas sans désolution. Il découvre que même dans un mouvement de libération, les divisions internes menacent l'unité. Les tensions entre les chefs politiques et militaires et les rivalités personnelles sapent parfois la cohésion du mouvement. Ces divisions révèlent à François NON que la libération d'un peuple ne se résume pas à chasser le colon. Elle exige aussi de surmonter les fractures internes et construire une véritable unité. C'est cette lutte acharnée et courageuse qui nourrit ses réflexions. Pour lui, l'Algérie est un laboratoire vivant de la décolonisation, un espace où se jouent les espoirs et les contradictions de la libération. Nous sommes en 1961. Frantz Fanon est gravement atteint d'une leucémie, une maladie qui ronge son corps. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Pourtant, au milieu de cette lutte contre la mort, il écrit l'œuvre la plus importante de sa vie, Les damnés de la terre. Ce livre n'est pas non seulement une analyse de la condition des peuples colonisés, mais c'est aussi un manifeste pour leur libération totale. C'est un cri, un guide, une mise en garde dictée dans l'urgence, mais avec une clarté et une profondeur saisissantes. Dans les damnés de la terre, il ne se contente pas de dénoncer les violences visibles du colonialisme comme les massacres ou l'exploitation économique. Il s'attaque aux racines profondes du système colonial. Il montre comment le colonialisme détruit les identités, manipule les esprits et déshumanise à la fois les opprimés et les oppresseurs. Il explique que la violence du système colonial crée un cycle infernal où les colonisés, privés de dignité et de pouvoir, intériorisent leur oppression et parfois reproduisent cette violence entre eux. Cette analyse va au-delà des simples faits. Elle révèle les mécanismes invisibles qui permettent au colonialisme de perdurer. L'une des thèses les plus controversées de cet ouvrage est la place qu'il accorde à la violence dans le processus de libération. Pour Frantz Fanon, le colonialisme est né dans la violence et ne peut être renversé que par une force équivalente. Cette violence, explique-t-il, ne doit pas être aveuglée ou destructrice, elle doit être constructive, guidée par une vision claire d'un avenir meilleur. Il met en garde contre un danger qu'il perçoit déjà dans les luttes anticoloniales. celui de la bourgeoisie nationale. Il craint que cette élite, éduquée par les colons, prenne le pouvoir après l'indépendance pour simplement reproduire les structures de domination. Pour lui, la libération politique ne suffit pas. Si les anciennes colonies tombent sous le contrôle d'une nouvelle classe dirigeante qui exploite les masses, alors la révolution aura échoué. Frantz Fanon appelle à une révolution plus profonde, menée par les classes populaires, les paysans et les ouvriers qui doivent non seulement reverser le colonisateur, mais aussi réinventer les structures politiques, économiques et sociales pour qu'elles servent les besoins du peuple. Mais le cœur de son message est la décolonisation mentale. Il exhorte les opprimés à se libérer des chaînes invisibles de l'aliénation, à se réapproprier leur histoire, leur dignité et leur identité. Il appelle à un rejet total des valeurs imposées par le colonisateur et à une redéfinition de ce que signifie être libre. Le livre, écrit dans l'urgence, devient rapidement une référence pour les mouvements révolutionnaires à travers le monde. Il est lu par les leaders des Black Panthers, par les militants anti-apartheid en Afrique du Sud et par les intellectuels. engagé dans des luttes pour la justice sociale. Quelques mois après la publication de ses chefs-d'oeuvre, Frantz Fanon s'éteint, mais son cri résonne toujours rappelant à tous ceux qui luttent que le chemin de la liberté est long, complexe, mais nécessaire. Nous avons tous à des degrés divers fait l'expérience des mécanismes que Frantz Fanon a décrit avec une telle lucidité. Cette voix dans votre tête qui vous dit Sois parfait, fais plus, prouve que tu mérites ta place. Ce masque que l'on porte parfois dans certains espaces. Cette façade pour paraître acceptable, pour ne pas déranger. Combien de fois avez-vous minimisé vos douleurs, vos réussites, vos doutes, parce que le système dans lequel nous vivons vous les a imposés comme invisibles ou illégitimes ? Frantz Fanon nous interpelle directement. Il ne parle pas seulement du passé, des colons et des colonisés, mais du présent, de ce que nous vivons ici et maintenant. Que faisons-nous lorsque nous nous surprenons à douter de nos propres capacités, à nous confronter à des attentes qui ne sont pas les nôtres ? Que faisons-nous lorsque nous nous regardons à travers le prisme des préjugés que d'autres ont imposés ? Frantz Fanon nous invite à aller au-delà de la survie, à dépasser les masques, à refuser les définitions imposées. Il nous rappelle que la liberté n'est pas un état, mais un processus, une conquête permanente qui commence en nous. Alors posons-nous cette question. Combien de fois avons-nous accepté sans même nous en rendre compte de jouer un rôle écrit par quelqu'un d'autre ? Combien de fois avons-nous été confrontés à un regard, à une attente, plutôt que de suivre ce qui nous définit vraiment ? Mais Frantz Fanon ne nous laisse pas sans solution. Il nous tend la main et nous montre une voie, celle de la réappropriation, celle de la transformation. Refuser de porter les masques, c'est un acte de résistance. Redonner du sens à nos histoires, à nos identités, c'est un acte de libération. Et reconstruire un monde où chacun peut exister pour lui-même, c'est un acte d'espoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si l'histoire de France Fanon vous inspire autant qu'elle m'inspire, alors abonnez-vous, partagez ce récit, commentez. Ensemble, célébrons les étoiles noires qui ont marqué notre histoire. A bientôt sur Portrait d'Ebène.