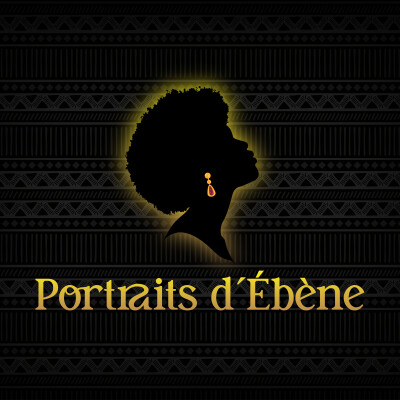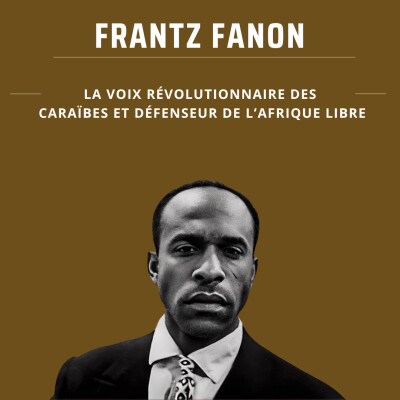Speaker #0Afrique de l'Ouest, 1892. Les tambours résonnent dans la nuit, portés par le vent chaud du désert. À travers les savannes et les forêts denses, des cavaliers pressent leur monture vers un campement fortifié. Au centre de ce rassemblement, un homme se tient debout, son regard fixé sur l'horizon. Cet homme, c'est Samori Touré, chef de guerre redouté et stratège visionnaire qui s'apprête une fois de plus à défier l'envahisseur. Samori Touré... n'est pas un chef ordinaire. Fils de commerçant, rien ne le destinait à devenir l'un des plus grands résistants africains. Mais ce soir, les hommes rassemblés autour de lui attendent ses ordres avec une loyauté indéfectible, prêts à défendre leurs terres contre l'armée française qui approche, résolus à préserver leur liberté coûte que coûte. Pour comprendre comment cet homme, autrefois simple commerçant, est devenu le chef d'un empire et un symbole de résistance, il faut revenir aux origines de sa lutte aux racines de son combat, là où son histoire commence. Samori Touré est né autour de 1830 dans le village de Millian-Baladou, dans l'actuel Guinée. Fils de commerçant, rien ne prédestinait ce jeune garçon à devenir un chef de guerre. Mais sa vie bascule. Quand encore adolescent, sa mère est capturée par un clan rival, les Sissés, lors d'un conflit avec son peuple. Samori prend alors une décision audacieuse. Pour libérer sa mère, il s'engage au service de ses ennemis et se forme à l'art de la guerre. Ainsi, pendant sept ans, sept mois et sept jours, Samori sert dans l'armée de Séré-Mourlaï. Il apprend l'art de la guerre, se convertit à l'islam et étudie le Coran. Grâce à son courage et à son intelligence, Il se distingue rapidement et gagne le respect de ses supérieurs. Durant cette période, Samori devient un guerrier accompli, mais il n'oublie jamais sa mission prioritaire. Libérer sa mère. Capturer. Cet objectif, qui semble initialement hors de portée pour un jeune homme sans ressources, deviendra l'une des premières victoires de Samo. Après avoir libéré sa mère, Samori décide de ne plus être sur l'autorité des Cissés. Il quitte leur armée et se tourne vers les Béretés, un autre groupe en conflit avec les Cissés. En rejoignant leurs forces, il met en œuvre une stratégie d'alliance tout en renforçant ses propres compétences militaires. Cela lui permet de gagner en stature et en pouvoir dans la région. Il rassemble progressivement ses forces et commence à construire son propre empire, qui deviendra le Wasul. Ce qui avait commencé comme une quête personnelle se transforme en une ambition plus grande. Unifier les peuples et résister à l'invasion européenne qui leur prend. Au fur et à mesure que l'Empire Ouassoulou se construit, Bissandougou devient la capitale du royaume. Cette ville fortifiée sert de centre administratif, commercial et militaire. Sous l'oreille de Samouri, Bissandougou se développe comme une véritable métropole africaine. L'organisation de la capitale est méthodique et reflète la vision stratégique de Samouri. Bissan-d'Ougu est une place commerciale florissante où se rassemblent les marchands venus de tout l'Empire, échangeant de l'or, des armes et des tissus précieux. La ville est également le siège du pouvoir militaire, avec une armée bien structurée et disciplinée. Les sofas, soldats professionnels de l'Empire, sont stationnés dans des casernes, organisées, prêtes à être mobilisées à tout moment. Bissan-d'Ougu devient également un centre culturel où l'islam se renforce sous l'influence de Samouri, qui a eu la foi religieuse. à ses ambitions politiques. L'Empire Ouassoulou à son apogée s'étend sur une partie de la Guinée actuelle, le nord de la Côte d'Ivoire, le sud du Mali et jusqu'aux frontières de la Sierra Leone et du Burkina Faso. Ce territoire est vaste et ethniquement diversifié. Samourie parvient cependant à tisser des alliances avec ses différentes communautés grâce à ses talents de diplomate mais aussi par la force lorsque cela est nécessaire. Cependant, en 1882, Les Français commencent à percevoir l'Empire Moissounou comme un obstacle à leur expansion coloniale. Samori est accusé d'avoir attaqué Kénérand, un important centre commercial sous contrôle français. Cet incident est le prétexte idéal pour la France qui accuse Samori de perturber la région. Mais derrière cette accusation, la vérité est bien plus simple. Les Français veulent contrôler les terres riches et les routes commerciales de l'Empire Moissounou. En 1883, La bataille de Woyou-Wayanko marque une victoire retentissante pour Samori contre les troupes coloniales françaises. Samori sait que ses forces, bien que disciplinées et courageuses, ne peuvent pas rivaliser directement avec la puissance de feu des Français. Il divise son armée en petites unités mobiles, capables d'attaquer rapidement et de disparaître avant que les troupes françaises ne puissent riposter. Capitalisant sur leur connaissance du terrain, les forces de Samori tendent des embuscades aux couloirs français dans les zones reculées. les forçant à ralentir leur progression. Les Français, peu familiers avec le terrain et mal préparés aux tactiques de guérilla, subissent de lourdes pertes. Chaque fois qu'ils tentent d'avancer, ils sont repoussés par des attaques éclairs, souvent de nuit ou dans des zones marécageuses. Samouris choisit ces lieux de combat stratégiquement, sachant que le terrain humide ralentira les mouvements des troupes françaises, limitant leur capacité de manœuvre. Malgré leurs armes modernes, les Français se retrouvent acculés. déconcertés par cette guerre asymétrique. Les attaques incessantes épuisent leurs soldats et la désorganisation s'installe dans leur rang. Les assauts répétés des sofas, les soldats fidèles de Samory, forcent finalement les Français à se replier, abandonnant leur objectif de conquête immédiate. Cette victoire retentissante marque un tournant dans la guerre contre les Français. Elle redonne espoir aux soldats et aux alliés de Samory, renforçant leur détermination à résister contre les envahisseurs. Dans toute la région, la réputation de Samori se renforce, et il est perçu comme un héros qui se dresse contre l'injustice coloniale. La bataille de Woyon Woyonko devient un symbole de la force de l'Afrique contre les forces étrangères, inspirant même les chefs des royaumes voisins à résister davantage. Cependant, malgré cette victoire, des tensions internes apparaissent. Alors que Samori impose l'islam comme religion d'État dans son empire, certaines communautés animistes rejettent fermement cette conversion forcée. Ce conflit religieux fragilise l'unité du Wasulu. La situation atteint son apogée lorsque Samori, suspectant son fils Diaole Karamoko, de comploter contre lui avec les Français, prend la décision déchirante de le faire exécuter. Du côté du camp français, la défaite de Woyowayanko est un choc. Habituellement sûrs de leur puissance militaire, les troupes coloniales ne s'attendaient pas à un tel revers face à un chef africain. Dans les rances françaises, Cette défaite instille un sentiment de frustration et de doute. Les soldats, épuisés par la tactique de guérilla de Saint-Mauri et accablés par le terrain difficile, réalisent qu'ils font face à un adversaire non seulement redoutable, mais aussi insaisissable. Le colonel Archinard, chef des opérations dans la région, est particulièrement affecté par cette défaite. Officier ambitieux et déterminé à marquer l'histoire en détendant l'influence française en Afrique de l'Ouest, Archinard perçoit l'échec de Woyowayonko. comme un affront personnel et d'insulte à l'honneur de l'armée française. Pour lui, cette défaite face à Samori qu'il considérait comme un obstacle temporaire est une atteinte directe à la mission coloniale. Archina décide de mobiliser plus de ressources et d'armes pour faire face à l'Empire Wasulu. Il met en place des stratégies plus agressives, cherchant à épuiser les ressources de Samori en attaquant directement ses bases et ses points de ravitaillement. Il ordonne également l'envoi de renforts, y compris des unités spéciales, doté de fusils à répétition et de canons pour compenser les pertes subies. Il commence à réorganiser ses forces, encourageant des patrouilles courantes dans les zones stratégiques de l'Empire Ouassoulou. Le but est d'affaiblir Samori en le forçant à épuiser ses soldats et ses ressources dans une guerre d'usure. Samori, bien qu'une fin stratège, est sous pression. Après plusieurs batailles difficiles, notamment contre les troupes d'Archila, il réalise qu'il ne peut pas rivaliser éternellement avec la puissance militaire des Français. En 1886, il signe le traité de Bissandoubou, un accord qui marque un tournant dans ses relations avec la France. Ce traité stipule que Samori accepte de placer une partie de son territoire sous la protection française. En échange, les Français promettent de ne plus interférer avec son empire. Mais Samori n'est pas dupe. Il sait que cet accord est un piège. Les Français n'ont jamais eu l'intention de respecter leur province. Peu après la signature du traité, les Français continuent d'étendre leur influence et cherchent à affaiblir Samouri en s'assurant qu'ils ne puissent pas établir d'autres alliances avec d'autres chefs, notamment Mabadou Lamine Dramé, qui lui aussi menait une rébellion contre les colonisateurs. Le traité de Bissandougou devient rapidement un outil pour manipuler Samouri et limiter ses actions militaires, ce qui trahit la véritable attention des Français, détruire l'Empire Ouassoulou. A la fin des années 1890, après des années de guerre et de résistance acharnée, Samori Touré voit son empire progressivement affaibli par la puissance militaire française. Ce déclin... provoquée par l'usure des combats et les tactiques de guerre de guérilla, plonge l'Empire Ouassoulou dans une situation de plus en plus précaire. En dépit de sa bravoure et de ses stratégies audacieuses, Samouri est confronté à des défis qui réduisent considérablement ses forces et ses chances de repousser les envahisseurs. Face à l'avancée des troupes françaises, Samouri adopte une politique de terre brûlée. Il ordonne à ses troupes de détruire tout sur leur passage, y compris les villages, les récoltes et les ressources vitales, dans l'espoir d'entraver l'approvisionnement de l'ennemi. Cette stratégie vise à ralentir les Français en les privant de nourriture et d'abri, tout en protégeant les territoires restants de l'Empire Ouassou. Malheureusement, cette tactique affaiblit également les troupes de Samouris qui doivent constamment se déplacer et lutter dans des conditions de plus en plus difficiles. Les ressources en armes et en munitions se raréfient également, car les Britanniques cessent de fournir des armes à Samouris à la suite de la Convention de Bruxelles de 1890, qui limite le commerce des armes en Afrique. pour tenter de freiner la traite des esclaves. Les Français, déterminés à en finir avec l'Empire Ouassoulou, augmentent la pression. Conscients de l'efficacité des embuscades de Samouri, ils adaptent leur stratégie, menant des attaques coordonnées et soutenues sur plusieurs fronts. Le colonel Archinard et d'autres officiers français concentrent leurs forces pour priver Samouri de ses derniers bastions. La capitale de son empire, Bissandougou, tombe finalement entre les mains des Français en 1892, obligeant Samouri à déplacer sa capitale pousse à l'est vers Damakala dans l'actuel Côte d'Ivoire. En 1893, Samoury décide de tenter une dernière stratégie. Il mène son peuple et ses troupes restantes vers l'est dans l'espoir de trouver refuge et de reconstituer ses forces. Il cherche à établir de nouvelles bases dans des régions moins accessibles aux Français. Cependant, cette décision de déplacement est risquée et épuisante pour ses troupes qui doivent traverser des terres hostiles et se confronter aux populations locales qui voient souvent l'arrivée des soldats de Samoury comme une invasion. L'isolement géographique, combiné aux conditions de vie de plus en plus précaires, pousse de nombreux soldats et civils à l'épuisement. L'armée de Samoury, autrefois renoutée, se retrouve réduite à une poignée de fidèles, privées de ratavitaillement, d'alliés et de munitions. Le 29 septembre 1898, alors que Samoury et ses fidèles sont installés dans un campement temporaire, un groupe de troupes françaises parvient à les encercler. Les Français mettent en place une embuscade pour neutraliser Samoury une bonne fois pour toutes. Samori, prenant conscience de l'inévitable, tente une dernière fois de s'échapper en se précipitant vers les écuries pour s'enfuir à cheval. Mais il est rapidement capturé par les soldats français. Les français, désireux de montrer leur victoire au monde, traînent Samori en captivité jusqu'au Gabon où il est exilé, loin de son empire et loin de son peuple. Samori meurt deux ans plus tard, en 1900, mais son esprit de résistance ne s'éteint pas avec lui. Sa capture marque la fin de l'Empire Ouassoulou, mais son héritage... reste gravé dans les mémoires. Aujourd'hui, le combat de Saint-Maurice nous inspire encore. Il nous rappelle que la liberté n'est pas un cadeau, elle est un droit, arraché avec courage et sacrifice. Il est la voix de tous ceux qui, dans l'ombre de l'histoire, se sont battus pour que leurs descendants puissent marcher libres. Et cette voix que son petit-fils s'est coutouré a fait résonner des décennies plus tard en tant que premier président de la Guinée indépendante, qui prononça ces mots inoubliables. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Aujourd'hui, alors que nous regardons en arrière, l'histoire de Saint-Maurice Touré nous apprend que même dans l'adversité la plus grande, même face à une puissance écrasante, un homme peut faire l'indifférence. Il peut inspirer des générations, changer le cours de l'histoire et offrir à son peuple quelque chose d'inestimable, l'espoir. Cet espoir, c'est la lumière que Saint-Maurice a allumée en défiant l'injustice. Une lumière que s'écoutourait son petit-fils, un porté, et une lumière que chacun d'entre nous peut choisir de porter à son tour. Que cette histoire soit pour nous un rappel, la liberté n'est jamais acquise. Elle se défend, elle se protège, elle se transmet. Et aujourd'hui encore, nous sommes les héritiers de ce combat. Le combat de Saint-Maurice Touré n'était pas uniquement celui de son époque, il est aussi le nôtre. Que ferons-nous pour protéger cette liberté ? Quel sacrifice sommes-nous prêts à consentir pour préserver l'héritage de nos ancêtres ? Car l'histoire de Samoury est celle de tous ceux qui refusent de plier face à l'injustice. Merci de m'avoir écouté. J'espère que l'histoire de Samoury Touré vous a inspiré autant qu'elle m'inspire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager avec vos amis. Ensemble, célébrons les étoiles noires qui illuminent notre histoire. A bientôt sur Portrait des Bêles.