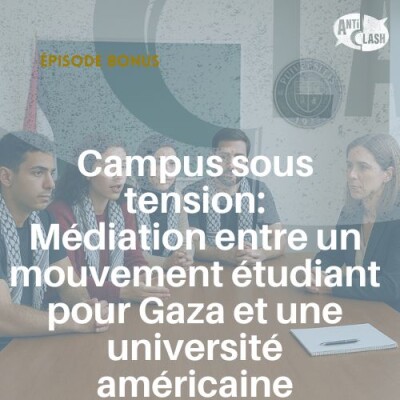- Speaker #0
Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Anti-clash. Anti-clash. Anti-clash. Hum... Je voudrais d'abord calmer ce qui nous fait plaisir. Mais arrête, quoi que tu en penses, c'est de m'ébuser. Non, non, dingue ! Non, oui, je voudrais normalement que les brosses puissent déclencher. ...
- Speaker #1
Bienvenue sur Anti-Clash, une émission qui va au fond des sujets polémiques sans tomber dans le clash. Une émission qui promeut la pratique, les pratiques du dialogue à travers ses nombreux acteurs. Je suis Raphaël Tisblat et aujourd'hui j'ai pour la deuxième fois sur Anti-Clash un seul invité, mais pas des moindres. Peter Barrett, bonjour.
- Speaker #0
Bonjour.
- Speaker #1
Alors Peter Barrett s'intéresse à la manière dont nous débattons. Alors on reviendra sur ce terme. Son premier amour du débat, il le vit en tant que compétiteur dans des concours d'étudiants et puis en tant que formateur à la Sorbonne. Depuis dix ans, il accompagne des professionnels pour les aider à améliorer leur impact à l'oral et à gérer les conversations difficiles. Après avoir formé plus de 7000 personnes à faire face aux journalistes sur les plateaux TV par exemple ou à leur boss lors des entretiens annuels, il décide de créer Debatology, avec un Y, à l'anglaise. un projet qui a pour ambition de proposer des méthodes et formats qui améliorent la qualité du débat public. Et il enseigne notamment à l'ESSEC un cours intitulé « Le débat au service des transitions » . Alors, on ne se connaît pas depuis très longtemps avec Peter Barrett, mais nous avons déjà eu des conversations assez profondes sur nos travaux respectifs. Alors, Peter promeut l'art du débat constructif. Moi, je me suis plutôt attaché aux termes de dialogue, même si évidemment, je n'en suis pas propriétaire. Mais en fait, je me sers de ce que je considère, moi, comme étant la définition du débat, que tu pourras bien sûr corriger, Peter, pour bien qualifier ce que serait le dialogue. Par exemple, j'ai tendance à penser que le débat, c'est plutôt un format compétitif, avec un gagnant et un perdant, alors que le dialogue serait plus dans la coopération avec une focalisation sur l'apprentissage des différences. Dans un débat, pour moi, on a tendance à un peu... représenter un camp, alors que dans un dialogue, on essaye de plutôt parler pour soi. Dans un débat, on est beaucoup à parler de concepts, alors que dans le dialogue, on essaye de vraiment partager des expériences qui informent aussi notre manière de voir le monde. Voilà, par exemple, dans un débat, on a l'impression que les émotions, ce n'est pas forcément ce qui est le plus bienvenu, alors que dans un dialogue, les émotions, elles sont vraiment normalisées. Voilà, et puis... Dans un débat, vu que c'est un format que je considère comme étant assez compétitif, les doutes qui peuvent être exprimés ne sont pas forcément la meilleure chose à faire, puisqu'on est dans un cadre un peu compétitif. Alors que dans un dialogue, les doutes sont tout à fait, encore une fois, normalisés. Voilà, moi, ce que j'avais comme idée au départ de ce que pouvait être un débat. Mais je sais que Peter va pouvoir peut-être corriger certaines choses, ou en tout cas, peut-être nous dire comment... tu veux réinventer ce terme à travers le concept de débat constructif. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
- Speaker #0
Merci Raphaël. Et je vais commencer par te dire, en bon débatteur constructif, que tu as raison.
- Speaker #1
Voilà, ça commence bien.
- Speaker #0
Tu as raison. C'est-à-dire que tu as raison déjà de poser ce paradigme et de poser cette question, parce que c'est évidemment une question qu'on peut légitimement se poser. Pourquoi s'attacher à ce terme de débat alors qu'on y adosse cette... ce modérateur là, constructif, ce petit modulateur après, pourquoi est-ce qu'on s'attache à ce terme ? Pourquoi pas tout simplement parler de dialogue ? Et en fait, ça part de multiples constats. Un constat très lié aux institutions. On est dans un système démocratique, en tout cas en France c'est le cas, et de manière plus générale en Occident, c'est le système qu'on promeut, pour des raisons éthiques et assez légitimes. Dans ce contexte-là, on sait que le débat public est un espèce d'outil qu'on utilise pour faire des arbitrages, pour prendre des décisions. Et cet outil-là, il est absolument nécessaire, en tout cas il semble absolument nécessaire au plan des institutions, et pas que, c'est-à-dire des institutions formalisées comme l'Assemblée nationale, comme des institutions informelles comme les médias par exemple, ou les espaces de discussion publique. Et on voit bien que l'idée du débat est présente. du contradictoire, du pluralisme, de la volonté de prendre un peu de temps d'abstraction sur les idées, mais aussi de confronter ce que moi je vais appeler des cheminements épistémiques, c'est-à-dire des parcours de vie qui nous amènent à penser certaines choses ou à croire certaines choses. Donc ça, c'est une première réalité à laquelle je pense qu'il faut se confronter quand on parle dialogue, quand on parle débat, c'est institutionnaliser. C'est un truc dont on a besoin en démocratie. Et puis, il y a une autre question qu'on pourrait se poser, c'est à quoi on aspire de ces institutions ? Qu'est-ce qu'on voudrait qu'elles soient ? Qu'est-ce qu'on voudrait qu'elles représentent ? Quel genre de valeurs est-ce qu'on veut qu'elles défendent ? Et là, pour moi, on commence à soulever le fond du problème. C'est que réellement, aujourd'hui, le débat public, il ne défend pas... par sa matière, par sa façon d'exister, il ne défend pas vraiment les grandes valeurs aspirationnelles des démocraties. On ne respecte pas trop le pluralisme, on n'accepte pas trop que l'autre puisse penser différemment que nous, on veut absolument arbitrer et décider, alors qu'on peut accepter l'ambiguïté, ou accepter qu'il y a des différents points de vue. et faire coexister ces points de vue, trouver des points de convergence et des points de divergence, les divertir.
- Speaker #1
Aujourd'hui, on a plutôt tendance à disqualifier l'adversaire.
- Speaker #0
C'est ça. Et ça, c'est le jeu, je pense, de la politique actuelle, le résultat de milliers de choses complexes, mais c'est un peu le jeu auquel on se retrouve à jouer. Et je pense que les institutions du débat démocratique, parce qu'elles ont été pensées, pour certaines, il y a plus de 200 ans, et pour d'autres, elles n'ont jamais vraiment été pensées de façon systémique. Et moi, on se retrouve un peu, aujourd'hui, vers... un blocage du débat démocratique, on n'arrive plus trop à le faire avancer, et il mérite qu'on le repense de manière un peu plus systémique. Et puis, en toile de fond, il y a aussi un autre aspect que j'aime bien évoquer, c'est le débat, ou plutôt la dialectique, comme un mode de fonctionnement des systèmes humains dans la prise de décision. Et ça, je trouve que c'est aussi une manière de penser très... C'est un peu plus intellectuel, mais une manière de penser, je trouve, très intéressante, c'est de se dire, en fait... Les humains, ils coopèrent aussi bien grâce à un système qui est, en gros, la cognition sociale. Que nos cerveaux, ils ont des effets multiplicateurs, par contre, pardon, ce que je voulais dire, c'est nos cerveaux, par notre capacité à communiquer mutuellement, ont des effets multiplicateurs de pensée. Voilà, on peut réfléchir de façon plus intelligente, c'est l'intelligence collective, parce qu'on pense à plusieurs. Et ça... c'est un résultat de l'évolution qui est incroyable. C'est un truc de fou, quoi. Les humains, à plusieurs, ils sont plus intelligents que tout seuls. C'est génial. Et faire effet de levier de ça, c'est mettre à profit toutes les compétences d'échange, de dialogue, de débat, de discussion qui existent dans le répertoire humain. Et comment tu le fais à grande échelle ? Pour moi, il faut l'institutionnaliser. Et c'est là qu'on pose un peu ces questions de débat, dans le cadre du débat démocratique ou du débat public. Donc voilà, pour moi, ça revient à ces questions-là. Donc évidemment, là-dedans, il y a des choses qui se superposent. Par exemple, est-ce qu'on parle de débat quand il s'agit de faire de la médiation entre deux personnes qui sont en instance de divorce ? Je pense que parfois, ça peut ressembler à ce qu'on va appeler du débat, parfois, ça va ressembler à du dialogue, parfois, ça va ressembler à d'autres choses. Mais fondamentalement, on aspire à... Résoudre tout ce qu'on peut résoudre, accepter les différences qui émergent, et agir en fonction de cette réalité qu'on arrive à composer ensemble, pour satisfaire le plus de besoins possibles. Et parfois ça veut dire qu'on divorce, parfois ça veut dire qu'on avance, parfois ça veut dire qu'on se réconcilie ou pas, mais je pense que c'est ce à quoi on aspire tous les deux, et qu'on l'appelle débat, dialogue ou autre chose. Je pense que ça dépend dans quelle instance on cherche à agir. Et moi, c'est le débat public que je veux influencer ou sur lequel je veux passer du temps et ce que je veux chercher à repenser aussi dans ma pratique.
- Speaker #1
Mais alors, pour quand même juste essayer de clore cette question, même si on ne peut pas la clore complètement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir les termes, c'est toujours une tâche un peu sans fin, mais comment est-ce que toi, aujourd'hui, Tchou tchou tu différencierais quand même ce débat constructif d'un autre type de conversation, par exemple le dialogue ou par exemple autre chose, ou en quoi aussi ce débat constructif se démarque des débats qu'on a tendance à voir sur les plateaux télé ou aussi dans les prétoires, effectivement. Tu parlais d'instances de divorce. Là, typiquement, c'est un système qu'on appelle adversarial. Donc, en quoi ta définition du débat diffère de ça, par exemple ?
- Speaker #0
Ouais, ouais, c'est une bonne question. Je pense que j'essaye d'utiliser tous les outils à ma disposition pour penser ces nouvelles méthodes, ou penser des formats de débats constructifs que je crée. Et donc... évidemment, je m'inspire de beaucoup de choses. Donc, dire que compartimenter, c'est compliqué pour moi parce que je trouve qu'il y a plein de méthodes dont on peut s'inspirer. Par contre, là où peut-être je mettrais des limites à l'exercice, c'est comme je me pose la question du débat public. Pour moi, il y a des enjeux de décision publique à de grandes échelles. Et comment on fait exister la pluralité ? Comment est-ce qu'on permet l'incertitude ? aussi, c'est-à-dire, c'est ok de ne pas arbitrer, c'est ok de ne pas dire qu'il y a un qui a raison, un qui a tort, c'est ok de juste chercher à déterminer les points de convergence, les points de divergence, et pour ça je mêle beaucoup des outils d'intelligence collective, en gros j'essaie de repenser le débat comme un espace dans lequel on est confronté, nous, 2, 3, 4, 10, 50, on est confronté à un problème, et comment on le résout ? Et ce problème, c'est peut-être nous, c'est-à-dire le problème qu'on veut résoudre, c'est peut-être... les points de divergence et de convergence qu'on a. C'est peut-être ça. C'est un peu un méta-problème. C'est le problème de notre capacité à coopérer pour faire face au problème. C'est un peu ça que je proposais de résoudre. Et si je te donne un exemple concret de ça, c'est le débat entre deux tours des présidentielles. C'est un format classique qu'on connaît bien maintenant qui est ancré dans nos institutions. C'est un 1 versus 1, à peine modéré, si j'ose le dire, où on cherche... par les petites phrases successives à déterminer en gros, quelle sera la personne la plus habile au plan rhétorique pour, à un moment donné, prouver l'inocuité de son adversaire et s'instaurer, s'imposer vainqueur par sa compétence rhétorique. En fait, c'est ça qu'on regarde. Oui, bien sûr. Et moi, je pose la question.
- Speaker #1
On se demande typiquement, voilà, qui a gagné le débat ce soir ?
- Speaker #0
Et la question que je pose, c'est est-ce que ce sont ces compétences-là qu'on veut voir miroiter chez nos leaders politiques ? Je ne pense pas que ce soit une compétence absurde à vouloir chez des leaders politiques. Mais je pense que ce ne sont pas les compétences qu'on veut privilégier dans des leaders politiques en démocratie.
- Speaker #1
Oui, on veut savoir si, par exemple, ce sera un bon diplomate,
- Speaker #0
ce qu'il représente.
- Speaker #1
Ce ne sont pas les mêmes compétences oratoires.
- Speaker #0
Exact. Du coup, je me dis, quel est un format qui peut faire valoir ça ? Et c'est pour ça que j'ai créé par exemple un format 1v1, qui respecte un peu cette idée originelle, mais qui, par sept étapes successives, nous amène non pas à faire valoir la petite phrase qui a gagné, mais plutôt à faire valoir notre capacité à converger, être constructif, à exprimer avec humilité notre propos, à reconnaître nos défauts, etc. Et par ces mécanismes-là, du coup, modifier un petit peu les... Ouais, j'ai toujours du mal à retrouver ce terme en français, incentive.
- Speaker #1
Les motivations.
- Speaker #0
Ouais, ce qui pousse les personnes à avoir certains comportements. Et donc, moi, c'est ça que surtout que je cherchais à influencer. Donc ouais, clairement, c'est pas évident non plus, parce que l'espace médiatique, je pense, a justement pas, est pas motivé par des raisons qui sont... nécessairement alignés avec les objectifs démocratiques.
- Speaker #1
Oui, et d'intelligence collective, au contraire. C'est très compétitif.
- Speaker #0
Exactement. Donc, pour moi, ça implique plein de choses que cette modification, ce changement impliquerait. Mais, à minima, ce que je remarque, pour avoir fait l'expérience, quand même, de pas mal, l'organisation de pas mal de ce genre de débat, c'est que les personnes en sortent assez satisfaites. C'est-à-dire qu'à la fois les protagonistes qui, à la base, se détestaient, ne pouvaient pas se voir, là, commencent un peu plus à comprendre la position de l'autre plus finement. et se rendre compte qu'au final, il y a pas mal de choses sur lesquelles ils convergent, et sur les points de divergence, en fait, c'est des points de divergence légitimes, c'est des éléments d'arbitrage qui sont tout à fait légitimes, et c'est ok d'avoir ce pluralisme, en fait. Et surtout, le public qui regarde ça, il se dit « Ah, ben, je serai un peu plus intelligent, et je comprends mieux les enjeux. » Et c'est moins dichotomique, c'est pas une évidence. Ben, accepter l'incertitude, on le sait, en plus, que ça permet non seulement d'améliorer sa santé mentale, mais aussi... D'accepter un peu plus les idées différentes, les personnes différentes.
- Speaker #1
Donc en gros, là je vois une convergence quand même avec ce que moi je conçois par rapport au dialogue, c'est effectivement de comprendre là où on est d'accord, là où on n'est pas d'accord, de comprendre aussi d'où vient le fait qu'on peut ne pas être d'accord sur tel ou tel point, et qu'on en ressorte, les participants et éventuellement le public qui assiste, enrichis par cette connaissance-là. Donc dans les débats que tu organises, juste pour entrer un tout petit peu dans les détails, donc il n'y a pas nécessairement de gagnant ou de perdant, ou alors en tout cas... disons que l'enjeu n'est pas forcément d'avoir raison sur l'autre mais c'est un peu plus complexe que ça, on essaye aussi, l'enjeu c'est aussi d'être capable de comprendre le point de vue de l'autre ou d'être capable de oui même de bien le représenter je crois tu décris pas mal de ces choses là sur ton site je donne le site phsbarret.com il y a pas mal de d'éléments comme ça que tu décris pour... Est-ce que tu veux un peu résumer, par exemple, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les règles que tu invites les participants à adopter ?
- Speaker #0
Oui, avec plaisir. Oui, en gros, il y a un mécanisme que je teste et je mets l'accent sur le fait que je le teste parce que je ne suis pas encore 100% convaincu aujourd'hui de son efficacité. Mais un des mécanismes que je teste, c'est justement me dire, bon, comme on ne peut pas totalement enlever... la dynamique compétitive dans un cadre de débat public, parce que la compétition des idées, elle est inhérente à l'existence de ce débat, en fait. Quelque part, c'est même assez sain, parce que la compétition des idées, ça permet à des moments donnés de faire émerger des arbitrages, de dire « Ah ben, on préfère celle-là à une autre. » Donc, moi, je ne suis pas anti-compétition. Je me dis juste « Comment... » on pousse la coopération à son maximum d'efficacité. Et à l'intérieur de cette considération-là, il y a des éléments de compétition. La compétition est partiellement nécessaire à une coopération maximisée. Et donc, je me dis, OK, comment j'optimise ça ? Je me suis dit, comme tu dis, de toute manière, on va se poser la question de qui a gagné. Autant qu'on se la pose bien. Donc moi, ce que je propose au débat...
- Speaker #1
Tu changes les critères.
- Speaker #0
C'est ça, c'est changer les critères. Donc, j'utilise plusieurs outils, on va dire, des sciences cognitives. pour le faire. Donc en toile de fond, j'essaie de fonder sur la recherche les décisions que je prends dans les formats, mais l'idée est assez simple fondamentalement. Une fois qu'on la présente au public et aux débatteurs et aux débattrices, c'est de dire nous ce qu'on va regarder pendant tout le long du débat, c'est votre capacité à être constructif. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On veut dire par là que tout ce qui est attaque personnelle, ad hominem, ad personam, les grands classiques de la rhétorique d'attaque personnelle, on évite, voilà, déshonneur par proximité, voilà on évite. Tout ce qui, donc ça c'est assez facile en général, se couper, etc en vrai, à partir du moment où tu mets un cadre de temps, où chacun a un temps de s'exprimer déjà, tu fais péter ce problème là assez rapidement, c'est assez facile de...
- Speaker #1
Déjà il y a une structure, le temps de parole etc, où chacun s'entoure Exact,
- Speaker #0
donc déjà ce problème là franchement il disparaît assez vite, à partir du moment où tu mets un peu de structure, un peu de cadre tu sais faciliter un débat en vrai c'est pas très compliqué d'empêcher ces comportements. Là où c'est plus difficile, c'est comment tu fais pour interpréter généreusement ce que dit l'autre. Ou est-ce que tu vas être capable de bien représenter les idées de l'autre ?
- Speaker #1
À un moment du débat, un des stades de format que tu utilises, c'est que chacun des débatteurs doit faire cet exercice de reformuler en quelque sorte ce que son adversaire a dit.
- Speaker #0
Ouais, c'est ce qu'on appelle l'homme de fer. Alors, c'est un peu une... C'est quelque chose de connu dans le petit monde, on va dire, rhétorique, débat constructif, tout ça. C'est l'idée de représenter la manière la plus convaincante de notre point de vue, de ce que nous dit l'autre. Donc, par exemple, si moi, j'ai face à moi quelqu'un qui dit des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, donc par exemple, je vais prendre une idée facile, mais par exemple, quelqu'un qui me dit on devrait fermer les frontières et interdire toute immigration. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, par exemple. Ok, ben, c'est quoi la version la plus convaincante que je trouve de cette idée-là ? Donc, ce n'est pas les arguments les plus convaincants dans ce que tu me dis, c'est quelle est la version que moi, je trouve la plus convaincante de cette idée. Donc, ce serait, par exemple, si le fait que... Intégrer de nouvelles personnes dans une communauté, dans un contexte culturel, en vrai c'est difficile. C'est pas évident de faire fonctionner une société multiculturelle, c'est pas facile. De faire en sorte que les personnes aient un boulot, un toit, contribuent à la société efficacement, c'est pas évident non plus. S'assurer que ça, ça n'a pas des effets de bord négatifs sur les personnes qui sont déjà présentes dans ce territoire, c'est pas évident non plus en fait. Et parfois, il y a carrément des effets négatifs qui peuvent être observés dans certains pays. Donc tu vois, quelque part, j'essaie de trouver tout ce qu'il y a de bon, de vrai, de juste dans la perspective de l'autre. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec sa conclusion ? Non. Mais... je lui montre que je suis capable de comprendre pourquoi il en arrive là où il en arrive. Et mon but, c'est que lui, il se dise « Franchement, je n'aurais pas mieux dit. » Mon but, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin, et je repasse...
- Speaker #1
C'est de montrer que tu écoutes bien, en fait, aussi, la perspective de l'autre, c'est déjà...
- Speaker #0
C'est une forme de travail d'écoute active derrière. Je pense que ça va un peu plus loin que ça, parce que c'est démontrer de l'empathie cognitive. C'est pas... Après, on pourrait dire, oui, dans l'écoute active, il y a une dimension empathique aussi. Donc, voilà, ça dépend comment on définit l'écoute. Mais, ouais, clairement, c'est ce qu'on essaie de prouver à l'autre. Et donc, moi, en tant que modérateur, j'observe ça, je les aide. Donc, j'aide les personnes à avoir cette capacité de reformulation. Je les invite à reformuler quand ça n'a pas bien fonctionné. Et en gros, tout ce qu'ils ont à faire, c'est faire preuve de bonne foi et d'essayer. Et ensuite, le public, lui, il les note, entre guillemets. Donc, il leur donne des scores, etc. C'est là où je mets un peu d'eau dans mon vin, parce que jusqu'à maintenant, j'ai des effets mixtes sur ce mécanisme. A la fois, le public est engagé, il participe, il a une écoute qui est orientée. Donc, il pense plus en termes de qui a été le plus constructif et pas qui a eu le plus raison. Donc, de ce point de vue-là, j'ai l'impression que ça a des effets positifs. Mais je vois aussi des effets négatifs. Par exemple, quand il y a des différences de score, ce que j'observe, c'est que la personne qui a le... moins bon score, a tendance à rationaliser son moins bon score, donc à dire oui, mais de toute façon, moi je m'en fiche, c'est comme ça. Donc quelque part, à se désolidariser du processus. Donc moi, c'est mon job après de le réintégrer dedans, de lui dire, ça ne te conviendrait pas de rester plus constructif ? Est-ce que pour toi, tu ne vois pas l'intérêt du coup ? Est-ce que tu continues d'en voir l'intérêt ? Merci. Et en plein milieu du débat, faire ça, c'est compliqué parce que c'est un recadrage quand même important. Ça prend du temps. Donc ça, c'est un peu d'eau dans mon vin. Et un deuxième élément qui est ressorti, c'est que du coup, l'autre qui a un meilleur score, il peut s'en targuer. Oui, c'est ça. Il peut dire, mais regarde, j'ai été plus constructif que l'autre.
- Speaker #1
Un complexe de supériorité.
- Speaker #0
Et je l'ai vécu là, très récemment, avec un des intervenants, un des débats constructifs que j'ai organisé récemment, qui fait un live sur Twitch. et qui dit « Ouais, quand même, moi j'étais vachement constructif, l'autre n'était pas, mais c'est bien la preuve, quelque part, que j'avais raison. » Et là, on quitte toute l'ambition que j'avais, c'est qu'on réutilise le score comme proxy pour montrer qu'on avait raison. Alors que non, ce n'est pas ce que ce score montre, quand bien même il montrerait quelque chose, déjà. Ce n'est même pas ce qui montre.
- Speaker #1
Mais ça, c'est des dynamiques qu'on peut observer dans d'autres contextes. Je pense que ça me fait penser un petit peu à la communication non-violente aussi. On sait qu'un des effets pervers possibles, quand on est très calé en communication non-violente, ou on commence en tout cas à être calé, c'est de se dire, moi j'utilise toutes les compétences, tous les outils de la communication non-violente, mais mon adversaire, lui, il n'a pas utilisé. Et donc, il y a quelque chose de presque contradictoire dans cette prise un peu de position un petit peu supérieure dans la manière... le maniement des outils, qui vient contredire l'objectif même de la communication non-violente, qui est de coopérer et d'essayer de désescalader même quand l'adversaire est un peu difficile.
- Speaker #0
Mais je pense que dès qu'on s'attaque à un problème systémique, on se confronte à ce genre de problème. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des mécanismes, des outils, et ils peuvent être utilisés d'une façon qui est cohérente avec l'esprit de la loi, l'esprit de ce qu'on essaie de faire advenir. Et puis, elles peuvent être aussi utilisées contre cet esprit-là. Et je pense que c'est la réalité de n'importe quel problème qu'on essaie de régler par de l'outillage, par des mécanismes qu'on met en place. On peut toujours trouver des effets pervers, on peut toujours mal les utiliser. Mais moi, j'essaye d'être très vigilant là-dessus pour me dire comment je peux fabriquer des outils qui orientent le plus possible vers certains usages. Mon couteau avec le plus de bourron possible pour que tu puisses que l'utiliser pour couper tes carottes. Et comme ça, après, le reste, il va bien falloir qu'on fasse un travail de fond collectif sur pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on cherche à faire. Et ça, c'est tout le travail que je fais en amont avec les intervenants. Je ne me rendais pas compte de ça au début quand j'ai mis ça en place. C'est tout ce travail de persuasion à faire avec les intervenants. sur l'état d'esprit avec lequel ils vont venir à la discussion. Et je vois la différence. entre ceux que j'ai bien réussi à préparer et ceux que j'ai mal réussi à préparer.
- Speaker #1
On va revenir là-dessus, parce que c'est un des challenges auxquels moi aussi je suis très confronté, sur comment convaincre de venir à la table de discussion. Ce n'est vraiment pas évident, surtout ces temps-ci. Est-ce que je peux te demander d'abord une question un peu plus personnelle ? Comment est-ce que toi, tu es venu à ce travail-là ? Comment est-ce que tu t'es un peu donné cette mission de promouvoir et de mettre en œuvre le plus possible cette activité du débat constructif ? Comment tu es venu à ça ?
- Speaker #0
C'est une bonne question. Récemment, je commence à accepter un petit peu plus, je pense, la vraie genèse de cette histoire. Il y a une histoire construite, il y a une histoire peut-être plus vraie, plus sincère. L'histoire construite, c'est l'histoire récente. J'ai été débatteur. J'ai passé quasiment dix ans de ma vie à faire des concours de débat, des concours de plaidoirie, des concours d'éloquence, à gagner tous ces concours. Enfin, gagner tous ces concours, j'ai quand même le plaire du pain, mais on gagnait pas mal. Et surtout, à former des élèves à ça, à être super persuasif, à bien construire des discours, à utiliser les bons arguments. Je sais faire ça. Et à la fin, le bilan, et c'était un bilan qui m'a fait beaucoup de mal au cœur, c'est de dire... Est-ce que j'ai avec moi des élèves qui sont plus capables de coopérer ensemble, de co-construire des projets en commun, de régler des situations conflictuelles ? Je ne sais pas. Et surtout, je me disais, moi avec mes élèves que j'ai en direct, j'arrive assez bien à le faire. Mais c'est marrant parce que... On fait à peu près la même chose avec d'autres collègues, et on fait les mêmes concours, et leurs élèves, ils sont très très bons, mais ils sont pas du tout dans le même état d'esprit que les miens. Je me dis, qu'est-ce que je fais de différent avec les miens, parfois, certaines années en tout cas. Et en fait, je me suis rendu compte, en leur posant la question, que c'est ma façon d'être, où j'accepte pas qu'on se moque de quelqu'un en classe. J'accepte pas qu'on discute pas des sujets qui fâchent. J'accepte pas qu'à un moment donné, quelqu'un puisse juste imposer une idée politique et empêcher les autres d'exprimer leur point de vue. J'accepte pas tout ça, en fait. Et le fait que je sois radicalement opposé à tout ce qui nous empêche de vivre ensemble, dans la complexité et la diversité, eh ben, ça fait que mes élèves, ils sont très attachés au processus d'apprentissage qu'on avait, qu'au final, ils étaient heureux d'être des personnes assez différentes de d'autres élèves qu'ils rencontraient dans les tournois de débat qui étaient fixés sur la gagne, pour la gagne. Et je me suis dit, ok, donc en fait, le vrai truc différent que j'inspire, ce n'est pas du tout la rhétorique, la structure persuasive, les discours, ce n'est rien de tout ça en fait. Et donc ça m'a vraiment remis en question sur ma pratique et ce à quoi j'aspire. Donc ça, c'est la... On va dire la genèse un peu construite. Je pense que la vraie, vraie, vraie raison, c'est que j'ai trop, trop vu mes parents se détruire mutuellement par leur incapacité à gérer les conflits entre eux. Mon père, par son incapacité à parler de sujets difficiles, par peur. ce qui pourrait venir par peur de représailles, par des peurs légitimes aussi, par moi, et ma mère, par toutes les stratégies de manipulation possibles et imaginables pour éviter de parler du sujet, pour ne pas l'adresser en front de moi.
- Speaker #1
Ils n'étaient pas dans la confrontation, ils étaient plutôt dans l'évitement.
- Speaker #0
Ah mais, tout sauf, enfin, la confrontation, si, mais tout sauf régler, tu vois, gérer le problème. C'était accusation, manipulation, Non-confrontation, je passe par derrière, je te dis pas, je manipule les enfants, le truc. Et alors là, ça a l'air horrible quand je dis ça. Ce qui était le plus génial dans tout ça, c'était que, par ailleurs, j'ai une enfance géniale. C'est-à-dire que mes parents, ils ont été géniaux sur dix mille trucs. Mais sur ce truc-là, ils étaient vraiment pas bons. Et ça a un peu pourri le reste. C'est trop dommage. de ce nid mais En vrai, je pense que ma passion pour le débat et le conflit, il vient plus de là que d'ailleurs. Je pense comme beaucoup, on est motivé par ce qui nous arrive dans l'enfance. Par contre, je tiens à le garder en tête pour moi, pour ne pas dériver non plus, pour ne pas que... Du coup, ça devient une espèce de besoin viscéral que tout le monde s'entende. Non, c'est OK. On a le droit de ne pas être d'accord. C'est pas un problème. Ça, c'est un truc que moi, je dois déconstruire beaucoup. Parce que sinon, je me retrouve à imposer mes biais aux autres et ce n'est pas l'objectif. Mais je pense qu'il y a de ça aussi dans mon parcours.
- Speaker #1
D'accord. Merci, merci d'avoir partagé ça. Je peux me relier à certaines choses, notamment les parents. Effectivement, les parents n'étaient pas tellement dans l'évitement. Ils s'engueulaient très franchement assez souvent. Et ce n'était pas gravissime. Mais je pense que ça m'a... pas mal motivé aussi à m'intéresser au conflit, à la dynamique du conflit et à essayer effectivement de trouver des manières d'aborder des sujets de manière un peu plus sereine au moins. Mais merci, merci de ta réponse. Alors, pour revenir un peu sur faire le lien avec la société, bon, voilà, tu y as un tout petit peu touché, mais en rentrant un peu plus dans le sujet, un des problèmes qu'on a, c'est la polarisation du débat qui, pour moi, en un sens, a... a toujours existé, mais qui est devenue, on a l'impression, en tout cas, d'autant plus dangereuse qu'elle s'aggrave en intensité, on a l'impression que c'est exponentiel, l'escalade à laquelle on assiste tous les jours, sur les médias, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, d'autant plus dangereuse qu'on a l'impression aussi, justement grâce aux réseaux sociaux, elle a le pouvoir de toucher toute la société. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce qui se passe au niveau du débat public et de la polarisation, et comment est-ce que tu penses que... la pratique du débat pourrait y remédier ?
- Speaker #0
Très bonne question.
- Speaker #1
Et d'ailleurs, si tu veux donner peut-être ta définition en ce qui est de la polarisation, en passant, même s'il est encore...
- Speaker #0
Tranquille. Non, non, mais tu as raison. Moi, j'avoue, je m'attache assez peu aux définitions de manière générale parce que je trouve que c'est l'objet des discussions. Souvent, la définition, c'est en fait ce qu'on discute. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Après, on a des... définition de travail, entre guillemets, voilà, on les utilise pour penser les idées. La polarisation, c'est clairement un outil de travail, enfin, c'est une définition, un mot qu'on utilise quand on essaie de penser ces sujets-là, parce que, tout simplement, dans la littérature académique, on a ce terme, polarisation idéologique, donc c'est à quel point les idées sont éloignées les unes des autres, donc à quel point je suis en désaccord formel avec tes idées, à toi, ou toi avec les miennes, et la polarisation affective, c'est-à-dire... à quel point je te déteste pour ce que tu penses, à quel point tu me détestes pour ce que je pense.
- Speaker #1
Et puis encore une fois, cette dynamique de la tendance des gens à disqualifier pour telle raison ou telle autre son interlocuteur, qui n'aurait même plus droit à la parole, quelque part.
- Speaker #0
C'est ça, tout à fait. Donc dans la polarisation affective, c'est un peu ce qu'on observe, c'est la déshumanisation de la personne qui pense ce qu'elle pense, parce qu'en fait, elle est juste... C'est un monstre, quoi. Et sur la polarisation idéologique, c'est plutôt, on est tellement éloigné sur notamment les intérêts qui motivent nos positions. Donc ça, c'est un peu, par exemple, le parti pris d'une vision de la lutte des classes, par exemple. C'est une vision qui est polarisante par essence, par sa construction, parce qu'elle imagine qu'il y a des intérêts propres aux classes et que ces intérêts propres dictent les postures idéologiques. Et donc... on est forcément polarisé.
- Speaker #1
Ou de l'autre côté, le revers de la médaille, ça serait peut-être le clash des civilisations, par exemple. Oui,
- Speaker #0
oui.
- Speaker #1
Parce que ça me fait penser à ça, pas le revers de la médaille, mais l'opposé, on va dire. Parce qu'il y a souvent aussi ce clash entre ceux qui considèrent que le monde doit être lu, effectivement, selon des critères sociaux, etc., contre d'autres qui considèrent que, non, c'est une question identitaire, en quelque sorte.
- Speaker #0
Non, t'as raison, excuse-moi, tu m'amènes une nouvelle idée, j'avais pas pensé comme ça, mais oui, je pense que ça me plaît bien ce que tu dis là. En effet, on pourrait tout à fait penser d'autres verticales, d'autres façons de polariser les idéologies, tu as raison. Et donc on a cette façon, on va dire, un peu formelle aujourd'hui dans la littérature scientifique de parler de polarisation. Le problème quand on en parle comme ça, c'est que souvent, on a l'impression qu'on en parle comme d'une cause alors que c'est une conséquence. Tu vois ? J'en ai un peu l'impression qu'on parle de réduire la polarisation, et donc on agirait dessus, mais non, en fait c'est...
- Speaker #1
C'est un petit peu comme jusqu'à il y a peu de temps, c'est un peu en train de changer, mais toute cette focalisation que les institutions ont eue sur la radicalisation. Tout à fait. Là aussi, on avait l'impression de confondre un peu un symptôme avec le problème.
- Speaker #0
Exactement, je pense que c'est un très très bon parallèle que tu connais bien, il me semble. Mais on a beaucoup de travailleurs sociaux qui m'ont témoigné de sujets de ce type-là, sur le travail en prison par exemple, où en fait on prend le problème à l'envers. On ne regarde pas les conditions sociales et personnelles des individus, les cadres sociaux dans lesquels ils vivent, dans lesquels ils évoluent, et à la place, on dit juste l'islamisme. Ben non, en fait, il y a des conséquences, il y a des causes à ces conséquences. conséquences, ça ne veut pas dédonner pour autant dire qu'on dédonne les individus de leurs responsabilités et tout ça mais c'est intéressant de penser en système parce que ça nous aide à réduire les conséquences qu'on veut réduire moi je veux moins de gens qui posent des bombes, je veux moins On est tous d'accord avec ça. Donc, on s'attaque au même problème. Et du coup, le vrai enjeu qui se cache derrière la polarisation, c'est quoi ? Pour moi, c'est fondamentalement notre relation à l'incertitude. Explique ça un petit peu,
- Speaker #1
la relation à l'incertitude. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
- Speaker #0
Et ça, c'est humain. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc très ancré dans une époque, etc. C'est juste humain. On est dans un contexte mondial, socio-économique. avec beaucoup d'incertitudes, pour des milliers de raisons différentes, mais si je dois les symboliser de quelque manière, c'est quoi ? Changement climatique, donc incertitude importante sur l'avenir, mondialisation, démondialisation, voilà, dans quel sens est-ce qu'on va aller, est-ce que on est capable d'envisager une forme de stabilité économique, sociale et tout pour l'avenir, ou pas ? Donc c'est ça l'incertitude, C'est... je nais dans les années 50-60, il y a plein de risques qui existent dans le monde, mais il y a une forme de stabilité dans ces risques. On les reconnaît, ils sont visibles, on arrive à les mesurer, ils font partie de notre vision de la société, ils sont assez uniformément compris.
- Speaker #1
La démocratie elle-même aussi est sujette à incertitudes, c'est-à-dire que de plus en plus on se dit, nos institutions, elles sont fragiles, on voit ce qui se passe avec Etats-Unis notamment, on a l'impression que les contre-pouvoirs, les fameux contre-pouvoirs qui faisaient la stabilité de nos institutions, ils ne sont pas si stables ou solides que ça. Donc l'incertitude, elle est là aussi.
- Speaker #0
Oui, totalement. Elle est à tellement d'endroits différents. Et cette incertitude, c'est normal qu'elle génère, en tout cas, une fois qu'elle est présente dans notre esprit, qu'elle existe dans notre quotidien. Je pense que ça, ça fait partie aussi du problème. C'est qu'on vit dans un monde informationnel qui met beaucoup en lumière ces éléments d'incertitude, et donc ça les rend très saillants. Notre cerveau a évolué pour accorder beaucoup d'attention à l'incertitude, précisément parce qu'elle génère des risques importants à notre survie, et on a un bien de négativité qui nous aide à mieux survivre. Donc on voit ces choses-là de façon très saillante, ça prend beaucoup d'espace dans notre esprit, ça génère énormément des réactions émotionnelles fortes, Et... Et cette incertitude-là, du coup, elle nous amène à avoir une réaction instinctive qui est plutôt tribale. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'incertitudes dans le monde extérieur. Comment je recrée de l'incertitude dans un monde qui m'est plus proche ? Donc, ça, c'est…
- Speaker #1
Comment je recrée des certitudes dans un monde…
- Speaker #0
Oui, de la certitude, par exemple. D'accord. Oui, tu as raison. Comment je génère de la certitude là où il y a de l'incertitude dehors ? Et donc, le repli sur soi... communautaire, familial, individualiste aussi.
- Speaker #1
Mais c'est ça, on ne peut plus compter que sur nous-mêmes si nos institutions ou nous, disons, les mécanismes stabilisateurs font défaut, quoi.
- Speaker #0
Ouais, c'est ça. Et en plus de ce repli, il y a une espèce de compétition qui s'organise, parce que s'il y a beaucoup d'incertitudes, du coup, compétition pour les ressources, compétition pour générer de la certitude dans notre avenir, et donc, voilà, un tribalisme politique se l'organise assez naturellement.
- Speaker #1
Qui essaye de capter l'attention aussi, on parle de l'économie de l'attention, c'est ça aussi qu'on essaye de gagner quand on essaye de compter sur soi-même.
- Speaker #0
Ouais, ouais, c'est intéressant. Moi, je le vois plus comme une cause qu'une conséquence, c'est-à-dire, pour moi, ce qu'on a créé dans l'économie de l'attention, c'est-à-dire quand on crée des réseaux sociaux, des systèmes médiatiques, des systèmes de diffusion de l'information qui se qui font fondent leur... tout le système sur la capacité à capturer ton attention pendant un temps donné pour te vendre des trucs, pour vendre du ads, faire du marketing. C'est ce système-là qui... Par A-B test algorithmique, on se rend compte que notre aversion au risque et notre bien-négativité dictent énormément ce qui va attirer notre attention. Et donc, on va faire passer des messages négatifs, on va faire passer des messages polarisants, etc. Parce que c'est ce qui marche. Pas parce qu'on est méchant et qu'on a envie de faire du mal aux gens, mais juste parce que c'est ça qui génère de l'attention. parce qu'évolutionnairement c'est ce que l'humain a eu besoin de ce sur quoi il a eu à prêter attention pour survivre et aujourd'hui moi l'une des questions que je pose plus systémique c'est comment on repense le paysage informationnel pour qu'il soit un peu plus adapté au pauvre humain que nous sommes qui a évolué avec ces biais là et qui du coup si on cherche à les exploiter ... on viendrait à découvrir plein d'effets de bord qui sont notamment la polarisation et les conséquences de cette polarisation qui est du coup notre incapacité à faire société, à coopérer à des échelles importantes, donc plus de guerres, etc. Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire que ça arrive, évidemment, il y a plein d'autres causes, ce n'est pas la seule cause, mais je pense que le paysage informationnel et son mode de fonctionnement actuel, notamment les médias sociaux, je pense que contribuent. à l'accélération de cette polarisation.
- Speaker #1
Mais alors, et donc, les débats et les débats constructifs, comment est-ce que tu expliques, comment est-ce que tu penses que ces débats, si on essaye de vraiment généraliser un peu plus la pratique de ces débats constructifs, comment est-ce que ça peut réduire cette polarisation ? Est-ce que ça réduit l'incertitude ?
- Speaker #0
De quelle manière ? Oui, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a des dimensions d'incertitude qu'on ne peut pas réduire. Donc, le fait que le changement climatique existe, On peut agir dessus, mais on ne peut pas enlever l'incertitude quant au fait qu'il advienne ou comment il adviendra, etc. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est reprendre ce qu'on va appeler en psychologie l'ocus de contrôle, c'est reprendre une capacité d'action, reprendre du pouvoir vers l'action, ce qui fait qu'on se sent un petit peu mieux malgré l'incertitude. Donc c'est ce qu'on va appeler dans les travaux sur le... Au global, si on veut dépasser des problèmes psychologiques liés à la gestion d'incertitudes, ce qu'on va essayer de travailler, c'est créer des espaces de certitude, c'est une chose, et derrière, mieux gérer les incertitudes. Donc comment je fais ça ?
- Speaker #1
Plus résilient, pour utiliser un mot à la mode, à passer à l'incertitude.
- Speaker #0
Donc c'est en étant dans l'action, en faisant des choses. Donc c'est ce qu'on voit par exemple avec les quelques études récentes sur le journalisme de solution, etc. C'est typiquement quand on... Quand on modifie le paysage informationnel pour amener les gens à réfléchir de manière systémique, prendre du recul sur la situation, voir quels sont à la fois les types d'actions qu'ils peuvent mener et les types d'actions qui sont menées pour combattre le changement climatique notamment, pour revenir toujours à ce sujet, ça permet aux personnes de se sentir un petit peu mieux. Donc déjà, d'un point de vue santé mentale, c'est pas mal, mais ça, ça a comme effet de bord aussi de... du coup d'être un peu moins polarisé, parce que tu ne te dis pas que c'est la vie ou la mort, et il faut qu'absolument l'autre, il arrête de penser comme il pense, sinon on va tous crever, mais tu te dis un petit peu plus, ah, en fait, on peut contribuer ensemble, plus calmement, à un problème qu'on veut résoudre, parce qu'il y a moins de stress lié au fait que le problème ne sera pas résolu, qu'on ne trouvera pas de solution. Donc le débat constructif, pour moi, il sert ces objectifs-là. Donc c'est... permettre aux personnes de se sentir un peu plus, comme tu dis, résilient face à la réalité du monde telle qu'elle est, pas en faisant semblant qu'elle n'existe pas, mais plutôt vraiment en y faisant face d'une autre manière, avec une autre perspective. Alors on va m'accuser après de technosolutionniste ou de coquesse, mais pour moi ce n'est pas forcément qu'il y a une réponse unique ou évidente, c'est plutôt que nous en tant qu'humains, qu'est-ce qui va nous permettre de trouver les réponses ? C'est ça la question que je me pose. C'est pas quelle est la réponse, c'est comment on permet aux humains de trouver les réponses. Comme avec l'intelligence collective, on sait qu'il y a des conditions à remplir pour permettre l'intelligence collective de fonctionner mieux. C'est juste ça que moi je veux créer, c'est tout. Mais à une échelle, à grande échelle. Donc comment tu fais ça ? Pour moi, il faut des leaders politiques qui se prêtent à ce jeu. Des leaders de pensée, pas forcément que politiques d'ailleurs, qui se prêtent à ce jeu. Et en se prêtant à ce jeu, ils signalent. à leurs followers, aux personnes qui y suivent au plan idéologique, que c'est possible de jouer à ce jeu comme ça, qu'on peut être constructif, qu'on peut comprendre les autres, que ça ne nous empêche pas de penser ce qu'on pense, ça ne nous empêche pas d'avancer, etc. Et que, ce faisant, on peut un peu plus refaire société avec des divergences, et que c'est ok de laisser exister ces divergences, et que, non, l'autre ne pense pas comme nous, ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin du monde et que c'est la pire espèce, que c'est intolérable, que c'est une menace pour moi. Alors là, on va tout de suite me dire oui, mais Peter, du coup, tu valorises là, enfin, tu laisses un espace à l'intolérance. C'est le paradoxe de la tolérance. Tu laisses un espace à la peur.
- Speaker #1
Tu peux contolérer l'intolérance.
- Speaker #0
Moi, ce que je dis, c'est moi, je pense qu'il y a un paradoxe de la paradoxe de la tolérance. C'est-à-dire que le paradoxe de la tolérance, mon classique, c'est celui que tu décris. Si je tolère l'intolérant, du coup, j'accepte quelque chose d'inacceptable à l'avenir. Parce que pour moi, il y a un paradoxe dans ce paradoxe. C'est en disant que je ne veux pas accepter l'intolérance de l'autre, je deviens intolérant de ce qui peut l'amener à son intolérance, et donc j'empêche à ses vrais problèmes. qui l'amène à penser de manière intolérante, d'être réglé, d'être adressé. Du coup, je ne règle jamais le problème, en fait. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est de dire, s'intéresser à pourquoi les gens sont amenés à être intolérants, ce n'est pas accepter l'intolérance. Et donc, c'est juste là-dessus, c'est dans ce paradigme-là que j'essaie de me poser. C'est, on va regarder pourquoi. Et d'ailleurs, beaucoup de penseurs de gauche ou très à gauche sont sur ces questionnements-là, mais ils pensent avoir déjà les réponses. Ils pensent que, ah oui, mais c'est juste qu'ils ne savent pas voter comme il faut.
- Speaker #1
Oui, il y a un petit peu un regain de manque de confiance vis-à-vis des citoyens qui serait de moins en moins éclairé, apparemment.
- Speaker #0
Moi, j'adore l'élitisme des gens de gauche qui se... qui se prétendent défenseurs du prolétariat ou des ouvriers. Je suis mais complètement abachourdi par un satellite. Peut-être qu'au lieu de les infantiliser, on pourrait aller regarder sincèrement leur vécu et leur ressenti et essayer de comprendre la complexité de leurs pensées qui les amènent certes à un moment donné à arbitrer dans un certain sens. Donc là par exemple, un vote à l'extrême droite par exemple. Mais en réalité, c'est pas ça qui compte tant qu'on est capable d'adresser le fond de leur pensée. Et je pense que les populistes de droite sont très forts pour faire ça, bien mieux que tous les autres. Et l'un des grands risques qu'on prend aujourd'hui, c'est qu'à force de ne se cacher les oreilles et les yeux, ne pas vouloir se confronter aux sous-jacents des idées intolérantes qui existent dans notre société, qu'on se retrouve... à leur donner de plus en plus de place, parce que tout d'un coup, la seule solution qui semble possible pour ces personnes, c'est l'intolérance. Précisément parce que c'est le seul espace d'expression dans lequel ils sont acceptés. Et donc, bah oui, pourquoi c'est là qu'on m'accepte ? Bah j'y vais. J'ai besoin d'un groupe, j'ai besoin d'identité, j'ai besoin de faire partie de quelque chose. Si c'est là qu'on m'accepte, j'irai là. Et ça, on les connaît, ces mécanismes psychologiques-là, je veux dire, ils sont suffisamment bien étudiés.
- Speaker #1
C'est un grégaire qui pousse à ça,
- Speaker #0
oui. Pour moi, la meilleure manière de contrevenir à ces extrémismes, à ces radicalités qui nous poussent au conflit armé, à la destruction mutuelle, c'est de réinclure, non pas, encore une fois, les conclusions intolérantes, mais les raisons sous-jacentes. qui pousse les personnes, aujourd'hui, à arriver à ces conclusions, là où demain, peut-être, elles pourraient arriver à des conclusions différentes, si elles sont confrontées à différents points de vue, à différents avis, à différents vécus.
- Speaker #1
À ton avis, quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés, j'allais dire, parce que finalement, on voit qu'on a un peu les mêmes objectifs, toi et moi, avec d'autres collègues, bien sûr. Quels sont les défis auxquels ce genre d'action, d'essayer de... Ne serait-ce qu'on peut définir ça comme rassembler les gens autour de la table pour avoir une discussion qui fonctionne à peu près. Quels sont les défis auxquels on est confronté selon toi ? Et notamment, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire pour... attirer, j'allais dire rassurer plus de personnes pour participer à ce genre d'exercice.
- Speaker #0
Pour aller complètement dans ton sens, je pense qu'il y a un grand défi. On fait face à un grand défi et tous les acteurs, toutes les actrices de la paix, de la diplomatie, de ces pensées-là, de ces pensées inclusives, systémiques, ont toujours fait face à ces problèmes, je pense. C'est comment tu dépasses ces instincts compétitifs et guerriers tellement forts chez l'humain. Comment tu les dépasses ? Et la réalité, c'est que la plupart des personnes qui, d'une certaine mesure, arrivent à les dépasser, c'est des personnes qui sont extrêmement privilégiées, qui ont souvent des capacités... cognitives qui sont le résultat d'un vécu de chance incroyable. Et donc, en vouloir à d'autres de ne pas avoir eu cette chance, ça serait bien malvenu. Donc, déjà, pour moi, ça commence, la réflexion, elle démarre là, c'est, je me dois d'être profondément respectueux des personnes et de leur cheminement. même la personne qui me dit la pire chose la chose la plus horrible à propos de quelqu'un je me dois de de la voir comme un être humain qui a un vécu complexe et qui en est arrivé là ce
- Speaker #1
que Carl Rogers appelait l'acceptation positive inconditionnelle quelque part, t'essayes de pratiquer ça totalement,
- Speaker #0
c'est hyper important pour moi parce que déjà ça me semble être un enseignement philosophique que depuis des millénaires, certains humains sont arrivés à cette conclusion. Et donc, ça me semble peut-être qu'il y a quelque chose d'intelligent là-dedans. Mais aussi parce que je vois bien où est-ce que ça peut nous emmener. C'est-à-dire vers une capacité à modifier les perspectives, à persuader, etc. Et donc, comment on dépasse ces problèmes-là, ces difficultés-là ? Donc déjà, c'est faire un acte d'inclusion assez radical. Beaucoup de personnes dans certains bords de l'échiquier politique vont parler d'inclusion, sauf quand il y a certaines personnes qu'on n'a pas envie d'inclure autour de la table. Moi, j'aime bien parler d'inclusion radicale. Je veux pouvoir inclure tout le monde. Mon but, c'est de pouvoir inclure tout le monde. Alors la question, c'est dans quelles conditions, comment ? Parce qu'il y a toujours, évidemment, ce petit paradoxe qui est là, c'est certain... Les comportements, si je les inclue, ça en exclut d'autres. Donc comment on génère ça ?
- Speaker #1
On inclut les personnes, quoi qu'elles aient pu faire ou dire, ce qui ne veut pas dire qu'on inclut toute expression, lorsqu'elle est violente notamment. On fait cette différence-là.
- Speaker #0
C'est ça. Et pour autant, tu en as qui me diront, et moi j'ai déjà fait face à ces discours, qui me diront, Peter, c'est du tone policing. Donc, l'expression violente, en fait, elle est légitime. Et moi, comment ? Je me dis, ok, est-ce que je peux être inclusif de ça ? Je réfléchis. Est-ce que je peux être inclusif de ça ? Ouais, dans une certaine mesure, je pense que je peux. Ok, donc je vais essayer.
- Speaker #1
De dialogue ou de débat, d'ailleurs. Quelle est la place de la violence, en fait, dans les rapports sociaux ?
- Speaker #0
Exact. Et ça, je trouve ça super intéressant. Mais, ok, comment tu formules ça sans prendre trop de risques ? C'est des questions, je trouve, complexes, qui ne sont pas du tout évidentes. Mais... Je préfère tout le temps me poser la question de comment je peux inclure, plutôt que de fait, ou dès le début, par principe, ne pas inclure. Je préfère toujours me dire, ok, comment je peux inclure ça ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que je peux y arriver ? Est-ce que ça met vraiment en péril le dialogue, la discussion, le débat, la qualité de l'échange, ou pas ? Et souvent, ce dont je me rends compte, c'est qu'en faisant cette démarche, la personne elle-même, qui est la première à évoquer ce besoin, s'auto-corrigent. Et c'est ça sur quoi je me repose énormément, c'est l'intuition profondément humaine liée aux expériences sociales qu'on vit au quotidien, qui est que quand on fait preuve d'un peu d'empathie, quand on écoute un peu l'autre, lorsqu'on est sympa, on obtient des faveurs, l'autre nous concède des choses, nous aide, nous accompagne, et comme tout humain, a priori, a fait l'expérience de ces choses-là au moins une fois dans sa vie. Je m'aide un peu, je me repose un peu là-dessus pour dire, si on tentait ça, quoi. C'est pas que je veux pas que tu sois énervé contre l'autre. C'est juste, je me dis, comment on peut faire ? Moi, j'ai envie que tu puisses le persuader, tu vois. Donc, comment on peut faire ? Et je vais tenir le même discours à l'autre. Non pas que je sois un malin petit coquin qui cherche à manipuler les gens, mais parce que sincèrement, je veux que les espaces de débat et de dialogue soient vraiment des espaces où chacun a sa chance la plus...
- Speaker #1
D'être soi-même, en fait.
- Speaker #0
Alors, d'être soi-même, ça... Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est compliqué pour moi, être soi-même. Est-ce que la question de l'identité, mais ça, c'est un sujet que tu connais bien.
- Speaker #1
D'être authentique, je veux dire. Dire ce qu'ils ont à dire.
- Speaker #0
En tout cas, oui. De ne pas avoir l'impression de se confondre ou de se forcer. Ça, je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas que tu sors de là en disant « ça me saoule d'avoir été obligé de X, Y, Z » . Je n'ai pas envie que tu ressentes ça. Ce n'est pas mon but. Pour moi, ça serait un aveu de ne pas avoir réussi. Par contre, Ce que je veux, c'est aussi permettre à l'autre de faire ça. Comment on fait ? Et très souvent, l'autorégulation se fait très bien. Parce qu'on crée l'espace pour, etc. Et pour moi, ça amène à un sujet, je trouve, très important aussi. C'est quels sont les espaces qu'on crée, comment on les crée pour permettre ces dialogues.
- Speaker #1
Où est-ce que ça devrait se produire, ces dialogues, selon toi ?
- Speaker #0
Idéalement, ça pourrait se produire partout. Moi, ce que j'aimerais, c'est que ça puisse se produire partout. Je suis forcé de constater que Il y a des espaces dans lesquels, aujourd'hui, il y a trop d'intérêt à ne pas agir d'une manière constructive. Et donc, ça pousse à agir d'une manière qui n'est pas constructive. Donc, typiquement, c'est pour ça que je parlais des médias sociaux tout à l'heure. Pour moi, c'est un espace informationnel très important aujourd'hui. Et ils ne sont absolument pas pensés pour... qu'on fasse société en ce moment et qu'on arrive à penser la chose publique ensemble. Et tant qu'on n'aura pas réformé ça de façon profonde et vraiment j'insiste là-dessus, c'est un de mes gros sujets systémiques, je pense qu'on va faire face à de très grandes difficultés. Parce que le paysage informationnel, il doit nous aider à gérer l'incertitude, à prendre les bonnes décisions, etc. Et aujourd'hui... Ça fait tout le contraire. C'est un vrai sujet.
- Speaker #1
Il y a le poids des institutions, le poids presque anthropologique, en fait, notre ancrage anthropologique qui nous fait aller vers effectivement la confrontation, la recherche de la dominance. C'est un gros sujet. Les obstacles sont nombreux. Mais, tu continues quand même de... de promouvoir ces idées auprès des décideurs, éventuellement auprès des élites, mais aussi auprès des citoyens. Alors, est-ce que tu peux juste nous dire quels sont tes projets en ce moment ? Sur quoi tu travailles ?
- Speaker #0
J'ai toujours un peu le problème de ne pas trop me disperser. Comme j'essaie de penser ce projet de façon systémique, ça peut vite se transformer en hydre à plusieurs têtes. Mais l'idée, c'est que derrière le projet Débatologie, il y a un projet de vulgarisation, de création d'outils, de méthodes pour avoir des débats constructifs. Et l'idée, c'est de, moi, les tester, générer des données pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, utiliser les meilleures références scientifiques du moment pour inspirer des personnes à tester des choses, trouver tout ça au même endroit gratuitement pour tout le monde. Et ensuite...
- Speaker #1
Oui, tu as pas mal de choses, d'outils qui sont en open source.
- Speaker #0
Le but, c'est de faire ça. Après, ça prend du temps à faire. Et donc, je ne suis pas du tout aussi avancé que ce que j'aimerais. Mais c'est bien le but. C'est de rendre ça accessible à toutes et tous absolument gratuitement. Et dans l'idée, tu as la méthode, tu as les outils. Ça, c'est plutôt des bathologies. Je veux aussi un autre pan qui, pour moi, est un pan plutôt influence. c'est-à-dire... montrer qu'on peut le faire à grande échelle Donc pour moi, il y a un enjeu de créer des espaces médiatiques, des espaces physiques dans lesquels on peut avoir ces débats constructifs, avec des personnalités politiques, mais aussi avec des personnalités de la société civile, et aussi entre citoyens, et c'est de scénariser ça, médiatiser ça. Donc, aujourd'hui, j'essaie de m'entourer d'un certain nombre d'acteurs pour convaincre aussi un certain nombre de médias pour aller dans ce sens, ce qui est un vaste chemin compliqué. Et un troisième pan, j'en ai quatre, un troisième pan qui est plutôt sur de la recherche. J'aimerais bien créer une fondation, quelque chose de ce type-là, qui financerait de la recherche interdisciplinaire sur ces sujets pour... aussi générer des recommandations de politique publique autour de ça, un peu comment on peut penser nos institutions pour qu'elles célèbrent le débat d'idées constructives, et un quatrième pan qui est plutôt technologique, c'est, ok, si on veut faire ça à grande échelle, autant utiliser des outils technologiques les plus avancés, et aujourd'hui, il y a plein de startups, de chercheuses, de chercheurs, qui travaillent sur des outils technologiques qui visent à nous aider à avoir des échanges plus constructifs. Et j'essaie pareil de m'entourer de gens de ce monde-là, et si possible de créer des synergies au sein d'un labo pour penser des outils open source qu'on pourrait mettre à profit de plein de contextes différents. Ça va de ta réunion annuelle du syndic de copropriété, où on sait que c'est souvent le bordel et les débats ne sont pas très constructifs, jusqu'à des questions évidemment de... de démocratie participative locale, jusqu'à peut-être aussi des questions nationales, des questions de société, etc. On a vu déjà des outils numériques être utilisés, parfois souvent détournés malheureusement, à des fins politiques partisans. Donc voilà, le but c'est d'outiller le citoyen avec tout ça, de le sensibiliser à ça, et d'amener petit à petit à repenser le débat public comme une institution à part entière de démocratie. qui nous permet de mieux gérer les informations, de mieux se comprendre et de composer avec la diversité des points de vue au sein d'une société, et de décider ensemble pour faire advenir la société qu'on veut voir faire advenir de façon la plus consensuelle, à travers des groupes de pensées différents.
- Speaker #1
Merci pour cette générosité, de bien vouloir partager tous ces outils dont on espère vraiment que les... Les gens vont s'emparer, on voit bien qu'il y a quand même des vraies similitudes, ou au moins en tout cas des vrais ponts qui sont très concrets entre cette pratique du dialogue constructif et ce que moi je peux faire dans ma pratique en termes de dialogue. Et effectivement l'objectif en tout cas commun c'est de contribuer à dépolariser, pour employer ce terme, ou à désescalader la communication sur quand on n'est pas d'accord. sur certains sujets et à restaurer en fait, on n'a pas tellement utilisé ce terme mais finalement, restaurer les relations en quelque sorte, c'est ça in fine qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que les gens se réhumanisent et puissent travailler ensemble, même lorsqu'ils sont différents ou pensent différemment, et heureusement qu'ils sont différents et heureusement qu'ils pensent différemment sinon ça serait un peu bizarre comme société si on pensait tous pareil, mais voilà, comment on fait pour bien travailler ensemble pour bien vivre ensemble malgré ou peut-être même grâce à ces différences ...
- Speaker #0
Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que pour moi, c'est vraiment une idée clé que j'ai envie de remettre au centre de l'enjeu du débat démocratique. C'est grâce aux différences et pas malgré. Et c'est très important parce que je pense que c'est une des idées qu'on a le plus perdu récemment. C'est l'idée que le pluralisme, c'est une richesse. Et moi, je vais un peu plus loin que ça. C'est-à-dire, c'est pas juste, ah oui, c'est une richesse de penser différemment. Non, mais même plus loin que ça, c'est au plan évolutionnaire, c'est une richesse.
- Speaker #1
Quand on parle d'écosystème, on ne peut pas avoir que des éléments identiques.
- Speaker #0
C'est la résilience d'un écosystème. Le pluralisme, c'est la résilience d'un écosystème. Et ça, c'est génial, en fait. Parce que quand tu commences à le penser dans ces termes-là, moi, j'aime beaucoup l'idée de penser la culture comme au plan évolutionniste aussi. C'est-à-dire, la culture, elle a des mécanismes. évolutionnaire, comme la biologie. Et quand tu le penses un peu la culture comme ça, tu te dis, en fait, la culture, elle sert des fonctions dans un environnement. Et donc, notre but, c'est de générer des cultures qui sont les plus adaptées aux environnements. Et si t'as pas de pluralisme, bah en fait, t'as pas de résilience face aux environnements changeants. Ou en tout cas, c'est très lourd, tu vois. C'est-à-dire que ça va demander des changements radicaux, c'est très destructeur comme mécanisme. Donc, moi je me dis, comment on peut créer, générer un système qui est le plus résilient possible, qui a des mécanismes le plus résilients possibles ? Clairement, le pluralisme, ça fait partie intégrante. Ce n'est pas un « oui, malgré ça » , non, il en faut que ça marche bien. Et ça, je pense que c'est un des trucs les plus durs à penser pour... pour beaucoup de gens.
- Speaker #1
Oui, notamment en ce moment où on voit qu'il y a ce fameux backlash, qui est un backlash qui se situe contre, en tout cas, tout ce qu'on a appelé diversité-inclusion, etc. Et donc la diversité, ça sera peut-être l'objet d'une autre émission, quelle différence entre pluralisme et diversité, ou comment est-ce qu'on se positionne là-dessus. Mais oui, c'est vrai que malheureusement, l'idée même de pluralisme, parce qu'il peut être associé à d'autres choses, d'autres idéologies, d'autres pratiques, c'est pas évident de convaincre les gens que c'est quelque chose d'effectivement nécessaire anthropologiquement mais bon on pourra en reparler peut-être en tout cas on a hâte de consulter ce livre en attendant je rappelle tes deux sites donc phsbarret.com p-h-s-b-a-2-r-e-2-t .com ou debatology avec un y à la fin .com Et puis j'invite aussi les auditeurs et auditrices à regarder un peu sur YouTube les vidéos que tu postes qui sont assez sympas où tu partages aussi pas mal de ces réflexions et de ces outils dans le débat constructif. Merci beaucoup de ton temps. Merci de nous avoir exposé un peu ton travail. Et puis bon courage pour tous ces projets.
- Speaker #0
Merci Raphaël, bon courage à toi aussi.
- Speaker #1
Merci Peter.