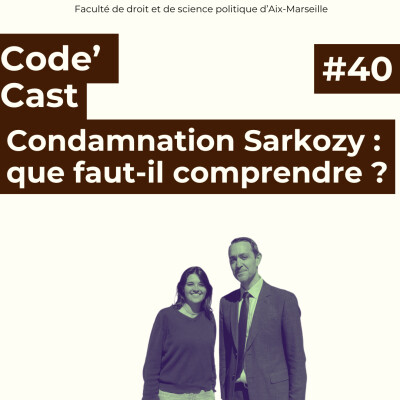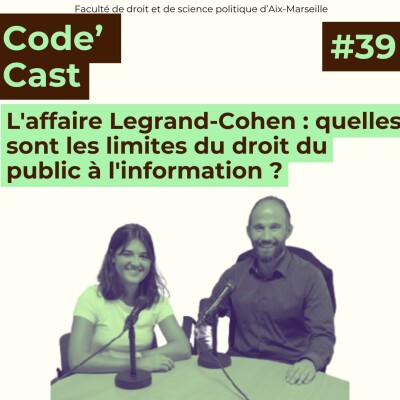- Speaker #0
Codcast, podcast juridique de la Faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université.
- Speaker #1
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Codecast revient avec un nouvel épisode consacré aux droits de l'environnement et aux droits de l'aménagement. Après l'affaire de l'autoroute A69, dont nous avions parlé dans un précédent épisode, nous allons aujourd'hui aborder un sujet plus large mais très concret, comment aménager nos territoires en protégeant la nature. Pour cela, une question en pratique se pose, pour les aménageurs, comment est-ce qu'on crée un projet de A à Z ? Pour évoquer ce sujet, nous avons de nouveau le plaisir d'accueillir Mme... Eva Mastromarino, qui est doctorante au sein de l'université d'Aix-Marseille et spécialiste en droit de l'aménagement. Alors je repose la question, comment est-ce qu'un aménageur doit s'y prendre pour créer un projet ?
- Speaker #0
Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est une très bonne question. C'est là que la théorie rencontre la réalité. Donc pour revenir un petit peu en arrière, après la Seconde Guerre mondiale, on a souvent fait grandir les villes en les étendant. Au cours des 20 dernières années, l'aménagement urbain a connu en France de profonds bouleversements. marqué notamment par la décentralisation de l'urbanisme, le lancement de nombreux grands projets et l'apparition à la fin des années 80 d'une bulle spéculative. Aujourd'hui, on a toujours besoin de logements, mais d'autres priorités sont apparues. Protéger l'environnement et construire de façon durable. L'idée, c'est de construire sur l'existant, c'est-à-dire de réutiliser des zones déjà bâties. Mais c'est complexe, ça soulève des problèmes pour la nature, la circulation et les coûts. Quand on construit sur des terrains naturels, cela pose aussi des questions sur l'étalement urbain et l'artificialisation des sols, c'est-à-dire le fait de recouvrir les terres naturelles de béton. Un projet d'aménagement, c'est un ensemble qui touche à plusieurs choses. Les terrains, où est situé le projet, la maîtrise du foncier, mais également la nature, quels sont les impacts et comment les éviter, les réduire et les compenser, également les acteurs qui y sont impliqués, l'argent, bien sûr, combien ça coûte, quels sont les risques financiers, quels montages de financement lourds et souvent complexes sont à réaliser, le planning, quelles autorisations faut-il obtenir, et le temps, combien de temps cela va durer. Ainsi, les aménageurs doivent jongler avec toutes ces complexités.
- Speaker #1
D'accord, c'est clair. Mais comment définir une opération d'aménagement ? Qui peut lancer un tel projet ?
- Speaker #0
La loi nous explique une opération d'aménagement visant aussi bien la politique locale de l'habitat, le maintien, l'extension, l'accueil des activités économiques, de tourisme et de loisirs, mais également la lutte contre l'insalubrité, la mise en œuvre du renouvellement urbain ou la préservation des espaces naturels. Comme cette définition est très large, la jurisprudence a ajouté trois points importants. Tout d'abord, le projet doit correspondre à l'un des objectifs de la loi. Puis, il doit avoir un impact important sur le lieu. et être aussi d'une certaine taille. Et enfin, il doit aussi combiner plusieurs actions sur le tissu urbain, ce n'est pas juste une construction isolée. On peut dire qu'une opération d'aménagement ne consiste pas seulement dans la production de terrains à bâtir. Et pour savoir qui est responsable pour lancer ces projets, la décision est souvent passée des communes aux groupements de communes, qu'on appelle les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. Et au-delà de ces groupements et des aménageurs habituels, comme les sociétés d'économie mixte, on retrouve également les offices... public de l'habitat, les OPH, qui peuvent également désormais réaliser ces projets.
- Speaker #1
Très bien. Alors une fois qu'on a défini et identifié les acteurs, comment est-ce qu'un aménageur met-il concrètement en œuvre une opération d'aménagement ?
- Speaker #0
Pour un aménageur, monter un projet suit une démarche organisée. Cela commence par l'urbanisme préopérationnel, donc une phase de préparation où l'on définit la vision du futur quartier, le nombre de logements et les équipements, pour identifier les besoins et les contraintes. Ensuite, on réalise des études préalables. Elles sont menées pour anticiper les impacts, notamment environnementaux. Elles évaluent la faisabilité et l'opportunité du projet, ses caractéristiques et ses incidences financières et environnementales. Pour les grands projets, une évaluation environnementale est souvent obligatoire, via une étude d'impact. Elle est systématique si le terrain dépasse 10 hectares ou 40 000 m2 de surface construite. Une partie clé de cette évaluation environnementale est l'inventaire. Fond-flor, qui sera mené sur un an, complété par des études sur l'eau ou le sol. La loi exige une évaluation globale du projet, même s'il est divisé. Et également, on peut citer les études de faisabilité, notamment financières, qui sont aussi réalisées, parfois avec l'aide d'experts, donc on appelle des AMO, pour concevoir le projet et évaluer ses conséquences économiques, aidant à choisir la meilleure méthode de réalisation, soit un permis de construire, soit une zone d'aménagement concertée, mais également à prévenir les problèmes. Après toutes ces étapes, le projet est déposé auprès de l'autorité compétente, c'est soit la mairie, soit la préfecture, ça dépend de la première autorisation qui est sollicitée. Et enfin, la deuxième grande phase, c'est l'urbanisme opérationnel, il correspond à la réalisation concrète, donc via l'acquisition de terrain, la vente des parcelles et les exécutions de travaux d'aménagement et de construction.
- Speaker #1
Très bien, merci. Alors prenons maintenant un peu de hauteur parce que le droit de l'aménagement est un domaine qui semble en vérité assez vaste et complexe. Alors comment cette branche du droit, si on peut l'appeler comme ça, en général prend-elle en compte les enjeux environnementaux aujourd'hui ?
- Speaker #0
En effet, le droit de l'aménagement est un domaine très riche qui s'appuie sur plusieurs textes. On le retrouve principalement dans le Code de l'urbanisme et le Code de l'environnement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la dimension environnementale est maintenant... partout dans nos lois, du plus haut niveau au plus concret. C'est une intégration complète. Cela commence par les principes fondamentaux comme la charte de l'environnement de 2005 qui a la même valeur donc qui est au sein de notre bloc de constitutionnalité. Et également ça vient des directives européennes qui nous donnent des objectifs stricts pour la protection de la nature. Et on le retrouve plus spécifiquement dans nos lois nationales comme les lois Grenelle ou plus récemment la loi climat et résilience qui fixe des objectifs ambitieux notamment le zéro artificialisation net. c'est-à-dire ne plus ajouter de béton sur nos terres naturelles. Concrètement, les règles de l'urbanisme ont beaucoup changé. La définition même des opérations d'aménagement inclut maintenant dans leur objet la restauration, la renaturation, donc redonner un aspect naturel, également la désartificialisation des sols, donc enlever le béton. Aménager, ce n'est plus seulement construire du neuf, mais c'est aussi réparer et rendre plus vert ce qui existe déjà. Ainsi, les objectifs de l'urbanisme intègrent désormais pleinement les préoccupations environnementales. Mais il y a également des contraintes environnementales très directes. L'interdiction de détruire des espèces protégées, qui est une règle majeure pour tout projet, comme on l'a vu avec la 69. On a également des règles qui limitent la construction dans certaines zones, la loi littorale par exemple. Et bien sûr, les objectifs du zéro artificialisation net, donc le ZAN, qui nous oblige à réduire fortement la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Également, et c'est ce qui a le plus changé pour les aménageurs, ce sont les procédures. L'environnement est pris en compte dès le début des projets. C'est le processus d'évaluation environnementale. La plupart des projets importants, de grande taille, sont soumis à études d'impact, c'est-à-dire une évaluation formelle de leurs conséquences sur l'environnement. Il existe également des évaluations spécifiques pour les sites protégés, on appelle les sites l'autorisation Natura 2000, et l'autorisation environnementale unique, qui regroupe toutes les permissions nécessaires pour un projet qui a un impact, comme les installations industrielles ou celles qui touchent à l'eau.
- Speaker #1
C'est un tableau très complet du cadre juridique que vous avez dressé. Alors si le droit est si armé, comme vous l'avez dit, quels sont les défis que rencontrent encore les aménageurs sur le terrain ? Quelles sont les limites du cadre juridique actuel ?
- Speaker #0
Alors effectivement, l'aménagement traverse une crise profonde qui remet en question le métier même d'aménageur. Il y a des obligations physiques et des demandes politiques sur les enjeux environnementaux. Et la question que l'on se pose, et la question que je me pose également au sein de ma thèse, c'est comment adapter nos pratiques aux limites de la planète et aux contraintes écologiques. Donc la première, c'est la complexité des règles. On a ce qu'on appelle un millefeuille législatif et réglementaire, les lois sont très denses, avec beaucoup de renvois entre les textes et des liens assez complexes. Les documents d'urbanisme à prendre en compte sont nombreux, la planification avec le SRADET, les SCOT et les PLU sont complexes également. Et pour un aménageur, s'y retrouver est un vrai casse-tête. Ajouter à cela une multitude d'autorisations à obtenir et des procédures de participation du public également complexes, tout cela rend les projets fragiles face au risque d'être annulés par un juge. La deuxième limite que je pourrais évoquer, c'est l'incertitude juridique. Le droit de l'environnement change régulièrement. Par exemple, depuis mars 2023, on a eu la loi ZAN 2, on a eu également la loi Industrie verte avec un décret d'application en 2024. et cette succession de nouveaux textes crée une insécurité juridique pour les aménageurs qui ont du mal à savoir quelles seront les règles de demain et à pouvoir les anticiper. Enfin, et c'est un point crucial, l'inadaptation de notre fiscalité. Car pour l'instant, le droit fiscal encourage trop souvent à construire du neuf plutôt qu'à rénover l'existant ou à réhabiliter des friches, des terrains abandonnés. Or, pour un aménageur, préserver la biodiversité ou désartificialiser coûte cher et peut réduire les gains du projet. Enfin, le modèle économique actuel est à bout de souffle parce qu'il ne correspond plus aux défis de notre époque. Il repose sur la vente de terrain, ce qui n'est plus compatible avec les objectifs de limiter l'artificialisation et de restaurer les milieux naturels. En conclusion, ces obstacles montrent clairement que notre droit actuel n'est pas encore totalement adapté aux exigences de la transition écologique.
- Speaker #1
Merci beaucoup pour cette présentation. très complète et inspirante. Nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à le réécouter, à le partager et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode de Codecast. A bientôt, au revoir.