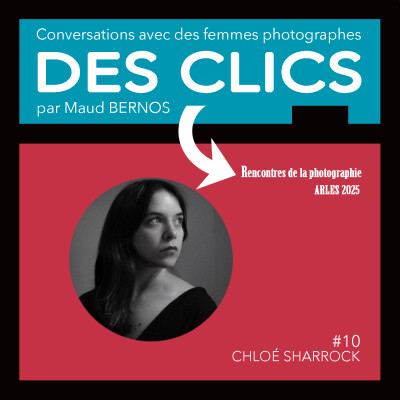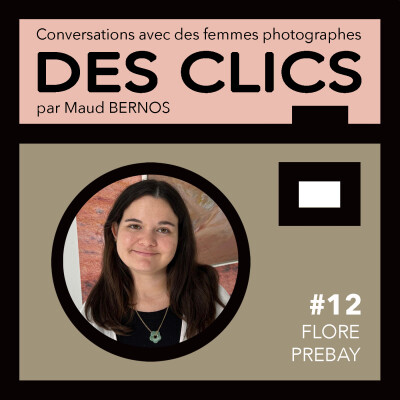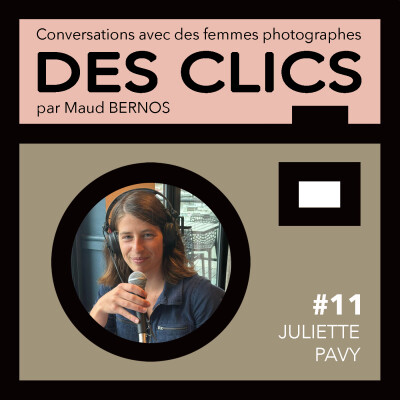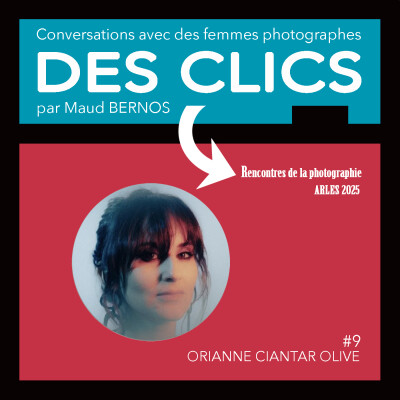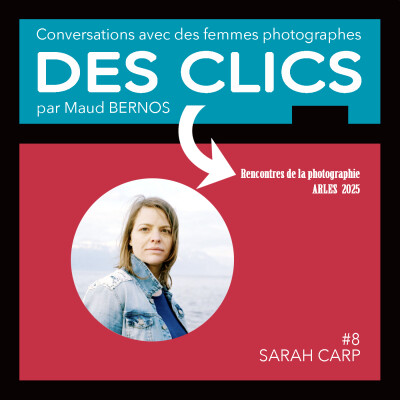- Speaker #0
Nous sommes au 56e rencontre de la photographie d'Arles qui commence aujourd'hui et qui ont lieu du 7 juillet au 5 octobre. Les expos viennent tout juste d'ouvrir ce matin, on entend les cigales derrière nous et cette année le collectif MIOP fête ses 20 ans et s'est installé à cette occasion aux douches municipales d'Arles. Et je reçois Chloé Charoc qui fait partie du collectif. et qui est à mes côtés, dans une petite cour, sous des parasols, sur des jolis tapis, et avec un bruit de fond hyper agréable. Bonjour Chloé.
- Speaker #1
Bonjour.
- Speaker #0
Est-ce que tu pourrais, pour commencer, me dire ce que tu aimes particulièrement à Arles ?
- Speaker #1
Vaste question. Bon déjà la ville est très belle. Chaque année où je reviens, je me rends compte du charme de cette ville. Et puis la diversité des écritures photographiques, des expositions, les scénographies différentes. Il y a une vraie diversité qui représente assez bien ce qu'est la photographie aujourd'hui. Et puis surtout le côté très social aussi, où on revoit tout le monde. C'est un espèce de rendez-vous avec pas seulement les amis de Paris, mais aussi tous ceux qu'on a moins l'occasion de voir. Et donc voilà, c'est un petit air de colonie de vacances, un peu sous le signe de la photographie.
- Speaker #0
Donc c'est colonie, c'est amical, c'est professionnel, c'est le sud, c'est un peu tout en même temps.
- Speaker #1
C'est un peu tout en même temps. Moi j'ai beaucoup de mal à vraiment faire du très professionnel. Chaque année je me dis il faut que je prenne des rendez-vous, il faut que je prenne des rendez-vous et à chaque fois j'oublie. Donc voilà tu es mon seul rendez-vous de la semaine. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup. Je suis hyper flattée.
- Speaker #0
Est-ce que tu pourrais me présenter le collectif Myop ?
- Speaker #1
Alors le collectif Myop, on est maintenant 20 photographes très exactement. avec des écritures photographiques assez différentes aussi, même si on a quand même un ADN assez proche du photojournalisme ou en tout cas du documentaire. On a un collectif qui est engagé, on ambitionne en tout cas de raconter le monde avec des valeurs et de l'engagement. Et puis on a vraiment cet aspect collectif qui fait qu'on crée justement des événements tels qu'à Arles, des livres, des expositions communes. Donc c'est vraiment peut-être ce qui différencie d'une agence, c'est vraiment cette envie en fait de créer des choses en commun. Donc moi je suis rentrée dans l'agence en 2021, c'était à Arles d'ailleurs que je suis rentrée, donc 4 ans maintenant, c'est passé très vite. Et donc voilà, que dire d'autre ?
- Speaker #0
Mais on peut décrire un peu le lieu parce que c'est quand même à chaque fois à Arles, toujours des endroits hallucinants.
- Speaker #1
Oui, alors on est très friands de récupérer des lieux abandonnés en friche dans des états pas possibles. et du coup de les remettre sur pied nous-mêmes. Bon là cette année il y a une particularité, on a vraiment fait appel à un commissaire d'exposition et un scénographe extérieur pour poser justement un regard un peu extérieur sur l'agence pour les 20 ans. Mais généralement tout est fait vraiment de l'intérieur, donc la scénographie, la direction artistique, les travaux, donc à chaque fois effectivement c'est des lieux abandonnés où il faut... Arracher la moquette, lessiver les murs, nettoyer la cour, repeindre tout, faire l'électricité, enfin voilà. Donc on a aussi un petit penchant BTP. Donc ça fait partie des formations dans l'agence. Généralement, on repart de là avec un peu de connaissances en maçonnerie. Et donc voilà. Et donc là, effectivement, on a quand même pas mal mis la main à la pâte encore. Donc on est arrivé il y a une semaine. Et pendant une semaine, en fait, on se rassemble, on fait tout ensemble. Voilà, c'est un peu l'idée du collectif également. Alors il y a... Pour soucis économiques également, c'est vrai que de faire tout soi-même, ça fait des économies, mais c'est également pour vraiment, c'est un côté un peu aussi team building entre guillemets, ça nous soude, ça veut dire qu'on a ce bonheur aussi de créer les choses ensemble.
- Speaker #0
Tu n'as pas d'expo en tant que Chloé Charoc, parce que vous avez décidé de faire une installation particulière cette année, qui est un écran. Et on vient de me dire qu'il y avait 40 000 photos qui défilaient à 100 à l'heure. Est-ce que tu peux m'expliquer juste un tout petit peu le concept ? Parce que je pense que c'est la particularité de l'exposition de cette année. Oui,
- Speaker #1
alors effectivement, on se retrouve en fait, donc on descend au sous-sol de ce bâtiment. On a déjà toute une partie un petit peu qui présente les différentes éditions de MIOP pour montrer justement, parce que c'est aussi quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de l'agence, c'est le côté édition. Donc là, on a voulu rassembler un petit peu tout ce qui a été fait en termes de livres, de journaux, etc. Et puis après, on va traverser dans un long couloir, donc c'est les anciennes douches municipales justement, avec un peu des petits extraits, on va dire, d'images de chaque photographe en grand format, un peu rétro-éclairé. Et puis face à ce long tunnel, on se retrouve donc face effectivement à cet écran qui est en fait un espèce de flux continu de 25 images secondes de toutes les images de l'agence. En fait, on a chacun sélectionné une centaine de nos meilleures images. des 20 dernières années. Donc bon, 20 dernières années, quand on est photographe depuis 20 ans, c'est pas mal. Quand on est photographe depuis 8 ans, comme moi, c'est un peu moins fourni. Et donc l'idée, c'est d'avoir cette espèce de flot continu de toutes ces images mises bout à bout. Et en fait, quand on approche de l'écran, on va ralentir le flux. Et là, les images s'arrêtent. Et là, on a le temps de contempler les images une par une qui passent du coup sur l'écran. Et donc, c'est un peu dans l'envie justement de montrer que nous, dans ce flot continu d'images qui est produit en permanence et dans lequel parfois on pourrait facilement se noyer, on essaye parfois de ralentir un peu justement tout ça. On essaye de faire en sorte en tout cas que le regard des gens s'arrête un peu et prenne le temps de regarder les choses.
- Speaker #0
Alors, l'expo s'appelle Mes yeux, objets patients. Et quand on rentre, quand on franchit la porte, qu'on quitte le trottoir et qu'on franchit la porte. Il y a un mur avec une phrase que je vais vous lire. « Mes yeux, objet patient, étaient à jamais ouverts sur l'étendue des mers où je me noyais. Enfin, une écume blanche passa sur le point noir qui fuyait. Tout s'effaça. Paul-Éloire, donnez à voir. » Qu'est-ce que ça t'inspire ?
- Speaker #1
Déjà, il faut savoir que c'est de là dont vient le nom Myop. Et ça, peu de personnes le savent en fait. C'est les premières lettres, « Mes yeux, objet patient » . Miop.
- Speaker #0
Je ne le savais pas. Voilà.
- Speaker #1
Et on s'est dit, c'est marrant, on va le mettre en titre. On va voir combien de personnes arrivent à faire le lien. Parce que souvent, les gens pensent que Miop, c'est une espèce de petit pied de nez au fait qu'on voit rien. Alors qu'en fait, non, c'est l'acronyme de cette phrase-là. Mes yeux, objet, passion. Et donc là, on s'est dit, on va la mettre pour une fois vraiment en grand, lisible, en énorme dans l'exposition. Ça va être le titre de l'exposition. Et en fait, effectivement, les gens ne feront pas forcément encore le rapprochement. Mais c'est bien, c'est mystérieux du coup. on se demande pourquoi mais qu'est-ce qu'elle fait là cette phrase
- Speaker #0
On va parler de toi maintenant Chloé, est-ce que tu pourrais me raconter les grandes étapes de ton parcours ? Comment t'es arrivée jusqu'à cette cour ensoleillée, plein de cigales ?
- Speaker #1
Bon ça fait un peu cliché mais je suis arrivée un peu par hasard à la photographie. J'ai toujours un peu aimé la photographie mais plus comme un hobby. Mais jamais j'avais eu vocation en tout cas d'en faire un métier, jamais ça m'avait même effleuré l'esprit on va dire. Même si j'avais quand même toujours eu envie de me tourner vers quelque chose d'un peu créatif, quelque chose de lié à l'image. Et en même temps, j'avais un peu aussi des envies, je pense, de choses plus terre à terre, d'engagement. Et c'était en 2017, je m'étais installée à Paris depuis un an, je pense. Là, je faisais des études de cinéma à cette époque, après avoir fait des études d'histoire de l'art. Et puis, il y a eu des manifestations très violentes, vraiment, en bas de chez moi, dans mon quartier. Et je ne sais plus pourquoi, je m'étais dit, tiens, je prends mon appareil photo, je vais faire des photos. Et voilà, parce que je pense que je devais voir qu'il y avait plein de photographes, de trucs comme ça pendant les manifestations, mais sans me dire, tiens, photojournalisme, métier de photojournaliste. Et bref, j'ai fait ça, j'ai adoré. C'était un moment donné où je n'avais pas touché à mon appareil photo depuis des mois et des mois. J'ai touché juste pour faire des photos en soirée de mes potes, donc vraiment rien de plus. Et de fil en aiguille, je les ai postés sur les réseaux sociaux. J'ai eu des retours assez positifs. Et à partir de là, en fait, ça a été juste un peu une évidence où je me suis dit bon, en fait, c'est ça. Maintenant, ça va être mon métier. Et donc, voilà. Et donc, j'ai arrêté mes études et je me suis lancée dans le photojournalisme. Et très rapidement, pour moi, c'était vraiment avec l'idée d'aller travailler au Moyen-Orient, parce que c'est une région qui m'intéressait particulièrement pour tout ce qu'il y avait comme événements géopolitiques, le fait que ce soit toujours un peu au carrefour, on va dire, de tous les enjeux politiques mondiaux. Et donc, je suis partie au Liban dès 2017. À partir du Liban, le Liban est une porte d'ouverture sur toute la région. C'est un pays assez facile d'accès, de compréhension. Ça ne craint pas trop quand on est un jeune photographe. Surtout en 2017, il ne se passait pas énormément de choses. Mais ça permet d'avoir une bonne idée de ce que peut être la culture dans la région, des enjeux du contexte géopolitique, de la complexité entre les différentes communautés, du passé de la guerre, le poids de la guerre, la mémoire de la guerre. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment intéressée, c'est tout ce rapport à la mémoire de la guerre. Et là je me suis dit, ah waouh, l'héritage de la violence, les conséquences des conflits sur les populations civiles, au long terme, au moyen terme, c'est fascinant, c'est passionnant, et à partir de là ça a été un peu ma spécialisation. Donc après Liban j'ai fait Gaza, après Gaza j'ai fait Égypte, Irak, et après beaucoup ça a été aussi une grande... Une grande étape, on va dire, dans ma petite carrière, parce que c'est un pays dans lequel j'ai énormément aimé travailler, pour toutes les choses qu'il y a à dire également. Toutes les choses qu'il y a à dire, par exemple, sur les conséquences de la guerre, sur la reconstruction après la guerre. Moi, je me suis beaucoup penchée sur la question de la santé mentale, ou en tout cas du traumatisme, donc vraiment les spectres de la guerre. Enfin voilà, il y a plein, plein, plein, plein de choses à dire encore sur ce pays.
- Speaker #0
Qu'est-ce qui fait que tu es passée des manifestations à Paris, en bas de chez toi,
- Speaker #1
à la guerre ? Je pense que la guerre, déjà il y a un engagement, on a envie d'aller se pencher un peu sur ce qui se passe là-bas, parce qu'on a envie de dénoncer, mais il y a aussi, moi il y a une fascination pour la violence, parce que je ne la comprends pas, la violence de l'homme je ne la comprends pas. Et je pense que plus on s'en approche, plus on la comprend, et du coup plus on essaie d'aller encore plus près. Et donc c'est une quête un peu infinie de pourquoi la violence de l'homme. Et pourquoi les êtres humains s'entretuent ? Pourquoi on continue encore en 2025 à en être là ? Pourquoi ? Quelles sont les conséquences ? Et voilà, et donc pour ça en fait, c'est pas en restant à Paris qu'on comprend la violence profonde de l'homme. Et donc il y avait ce besoin au fond de moi d'aller au plus près en tout cas de cette violence. Et d'essayer en tout cas de l'expliquer, d'essayer de la comprendre. d'essayer de la décortiquer pour essayer de la mettre en avant et de la dénoncer, évidemment. Mais en fait, on se rend compte que plus on approche et moins on la comprend. Donc ça pourrait être une quête un peu sans fin. Donc à un moment donné, il faut aussi arrêter.
- Speaker #0
Tu n'as pas l'impression d'avoir en main plus de clés qu'il y a quelques années ?
- Speaker #1
Pas du tout. Pour moi, la violence est de moins en moins compréhensible. Plus je m'en approche, plus je me rends compte de à quel point elle va loin. Puis là, en plus en ce moment, en 2025, quand on voit ce qui se passe à Gaza, par exemple. On est tellement tellement loin dans l'inhumanité, dans...
- Speaker #0
Par rapport à ça, quand on ne va pas sur les terrains de guerre, ce qui est mon cas, on voit les images qui peuvent être ultra violentes tout d'un coup et qui ne sont pas décontextualisées parce qu'on sait d'où elles viennent, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant et après, ce qui les rend encore plus dures. Je pensais à ça avant de venir te retrouver. Et je pensais à deux photos de toi particulièrement qui, moi, m'habitent, me hantent, m'assaillent, je ne sais pas quel mot utiliser. qui sont la photo de la main et la photo d'Artem, qui sont très différentes. Alors la photo de la main, c'est tout simple, c'est une nature morte, c'est le cas de le dire. Et la photo d'Artem, qui est une photo qui n'a rien à voir avec la main, c'est un visage d'un soldat ukrainien avec des yeux bleus, couleur Polynésie. On peut plonger dans la mer cristalline. En fait, dans les yeux, il y a le drame et il y a toute l'ignominie de la guerre et de l'inhumanité. Et c'est deux photos très fortes dont toi, tu connais le contexte. Parce que nous, cette main, elle sort de nulle part, mais elle en dit énormément. Est-ce que tu peux, pour essayer de comprendre la violence, comme tu dis ?
- Speaker #1
Oui, et c'est vrai que cette main, moi, ça a été ma première confrontation parce que j'ai beaucoup travaillé dans des pays d'après-guerre. Quand je suis allée en Syrie, en Irak, à Gaza, ça a été plutôt de l'après-guerre. Mais jamais j'avais été confrontée à la mort en direct ou à la violence de manière aussi frontale. Et là, ça faisait peut-être une ou deux semaines que j'étais en Ukraine, je travaillais pour Le Monde. Et donc c'était vraiment tout début avril, je crois que c'était le 2 avril. Donc on était quand même assez peu de temps après le début de la guerre de 2022. Et donc il y avait Boucha qui venait un peu d'être libéré. Et donc il y avait enfin cette possibilité de peut-être aller accéder à Boucha, où il y avait toutes les atrocités dont on commençait un peu à avoir vent. Donc bref, avec Rémi Audan, le journaliste, on essaie d'aller à Boucha, finalement ce n'est pas encore ouvert aux journalistes. On se dit bon, dans ce cas-là, on va aller ailleurs. Et en fait, on avait entendu parler de cette espèce de portion d'autoroute où il y avait eu des massacres également, parce que c'était la route vers Zitomir et vers l'ouest du pays par laquelle les gens essayaient de fuir Kiev. Et les positions russes, enfin les russes étaient positionnés en fait de part et d'autre de cette autoroute et en gros ils dégommaient tout ce qui essayait de passer par là. Dont des civils, dont des familles, dont des militaires également aussi. Et donc du coup cette espèce de 500 mètres d'autoroute était juste jonchée de voitures avec des cadavres, des gens brûlés, encore figés dans leur tentative de fuite. Enfin c'était absolument atroce. Et les russes avaient essayé de cacher un peu ces preuves-là en entassant des corps et en essayant d'y mettre feu. Ce qui n'a pas très bien marché. Donc cette main, en fait, c'est une main qui dépasse sous un tas de corps à moitié brûlés et dénudés. Et alors c'était très particulier, en plus on était peut-être deux photographes à tout casser sur cette aire d'autoroute, il n'y avait vraiment personne, moi j'étais seule face à ces cadavres. Le journaliste était parti parler avec des militaires un peu plus loin, et donc moi j'étais là seule à tourner autour de ces corps en me disant mais comment je photographie ça ? Comment je peux montrer ça en fait ? En gardant un tout petit peu d'éthique, en gardant de la pudeur. Et en même temps, il faut aussi en parler parce que c'est quand même un truc ignoble qu'on a sous les yeux. Et c'est possible que dans 24 heures à peine, les corps soient ramassés et puis il n'y ait plus de preuves. Et il y avait cette main qui dépassait et là, je me suis dit, non mais voilà, je prends cette main en photo. Et donc, j'ai fait vraiment le détail de cette main et je me souviens de m'être immédiatement dit, bon, ça, ça va être la photo. Ça va être la photo qui va parler de cette main. Parce que ça permettait de... En fait, c'est la suggestion de ce qu'il peut y avoir au bout de la main. Et pour moi, on a une espèce de responsabilité qui est celle effectivement de ne pas trop montrer. Sinon, les gens détournent le regard. Si j'avais montré le reste, les gens auraient détourné le regard. Et en regardant ailleurs, on ne regarde plus les choses. Donc il y avait pas mal de trucs comme ça. Il y avait un autre corps où le visage était recouvert et il était habillé. Donc du coup, ça restait encore un peu pudique. Donc il y avait ça qui était en première page du journal. Et la main était à l'intérieur. Et cette main, effectivement, a fait beaucoup, beaucoup parler. Et pour Artem, c'était encore différent, effectivement. Alors, il n'était pas soldat. C'était un habitant de Kherson qui avait été soupçonné d'avoir collaboré. Pendant l'occupation russe, il était soupçonné d'avoir collaboré avec les Ukrainiens. Et donc, il avait été arrêté et torturé par les Russes. Et donc là, en fait, il nous emmenait devant le lieu où il avait été torturé pour nous dire que c'est là que ça s'est passé et nous décrire un peu ce qui s'était passé. Et il avait été libéré, je crois, à peine quelques semaines auparavant. Donc il était encore vraiment hanté par ce qui lui était arrivé. Et il était tout jeune, tout gentil. Il avait 26 ans. Et vraiment, effectivement, dans son regard, on le voyait tellement l'espèce de terreur, le traumatisme, les démons qui continuaient à l'habiter. Et donc j'avais essayé de faire une photo de lui devant vraiment le centre pénitentiel, l'endroit où il avait été torturé. Il n'était pas très à l'aise, ça ne marchait pas très bien. Et j'avais essayé un peu de détendre le truc en disant, ah bah tiens, regardez là-bas, il y a une porte bleue. En plus, vous avez des super beaux yeux, ça va super bien aller avec vos yeux. Pour un peu le détendre. Et effectivement, il avait un regard mais juste incroyable, effectivement. Et qui disait tellement de choses aussi. Et encore une fois, la suggestion aussi. Par son regard, on suggère en fait toute l'horreur qu'il a pu voir. Et effectivement, devant cette porte, le portrait était rapide. Et effectivement, ce portrait, il marche aussi très bien. parce qu'on voit dans son regard ce qu'il s'est passé.
- Speaker #0
Chloé, tu as une particularité qui sont les notebooks que tu fais quand tu es en déplacement, en reportage. Je ne sais pas si tu les fais partout, mais en tout cas, il y en a d'Ukraine. Est-ce que c'est ce qui te permet de survivre, entre guillemets, de surmonter le quotidien de la guerre ?
- Speaker #1
Alors c'est vrai que je l'ai toujours fait parce que je suis très carnée de manière générale, mais particulièrement en Ukraine. Ça a été vraiment assez foisonnant, on va dire, au niveau des carnées. Déjà parce que de toute manière, les carnées de notes... C'est un truc, c'est un outil de travail, dès qu'il y a des interviews, des trucs comme ça, on note tout. C'est un outil de travail de manière générale. Et puis en plus de ça, c'est quelque chose dans lequel je déverse un peu le reste. Et je pense qu'en Ukraine, ça a été particulièrement le cas. Parce que déjà c'était très dense, il y avait beaucoup de choses à emmagasiner mentalement. Et c'est vrai que quand on est sur le terrain pendant la journée, on se met un peu des œillères, on fait son travail, on se pose. pas trop de questions, etc. Et puis c'est le soir, généralement,
- Speaker #0
quand on rentre.
- Speaker #1
On se retrouve dans la chambre d'hôtel, toute seule. On se dit, putain, qu'est-ce que j'ai vu encore aujourd'hui ? Et puis on a des ressentis, en fait. Et c'est vrai qu'en photojournalisme, on est tenu à une espèce d'objectivité, de rigueur un peu journalistique. Et c'est vrai que des choses un peu plus personnelles, plus émotives, plus... Plus intime, en fait, c'est un peu là-dedans que ça me permet de déverser tout ça. C'est une espèce de prolongation de ce que je vois, de ce que je rêve, de ce que je pense, de mon cerveau. Et puis je pense qu'en Ukraine, il y a vraiment eu aussi cette particularité où je n'ai jamais autant eu l'impression que toutes les photos qui ont été produites se ressemblaient. J'ai l'impression qu'on faisait tous les mêmes photos. Déjà, on était un nombre de photographes, on était des centaines et de photographes sur place, avec des accès quand même assez restreints. Et j'avais un peu cette impression de voir des images en triple, en quadruple, en cinq-tuple. Parfois, je ne savais même pas si c'était mes images ou celles d'un collègue. Et en fait, je pense que les carnets de notes me permettaient un peu de me réapproprier ce que j'avais vu, de le traiter un peu différemment. Et donc, ça a commencé à être vraiment effectivement un vrai support pendant mes séjours. Et voilà, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai autant rempli des carnets de notes. Je me souviens, il y a vraiment des soirs où je... Je me faisais des sessions car des notes, peinture, dessin, j'écrivais beaucoup plus, j'avais beaucoup plus de choses je pense à exprimer, que je n'arrivais pas à exprimer autrement dans la photographie.
- Speaker #0
Est-ce que tu pourrais nous lire un petit extrait ? Parce que moi ce que j'ai vu, j'en ai pas vu beaucoup, je les ai vus sur ton site, mais je les ai jamais vus ailleurs. Il y a une page qui m'a particulièrement marquée, il y a un texte, il y a des très belles illustrations, et à côté de ça... Air raid, les attaques aériennes.
- Speaker #1
J'avais noté effectivement...
- Speaker #0
La chronologie des attaques aériennes.
- Speaker #1
Voilà, j'avais un peu compris. Une journée en tout cas, toutes les attaques aériennes qu'il y avait eu là où j'étais, dans le Donbass. Et effectivement, il y en avait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y en avait sept dans la journée. Et avec surtout la durée également à chaque fois, parce que parfois c'est des alertes qui durent plus d'une heure. C'est-à-dire que pendant plus d'une heure, il y a un risque de... Mais bon, après, c'est des choses où on n'allait pas forcément se cacher dans les...
- Speaker #0
Non,
- Speaker #1
mais ça rend compte aussi de... Voilà, ça montrait aussi le quotidien, entre guillemets, parce que du coup, on les imagine, ces alarmes. En fait, ça faisait tellement partie prenante du quotidien là-bas, ces alarmes, ce bruit. C'est un bruit qu'on entendait en permanence. À la fin, on n'entendait plus, en fait. Mais du coup, il y avait cette espèce de banalisation de ce bruit, ce qui n'est pas normal, parce qu'on ne devrait pas s'habituer à des bruits d'alerte, à des attaques aériennes. Et donc de les retranscrire un peu comme ça dans le carnet, ça permettait de les remettre un peu en place en disant « Ah oui, il y a quand même ça aussi, c'est le quotidien de la guerre, c'est ces alertes permanentes, c'est... » Et voilà, et effectivement, donc là sur ce carnet, il y avait... J'étais à Kramatorsk, oui, je ne sais plus où j'étais exactement, et j'étais rentrée un soir en fait à pied, et en fait c'était le noir total parce que la nuit, toutes les lumières sont éteintes, et c'était une ambiance vraiment particulière. De longues marches silencieuses dans le noir lourd de la nuit. Ce soir-là... La seule source de lumière était la lune, ronde et chaude. Même pleine, elle peinait à éclairer le fond des tranchées à l'abandon le long des trottoirs désertés. Le long de la route, les barres d'immeubles n'étaient plus que d'immenses frigos vides dans lesquels l'armée planquait sa chair fraîche attendant d'aller sur le front. Nous dormions dans l'un de ces appartements figés dans le temps, dans lequel il était impossible de discerner le jour de la nuit. Un mince faisceau de lumière s'immisçait entre les planches de bois, filtré par un voilage poussiéreux. Et donc ça, c'est effectivement parce que dans ces appartements, tout était déserté parce que les civils ont fui, évidemment, le Donbass, cette région. Et les immeubles, l'appartement dans lequel là on habitait, il était en fait... Toutes les vitres sont placardées. Parce que s'il y a une explosion, le vitre n'explose pas comme ça. Et donc ça fait toujours des ambiances étranges. On est là dans des immeubles, dans des appartements avec des planches de bois qui coffrent tout, avec du scotch qui barre tout. En fait, on est un peu dans ces espèces de... C'est un peu des espèces de cercueils, c'est très particulier. Donc voilà, c'est un des petits textes que j'avais écrits.
- Speaker #0
On va passer des notebooks à Il hurlait encore. Tout à l'heure, tu m'as expliqué que tu allais sur les terrains de guerre pour essayer de comprendre la violence, mais que finalement, elle était incompréhensible. Et plus on parle, plus j'ai l'impression que tu fais une photo, tu creuses ta photo quand même en faisant les notebooks, et tu creuses encore plus en retravaillant tes photos avec Il hurlait encore. c'est vraiment de De tirer la substantifique moelle de la violence.
- Speaker #1
Alors là, en particulier, c'est vrai que ce travail, effectivement, c'est un travail qui n'est qu'à partir d'archives, de photographies qui étaient déjà existantes, que moi, j'avais prises dans des reportages passés. Et je pense que ça a été un peu le fruit de toute une réflexion après la guerre en Ukraine, de toute mon expérience en tant que photographe sur ce terrain-là en particulier, sur, de manière générale, la surproduction d'images qui en est sortie et qui a... découler de ce conflit-là en particulier. Et puis, c'est vrai qu'après avoir travaillé pendant plus d'un an pour un journal quotidien, il y avait vraiment cette impression de travailler à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, de produire des images à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, et des images qui se ressemblent toutes, et qui ressemblent à toutes les autres images que d'autres photographes produisaient aussi. Ça a été vraiment particulier comme expérience. Et donc, effectivement, j'ai eu une espèce de saturation visuelle au bout d'un an et quelques à travailler là-bas, où je n'arrivais plus à voir, en fait. J'arrivais plus à voir mes photos, j'arrivais plus à voir les photos de manière générale et j'ai eu besoin de requestionner d'abord ma photographie et puis de requestionner la photographie de manière générale et notamment toute l'iconographie de la guerre. Et donc je me suis un peu attaquée... Alors la première image, le premier geste, c'est un peu l'image fondatrice de cette série. C'est cette espèce de visage d'un grand cri un peu déformé. Et ça c'est un jour, dans un acte un peu de colère... Je regardais un peu dans mes archives, c'était en 2023, c'est une période où j'avais fait un burn-out photographique, j'arrivais plus à produire de photographie, j'avais plus envie de toucher à mon appareil photo, j'étais vraiment un peu en rejet total. Et cette photo de ce mec qui crie en Irak, j'avais commencé à l'imprimer, puis je l'ai photocopiée, puis j'ai re-photocopiée, et puis je l'ai re-photocopiée, et un peu avec une colère en me disant, mais allez, combien de fois je peux la répéter cette image avant de vraiment la détruire en fait ? et avec un peu cette idée que la répétition des images, ça les détruit, on altère le sens. Et puis à un moment donné, la feuille a un peu bougé pendant la photocopie, ça a déformé le cri, c'est un peu le geste fondateur on va dire. Et donc après ça, je me suis dit, je crois que j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller requestionner mes images, j'ai envie d'aller les torturer un peu, j'ai envie d'aller les détruire en fait par la répétition, par répétition et par répétition. Puis après, il y a la photogravure qui s'est un peu mise dans le chemin aussi. Parce que la photogravure, c'était pareil, c'était une idée de répéter une image. Parce que du coup, j'ai fait tout un processus de création. Donc, je créais la plaque de gravure moi-même à partir de matériaux assez consciemment fragiles, avec l'idée qu'à chaque fois que je refaisais l'image, la plaque s'autodétruisait, donc l'image se détruisait aussi. Puis, il y a eu beaucoup la présence du charbon comme matériau organique dans toute cette série aussi, pour un peu essayer de contrer justement le manque, on va dire, de matérialité de l'image. Et là, ça a été vraiment cette envie de questionner ça, de questionner aussi la représentation même de l'image de guerre. Et puis de me réapproprier effectivement un peu le côté un peu plus créatif et artistique qui me manquait. Donc voilà, il laisse un peu cet équilibre entre mes travaux journalistiques qui nourrissent un peu ce travail plus artistique et ce travail artistique qui me permet de mieux faire mon travail journalistique aussi. parce que du coup j'ai aussi une... Un échappatoire où je peux être un peu plus dans l'émotion, où je suis un peu plus dans le questionnement, où je suis un peu plus dans la création par rapport à quelque chose. On est tenu à être très objectif, très neutre, assez peu créatif au final.
- Speaker #0
Mais du coup, c'est une question par rapport à ce que tu viens de dire, quand tu es sur le terrain de guerre, tu rentres dans un espèce de moule, tu te fermes à...
- Speaker #1
Sur un terrain, c'est compliqué de faire les deux, on ne peut pas... Dans le journalisme, déjà le rythme est tellement intense, on a assez peu le temps au final de se dire « tiens, je vais me faire un petit projet artistique à côté en parallèle » . Ce serait merveilleux d'avoir le temps, mais malheureusement pas sur de l'actualité, un peu de terrain comme ça, chaud. Et oui, et puis on est vraiment dans un truc. On bosse, on est dans un espèce de tunnel de travail énorme, on n'a pas vraiment le temps de prendre du recul sur les images qu'on a produites. Donc c'est quelque chose qui est venu après et qui m'a fait beaucoup de bien. Et en même temps j'ai eu besoin d'un certain temps avant de pouvoir le faire ce travail. Au début j'y arrivais pas, j'y arrivais même pas à re-regarder mes images. Et puis quand j'ai commencé à le faire je me suis rendu compte aussi dans le photojournalisme. Souvent on va faire un reportage, on fait aller 400 photos pendant la journée ou même 1000, on en envoie 30 à son journal et puis le lendemain on fait autre chose. Et donc en fait il n'y a que 30 photos qui ont été exploitées et le reste sont des fichiers RAW sur un disque dur qui dorment. Et puis ça dort, ça dort et puis au bout d'un moment on en accumule 10 000 qu'on n'a même pas traité et qui sont de l'espèce de matière brute comme ça. Et en fait là ça a été un peu le truc de tiens, je vais aussi prendre le temps de reservoler un peu tous mes disques durs, de re-regarder un peu tout ce que j'ai produit. Et c'est très intéressant de refaire un peu ça, mais ça, il faut le refaire avec du recul. Quand on a pris un petit pas de côté et qu'on est capable de nouveau de regarder ça d'un oeil nouveau. Et là, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Et c'est un projet qui est loin d'être terminé.
- Speaker #0
Il y a eu une exposition, mais c'est pas du tout...
- Speaker #1
Voilà, il y a eu une exposition, mais c'est un projet qui, en fait, mériterait aussi d'être poussé plus loin, je pense, dans la réflexion. J'ai l'impression que ce serait une source intarissable et que ce projet pourrait être le projet d'une vie. Et c'est possible, à mon avis, ça va être peut-être mon oeuvre artistique sera ce projet en fait. Même s'il se déclinera en plein de petits chapitres différents. Mais donc voilà, en tout cas, je suis encore loin d'avoir...
- Speaker #0
totalement exploiter ces sources-là.
- Speaker #1
Si tu pouvais choisir ton sujet utopique, idéal, quel serait ton sujet rêvé si demain une rédaction t'appelait en disant tu as carte blanche pour faire le sujet de tes rêves et tu as un bon budget,
- Speaker #0
en plus. Le rêve. Je ne sais pas du tout. Je sais que là, je fais un projet de résidence au musée de l'armée qui mélange justement de la photographie et quelque chose de plus plastique. et qui se porte vraiment sur les ruines de guerre. Et ça mélange la photographie, mais aussi une vieille technique archéologique, qui est le relevé d'empreintes par frottage au charbon sur des surfaces, donc les surfaces des ruines. Et je dois dire que je rêve d'aller faire ça sur des sites comme Palmyre, ou alors aller faire la ville entière d'Alep en frottage au charbon, et de faire un énorme travail vraiment sur la destruction matérielle des pays en guerre. Donc ça, oui, j'en rêverais. Après, si j'avais un énorme budget, j'irais repasser un an en Irak pour suivre mon projet sans fin sur le traumatisme. J'ai plein de choses. En tout cas, c'est sûr que ça serait toujours Moyen-Orient parce que c'est vraiment une région qui continue de vraiment m'intéresser et que j'ai vraiment mis de côté avec l'Ukraine. Donc là, ça fait depuis 2022 que je ne suis pas retournée. Donc, ce serait bien que j'y retourne quand même. Et voilà.
- Speaker #1
Pour finir cette conversation à Arles, est-ce que tu pourrais me donner ton coup de cœur et ton coup de gueule de la semaine ou du mois ?
- Speaker #0
Si, je sais. Mon coup de cœur énorme du moment, c'est encore une fois dans cette résidence que je fais. J'ai eu accès à des archives absolument fabuleuses, photographiques. Et il y a une photographie incroyable qui date de 1800 quelque chose. Et donc en fait c'est une technique photographique que j'ai découverte, c'est vraiment connu mais moi j'ai découvert ça. C'était des photographies en panorama faites avec plusieurs plaques. Et il y en a une absolument incroyable qui est une photographie après le siège de Sébastopol en 1800 quelque chose, j'ai pas envie de dire d'erreur dans la date. Et c'est fait en fait en plusieurs plaques, donc la photo est très longue, elle fait peut-être 70 cm de large sur peut-être 20 cm de haut. Et elle est composée en plusieurs plaques et ça fait un espèce de panorama, mais d'une beauté absolument incroyable et à tomber par terre. Et donc ça, ça a été mon petit coup de cœur du moment où je me suis dit wow, c'est trop beau. Et voilà, je suis en train de redécouvrir un peu la photographie d'un point de vue vraiment très, très, très historique. Et notamment la photographie de guerre d'un point de vue historique que je connaissais assez peu au final. Et où moi, je pensais que c'était que des vieilles photos en noir et blanc comme on en voit dans les manuels scolaires. Et en fait, il y a une richesse incroyable à partir de 1840, 50, 60, etc. Donc ça, c'est mon coup de cœur. Je ne sais pas si c'est très original, mais voilà. Et mon coup de gueule, j'ai déjà de me faire planter pour un workshop auquel je devais participer. Et je crois que mon coup de gueule, c'est de manière générale dans l'industrie de la photographie, en fait. La manière dont on est un peu quand même assez mal... Assez mal traité, à quel point on est parfois un peu des pions interchangeables. Et j'avoue que c'est un peu mon coup de gueule, mais c'est un coup de gueule que tous les photographes, on a tous ce coup de gueule en ce moment. C'est que l'industrie se porte mal et que c'est de plus en plus compliqué financièrement et que c'est de moins en moins éthique. Et c'est pour ça que c'est bien aussi parfois de venir à Arles. Ça nous rappelle aussi ce qui nous rassemble un peu dans ce milieu. Ça permet aussi de se rassembler dans des moments vraiment positifs. Et à travers des événements vraiment cool et de se rendre compte qu'en fait, c'est bien de se serrer les coudes et c'est bien d'être collectif. Et donc voilà.
- Speaker #1
Oui, je pense que le collectif a une toute dernière question. Qu'est-ce que t'amènes le collectif ?
- Speaker #0
On est dans un métier qui est quand même foncièrement solitaire, sinon, et qui est très, très rude. Franchement, c'est un métier qui est vraiment, vraiment compétitif. C'est un métier qui se meurt, enfin qui se meurt, en tout cas, l'industrie se meurt. Financièrement, c'est extrêmement difficile. Et du coup, c'est un peu facile d'être remplie de désillusions et d'être un peu épuisée. Moi, je sais que là, cette année, par exemple, Dieu merci, j'ai des choses vraiment très, très cool qui se sont mises en place. Des bourses, des résidences, une belle expo, etc. Mais 2023-2024, ça a été des années de déprime absolue. En 2024, j'étais prête à arrêter la photographie.
- Speaker #1
Malgré le fait que tu sois... Nombre de Myop. Oui,
- Speaker #0
mais parce qu'en fait, Myop, il y a des limites dans ce que Myop peut apporter. C'est-à-dire que Myop, ils ne sont pas là non plus pour nous amener des commandes sur un plateau d'argent. Ce n'est pas leur rôle, malheureusement. Un soutien moral, photographique. Mais malheureusement, quand on ne sait même pas comment on va payer son loyer le mois d'après, et quand on n'a pas la moindre commande, et quand on a l'impression vraiment d'avoir fait un choix de vie vraiment dangereux et compliqué et instable. Parfois on se dit, est-ce que ce métier me rend plus malheureuse ou heureuse ? Et quand la réponse a tendance à aller plutôt du côté de plus malheureuse qu'heureuse, on se dit, qu'est-ce que je fais là ? C'est vrai que c'est un métier qui est très dur, parce qu'il y a des moments où c'est très facile de désespérer, où c'est très facile de se sentir extrêmement seule, même si on est bien entouré, et puis je suis entourée de photographes qui traversent aussi les mêmes choses. Donc quand on est tous un peu au fond du trou, c'est compliqué collectivement de se relever. Mais voilà, c'est normal, ça fait partie un peu des aléas du métier. Mais voilà, c'est vrai que ça fait du bien quand on est à Arles, parce que ça permet un peu de se détendre, voir des choses un peu positives, que sinon on a un peu tendance à perdre de vue. Et voilà, ça fait du bien.
- Speaker #1
En tout cas, je souhaite une superbe semaine à Miop. et je te souhaite une super semaine et une très belle année parce qu'elle s'annonce meilleure que 2023-2024 et à très bientôt Chloé merci beaucoup