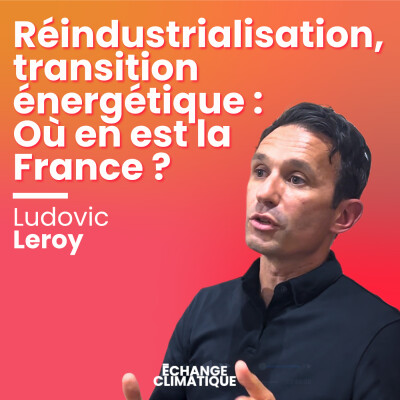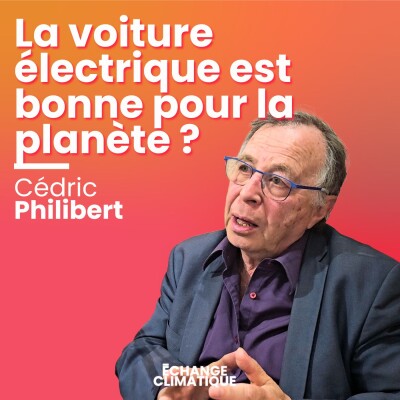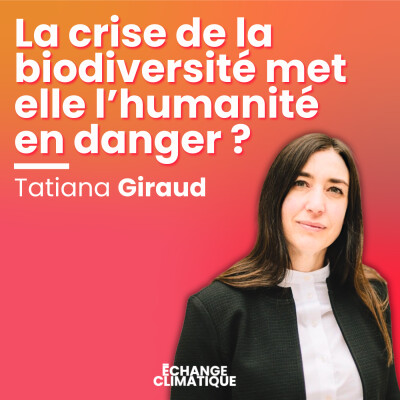- Speaker #0
Lorsqu'on pense aux gestes pour la planète, on pense bien sûr à manger moins de viande, privilégier le vélo à la voiture, le train à l'avion. Et c'est essentiel, il faut continuer à le faire dès que possible. Mais en démocratie, notre pouvoir ne s'arrête pas à nos choix individuels. Manifester, rejoindre des associations, signer des pétitions, interpeller nos élus, voter, ce sont aussi des leviers puissants pour faire changer les choses. Le Green Deal européen, par exemple, succède entre autres aux marches pour le climat des années 2018-2019. Mais aujourd'hui, l'élan semble retomber. Le climat glisse. peu à peu en bas des priorités et en conséquence, les politiques environnementales reculent. Pourquoi ce désengagement ? Comment raviver cette flamme collective ? Les sciences cognitives ont des réponses. Pour en parler, je reçois Mélusine Bounfalleur. Elle est chercheuse en sciences cognitives et enseigne à Sciences Po Paris. Ses travaux portent sur les freins psychologiques, individuels et collectifs, à la transition écologique. Comment encourager l'action collective face au changement climatique ? C'est le thème de cet échange climatique. Bonjour Mélusine Boutefalard.
- Speaker #1
Bonjour.
- Speaker #0
Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
- Speaker #1
Oui, alors donc je m'appelle Mélusine et je suis chercheuse en sciences cognitives et aujourd'hui je suis donc chercheuse et professeur à Sciences Po Paris et mes recherches portent sur deux grandes thématiques. La première c'est quels sont les freins à l'action climatique ? Pourquoi est-ce Est-ce que, alors, bien même qu'on est conscient du problème... Est-ce qu'on n'est pas en train de changer le système ? Et l'autre volet de mes recherches porte sur les inégalités sociales. Et je m'intéresse beaucoup à l'effet de la pauvreté, à l'effet de la précarité sur la prise de décision. Évidemment, ces deux sujets peuvent parfois s'entremêler. Il y a le climat exacerbe les inégalités sociales. Et les inégalités sont souvent un frein à l'action climatique. Et donc, je m'intéresse aussi au croisement entre ces deux sujets.
- Speaker #0
Tu viens peut-être un petit peu de répondre à cette question, mais est-ce que tu peux peut-être rappeler à quoi peuvent servir les sciences cognitives pour lutter contre le changement climatique ?
- Speaker #1
Oui, alors je pense que la première approche, déjà aujourd'hui, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a les solutions techniques, on a le savoir-faire et on a les ressources financières pour faire la transition écologique. On a tout ce qu'il faut, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, il ne faut pas me croire sur parole. C'est l'économiste coréen Ho Sung-li, qui était le président du GIEC, qui dit ça. Donc aujourd'hui, on a de quoi faire la transition, mais ce qui nous manque, c'est une volonté politique forte pour passer à l'action. Et donc, les sciences cognitives et les autres sciences sociales peuvent nous informer sur comment générer, comment mobiliser cette volonté politique forte. Donc on sait qu'il faut que les individus passent à l'action. Et alors quand moi je parle de passage à l'action, de mobilisation autour du climat, je ne parle pas des petits gestes. Je ne parle pas d'arrêter l'avion, la viande, la voiture, etc. C'est très important, il faut le faire. Mais ce n'est pas ça ce qui va nous permettre de résoudre la crise climatique. Aujourd'hui, la question à laquelle on doit répondre, ce n'est pas comment motiver les gens à être plus écolos. Ça, c'est important, mais ça ne suffit pas. Mais c'est plutôt comment... est-ce qu'on change le système pour rendre le système, notre économie, nos échanges, toutes les sociétés plus écologiques ?
- Speaker #0
Est-ce que toi, tu as le sentiment qu'on s'est trop penché sur la question comment changer les individus pour leur faire faire des petits gestes et pas assez comment les individus peuvent changer leur société ?
- Speaker #1
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'est pas assez penché sur la question de comment est-ce qu'on peut changer le système et comment est-ce qu'on peut motiver les individus à changer le système. donc moi ce qui m'intéresse c'est pas tant que que Florian, arrête de manger de la viande ou arrête de prendre la viande, c'est très bien si tu le fais, mais ce qui est plus important, peut-être, c'est que Florian vote en faveur de politique écologique, que chaque individu milite à son échelle, que ce soit une échelle très locale ou une échelle plus globale, mais milite pour un changement systémique, parce que c'est de ça dont on a besoin. Aujourd'hui, être écolo, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on est dans un monde où même les plus vertueux, vertueux, les plus... les personnes qui ont le plus envie d'être écolo sont quand même dans un système où tout est fait pour nous pousser à consommer trop de ressources à polluer. Et donc, plutôt que de s'astreindre à une discipline immense, peut-être on peut le faire, et d'ailleurs ça a plein de bénéfices même en termes de cohérence cognitive, on se sent moins, on n'a pas cette dissonance interne, ça c'est bien pour ça, mais par contre, tant qu'on ne change pas le système, tant qu'on ne réforme pas en profondeur l'économie, la politique, etc., on n'y arrivera pas. Et donc, il faut motiver les individus à changer ce système et trouver quel système, quel mode de distribution de ressources, quel mode de production de ressources va nous permettre de résoudre à la crise climatique et puis aux crises écologiques plus larges.
- Speaker #0
Si tu as décidé, toi, de te porter sur ce sujet, c'est que j'imagine que tu trouves, et les autres chercheurs dans ton domaine, constatent qu'il y a un petit peu un fossé entre ce qu'il faudrait faire et euh Et ce qui est fait, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se mobilisent activement pour le climat, alors même que tout de même le changement climatique, ses effets se font de plus en plus sentir. Et en plus, il y a même en parallèle une espèce de recrue de sens du climato-scepticisme aussi.
- Speaker #1
Oui, alors... qu'en est-il de l'attitude de la population pour le climat ? Est-ce qu'on est prêt à agir ? Est-ce qu'on a ce qu'il faut ? Ou est-ce qu'on est encore bien loin de cette révolution sociale qu'il nous faut, ou en tout cas de transformation profonde à la société ? D'une part, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de l'urgence climatique. La situation a fondamentalement changé par rapport à il y a 20 ans, où les enjeux climatiques, en 2005, restaient encore assez distants, assez nébuleux pour la plupart des personnes.
- Speaker #0
C'est une histoire d'ours polaire.
- Speaker #1
Exactement. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est 2004 ou 2005, la sortie du film Une vérité qui dérange, de Al Gore et de son livre. Et c'était un peu le premier grand moment médiatique, disons, de la crise climat. C'est ces moments-là qui ont permis, mais on était vraiment aux prémices de cette prise de conscience. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Aujourd'hui, dans les enquêtes, c'est 7 Européens sur 10 qui disent avoir ressenti... dans leur région les effets du changement climatique. Donc ils sont conscients que ça change et ils peuvent attribuer ça à un changement climatique. Dans les enquêtes aussi, c'est la vaste majorité de la population qui se dit concernée par le changement climatique, qui dit qu'ils aimeraient avoir des politiques plus ambitieuses sur le sujet, qu'il faudrait qu'on en fasse plus, que les entreprises doivent se mobiliser, etc. Donc il y a une vraie prise de conscience sur ces enjeux. Ce qui ne veut pas dire que... Tout le monde en a conscience. Aujourd'hui, on parle beaucoup, en 2025, de la recrudescence du climato-scepticisme. Et là, il faut bien apporter des nuances sur cette question où il y a plusieurs formes de climato-scepticisme. Il y a ceux qui disent que le climat ne change pas, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Et ça, c'est une petite minorité de la population. C'est moins d'un Français sur dix qui pense que le climat ne change pas. Et ça, il y a une... légère augmentation de ce chiffre, qui peut être liée à certains effets encore du Covid, de certaines chambres d'écho en ligne, de théories du complot, etc., qui ont peut-être un peu contribué à cet effet. Après, il y a d'autres climato-sceptiques qui pensent que le climat change, ont conscience qu'il y a du changement climatique, mais qui remettent en cause les origines humaines du changement climatique, qui disent soit que les humains ne sont pas du tout responsables, que c'est juste des changements des cycles naturels de la Terre, soit que les humains sont responsables, mais pas à 100%. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là remettent en cause le consensus scientifique, parce qu'il faut quand même le rappeler, aujourd'hui, on est à près de 100% des publications scientifiques sur le climat qui sont d'accord pour dire qu'il y a un changement climatique et qu'il est à 100% d'origine humaine. Donc il y a vraiment peu de sujets scientifiques où il y a autant de consensus. Même en physique, il n'y a pas autant de consensus sur n'importe quel phénomène physique. Là, on est vraiment à un degré de consensus vraiment extrême. Mais certaines personnes n'en ont pas conscience. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré cette remise en question du consensus, ces personnes peuvent par ailleurs soutenir des politiques écologiques, être en faveur du développement des énergies renouvelables. Et donc oui, il y a du climato-scepticisme quand on pose la question est-ce que les humains causent le changement climatique ? Mais est-ce que ça se traduit nécessairement par une opposition politique à la transition écologique ? Eh bien, ce n'est pas automatique.
- Speaker #0
OK. Donc, c'est vrai que ce chiffre de un tiers, parce qu'il y a plein de chiffres qui circulent, ça va entre 10 et 40 %, en moyenne, on tombe à peu près sur un tiers en France de climato-sceptiques. Donc, ce n'est pas aussi...
- Speaker #1
Voilà, c'est un tiers de personnes en France, effectivement, qui remettent en cause le consensus scientifique. Mais ce n'est pas un tiers de personnes qui sont contre la transition écologique. Il faut bien faire la différence entre ces différents aspects.
- Speaker #0
Vers 2018, c'était l'époque des marches de climat, c'était l'époque de l'affaire pour tous, ou l'affaire à tous, notre affaire à tous. C'était l'époque de la Convention citoyenne pour le climat, etc. Greta Thunberg aussi est émergée à cette période-là. Et on a l'impression qu'on arrivait presque à un point de bascule qui allait emporter un peu toute la population, que ça y est, enfin, on allait se mettre à fond pour lutter contre le changement climatique. Et finalement, en 2025, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de manifestations dans les rues. On n'entend plus trop parler de Greta Thunberg. Est-ce que toi aussi, tu constates un peu un recul ? Et si oui, comment tu l'expliques ? Est-ce que c'est une déception par rapport aux élus ? Ou est-ce que c'est parce que le Covid est passé par là ? Tout un tas de conflits qui émergent. C'est presque légitime que l'ordre de... de priorité, je pense.
- Speaker #1
Voilà, alors ici, je pense que ce qui est... De nouveau, il faut faire la différence entre est-ce que le climat a complètement disparu des préoccupations des individus, ou est-ce qu'il n'est simplement plus la préoccupation première ? Alors, je pense que c'est tout à fait légitime. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus la préoccupation première d'un certain nombre d'individus. Donc, quand on demande, quand on fait des enquêtes du style « Quelles sont vos trois plus grandes préoccupations ? » Alors qu'avant, peut-être que le climat figurait presque systématiquement chez les individus, aujourd'hui, il ne fait plus partie du top 3 ou du top 1 des préoccupations. Ça va être remplacé par des choses comme la sécurité, liée à des enjeux de la guerre, le pouvoir d'achat lié à la récession économique, etc. Et donc, le climat va être peut-être moins au devant de la scène. Et donc, ça, oui, ça s'explique par simplement le fait qu'il y a d'autres enjeux qui sont plus urgents, plus pressants. et ça, on le sait bien, notre cerveau a tendance à être... plus concernés par ce qui est plus urgent, par ce qui est plus pressant aujourd'hui. Et bien sûr, si on n'a pas de quoi manger à la fin du mois, eh bien, la fin du monde, c'est moins important, ce sera remis à plus tard. Si on a l'impression qu'il y a une menace immédiate de la sécurité du territoire français, eh bien, ça, ça va prendre le pas sur le climat qui est un phénomène plus diffus ou qui est perçu comme quelque chose de plus de long terme. Est-ce que, pour autant, le climat a complètement disparu des préoccupations ? Eh bien ça, de nouveau, les enquêtes semblent montrer que non, le climat fait toujours partie des préoccupations. Et d'ailleurs, entre 2019 et 2025, il y a eu un certain nombre de progrès sur ces questions climatiques, que ce soit sur l'engagement des individus, de plus en plus de gens adoptent des pratiques durables au quotidien, mais aussi, et c'est le plus important, des changements peut-être plus systémiques. l'engagement de certaines entreprises dans des transitions vers net zéro, vers zéro émission carbone, des politiques climatiques plus ambitieuses. Alors oui, évidemment, quand on fait des politiques climatiques plus ambitieuses, eh bien, ça génère plus de backlash. Parce qu'évidemment, si on ne fait que parler de la crise climatique, bon, a priori, ça ne gêne personne. Quand on commence à mettre en place des politiques où va y avoir des gagnants et des perdants, où va y avoir un certain nombre d'entreprises, d'organisations, d'individus qui vont être, du moins sur le court terme, pénalisés ou vont devoir faire un effort pour répondre à ces politiques, eh bien c'est normal que c'est à ce moment-là que ça commence à coincer, qu'on commence à avoir des personnes qui s'y opposent.
- Speaker #0
Oui, juste un mot, parce que tu parlais de l'inflation tout à l'heure, et en plus une partie de l'inflation, elle est driveée par le changement climatique, en tout cas l'inflation notamment alimentaire, avec le prix du... les paniers coûtent de plus en plus cher parce que les récoltes sont de plus en plus influencées négativement par le changement climatique. Bref, si les gens faisaient peut-être un peu le lien, mais ce n'est pas évident d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de l'inflation, on entend la radio, etc. Le lien n'est pas toujours fait avec le changement climatique, pourtant il existe. Donc tu parlais de ce backlash, et le problème avec ce backlash c'est qu'il a des conséquences aussi sur les politiques qu'on adopte. On voit que le Green Deal n'est pas complètement détricoté, mais en tout cas, Il est un peu relâché, notamment sur les dates butoirs où telle entreprise devait reporter sur ses activités, etc. Du coup, cette dépriorisation a un réel impact sur l'environnement.
- Speaker #1
Tout à fait. Alors, tu as parlé d'un phénomène hyper intéressant et très important pour comprendre peut-être ce manque d'engagement sur la question climatique. c'est cette opacité entre les causes et les conséquences du changement climatique. Donc tu disais, le changement climatique, c'est un des facteurs de l'inflation. Typiquement, avec les sécheresses, le canal du Panama a été plus difficile à croiser, on a dû réduire le flux, ça, ça retarde tout le commerce mondial et tous les prix vont augmenter. Mais ça, ce n'est pas visible. Personne ne se dit, tiens, il fait plus chaud et c'est ça ce qui fait que mon paquet de pâtes coûte 30 centimes de plus. surtout que au final, il fait... On ne le perçoit pas forcément toujours, cette augmentation de la température. Et donc, c'est très difficile de pouvoir lier. On n'a pas le lien de cause à effet, on n'a pas un modèle dans notre tête qui nous permet de voir explicitement, tiens, si je vote pour cette politique, si je soutiens cette personne, si je travaille pour cette entreprise, eh bien, je vais contribuer à la pollution qui entoure notre planète, qui va réchauffer la planète et causer tout un tas de dégâts. Ça, on ne s'en rend pas compte, ce n'est pas explicite. Et donc, évidemment, ce n'est pas pris en compte dans nos choix politiques, ce n'est pas pris en compte dans notre travail, dans nos choix sociaux, etc. Et donc, rendre visibles ces liens de cause à effet, montrer que, ben oui, plus ou moins on va investir dans des énergies renouvelables, plus on va continuer à investir dans des énergies fossiles, et bien plus on va se lier les mains vers des trajectoires qui vont augmenter le coût de la vie, augmenter l'instabilité. augmenter les risques d'inondations, de sécheresses, etc. vont augmenter le risque que notre maison ne pourra plus être assurée, parce qu'elle sera dans une zone trop dangereuse. On n'aura plus les fonds pour se protéger de tout ça. Et donc, une chose importante, c'est de rendre visibles ces liens de cause à effet. Il y a des études en sciences cognitives qui montrent que lorsqu'on comprend un phénomène, lorsqu'on a compris le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose, on est plus susceptible d'agir. Évidemment, personne n'aime suivre des ordres un peu à l'aveugle. C'est quand on a compris pourquoi on le fait, pourquoi est-ce que c'est bon, pourquoi c'est utile, qu'on est motivé pour le faire.
- Speaker #0
Je termine avec les enfants, d'ailleurs, par ailleurs.
- Speaker #1
Effectivement. Et ça, les parents se reconnaîtront peut-être là-dedans de dire... Déjà, les enfants, on va d'abord demander pourquoi. Et puis, si on leur dit, tu vas te coucher tôt, mais comme ça, demain, tu vas être en forme pour pouvoir voir tes amis, eh bien, ça marche mieux. Tandis que si on dit juste... couche-toi tôt, ça peut générer des problèmes de rouspétage de la part des enfants.
- Speaker #0
Oui, non seulement on ne voit pas tout de suite les conséquences en conduisant sa voiture, il n'y a pas le prix des pattes derrière qui va augmenter instantanément. Donc c'est aussi une question de... C'est loin en termes de spatiaux, spatial je veux dire, tu parlais du canal du Panama, mais aussi en termes temporels, les effets sont un petit peu... Comment dirais-je ? Retarder ou pas retarder, mais bon,
- Speaker #1
voilà ce que je veux dire. Ça, c'est un autre frein qui est bien connu en sciences collectives, c'est donc notre biais d'immédiateté, le fait qu'on a tendance à être plus préoccupé par ce qui nous arrive maintenant que ce qui nous arrive dans le futur, et aussi le fait qu'on préfère les récompenses immédiates aux récompenses dans le futur. Probablement que la plupart des gens préfèrent recevoir 100 euros aujourd'hui que 150 euros dans un an. Parce que le futur, il est distant, il est incertain, peut-être qu'on ne sera plus là pour le récolter, etc. Et évidemment, beaucoup d'enjeux écologiques, c'est un coût immédiat. Il faut investir dans la transition, il faut investir pour rénover son logement, il faut reformer énormément d'individus à des professions vertes, il faut faire tout ce genre de choses. donc le coût il est immédiat mais le bénéfice il est sur le long terme et donc comme on a tendance à préférer les bénéfices immédiats et bien on ne va pas investir, on va être moins motivé pour investir dans la transition écologique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut essayer de rendre ces bénéfices du futur plus visibles, on peut essayer de dire, non, non, non, en fait, on va gagner tout ça, essayer de les rendre moins abstraits, même s'ils ont lieu dans le futur, en parler, les rendre plus visibles, ou on peut essayer de trouver des manières d'avoir des bénéfices dès maintenant, et typiquement, on sait que pour mobiliser sur tout un tas de questions écologiques, eh bien, les questions de santé, peuvent être plus mobilisatrices parce que les bénéfices sont immédiats. Typiquement, là, récemment à Paris, eh bien, il y a eu un rapport de Air Paris qui s'intéresse à la pollution de l'air dans Paris. Et on voit que, alors il me semble que c'est ces dix dernières années, la pollution de l'air à Paris a été divisée par quatre. C'est énorme. Ça, c'est énormément de maladies respiratoires qui vont être évitées grâce à ça. Et ça, c'est un bénéfice qu'on a tout de suite. grâce aux politiques de limitation de la voiture dans les centres-villes et limitation de la vitesse. Ça, c'est un truc dont on peut profiter tout de suite. Tandis que les effets sur le climat de toutes les émissions de gaz à effet de serre qui vont être évitées grâce à cette politique, ça, ça va être beaucoup plus lointain. On ne va pas en profiter tout de suite.
- Speaker #0
Oui, il y a un autre problème que je vois, c'est que si, comme le climat, c'est un problème global, si nous, à notre échelle, on fait des efforts, et bien c'est pas pour autant que les pattes ne vont pas continuer de devenir de plus en plus chères parce que ça ne veut pas dire que les autres vont... faire l'effort aussi. Je crois que ça s'appelle le freerider ou quelque chose comme ça.
- Speaker #1
Oui, exactement, le problème du freerider. Le freerider, il faut avoir une image de quelqu'un qui s'accroche à un wagon mais sans faire d'effort, sans payer pour sa place dans le train. Et donc là, c'est tout ce problème-là où personne n'a envie de payer ou de subir les coûts de l'effort de la transition écologique. si d'autres ne font pas cet effort mais en profitent quand même. En fait, c'est tout ce qu'on appelle parfois aussi le dilemme des communs ou les problèmes d'action collective, ou parfois on appelle même ça la tragédie des communs, où le coût de l'effort, il est individuel, il est personnel. Si un individu, une entreprise, une collectivité locale, un pays décide de s'engager dans la transition écologique, eh bien, c'est cet individu, cette collectivité, ce pays qui va en... payer le coût, qui va devoir investir dans cette technologie. Par contre, le bénéfice, il va être partagé par tout le monde. Et dans le cas du climat, c'est vraiment la planète entière qui va pouvoir bénéficier de cette réduction de la pollution. Et donc, évidemment, personne n'a envie de payer pour quelque chose dont tout le monde va profiter. C'est un peu comme quand on vit en colocation. On n'a pas envie d'être celui qui fait toujours le ménage alors que tout le monde profite de l'appartement libre. On a envie que les coûts soient répartis équitablement. Et donc ça, c'est un facteur qui est très, très démotivant si on a l'impression d'agir seul.
- Speaker #0
Dans la vraie vie, on parle souvent, par exemple, du jet privé de Bernard Hannault. C'est un truc qui revient souvent sur les réseaux sociaux. Même chez les écolos.
- Speaker #1
Alors là, ça touche à deux sujets. C'est à la fois, il y a quelqu'un qui ne coopère pas, qui ne fait pas de sa part. Bernard Arnault, pour le prendre en exemple, mais il y en a tout un tas d'autres. C'est pas lui en particulier.
- Speaker #0
C'est les gens les plus riches.
- Speaker #1
Voilà, les élites économiques qui semblent freerider, qui ne font pas leur part d'effort. Et donc, c'est très démotivant. Et en plus, il y a non seulement un sujet de coopération, mais il y a aussi un sujet d'équité. Oui, là, ce n'est pas juste n'importe qui qui ne fait pas sa part. C'est quelqu'un qui contribue de manière disproportionnée aux problèmes climatiques. Donc, ce n'est pas juste Bernard Arnault a mangé un steak cette semaine, c'est Bernard Arnault a pris un jet privé. Et donc, un individu va représenter parfois mille fois plus d'émissions de gaz à effet de serre, mille fois plus de pollution qu'un autre. et donc on se dit si Non seulement les autres coopèrent pas, mais ceux qui contribuent le plus au problème ne font rien. Et donc ça, c'est un sentiment d'inéquité, d'injustice qui est très très fort et qui est aussi très démotivant. Et donc c'est pour ça que les élites économiques, en fait, la raison pour laquelle elles doivent s'engager, c'est pas juste l'effet direct de leurs émissions de gaz à effet de serre. Que Bernard Arnault arrête de prendre son jet privé, effectivement, ça va pas changer grand chose pour le climat. Oui, c'est des milliers de tonnes de carbone, mais ce n'est pas ça ce qui va sauver la planète ou non. Donc les émissions directes, elles sont importantes, il faudrait quand même qu'ils le fassent, mais ce n'est pas ça ce qui va tout changer. Quand on pense au jet privé de Bernard Arnault, mais de tous les autres, on a quand même eu un autre exemple qui a choqué vastement la planète, c'est plusieurs femmes, plusieurs célébrités américaines qui ont fait un petit tour dans l'espace. avec comment s'appelle la société de... non c'était pas SpaceX, c'était Blue je sais plus comment... oui Blue Origin, oui voilà donc ces célébrités qui vont passer quelques secondes dans l'espace avec Blue Origin de Jeff Bezos ce qui représente un voyage qui représente les émissions de gaz à effet de serre de toute une vie pour la plupart des individus sur Terre Et donc là, ce qui compte, ce n'est pas juste ces émissions directes, mais c'est l'effet indirect de ces pratiques qui a un effet démotivateur sur l'ensemble de la population. Où tout le monde va se dire, si ces personnes, si Bernard Arnault prend son jet privé, pourquoi est-ce que moi, je ferais un effort dans mon quotidien ? Ou pourquoi est-ce que moi, je voterais pour des politiques climatiques ? De toute façon, ça ne sert à rien et c'est injuste. Et donc, la raison pour laquelle on a vraiment besoin d'exemplarité de ces élites, c'est pas tant C'est en partie pour l'effet direct de leur comportement, la pollution directe que ça génère, mais aussi pour l'effet indirect de leur comportement sur la motivation de tous les autres.
- Speaker #0
Oui, ça c'est un truc, c'est un peu la symbolique. Et j'ai l'impression que c'est très souvent omis ou ignoré par le profil type ingénieur qui va regarder le tableau Excel avec le nombre de consommations et qui ne voit pas toutes ces... cette influence et cet effet un peu en cascade que ça peut avoir. Et c'est regrettable et en même temps, c'est un peu le lot des sciences sociales de manière générale.
- Speaker #1
Effectivement, moi, j'enseigne un cours de psychologie et de transition écologique où justement, j'essaie d'aborder tous ces sujets en disant que pour réussir la transition, il faut qu'elle soit compatible avec les humains. Et un exemple que je cite souvent en cours, c'est ce qu'on appelle l'effet Cobra. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. L'effet Cobra, ça vient d'une histoire vraie qui s'est passée en Inde au XIXe siècle pendant l'ère coloniale anglaise où le gouvernement anglais, il me semble que c'était à New Delhi, avait un problème où il y avait une infestation, une prolifération de cobras dans la ville de Delhi à l'époque. Et évidemment, ces cobras posent problème, etc. Et du coup, l'administration coloniale anglaise s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter la population de cobras ? Eh bien, très simple, on va mettre en place un système de récompense. Toutes les personnes qui nous amènent un cobra mort vont recevoir une compensation financière et comme ça, tout le monde va vouloir tuer les cobras, il n'y aura plus de problème de cobra dans la ville. Et effectivement, si on a une vision ingénieure ou très économiste de ce problème, on se dit ça va marcher. Sauf que, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? des personnes un peu malignes se sont dit « Moi, je vais faire un élevage de cobras, ce qui va me permettre d'en avoir tout plein et de recevoir énormément d'argent du gouvernement. » Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et le gouvernement anglais, quand il a réalisé, quand il a découvert l'existence de ces élevages, a mis fin au programme en se disant « On va arrêter de payer pour les cobras morts. » Et donc, tous ces éleveurs qui avaient a mis en place ces élevages, ont décidé de relâcher les cobras dans la ville, ce qui au final a donné lieu à une augmentation de la population de cobras à délire. Et donc une politique qui, sur papier, a l'air tout à fait fonctionnelle, on se dit ben voilà, on va payer les gens pour qu'ils tuent des cobras, ça va forcément marcher, a eu exactement l'effet inverse. Et donc si on ne prend pas en compte la psychologie, le comportement des individus, si on ne s'intéresse pas à qu'est-ce qui va motiver les gens à... à soutenir des politiques publiques, qu'est-ce qui va les motiver à changer les modes de production, etc. On peut se retrouver à générer exactement l'inverse de ce que l'on veut. Et donc, typiquement, oui, les politiques qu'on appelle parfois les politiques symboliques, où on va venir avoir une politique très forte qui n'a pas un effet direct important, par exemple, en termes de pollution, mais qui va avoir un effet très important sur la mobilisation, c'est important de les faire.
- Speaker #0
Il y a un autre problème que je vois, c'est que même si on veut agir, on peut se dire que de toute façon ça ne sert à rien, parce que nos politiques peut-être sont des incapables. Par exemple, si je prends l'exemple de la voiture électrique, on peut se dire que la voiture électrique, de toute façon c'est pire que la voiture thermique. Alors pourquoi je suivrais, pourquoi je voterais pour des gens qui veulent la démocratiser ? Comment on fait face à ce problème ? Merci. On ne peut pas se mentir, ces dernières années, on a quand même des bonnes raisons parfois de douter dans nos politiques. Donc comment on fait ? Parce que c'est eux au final qui y agissent.
- Speaker #1
Oui, et ça, en France, on est un petit peu les champions de ça, de dire « de toute façon, c'est trop tard » ou « de toute façon, ça ne sert à rien » . Malheureusement, beaucoup de gens ont cette attitude face au climat en disant « ça ne sert à rien, on n'y arrivera pas, on ne changera rien » . Et donc oui, alors du point de vue des politiques, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème ? Eh bien déjà, il faut avoir des politiques claires et s'y tenir. Lorsqu'on change régulièrement d'avis, eh bien ça crée de la confusion. Et donc parfois, il faut être peut-être un peu moins complexe, moins ambitieux, mais rester clair. Et comme ça, on peut bâtir sur le long terme. L'autre chose, c'est aussi d'être très transparent dans le niveau de confiance qu'on a. De dire voilà, on va peut-être tester, on va piloter certaines solutions. On va voir si ça marche ou pas.
- Speaker #0
Je trouve qu'on fait quand même très mal, je ne sais pas quand c'est dans d'autres pays, mais en France, par exemple, lors de la crise du Covid, il y avait... Très peu de transparence. Au lieu de dire, on ne sait pas, on est dans le doute, on a surtout dit, ouais, on sait, c'est comme ça, les masses, ça ne sert à rien, puis les masses, ça ne sert à quelque chose. On n'a pas... Je vois ce que je veux dire, c'est que... Bon, bref, je te laisse continuer.
- Speaker #1
C'est difficile, parce que c'est difficile de communiquer sur l'incertitude. Et donc, on peut être tenté d'être très confiant en se disant, voilà, c'est avec cette confiance en soi, cette assertion qu'on va pouvoir embarquer la population. Mais évidemment, quand on change de cap, ça vient éroder le capital confiance qu'on a en tant que politique. Et donc, c'est un équilibre assez fin à trouver, parce qu'évidemment, si à chaque fois qu'on propose quelque chose, on dit « Ah, on ne sait pas trop, peut-être ça va marcher, peut-être pas » , etc. Ça peut poser problème. Mais trouver le bon degré d'humilité en tant que décideur politique peut être très important. Et surtout, là, il y a une solution toute faite, c'est simplement de tester. à plus petite échelle des politiques avant de les déployer à plus grande échelle. C'est malheureusement une culture qui n'est pas encore très courante dans les administrations, de tester, de mesurer l'impact et puis de déployer à plus grande échelle. Mais petit à petit, c'est les choses qui se développent. Et c'est compliqué, il y a des vrais enjeux d'équité en se disant je ne vais pas déployer la même politique sur tout le monde en même temps. on va d'abord faire ça sur une région ou un groupe d'individus, eh bien, ça pose tout un tas de problèmes de démocratie, d'équité. Et donc, parfois, ce n'est pas toujours possible. Mais il y a parfois des opportunités qui se présentent aussi. Ensuite, l'autre question, c'est de se dire, voilà, ça, c'est du point de vue du politique, mais du point de vue de l'individu, comment ne pas être dans cette forme de doute ou d'apathie ? Eh bien, un des ingrédients qui est important pour passer à l'action, pour avoir envie de changer le système, mais surtout qui est très important dans l'activisme, ... c'est le sentiment qu'on appelle l'efficacité collective ou le sentiment d'efficacité individuelle. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ce sentiment d'efficacité ? C'est la confiance dans le fait que lorsqu'on agit, ça va servir à quelque chose. Et donc ça, pour beaucoup, de nouveau, ça revient un peu sur cette question de « on ne voit pas les liens de cause à effet » . Donc on se dit « est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Est-ce que ça marche ? » On ne sait pas, on n'a pas un retour direct. sur notre action. Pour reprendre l'exemple tout à l'heure, quand on fait du vélo, on ne voit pas le prix des pâtes qui décroît. Donc, parfois, on a l'impression, on peut se demander est-ce que ça sert à quelque chose ? Et puis, comme c'est des choses qui sont complexes, ça peut être très bien dans un domaine. Et puis, en fait, ce qui est bon pour le climat peut être parfois mauvais en termes de biodiversité. Et donc, il faut arriver à naviguer là-dedans.
- Speaker #0
C'est vrai. Enfin, juste, j'abonde. Mais en fait, c'est vrai que dans le climat, on nous a dit... plein de trucs à une certaine époque, où aujourd'hui, on est quand même revenu en arrière, donc on ne sait plus trop sur quel pays on s'est. Si je prends l'exemple des chaudières à bois à la maison, maintenant, on nous dit que ça pollue l'air. Si je prends l'exemple de la forestation, c'est-à-dire planter des arbres, maintenant, on nous dit qu'en fait, c'est des arnaques, c'est des schemes pas possibles. Donc, quelque part, c'est un phénomène complexe. Comme tu dis, c'est la biodiversité qui est liée à tout ça, et donc c'est très difficile, finalement, d'avoir... Il faut aussi trouver les bonnes informations. quoi.
- Speaker #1
Effectivement. mais cela dit, il y a plein de choses où on sait que ça marche et dans les grandes lignes on sait très bien que la première chose qu'il va falloir faire c'est sortir des énergies fossiles et ça, il n'y a pas de doute là-dessus après, sur l'autre chose qu'on sait, c'est qu'il va falloir de l'énergie propre après, le pourquoi du comment quel type d'éoliennes, quel type de panneaux solaires comment est-ce qu'on les produit, etc. voilà, c'est des questions qu'il faut régler mais si au moins on peut se mettre tous d'accord là-dessus et se dire que chaque pas qu'on fait dans cette direction c'est utile, c'est déjà pas mal ... Récemment, j'ai participé à une étude internationale avec tout un groupe de chercheurs qui s'intéressaient aux facteurs qui vont motiver les individus à s'engager de manière militante pour le climat. Donc vraiment une action plus systémique, comme écrire à son élu politique pour demander des actions pour le climat, signer une pétition, faire ce genre de choses qui sont vraiment de l'ordre de la mobilisation de l'action collective. Et le but de cette étude, c'était de comparer plein d'interventions différentes pour motiver, pour voir lesquelles étaient les plus motivantes, lesquelles avaient le plus gros impact sur le passage à l'action. Et ce que cette étude a montré, c'est que de dire que ça marche, que de se mobiliser, que d'écrire à son élu, signer une pétition, ça sert à quelque chose, c'était ça qui avait le plus gros impact sur le passage à l'action. Beaucoup plus que de faire peur sur la crise climatique. Beaucoup plus que de dire, d'avoir un framing moral, de dire, voilà, si on n'agit pas, c'est vraiment terrible, ou les gens qui n'agissent pas sont terribles. Plus que toutes les choses qui sont liées à la peur, ce genre de choses. Et donc dire, ça marche, eh bien, c'est très motivant. Et on a de plus en plus... de preuve que l'action collective, ça marche. En fait, presque à chaque fois qu'il y a eu un changement d'ampleur, eh bien, il s'est fait suite à une action collective.
- Speaker #0
Tu as des exemples peut-être ?
- Speaker #1
Eh bien, encore aujourd'hui, j'étais à une présentation d'une femme qui était employée chez Amazon. qui a passé des années à travailler sur des problématiques de marketing d'Amazon, jusqu'à ce qu'elle prenne conscience de l'urgence climatique, qu'elle se dise « bon, il faudrait peut-être qu'on change nos pratiques » . Et cette femme a créé un mouvement interne à Amazon avec d'autres employés pour demander que Amazon puisse formuler... Leur première étape, c'était de demander qu'Amazon formule une politique climatique claire, des ambitions sur lesquelles ils pouvaient s'engager, un plan climat. Et donc... En ayant créé un groupe au sein d'Amazon, avec des milliers et des milliers d'employés qui ont d'abord signé une pétition pour demander ça, première victoire qu'ils ont eue, c'est qu'Amazon a effectivement publié son premier plan climat. Ensuite, ils ont fait tout un tas d'autres actions collectives. Lors des Journées de la Terre, ils ont fait des mobilisations, des manifestations, etc. pour essayer d'améliorer les conditions de vie des salariés, de changer certaines pratiques dans... des pratiques de livraison, des pratiques d'où venait la consommation d'énergie, etc. Et donc là, c'est vraiment un exemple concret d'une pétition en interne d'une entreprise, d'un mouvement de salariés qui a donné lieu à des changements. Alors évidemment, il reste encore beaucoup à faire pour que Amazon devienne une entreprise vertueuse, mais ça prouve bien que même... dans une entreprise comme Amazon qui a des politiques vraiment très strictes envers ses employés. Ce n'est pas une partie de plaisir. D'ailleurs, cette femme a fini par se faire licencier de chez Amazon pour son engagement. Donc, même dans des sociétés, des entreprises qui sont aussi hostiles à ces mouvements, l'action collective, la mobilisation peut donner lieu à un changement.
- Speaker #0
Cette femme, j'ai retrouvé son nom, elle s'appelle Marine Costa et elle est dans un documentaire sur un effet qui s'appelle « By Now » . Voilà. conseil à ceux qui nous écoutent. Donc tu me fais une transition quand même assez élégante sur ma prochaine question, c'est comment on fait si on veut embarquer un petit peu les gens autour de nous, une fois de plus, pas pour peut-être les faire faire plus de vélo ou manger moins de viande, etc., mais pour avoir une action un peu plus collective, qu'on soit l'écolo de sa famille, enfin l'écolo, je dis ça de manière un petit peu péjorative, mais je le pense pas, c'est juste pour mettre un nom sur... que tout le monde comprenne, celui de sa bande de potes ou celui dans son entreprise. Comment on fait pour embarquer des gens qui s'en foutent, mais ils ont d'autres trucs dans la vie.
- Speaker #1
Souvent, d'ailleurs, ils ne s'en foutent pas. Quand on creuse un peu, quand on pose la question, est-ce que tu as envie d'une planète en bonne santé, que tes enfants ne subissent pas des conséquences atroces du changement climatique, généralement, les gens sont d'accord. Cette partie-là, elle est très consensuelle. Après, c'est... Ce qui est plus dur, c'est est-ce que tu es prêt à renoncer à ceci ? Est-ce que tu es prêt à faire cela ? Quel risque est-ce que tu es prêt à prendre pour l'action climatique ? Là, ça devient un peu plus compliqué. Mais donc, il y a plusieurs choses. Je pense qu'une première étape, c'est d'avoir un message qui est très clair et donc peut-être d'essayer de convaincre quelqu'un sur une première chose, pas essayer de faire tout changer en même temps. Ça peut être trop compliqué, ça peut générer un sentiment de rejet parce qu'on en demande trop, on peut être trop culpabilisant. On sait que ça ne marche pas. Et donc peut-être de simplement commencer avec quelque chose de simple. Donc si on s'adresse à un membre de sa famille, et bien peut-être que la première chose, si on va demander, voilà, est-ce que tu peux t'informer sur le sujet ? Voilà, simplement se former là-dessus, lire un livre. Ça, a priori, ça peut être... Après, on peut penser à d'autres actions, voilà, voter. En France, on a les municipales l'année prochaine qui vont arriver. Peut-être que ce qu'on veut faire, c'est simplement faire en sorte que des gens proches de nous votent. en faveur de candidats qui ont un programme écologique à la hauteur des enjeux. Donc, définir quelque chose de clair, plutôt que de faire culpabiliser sur un million de petits gestes qui n'ont pas forcément un impact aussi important. Ensuite, l'autre chose qui est importante pour mobiliser un individu, on peut penser, je ne sais pas, à son patron d'entreprise. Peut-être qu'on a envie de faire évoluer la politique d'achat de l'entreprise, ou je ne sais quoi, et qu'il va falloir embarquer son patron. Eh bien... Une chose qui est montrée en sciences cognitives, c'est donc chaque individu a un certain nombre de valeurs qui sont très importantes pour lui. On appelle ça parfois le modèle de Schwartz, qui recense dix valeurs fondamentales chez les individus, mais il y a tout un tas d'autres modèles qui décrivent ces valeurs. Et pour être entendu, pour que notre message soit entendu, il faut qu'il soit adapté aux valeurs de notre interlocuteur. Donc, si toi, tes valeurs, c'est plutôt la bienveillance, l'universalisme, etc. Et que je te dis, peut-être que je peux te dire, vote en faveur de politique écologique, parce que ça va protéger les animaux et que les humains et les animaux ne font qu'un sur terre. Peut-être que ça, ça va marcher avec toi, mais peut-être que ça ne va pas du tout, du tout marcher comme message pour son patron. Et qu'au contraire, ça va peut-être même créer un sentiment de réactance, de rejet en disant « Oulala, qu'est-ce qu'on m'embête avec ces valeurs de hippie, youhou ! » Et donc, il faut trouver quelles sont les autres valeurs de cet individu. Par exemple, ça peut être des valeurs de tradition. Deux, on va maintenir une certaine tradition. Ou des valeurs de sécurité. Et donc, il va falloir faire ce qu'on appelle, en sciences cognitives, on appelle ça en anglais le « message matching » . Donc, comment est-ce qu'on adapte son message à son audience. et donc trouver quelle est la valeur de cet individu et comment est-ce que je peux adapter mon discours pour qu'il incarne cette valeur. Alors oui, on pourra dire tout de suite, mais ça, ça sonne vachement comme du marketing. Et effectivement, quelque part, on peut dire que c'est une forme de marketing politique ou du marketing idéologique.
- Speaker #0
Il y a des questions éthiques derrière. Est-ce que c'est de la manipulation ou pas ?
- Speaker #1
Disons que déjà, première chose sur la manipulation, en fait, c'est assez dur de manipuler les gens. on a l'impression toujours, on a souvent des paniques morales de « ah, on peut manipuler, on est manipulé » . En fait, c'est dur de faire en sorte que les gens agissent contre leurs propres intérêts. Ou en tout cas, il faut beaucoup, beaucoup de moyens pour le faire. Et donc, surtout dans le cas du climat, en fait, on n'agit pas contre les intérêts des gens, parce que souvent, la première étape, tout le monde veut une planète en meilleure santé. Tout le monde veut... Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment la pollution. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le réchauffement climatique. Il faut simplement arriver à faire passer un message pour dire « voilà, Vous aimez ceci, et bien les moyens pour arriver sont peut-être plus compatibles que ce que vous ne pensez avec vos valeurs, vos manières de vivre. Et donc ça, c'est pas vraiment de la manipulation quand on va dans le sens de l'individu. C'est un peu comme si on disait, les médecins nous manipulent pour être en bonne santé. Non, ils sont juste en train de nous aider à prendre soin de nous-mêmes. Donc personne ne dit, tu te fais manipuler par ton médecin, il t'a dit de moins fumer. Non. On trouve que c'est juste la bonne réponse. La manipulation, c'est très subjectif, disons. Trouver le bon framing, la bonne manière de cadrer un message pour correspondre aux valeurs d'un individu, c'est très important. Et la dernière chose, peut-être, je finirai là-dessus, sur comment embarquer, c'est de se dire qu'en fait, pas tout le monde, peut-être qu'on n'est pas la bonne personne pour embarquer son interlocuteur. On a, chacun de nous, des relais de confiance, des personnes qui vont être des rôles modèles ou des personnes qu'on a tendance à écouter et qui vont pouvoir faire passer un message. Et parfois, eh bien, on n'est pas la bonne personne pour faire passer un message, ou en tout cas, pas pour tout le monde. Et donc, de se dire, d'accepter que ce n'est peut-être pas nous qui devons faire passer le message, mais peut-être qu'il y a, je ne sais pas si on reprend l'exemple de notre directeur d'entreprise, peut-être que la bonne personne, ça va être... un autre chef d'entreprise qui s'est engagé sur ces questions. Et peut-être que de relayer, je ne sais pas, une vidéo, un podcast d'un chef d'entreprise qui s'est engagé sur cette question, eh bien, ce sera beaucoup plus impactant que d'en parler soi-même parce qu'on n'est pas le bon émetteur. Et donc, d'aller trouver qui est le bon individu, la bonne profession, le bon type de personne qui va pouvoir être entendu sur ces sujets, eh bien, c'est aussi très important.
- Speaker #0
Oui, et l'exemple que je donne souvent en pensant à ça, c'est un peu Jean-Marc Jancovici. avec ses qualités et ses défauts, mais de toute façon je ne veux pas parler du contenu de ce qu'il dit, mais il a quand même touché une partie des gens qui n'étaient pas de base la cible des messages écolos, c'est-à-dire des gens un peu plus CSP+, hommes, etc. Et donc je pense que ça abonde dans ton sens.
- Speaker #1
Exactement. Donc peut-être qu'on a le modèle en tête, voilà, Jean-Marc Jancovici, il arrive à parler avec certaines valeurs, un certain discours qui va être attirant pour des gens qui ont peut-être un profil plus ingénieur, plus scientifique, peut-être plus cadre supérieur, etc. Là où un autre individu, je ne sais pas, François Ruffin, va pouvoir... peut-être s'adresser plus facilement à des individus qui sont plutôt issus des classes populaires ou qui sont dans d'autres enjeux, plutôt des individus issus de la ruralité. Et en fait, chaque personne va avoir des relais. confiance différente, et c'est pour ça qu'il faut absolument multiplier les émetteurs sur ces questions. On ne peut pas s'attendre à ce que ce soit la même personne ou la même institution qui va convaincre tout le monde.
- Speaker #0
Est-ce qu'il y a d'autres messages pour convaincre les gens que leurs actions peuvent être efficaces, que tu voudrais partager ?
- Speaker #1
Je pense qu'un autre effet qui est important de souligner, c'est ce qu'on appelle l'ignorance pluraliste en sciences cognitives. Et donc, c'est le sentiment qu'on a qu'on est le seul à vouloir s'engager et que les autres ne veulent pas le faire. Et du coup, on ne change pas parce qu'on se dit qu'on ne veut pas passer pour le rabat-joie ou la personne un peu marginale dans son groupe. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans le climat. Il y a une étude qui a été publiée très récemment, il me semble, dans la publication, dans le journal académique Nature Climate Change, qui mesure dans énormément de pays dans le monde les altitudes des individus sur le climat. Donc ça va être à quel point êtes-vous concernés par le changement climatique ? Quelle somme d'argent êtes-vous prêts à donner pour lutter contre le changement climatique, etc. ? Et on leur demandait aussi, à votre avis, dans votre pays, quelle est la part des gens qui sont concernés par le changement climatique, qui sont prêts à donner 1% de leur revenu pour s'engager, etc. Et donc, ces chercheurs ont pu comparer ce que les gens pensent et ce que les gens pensent que les autres pensent. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'en fait, il y a une partie très importante, une vaste majorité de la population, il me semble que dans certains pays, c'est 90% de 9 personnes sur 10 qui sont prêts à donner 1% de leur revenu. pour la transition écologique. Donc il y a une partie très importante de la population qui est prête à s'engager, mais par contre, les gens pensent que les autres ne sont pas prêts à le faire. Et donc il y a un vrai écart entre la volonté réelle de s'engager et la volonté perçue. Et donc évidemment, si on a l'impression qu'autour de nous, il n'y a que les gens qui ne veulent pas s'engager, bon, ça va être plus dur de lancer la machine. On n'a pas envie de le faire tout seul, on ne veut pas être un peu ostracisé. Mais par contre, si on se rend compte qu'en fait, autour de nous. il y a beaucoup de gens qui sont prêts à agir, ça, c'est évidemment beaucoup plus motivant. Et donc, de rendre visible le fait qu'on est prêts à agir, que beaucoup de gens veulent s'engager, ça peut être une manière de lever un certain frein.
- Speaker #0
Et peut-être une question un peu plus personnelle, est-ce que tu trouves qu'en France, il y a un climat assez, peut-être pas catastrophiste, mais en tout cas un climat assez pessimiste, on va dire, qui est plutôt prégnant, et peut-être par rapport à d'autres pays, et Je ne sais pas, et comment le lier, par exemple, à ta recherche, à tes études ?
- Speaker #1
Oui, alors je pense que, bon, on dit souvent que les Français sont champions du pessimisme dans plein de domaines, pas que sur le climat. C'est un peu le cliché du Français râleur. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve parfois dans les sondages, où, comme je l'évoquais tout à l'heure, les Français tendent à être assez catastrophistes, assez défaitistes sur le climat. Et ça, évidemment, on le sait, c'est un problème pour le passage à l'action. Moi, j'ai la chance d'être belge, donc je suis de naissance vaccinée contre le pessimisme. On est plutôt un pays d'optimistes et de gens joyeux. Donc moi, ça va, je ne suis pas trop touchée par cet effet. Et je dois le dire que même autour de moi, j'ai la chance d'être beaucoup en contact avec des activistes, des personnes qui sont vraiment engagées pour le climat et qui donc peuvent parfois être un peu... un peu attristés par ce qui se passe, mais ont une vraie volonté d'agir et font beaucoup de choses. Mais c'est vrai que d'être dans un discours qui est très négatif, en fait, on ne se rend pas compte que, paradoxalement, ça peut être démobilisateur. Donc, quand on le voit sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les journaux, etc., en ligne, sur YouTube, il peut y avoir beaucoup de messages de « ça n'avance pas » , « les riches ne font rien » , « c'est catastrophique » . Et même si en disant ce discours, on a peut-être envie de dire du coup, il faudrait agir, on veut mobiliser. Eh bien, peut-être que de manière non consciente, sans le vouloir, on est en train de démobiliser plein de gens qui disent bon, c'est trop tard, ça sert à rien, personne n'agit.
- Speaker #0
Et un côté un peu prophétie autoréalisatrice.
- Speaker #1
Exactement. Et de nouveau, surtout vu qu'on a déjà une tendance à sous-estimer à quel point les autres agissent. Si on nous répète en permanence qu'il y a des gens qui n'agissent pas, et bien sûr il y en a, on a tendance à généraliser ça à l'ensemble de la population. Vu qu'il y a quelques personnes qui n'agissent pas, ça veut dire que personne n'agit. Et en plus, vu qu'on a tendance à ne pas voir les conséquences positives de notre action, quand on prend notre vélo, il n'y a pas le prix des pâtes qui décroît, il n'y a pas le climat qui se rétablit, on va avoir tendance à généraliser les mauvaises nouvelles, se dire qu'il n'y a rien qui ne sert à rien. Et donc, mettre l'accent sur les victoires, les choses qui se passent bien, et il y en a, heureusement, ça peut être très important pour continuer à mobiliser la population.
- Speaker #0
Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ou on a tout dit ?
- Speaker #1
La seule chose, peut-être le message clé à prendre en compte, c'est vraiment que ce qu'il faut réussir à faire, c'est changer le système et motiver les individus à changer le système. Et pour ça, on va avoir besoin que les individus connaissent les solutions, comprennent vers où est-ce qu'il faut aller. Il faut que ce soit simple, qu'on ait tous les bons réflexes, qu'on ait tous une vision claire de la transition écologique. Il faut qu'on se dise qu'on est capable d'y aller, que ça peut marcher. qu'on a quelque chose à y gagner et qu'on a des choses à y gagner peut-être de manière immédiate, qu'on va y gagner en termes de santé, de bien-être social, de réduction des inégalités, etc. Et qu'on n'est pas tout seul à agir. Et si on arrive à mettre un peu tous ces ingrédients ensemble, alors on a plus de chances que les individus se mobilisent pour changer le système.
- Speaker #0
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Méline Pounfala.
- Speaker #1
Merci beaucoup.