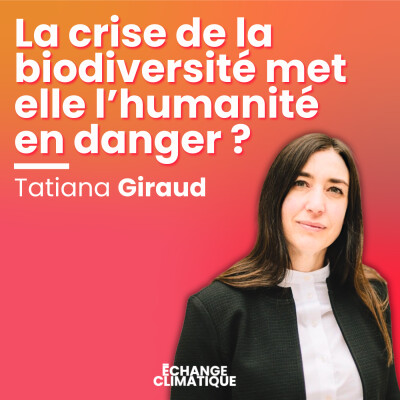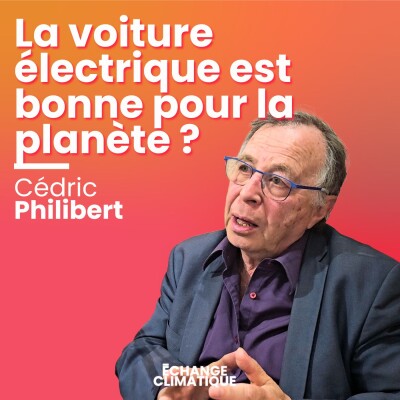- Speaker #0
Quand j'étais enfant, je passais des heures à jouer dans le jardin. Il y avait de la vie partout. Des gendarmes, des cloportes, des papillons. Aujourd'hui, tout cela me paraît bien plus rare. Il suffit de regarder un pare-brise après un trajet. Autrefois, il était couvert d'insectes après une dizaine de kilomètres, alors que de nos jours, presque plus besoin de passer les essuie-glaces. Ce que je ressens comme beaucoup d'autres, ce n'est pas qu'une impression. C'est le symptôme d'un phénomène global, l'effondrement de la biodiversité. Dans cet épisode, on va explorer les causes de ce déclin, les pistes pour y faire face, et surtout... On va se rappeler pourquoi la nature est essentielle, pour notre survie bien sûr, mais aussi pour continuer à s'émerveiller, comme quand on était enfant et qu'on jouait dans le jardin. Mon invitée est Tatiana Giraud, elle est directrice de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences et chercheuse à l'Université Paris-Saclay au laboratoire écologie, société et évolution. Elle est également l'auteur de l'ouvrage « L'attention aux vivants » paru aux éditions de l'Observatoire. L'effondrement de la biodiversité met-il l'humanité en danger ? C'est le thème de cet échange climatique. Bonjour Tatiana Giraud.
- Speaker #1
Bonjour.
- Speaker #0
Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
- Speaker #1
Je suis directrice de recherche CNRS, je travaille à l'université Paris-Saclay dans le laboratoire écologie, société et évolution et je suis aussi membre de l'académie des sciences.
- Speaker #0
Donc on va commencer de manière peut-être un peu scolaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire la biodiversité, le concept, ce que c'est ?
- Speaker #1
Oui, la biodiversité c'est une notion un peu complexe, qui est beaucoup plus complexe que l'impression qu'on en a en général dans le grand public. Souvent quand on parle de biodiversité, on a une vision un peu de nombre d'espèces, et puis on visualise surtout quelques espèces animales charismatiques. Alors que la biodiversité, c'est un concept à plein de dimensions différentes. Donc effectivement, c'est un nombre d'espèces déjà, mais pas que des espèces animales. Il y a aussi des végétaux, bien sûr, mais aussi plein de micro-organismes. D'ailleurs, la majorité des organismes sur Terre, c'est des micro-organismes.
- Speaker #0
L'extrême grande majorité d'ailleurs, non ?
- Speaker #1
Oui, à la fois en nombre de lignées différentes, en nombre d'espèces, en masse, c'est surtout des micro-organismes. Et surtout, la biodiversité, ce n'est pas seulement un nombre d'espèces juxtaposées les unes à côté des autres. Il y a aussi la diversité génétique au sein des espèces, qui est vraiment essentielle à la notion de biodiversité et surtout à son fonctionnement. Parce que la biodiversité, c'est des espèces qui se maintiennent au cours du temps, qui s'adaptent, et elles ne peuvent pas s'adapter sans diversité génétique.
- Speaker #0
Par exemple, j'ai un exemple pour la... L'espèce, le chien, il y a des races de chiens qui sont complètement différentes, ça va du chihuahua au labrador.
- Speaker #1
Voilà, et tout ça c'est la même espèce. Et c'est même la même espèce que le loup, depuis lequel on a domestiqué le chien. Tout ça c'est la même espèce, le même nom latin. Et donc on voit bien que si tous les chiens disparaissent, sauf le bulldog, l'espèce n'aura pas disparu, mais on aura perdu beaucoup de diversité et en termes d'adaptation à des niches écologiques différentes par exemple.
- Speaker #0
Il y a une phrase que je voudrais citer dans votre livre parce qu'elle m'a un petit peu surprise. Si on séquence l'ADN d'une goutte d'eau prélevée dans une mare, on y retrouvera bien plus de diversité qu'en dénombrant toutes les espèces animales et végétales peuplant de notre planète. Donc il y a autant d'espèces différentes dans une goutte d'une mare que toutes les espèces d'animaux et de plantes sur la Terre.
- Speaker #1
Voilà, c'est l'idée un peu de tous ces micro-organismes qui sont délignés très différents. et qui sont innombrables, et dont on avait très peu idée jusqu'à ce qu'on puisse séquencer la DNA. Et effectivement, on s'aperçoit en séquençant une goutte d'eau dans une mare, qu'il y a une diversité de micro-organismes, mais énormes par rapport à ce qu'on appréhende en termes de juste les animaux et les végétaux, qui sont juste deux petits rameaux dans l'arbre du vivant.
- Speaker #0
Donc, ce n'est pas une image, c'est vrai ?
- Speaker #1
C'est vrai.
- Speaker #0
Ok, d'accord, c'est assez fou. Souvent, en parlant de la biodiversité, on pense parfois, pas tout le monde, mais à l'Arche de Noé. Et c'est intéressant parce que ça véhicule un peu des images faussées de ce que c'est la biodiversité. C'est un couple de chaque espèce et comme vous disiez, c'est des animaux. Et un couple, ça ne représente pas la diversité génétique de l'espèce.
- Speaker #1
Voilà, c'est ça. À l'âge de nous, typiquement, ça correspond à cette vision où c'est que des animaux, où la diversité génétique au sein des espèces n'a pas d'importance puisque un mâle, une femelle suffit. Et donc, il n'y a pas de diversité génétique. Et puis, ça oublie toutes les plantes, tous les micro-organismes. Et aussi, ça oublie tous les écosystèmes. C'est un peu l'idée qu'il suffirait d'un malade d'une femelle pour repeupler la terre, mais s'ils n'ont pas d'habitat dans lequel ils ont leur nourriture, leur habitat, ils ne peuvent pas survivre. Et c'est vraiment important parce que cette vision fausse de ce que c'est que la biodiversité, ça conditionne les solutions qu'on met en place pour la conserver si on veut la conserver. Et donc ça correspond tout à fait à l'idée qu'on pourrait avoir quelques petites réserves. quelques os, quelques banques de graines, et que ça suffirait à sauver la biodiversité, alors que ce n'est pas du tout le cas.
- Speaker #0
Il y a notamment quelque chose qui a un peu défris la chronique dernièrement, c'est la résurrection entre guillemets du loup terrible. Et en fait, malgré le fait que certains veulent nous faire croire que c'est possible de ressusciter une espèce à partir de quelques échantillons d'ADN, en réalité, Ce genre d'expérience ne va pas aboutir réellement sur une réintronisation de l'espèce dans son milieu naturel qui n'existe plus.
- Speaker #1
C'est trompeur sur plein d'aspects. Déjà, ce n'est pas une vraie désextinction ou résurrection, parce qu'en fait, ce n'est pas le loup terrible qu'ils ont recréé en quelque sorte. Ils ont juste changé quelques gènes dans un loup normal. donc ils ont juste changé leur nature des poils donc c'est pas du tout l'espèce loup terrible déjà, donc c'est pas une vraie désextinction et donc ils annoncent qu'ils veulent faire la même chose avec le dodo et le mammouth mais ça sera exactement la même chose, ça sera pas vraiment le dodo et le mammouth, ça sera juste des espèces proches avec quelques gènes changés et en plus ça a aussi le problème que si on... un des problèmes principaux de Euh... De l'effondrement de la biodiversité actuelle, les causes principales c'est la destruction des habitats et les pesticides. Et donc si on détruit les habitats et qu'on les empoisonne les habitats, on ne peut pas réintroduire les espèces. Donc même si on les régénérait, on les recréait, elles ne pourraient pas se maintenir. En plus on ne les recrée pas et en plus ça participe du déni du fait d'agir sur les vraies causes. Les vraies causes, c'est la destruction d'habitats, la surexploitation, les pesticides. Et si on se dit qu'on pourra toujours déséteindre les espèces, on ne va pas agir sur les causes.
- Speaker #0
Vous avez parlé tout à l'heure d'adaptation, donc on va un petit peu parler d'évolution, histoire de comprendre un peu comment ça se passe. Parce que là aussi, il y a pas mal, je ne sais pas, peut-être pas des idées reçues, mais en tout cas des choses que le grand public ne sait pas. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. par exemple le fait que l'évolution des espèces, ça ne se passe pas au sein de la vie d'une espèce. Vous prenez l'exemple de la girafe, ce n'est pas une girafe qui va tellement allonger son cou pour aller chercher des feuilles dans sa vie que son cou va s'allonger, etc. En fait, c'est une espèce... Enfin, peut-être que vous allez m'expliquer pourquoi ce n'est pas ça. Je vous laisse le faire.
- Speaker #1
Effectivement, c'est depuis Darwin, depuis son livre L'origine des espèces en 1859 où on a la théorie de... d'évolution par sélection naturelle et qui est très... qui est la théorie la plus acceptée actuellement pour expliquer l'évolution des espèces. C'était l'originalité de Darwin, c'était pas tellement que c'était l'évolution, à son époque c'était déjà dans l'ère du temps, c'était vraiment le mécanisme par sélection naturelle et qui est, donc effectivement si on prend l'exemple du coup de la girafe... À l'époque, la théorie concurrente, c'était celle de Lamarck, qui était que les girafes ont un cou long, parce qu'effectivement, au cours de leur vie, elles étirent leur cou pour arriver à atteindre les branches les plus hautes possibles, et du coup, ça allonge leur cou pendant leur vie, et elles passent à leurs enfants le cou plus long qu'elles ont acquis pendant leur vie. C'est l'hérédité des caractères acquis. Et Darwin propose un mécanisme complètement différent qui est qu'il y a une variation dans les populations. Les individus ont des coûts plus ou moins longs. Alors maintenant, on dirait génétiquement, il ne connaissait pas l'ADN, mais génétiquement, il y a des variations, des différences.
- Speaker #0
Complètement aléatoire.
- Speaker #1
Les mutations au départ sont aléatoires. La variation, quand elle apparaît, c'est aléatoirement. Mais après, il y a un tri. Et effectivement, celles qui, par hasard, ont des coups plus longs, elles arrivent à mieux se nourrir. Elles font plus d'enfants qu'ils leur ressemblent, qui ont aussi un coup long. Et donc, de génération en génération, les girafes ont un coup plus long. Mais pas parce qu'elles ont étiré leur cou, parce que celles qui avaient un coup plus court ont laissé moins d'enfants et sont mortes plus jeunes. Et donc c'est vraiment la sélection naturelle, c'est un tri parmi la variation qui existe dans les populations. Et c'est pour ça que la variation, la diversité génétique est essentielle à prendre en compte dans le concept de biodiversité. Parce que sans variation, il ne peut pas y avoir d'adaptation. Sans diversité génétique, les espèces ne peuvent pas s'adapter.
- Speaker #0
Pour être un peu un fan de documentaires animaliers, souvent ce qui est pointé du doigt, c'est l'évolution parfaite des espèces. espèces qui leur permettent de faire vraiment des trucs de dingue si bien que dans ma représentation des choux j'avais l'impression que ce que je voyais autour de moi c'était super optimisé toutes les espèces avaient trouvé un peu elles étaient d'une manière qui ne pouvait pas être améliorée en fait et ce que vous disiez aussi dans le livre c'est que pas du tout par exemple nous on a les dents de sagesse qui nous servent à pas grand chose et il y a aussi d'autres traits comme ça un peu superflus voire carrément parfois qui peuvent porter préjudice aux espèces dans la nature autour de nous.
- Speaker #1
Oui, c'est vrai que dans les documentaires animaliers, on entend souvent pour la survie de l'espèce ou l'adaptation. C'est une vision un peu... C'est comme si on avait remplacé Dieu par la sélection naturelle qui optimiserait tout. Alors que vraiment, ce qu'il faut voir, c'est le processus d'évolution par sélection naturelle. Effectivement, il y a des mutations qui introduisent des variations au hasard. Et celles qui marchent mieux que les autres sont conservées, augmentent en fréquence dans les populations, se fixent. Mais ce n'est pas comme s'il y avait un ingénieur qui partrait de zéro et qui ferait la meilleure girafe optimisée avec le meilleur plan possible. C'est vraiment une histoire avec des petites améliorations. Et s'il y a quelque chose de bien, on le garde et on élimine ce qui est moins bien. Mais peut-être que la meilleure mutation n'est pas arrivée et n'a pas été optimisée. Par exemple, encore pour reprendre l'exemple de la girafe, Richard Dawkins, qui est un vulgarisateur formidable de l'évolution et de la sélection naturelle, avait même disséqué une girafe pour le montrer. Et en fait, c'est presque les meilleures preuves que l'évolution se produit, le fait que les espèces ne soient pas optimisées. Parce que ça montre bien que la sélection naturelle fonctionne par bricolage. C'est vraiment un héritage historique. Ce qui existait, les mutations qui sont apparues, mais ce n'est pas comme un ingénieur. Et donc chez la girafe, il y a ce qu'on appelle un air laryngé récurrent. C'est un air qui passe du cœur jusqu'au cerveau. Et chez la girafe, il fait tout le tour, il fait des mètres de long, alors qu'il fait un aller-retour dans son long cou. alors qu'il pourrait faire un trajet beaucoup plus direct. Et si on le replace dans l'évolution et dans l'histoire de l'évolution, effectivement, chez les ancêtres de la girafe qui n'avaient pas un long cou, ça faisait un trajet très court. Et petit à petit, le cou s'est allongé. Et le nerf, il a dû s'allonger aussi, petit à petit. Et il n'y a pas eu de mutation qui a fait qu'il passe direct. Et donc, c'est quelque chose de pas optimal, mais qui montre que c'est un héritage historique entre eux. comment étaient les ancêtres et les mutations qui sont arrivées. Un autre exemple, c'est les cétacés. Donc, c'est des mammifères dont les ancêtres étaient terrestres et qui sont retournés secondairement à la mer. Et donc, ils avaient quatre pattes et ils marchaient sur la terre, leurs ancêtres. Et donc, petit à petit, ils se sont adaptés au milieu marin. ils ont perdu leurs pattes mais en fait il reste des os ce qu'on appelle des os vestigiaux qui sont les restes de ces pattes et qui n'ont pas complètement disparu et qui ne servent à rien mais qui montrent bien qu'ils avaient des ancêtres terrestres que petit à petit il y a des mutations qui ont fait disparaître ces pattes qui ne servaient à rien voire qui gênaient dans le milieu marin mais il en reste des petits bouts qui ne servent à rien un peu comme notre appendicite ou notre coccyx qui sont des restes de nos ancêtres ...
- Speaker #0
Il y a aussi une autre idée reçue qu'on entend souvent, c'est que l'homme descend du singe. Et ça c'est pas vrai. Alors, c'est pas si faux que ça. C'est-à-dire que l'homme descend pas des singes actuels. Notre plus proche cousin, c'est le chimpanzé. On descend pas du chimpanzé. Par contre, on avait des ancêtres qui ressemblaient tout à fait à des singes.
- Speaker #1
Oui, donc en fait, je pense que l'idée, c'est qu'on pense qu'on descend du chimpanzé actuel. C'est pas du tout. Ok. Je propose qu'on rentre peut-être dans le cœur du sujet. Quand j'étais enfant, je me souviens... que quand je jouais dans le jardin dans la cour de récréation, j'observais vraiment beaucoup de petites bêtes, de gendarmes, de cloportes, de papillons, de fourmis, etc. Et aujourd'hui, c'est peut-être parce que déjà je joue un peu moins dans les jardins, mais quand même j'en observe beaucoup moins. Est-ce que ça c'est juste un biais que moi j'ai ou c'est vraiment un stigmate de l'effondrement de la biodiversité ?
- Speaker #0
Non, ça a vraiment été montré par de nombreuses études scientifiques qu'il y a vraiment un effondrement des populations d'insectes. ... des populations en général d'animaux, mais aussi des populations d'insectes, et dans des zones anthropisées, mais aussi dans des réserves naturelles. Il y a une étude, par exemple, dans une réserve en Allemagne, qui a suivi sur 30 ans la quantité, la biomasse, donc la quantité en poids d'insectes en faisant des pièges, et ça a diminué des trois quarts, qui est une baisse des trois quarts. et d'ailleurs que des gens qui sont... À part peut-être les plus jeunes actuellement, mais on se souvient, dans les années 70, par exemple, quand on faisait un trajet en voiture, en autoroute, on devait s'arrêter pour nettoyer son pare-brise régulièrement parce qu'il y avait plein d'insectes morts. Et actuellement, on n'a pas besoin de nettoyer son pare-brise. Donc, c'est une autre preuve qu'il y a vraiment un effondrement des populations d'insectes.
- Speaker #1
Sur cette étude... Donc, c'était 75% de déclin dans une zone protégée. Mais on a dit tout à l'heure que les causes principales, c'était les pesticides et le changement d'habitat. Donc, en gros, l'artificialisation. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Pourquoi, du coup, ça baisse ici aussi ?
- Speaker #0
Le problème, c'est que les pesticides se répandent partout. C'est-à-dire que, surtout, en fait, depuis 30 ans, justement, où on a complètement changé notre mode... d'application des pesticides. Avant, quand il y avait une maladie, on faisait un traitement. Maintenant, on fait des semences enrobées. La plupart des graines qu'on plante, elles sont enrobées de pesticides. et donc il y a des oiseaux qui les mangent et surtout les trois quarts du produit part dans l'eau quand il y a de la pluie, dans les sols et ça ruisselle et ça contamine tous les ruisseaux en fait même la pollution plastique, il y a une étude qui vient de sortir récemment qui montre que la plupart des fleuves sont pollués au microplastique et on... On a vu aussi la plupart de l'eau, même notre eau potable, est polluée aux faces qui viennent des pesticides. Donc le fait qu'on mette des pesticides tout le temps, partout dans les sols, en permanence, et pas seulement quand il y a de la maladie. En fait, ça lave des pesticides partout, tout le temps, et la plupart des environnements sont contaminés, même dans les réserves naturelles.
- Speaker #1
Et est-ce que c'est parce que les écosystèmes ne sont pas complètement dépendants les uns des autres ? Et si, par exemple, il y a un champ à l'orée d'une forêt...
- Speaker #0
Exactement,
- Speaker #1
ils sont connectés par les eaux. Donc cet effondrement de la biodiversité, on a dit que c'était très difficile de compter le nombre d'espèces, on a dit qu'on perdait beaucoup d'insectes, etc. Est-ce qu'on peut le quantifier tout de même, et en fonction aussi peut-être des espèces ? Donc les insectes, c'est une chose, mais il y a aussi tout ce qui est plus gros mammifères, etc. Peut-être on peut commencer par l'Europe.
- Speaker #0
Donc, c'est pareil, il y a plusieurs mesures. On peut regarder combien d'espèces disparaissent, ou à quel point les populations s'effondrent. C'est soit combien d'espèces disparaissent, ou en termes de biomasse, ou de nombre d'individus, combien il y en a en moins. Donc, les nombres d'espèces qui sont vraiment disparues, actuellement, ce n'est pas encore, c'est des ordres de grandeur de quelques pourcents. On peut se dire que ce n'est pas encore dramatique. Le problème, c'est l'accélération des taux. C'est-à-dire que quand on fait la courbe du pourcentage d'espèces cumulées au cours du temps, c'est des courbes exponentielles. Donc on peut se dire que pour l'instant, il n'y a pas encore trop d'espèces qui ont vraiment disparu, mais que les taux d'extinction, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les espèces disparaissent, en fait, ils sont au moins 10 fois ou 100 fois plus grands que lors de la dernière extinction de masse au Crétacé qu'ont vu les dinosaures disparaître. Donc, il y a eu cinq extinctions de masse au cours du temps qu'on peut voir dans les registres fossiles. La dernière au Crétacé, donc quand les dinosaures ont disparu, il y a les trois quarts des espèces sur Terre qui ont disparu. Si on compare les vitesses d'extinction actuelles à celles du Crétacé, on est à dix fois ou cent fois plus élevées. Donc c'est plutôt la vitesse de disparition des espèces qui est critique actuellement que les nombres totaux. Et aussi ces effondrements de population, c'est-à-dire qu'on peut dire que les espèces existent toujours, mais qu'elles ont perdu les trois quarts de leur masse ou de leur nombre d'individus. Et donc ça veut dire qu'elles ont perdu leur diversité génétique, qu'elles ont perdu leur capacité à se régénérer, à s'adapter, et donc ça nous alerte.
- Speaker #1
Oui, parce qu'en fait, Tout à l'heure, vous avez dit qu'on a besoin de la diversité génétique pour pouvoir permettre l'adaptation. On peut penser peut-être que ce faible nombre d'espèces disparues cache le fait que l'effondrement de la population de l'espèce... met à terme en péril la possibilité d'adaptation de cette espèce et donc d'un coup on pourrait avoir un effet...
- Speaker #0
On appelle ça un vortex d'extinction un peu, c'est-à-dire à partir du moment où les populations deviennent trop petites, quelque part elles sont vouées à l'extinction, même si elles ne le sont pas déjà.
- Speaker #1
Est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette notion ? Pourquoi il faut une diversité génétique pour permettre l'adaptation ? J'ai bien compris qu'il fallait qu'il y ait plusieurs critères génétiques Je... différence, c'est ça ? Et en fait, comme c'est aléatoire, plus il y en a, plus il y a de chances que ça marche ?
- Speaker #0
Quelque chose comme ça ? Donc, on comprend bien l'évolution par sélection naturelle. C'est vraiment un tri parmi la variation qui existe. Donc, si par exemple, l'environnement change, ça devient plus sec, pour qu'il y ait une adaptation, il faut que, dans la population, il existe un variant génétique qui soit plus résistant à la sécheresse. Et comme ces variations, elles existent au hasard, plus il y a de diversité dans la population, plus il y a de chances qu'il y ait le bon variant qui permette l'adaptation.
- Speaker #1
Donc ça, c'était pour l'Europe. On a vu que c'était essentiellement le changement d'usage des sols.
- Speaker #0
C'est surtout la destruction d'habitats, oui, c'est ça.
- Speaker #1
Et dans le monde entier, c'est plus ou moins les mêmes causes ?
- Speaker #0
Voilà, donc ça peut dépendre. Les causes principales, c'est la destruction d'habitats. Donc, ça va peut-être être la déforestation en Amazonie, par exemple. Ça va être plus important que les pesticides, alors qu'en Europe, ça va être plutôt les pesticides plutôt que la déforestation. Mais il y a quand même de l'artificialisation des sols en Europe qui détruit beaucoup de zones humides, par exemple, de zones riches en biodiversité. La surexploitation, donc.
- Speaker #1
Comme si ça ne suffisait pas, le changement climatique.
- Speaker #0
Et le dérèglement climatique, voilà.
- Speaker #1
D'ailleurs, sur le dérèglement climatique, ça fait vraiment peur. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'à plus de degrés, on n'a plus de coraux. C'est incroyable, en fait. Un monde sans coraux, où plus de 50% des espèces sont hébergées sur ces endroits, on se demande si ce n'est pas un énorme point de bascule en devenir.
- Speaker #0
Non, c'est ça. On peut se dire... Effectivement, qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de différences, par exemple, entre 1,5°C et 2°C de réchauffement moyen sur la planète, mais en fait, ça change énormément pour beaucoup d'espèces. Si c'est 1,5°C ou 2°C, effectivement, on arrive à garder 10% ou 20%. On sent des coraux à un réchauffement de 1,5 degré et à 2 degrés, on les perd pratiquement tous. Et effectivement, ce n'est pas que des coraux, ça héberge une diversité énorme. Et effectivement, il y a cette notion de point de bascule où il y a des effets qui ne sont pas linéaires. par rapport avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... On passe de 1,9 à 2 degrés et tout d'un coup, ça va faire, par exemple, disparaître les coraux qui vont faire disparaître plein d'autres espèces et qui, en chaîne, peuvent entraîner des catastrophes globales sans possibilité de retour en arrière. Parce que quand les espèces ont disparu, elles ont disparu. Oui,
- Speaker #1
c'est ce que vous dites. C'est qu'une espèce qui disparaît ou, en tout cas, une population qui diminue drastiquement, il faudra 3 à 5 millions d'années pour qu'on retrouve la même diversité en population.
- Speaker #0
C'est-à-dire que c'est effectivement l'aspect positif, c'est que la vie reprend. On parlait de la dernière extinction de masse, où les trois quarts des espèces ont disparu. La biodiversité s'est régénérée depuis. Mais ça prend des millions d'années, donc ce n'est pas aux échelles humaines. Et effectivement, il y a une étude scientifique qui a estimé que la biodiversité le compte perdrait dans les 50 prochaines années chez les mammifères, il faudrait 5 à 10 millions d'années pour qu'elles se régénèrent. Donc, qu'elles le feraient si les habitats existent, s'ils ne sont pas trop pollués, mais pas aux échelles humaines.
- Speaker #1
Alors, la prochaine question, je pense qu'avec tout ce que vous avez dit, je peux y répondre maintenant. Et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, mais c'était sur l'adaptation de la biodiversité au changement climatique. Quand j'ai écrit cette question, je me suis dit qu'il y a bien quelques espèces qui vont y arriver, mais en fait, si leur environnement, lui, n'y arrive pas, ça ne sert à rien.
- Speaker #0
C'est ça. Il y a quelques espèces qui peuvent s'adapter à un changement climatique pas trop fort. D'ailleurs, on observe déjà des changements chez certaines espèces, de taille de bec chez les oiseaux, de moments de floraison chez des plantes. Mais ça a une limite, évidemment. Elles ne peuvent pas s'adapter à des dérèglements climatiques trop forts. Et surtout, effectivement, ça dépend aussi des autres espèces dans leur environnement, parce que c'est un aspect dont on n'a pas encore parlé, mais qui est vraiment essentiel pour bien comprendre tous les enjeux de la biodiversité, c'est qu'une espèce, elle n'est pas là toute seule dans son environnement. elle est en interaction avec plein d'autres, elle dépend de plein d'autres espèces. Un arbre, par exemple, on peut se dire, est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à plus de degrés ? Ou est-ce qu'il va pouvoir se maintenir ? Mais si lui, il supporte des conditions, imaginons, à plus de degrés, mais que son champignon symbiotique, lui, ne le supporte pas, ça ne sert à rien, il ne pourra pas se maintenir. Les trois quarts des arbres, ils ne peuvent pas pousser. sans une symbiose avec un champignon qui l'aide à aller chercher de l'eau et des nutriments dans le sol. Il ne peut pas non plus se maintenir sans ses pollinisateurs, ni sans ses disperseurs de graines, ni sans les parasites de ses propres parasites. Et donc chaque espèce est en interaction avec des dizaines ou des centaines d'autres dans un environnement. Et donc le dérèglement climatique, il va aussi affecter, complètement disrupter toutes ces interactions. Et ça c'est extrêmement difficile à prédire. et aussi très... très difficile à s'adapter tout en même temps.
- Speaker #1
Oui, c'est ça. C'est que même si, par exemple, pour le climat, on a tendance à mettre en avant des solutions techniques, et certaines sont bonnes, certaines sont nécessaires, etc. Là, dans la biodiversité, on se dit... En fait, cette complexité du vivant nous rend humbles. Je préfère ne pas toucher que d'essayer de faire un truc. Même pour lutter pour les espèces invasives, parfois on se dit, on va rajouter cette espèce, etc. Mais en fait, c'est que le bout de la ficelle.
- Speaker #0
D'ailleurs, on voit souvent que ça a des effets contraires de ce qu'on attendait. Donc, quand on ajoute ou qu'on enlève une espèce dans un écosystème, ça a des conséquences difficilement prédictibles à cause de toutes ces interactions. Par exemple, un cas bien étudié, c'est dans le parc du Yellowstone où le loup avait disparu parce qu'il était trop chassé. Ça a fait disparaître des plantes qui étaient protégées, et ça a fait disparaître des batraciens, ça a fait disparaître des salamandres. Alors on peut se dire que le castor aussi est parti. On peut se demander quel rapport. Et là, c'est un exemple tout simple. Le loup, quand il est disparu, les herbivores qu'il mangeait ont pullulé, les wapitis. Du coup, il mangeait beaucoup plus les plantes protégées. C'était une espèce de saule en particulier. et du coup ces arbres ont beaucoup diminué en abondance du coup les castors sont partis ils n'avaient plus assez d'arbres pour faire leurs barrages donc il n'y avait plus les barrages des castors et donc les batraciens n'avaient plus leurs habitats et donc quand on a réintroduit le loup, le stone les wapitis ont diminué, les arbres sont revenus, les castors sont revenus, les batraciens sont revenus. Donc là, c'est un exemple tout somme qui montre qu'une espèce, en plus ou en moins dans un écosystème, ça a des conséquences en chaîne sur plein d'autres.
- Speaker #1
Il y a une phrase qui est faussement attribuée à Albert Einstein. « Si les abeilles disparaissent de la surface du globe, l'homme n'aurait plus que quatre années à vivre. » Dans quelle mesure c'est vrai ?
- Speaker #0
C'est toujours difficile à prédire ce qui est vrai et ce que ça veut dire cette phrase, c'est qu'on est très dépendant de beaucoup de ce qu'on appelle les services écosystémiques, donc des services qu'on tire de la biodiversité et en particulier des abeilles. Encore une fois, les trois quarts de ce qu'on mange, de nos fruits, c'est produit grâce à la pollinisation, donc c'est des insectes ou d'autres animaux. qui apportent de la pollen des fleurs mâles aux fleurs femelles, qui leur permettent d'être fécondées, et donc de produire des fruits, des graines, des céréales, etc. Et donc, sans l'héponisateur, oui, on aurait beaucoup moins de fruits et de légumes, par exemple. Mais il y a plein d'autres services qu'on tire de la biodiversité, qui sont... presque encore plus essentielles, comme le stockage du carbone. On ne se rend pas compte, mais en fait, la plupart du carbone qu'on a émis dans l'atmosphère a été stocké dans les océans, dans des forêts. Et donc, on estime, par exemple, que sans ce stockage par la biodiversité du carbone qu'on a émis, on serait déjà à un degré de plus par rapport au réchauffement actuel. Et le problème, c'est que justement, à cause du dérèglement climatique, le fait qu'il y a déjà eu beaucoup de stockage, en fait, on s'est aperçu l'année dernière que ces puits de carbone, ils ont très peu joué leur rôle. Les forêts ont beaucoup moins stocké le carbone l'année dernière qu'elles le font habituellement. Et donc, on se demande si on n'arrive pas à un de ces points de bascule où, à force d'avoir trop émis dans l'atmosphère, ça a déjà trop déréglé le climat. Les forêts sont trop sèches, elles ne stockent plus le carbone, ce qui va encore accélérer le dérèglement climatique. Et en somme, ce que le cinémique est essentiel, c'est aussi toutes les régulations de l'eau et des catastrophes naturelles. C'est-à-dire qu'on commence à prendre conscience que les règlements climatiques causent des inondations, des catastrophes naturelles, mais c'est aussi à cause de la perte de biodiversité. Par exemple, le fait qu'on a fait disparaître toutes les zones humides qui, avant, stockaient l'eau en période de trop d'eau. et le relarguait en période de sécheresse, ça faisait tampon. Et donc, en fait, la plupart des inondations catastrophiques qu'on a vues récemment, c'était autant parce qu'on avait fait disparaître des milieux naturels que le dérèglement climatique en soi. Oui,
- Speaker #1
et c'est ce qu'on voit aussi dans votre livre, c'est que climat et biodiversité, en fait, sont super imbriqués, que ce soit parmi les causes du problème, mais aussi parmi les solutions. Et voilà, en parlant de solutions, parce qu'on... On va essayer d'en sortir quand même quelques-unes, même si je pense qu'aucune ne sera la panacée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins freiner ce déclin ?
- Speaker #0
Effectivement, les meilleures solutions, c'est d'arrêter les causes. C'est tout bête et quelque part, ça peut être un peu frustrant de se dire, une solution technologique, on a l'impression qu'on peut vraiment faire quelque chose. Alors que... Il faut le faire. Ouais. Alors qu'en fait, le mieux, c'est d'arrêter de détruire les habitats et d'arrêter de répandre des pesticides et de surexploiter. Ça, c'est les solutions les plus efficaces, les meilleures et pas si difficiles à mettre en œuvre. Mais effectivement, ça demande un courage individuel et politique. Ça veut dire qu'il faut de la sobriété. Globalement, on ne peut pas continuer à une croissance exponentielle dans un monde fini. Donc, il faut accepter ça et mettre en action les conséquences, les solutions.
- Speaker #1
Pour l'agriculture, concernant la baisse de l'utilisation des pesticides, comment on s'y prend ? Parce que tout le modèle agricole aujourd'hui, partout sur Terre quasiment, il est basé quand même sur un usage intensif des pesticides. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est même plus en curation, c'est en prévention, etc. On a vu aussi que ça avait permis d'améliorer les rendements sur les dernières dizaines d'années, que ça a suivi une hausse de la population. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu un effet cliqué, qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Comment on fait pour produire, pour nourrir tout le monde, disons comme ça, en se passant des pesticides ? Et déjà, est-ce qu'il faut vraiment se passer entièrement des pesticides ou on peut en garder un peu comme avant.
- Speaker #0
Donc effectivement, déjà, si on enlevait les pesticides les plus toxiques, parce que la toxicité des pesticides a beaucoup augmenté ces dernières années, et qu'on réduisait leur utilisation au moment où on a des maladies, et pas seulement en prévention, par exemple, déjà, ça serait un gros progrès. Et en fait, l'idée qu'on a absolument besoin des pesticides pour nourrir la population humaine est complètement fausse. C'est... on a... On a besoin des pesticides dans un modèle où le rendement maximal est vraiment le but à atteindre. Et ce n'est pas durable. Parce que si on répand plein de pesticides, on tue les insectes et on stérilise les sols. Donc on tue tous les micro-organismes qui font la fertilité des sols. Donc ça veut dire qu'à terme, les agriculteurs n'arriveront à rien faire pousser s'ils rendent les sols complètement stériles et qu'il n'y a plus de pollinisateurs. Sans compter toute la toxicité pour les êtres humains, de mettre des poisons dans l'environnement, etc. Et en plus, vraiment... Pour l'instant, on arrive à produire assez de calories pour la population humaine. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas la quantité totale qui est produite, mais sa répartition. Et aussi parce que c'est la façon dont on se nourrit qu'on peut aussi essayer de repenser. Par exemple, en France, pour une calorie, il faut quatre fois plus de surface pour une calorie animale que pour une calorie végétale. Si on réduisait, par exemple, notre consommation de viande par deux, des Déjà, on arriverait à atteindre notre objectif de l'accord de Paris au niveau des émissions de CO2, parce que ça dégage énormément de CO2, cette agriculture intensive. Et en plus, on réduirait beaucoup l'utilisation des pesticides et des surfaces agricoles, et donc de la destruction d'habitats. Si on réduisait ne serait-ce que notre consommation de viande, ça résoudrait pas mal de problèmes. Ensuite, ce qui est des rendements, ça dépend des cultures qui sont plantées. Il y en a certaines qui peuvent très bien se passer des pesticides sans diminuer les rendements, comme les légumineuses. Et donc on pourrait imaginer manger davantage de ces cultures-là. Pour les céréales, c'est vrai que c'est plus difficile de cultiver vraiment en bio sans baisser les rendements. Mais encore une fois, on peut se demander, est-ce qu'il vaut mieux pas baisser les rendements et garder une planète viable, ou baisser un peu les rendements et donc avoir une nourriture peut-être plus subventionnée ? Mais encore une fois, ça dépend vraiment du choix politique, parce qu'actuellement, l'agriculture est extrêmement subventionnée. Mais c'est un modèle. destructeur de l'environnement qui est subventionné. Et si toutes ces subventions allaient plutôt à une agriculture qui est respectueuse de l'environnement et donc qui nous garde notre planète habitable, est-ce que ça ne serait pas mieux ? Et en subventionnant ça, ça permettrait d'avoir des rendements un peu moindres sans changer forcément la capacité des gens à acheter la nourriture.
- Speaker #1
Donc ça c'est pour le secteur agricole. Pas énormément de prise dessus d'un point de vue politique, même si on peut évidemment voter, voter et aussi on peut acheter peut-être...
- Speaker #0
C'est ça, si on achète bio, si on mange moins de viande déjà...
- Speaker #1
Malheureusement, l'inflation est passée par là et le bio pèse d'année en année, mais comme vous dites, il y a beaucoup de subventions qui vont dans le congé.
- Speaker #0
C'est ça.
- Speaker #1
Parmi les autres solutions individuelles, à l'échelle locale, est-ce que tout ce qui est arbre à insectes, choses comme ça, ça marche ? Parce que je ne vois jamais des insectes dedans.
- Speaker #0
Oui, alors ça c'est des idées un peu... Souvent, les gens veulent bien faire. Ils vont, par exemple, mettre des ruches sur les toits ou des hôtels à insectes. Mais, en fait, ça peut être pire que rien faire. Parce que, par exemple, les hôtels à insectes, ça va concentrer les insectes au même endroit. Et donc, les maladies vont être, par exemple, plus contaminées les uns les autres. Les prédateurs vont savoir où sont les insectes et venir les manger. Donc il vaut mieux dans son jardin, par exemple, laisser un peu de bois mort, des abris naturels, des haies, laisser un peu ré-ensovager les jardins, par exemple. Pareil, les ruches, s'il y a trop de ruches, ça fait paradoxalement de la compétition contre les autres pollinisateurs naturels, parce que les pollinisateurs, ce n'est pas juste l'abeille domestique. Il y a des milliers d'espèces d'abeilles et des milliers d'autres espèces pollinisateurs. Et s'il y a trop d'abeilles domestiques, ça fait une concurrence pour les autres pollinisateurs et ça peut être même contre-productif.
- Speaker #1
Autre chose que l'auditeur ou l'auditrice qui regarde ce podcast pourrait faire dès demain, si elle le voulait ?
- Speaker #0
Donc manger bio, manger moins de viande, ré-ensovager son jardin, ne pas couper les haies.
- Speaker #1
Les petites boules de graines, ça marche ? pour les oiseaux ?
- Speaker #0
Alors, ça peut aider, mais c'est pareil, il ne faut pas en mettre trop tout le temps parce qu'il y a des études par exemple qui montrent que si les mésanges qui sont trop nourris comme ça, elles ont des réflexes moins forts. Non, il vaut mieux en fait vraiment mimer les solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire... C'est ce qu'on disait, même si c'est frustrant, ne rien faire, c'est-à-dire ne pas tailler ses haies, ne pas trop débarrasser le bois mort, ne pas mettre d'insecticides. Quelque part, ça a un effet plus que de vouloir mettre des ruches, des hôtels à insectes, faire quelque chose. Mettre aussi une clochette à son chat, parce que ça mange pas mal d'oiseaux.
- Speaker #1
Il y a un truc que les entreprises aiment bien faire, c'est la foresterie. La foresterie, c'est planter des arbres ou replanter des arbres là où il y en avait. Mais j'ai entendu des trucs pas top dessus. Est-ce que vous avez des infos à partager ?
- Speaker #0
Oui, c'est pareil. Clairement, les arbres, c'est bien. Mais la compensation en plantant des arbres, ça peut paraître être une bonne idée. Mais souvent, dans les fêtes, ce n'est pas efficace. Alors déjà, souvent, c'est des monocultures qui sont plantées. c'est-à-dire la même espèce d'arbre boit le même individu, le même clone, au même âge, et donc ça stocke beaucoup moins de carbone et ça abrite beaucoup moins de diversité qu'une forêt naturelle, avec plein d'espèces différentes, d'âges différents. du bois mort, etc. En plus, souvent, ce n'est pas suivi dans le temps, ces projets. Et souvent, parce que, par exemple, on émet du CO2 en faisant un aller-retour Paris-New York et on se dit, on va planter des arbres pour compenser. Le problème, c'est que le CO2 qui est brûlé par l'avion, c'est tout de suite alors que l'arbre, il va mettre 40 ans peut-être à compenser. Et en 40 ans, peut-être qu'il aura brûlé, peut-être que la forêt aura été coupée pour exploiter du bois. Et en fait, les quelques études qu'on suivit un peu sur le long terme, ces compensations montrent que la plupart ne sont pas efficaces parce que les arbres ont disparu ou n'ont pas stocké assez que ce qu'ils étaient censés compenser. En plus, souvent, c'est fait dans des pays lointains où on peut même déplacer des populations locales ou détruire des habitats naturels pour replanter les arbres. Donc là, c'est même pire que si on n'avait rien fait.
- Speaker #1
Il faudrait mieux peut-être payer pour ne pas détruire.
- Speaker #0
Exactement.
- Speaker #1
Maintenant, je vais passer sur une phase avec des questions peut-être un peu plus personnelles. Moi, j'ai le sentiment que la biodiversité, c'est toujours la biodiversité ou le développement humain, quelque part. Enfin, je vais m'expliquer. Par exemple, si on veut faire plus d'agriculture pour nourrir plus de monde, c'est plutôt bien, mais ça se fait au dépend de la biodiversité. Si on veut créer des logements, en France, on a une grosse pénurie de logements, ça se fait au détriment de la biodiversité. Si on remet des lignes de train, des lignes de tramway, de métro, on l'a vu avec le Grand Paris Express qui a artificié ici encore plus de... C'est toujours au détriment de la biodiversité. C'est presque comme une tragédie grecque. Et évidemment, il n'y a personne pour... Enfin, il y a très peu de personnes pour défendre les intérêts de la biodiversité. Moi, je suis du coup pessimiste. Quel est votre point de vue par rapport à tout ça ?
- Speaker #0
Alors, c'est vrai que ça peut... peut être difficile de rester optimiste. Après, on peut voir les nouvelles générations comme vous, comme d'autres, qui se rendent compte à quel point c'est important, même pour la survie de l'espace humain, et qui veulent faire exprimer leur voix et faire des choses activement. Et on peut prendre confiance. Donc, on voit des fois qu'il suffit des petites actions individuelles qui peuvent avoir des effets énormes. Il y a quelques figures qui sont très inspirantes, comme Wangari Matai, par exemple, qui s'est mise à planter des arbres presque toute seule. Petit à petit, ça a pris de l'essor et ça a eu finalement un impact énorme. Il y a beaucoup d'associations qui œuvrent pour la biodiversité et qui arrivent vraiment à... à changer des politiques et le cours des choses. Vous demandiez d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut faire individuellement. C'est s'investir aussi dans les associations, soit en donnant du temps, soit en les soutenant financièrement. Parce qu'elles ont vraiment un énorme pouvoir et arrivent à faire des choses, des vraies victoires régulièrement.
- Speaker #1
Surtout pour la biodiversité qui est plutôt locale, où l'impact peut être devant nos yeux et assez rapidement.
- Speaker #0
Exactement. Finalement, c'est un peu comme dans la tragédie des biens communs, où c'est un peu le problème de la biodiversité. C'est un concept qui avait été développé par un économiste qui disait qu'avec l'exemple d'un prêt, par exemple, dans une commune où les agriculteurs pouvaient amener leurs vaches, c'était un prêt commun. Et donc, le problème, c'est que si tout le monde amène toutes ses vaches tout le temps, très rapidement, le prêt, il ne vaudra plus rien, il sera complètement épuisé. Si tout le monde se restreint, mais qu'il y a un tricheur qui amène toutes ses vaches, lui, il va bénéficier du prêt. Et les autres, à la fin, ils n'auront plus rien, même s'ils ont été prudents. Et c'est un peu comme les ressources naturelles sur la planète. C'est un bien commun. Et le problème, c'est que s'il y a quelques personnes qui les exploitent, eux vont bénéficier. et à la fin, il n'en restera plus pour personne. Et donc, dans ces cas-là, comment on résout la tragédie des biens communs ? C'est avec des accords globaux. Il faut arriver à punir les tricheurs et avoir une réglementation. Ou que ce soit localement, que chacun ait intérêt à conserver son propre environnement. Donc, effectivement, l'échelle locale est absolument essentielle, parce que... Les gens se rendent bien compte localement qu'ils ont tout à fait intérêt à préserver leur environnement pour y vivre. En même temps, il faut aussi des solutions globales. Parce qu'au niveau de la planète, sans ça, il y a toujours des tricheurs qui vont aller exploiter...
- Speaker #1
Par exemple, pour les COP du climat, il y a beaucoup de gens qui critiquent ça, qui disent que ça ne sert à rien, etc. Qui les moquent, en fait. Et qu'est-ce que vous pensez de l'équivalent ?
- Speaker #0
Il y a un nom qui m'échappe.
- Speaker #1
C'est une coppe aussi. La coppe biodiversité.
- Speaker #0
Ça, est-ce que ça porte ses fruits ?
- Speaker #1
Alors, quasiment, ça peut paraître frustrant des fois et pas à la hauteur de ce qu'on attend, mais c'est absolument essentiel, déjà pour en parler, parce que ça amène tous les acteurs autour de la table pour en discuter. Alors, c'est vrai que les coppes biodiversité attirent souvent moins de chefs d'État que les coppes du climat, mais on commence à en parler de plus en plus. La COP de Montréal a amené des objectifs assez ambitieux, donc non seulement de préservation de 30% des aires marines et terrestres, mais aussi ce dont on parlait de faire attention aux subventions, de réduire les subventions délétères pour la biodiversité et d'augmenter celles qui sont en faveur de la biodiversité. Après, il reste à les mettre en action par les pays. Mais c'est aussi une approche qui est absolument essentielle.
- Speaker #0
J'ai dit tout à l'heure que j'étais pessimiste. On parle quand même de plus en plus de ces solutions fondées sur la nature. On a l'impression qu'avant, la biodiversité, c'était quand même un truc un peu de retraité, qui aime bien les oiseaux et prendre des photos, des choses comme ça. Là, on entend beaucoup parler dans le monde de l'entreprise, même au niveau municipal, etc. est ce que Est-ce que vous aussi, vous partagez ce constat ? Et est-ce que ces solutions fondées sur la nature portées par les entreprises, ça peut avoir un impact réel ?
- Speaker #1
Plus on en parle mieux, ça y est. Et clairement, les entreprises ont un impact énorme sur la biodiversité et elles dépendent de la biodiversité. Les trois quarts des entreprises, leur chiffre d'affaires dépendent d'un service ou l'autre de la biodiversité. Donc le fait qu'elles s'en rendent compte et qu'elles soient maintenant obligées de faire un rapport en disant quelles sont les activités qu'elles font qui dépendent de la biodiversité et ce qu'elles font pour essayer de réduire leur impact, c'est complètement essentiel. Effectivement, on en parle de plus en plus. Il y a aussi des reculs au niveau de la biodiversité sur le plan éco-phyto où il y a eu des reculs, sur le plan zéro artificiel en aide des sols où il y a des reculs. Donc, ça avance, ça recule, mais on en parle quand même plus qu'avant. On commence à prendre conscience.
- Speaker #0
Peut-être juste une dernière question sur votre recherche. Le cœur de votre recherche, c'est les champignons, c'est ça ? Est-ce que vous voulez nous en parler pendant 2, 3, 4 minutes ? Carte blanche.
- Speaker #1
Effectivement, moi j'ai étudié les champignons, alors deux types de champignons. D'une part les champignons pathogènes, qui provoquent des maladies chez les plantes, et en particulier par exemple sur des plantes de culture. C'est un des aspects dont on n'a pas trop parlé, mais qui menace aussi certains aspects de la biodiversité, qui est les maladies émergentes dues à des espèces envahissantes. C'est vrai dans les milieux naturels, mais aussi sur les cultures. Il y a des champignons, par exemple, émergents, qui sont en train de décimer les batraciens sur la planète. C'est une des cinq causes de destruction de la biodiversité, les espèces envahissantes. Et il y a beaucoup de champignons pathogènes qui déciment des forêts entières, ou par exemple des chauves-souris, des crapauds à travers la planète, et aussi des maladies émergentes sur les cultures, qui sont dites à ces invasions biologiques. Donc j'ai étudié comme ça des espèces envahissantes sur le milieu de la vigne par exemple, et aussi dans des écosystèmes naturels, des champignons qui... des petites plantes de montagne qui les empêchent de se reproduire. C'est un peu des champignons, des maladies sexuellement transmissibles des plantes. Elles sont transmises par les pollinisateurs d'une plante à l'autre. Donc j'essaye de comprendre comment ces champignons s'adaptent à leurs hôtes et sont capables de créer des maladies sur des nouvelles plantes hôtes. en se formant des nouvelles espèces, à dater des nouvelles plantes hautes.
- Speaker #0
Donc si c'est des espèces envahissantes, ça veut dire que c'est des champignons exotiques, exogènes ?
- Speaker #1
Oui, par exemple, il y a le Cryphonectria qui vient d'Asie et qui a complètement décimé les châtaigniers en Amérique du Nord. D'ailleurs, ils ont été traumatisés parce que c'était une espèce dominante. aux Etats-Unis et il a été complètement décimé par cette espèce envahissante.
- Speaker #0
Et importé dans des... Voilà,
- Speaker #1
par des cultures, par des plants de châtaigniers. Pareil pour la maladie de la vigne, ça a été... En Europe, on avait eu le phylloxéra, donc c'était une maladie causée par des petits insectes. Et donc, pour lutter contre le phylloxéra, on a importé des plants de vigne d'Amérique du Nord et on a importé avec le mildiou, qui a créé une nouvelle maladie envahissante.
- Speaker #0
Ça revient toujours sur le problème des solutions techniques.
- Speaker #1
Et un autre aspect de mes recherches, c'est sur les moisissures qu'on utilise pour affiner les fromages. Donc, on a vraiment domestiqué ces moisissures, de la même façon qu'on a domestiqué le chien, ou qu'on a domestiqué le blé, le maïs. On utilisait des moisissures pour faire du fromage bleu, par exemple. Et petit à petit, les gens ont... On a pris la moisissure qui donnait le meilleur fromage bleu, l'ont réensemencé dans leur lait pour refaire du fromage, ou encore choisi le meilleur fromage pour réensemencer. Et donc on a vraiment sélectionné les meilleures moisissures qui faisaient le meilleur fromage. Et donc petit à petit on a changé l'espèce, on l'a fait évoluer, de la même façon qu'on a généré le chien à partir du loup, en sélectionnant de génération en génération des caractères un peu différents. On l'a fait de la même façon, un peu inconsciemment, dans les moisissures du fromage. Et donc on a pu montrer par exemple qu'on a vraiment sélectionné, changé l'espèce qui fait du meilleur fromage, plus bleu par exemple pour le Roquefort, avec des meilleurs arômes, qui dégrade le lait plus vite.
- Speaker #0
Et ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que c'est le même champignon sur le Roquefort que sur la tomate qui est pourrie dans le frigo.
- Speaker #1
Voilà, c'est la même espèce, mais donc pas exactement la même population. puisqu'on l'a domestiqué. Donc, on a essayé de faire du fromage façon Roquefort avec des moisissures de tomates ou de pain, et ça ne donne pas du bon fromage. Donc, c'est la même espèce, mais ce n'est pas la même population, et ce qui montre d'ailleurs qu'on l'a vraiment changé, domestiqué pour faire du bon fromage. Mais la contrepartie, donc c'est un peu aussi un des problèmes de biodiversité dont on n'a pas parlé, qui existe dans l'agriculture, c'est que... Pendant longtemps, on a domestiqué des espèces, on a créé plein de variétés. Quelque part, on a même augmenté la diversité génétique par la domestication. On a créé plein de variétés de tomates, du maïs. Nous, on ne connaît que le maïs jaune, le gros épi, mais il y a des maïs roses, il y a des maïs noirs, des petits, des gros, des trapus. Et récemment, il y a eu une intensification de la sélection. qui a fait drastiquement réduire la diversité dans nos semences, dans nos cultures. Et on l'a montré pareil chez les moisissures du fromage, où on avait pareil généré chaque producteur de fromage, avait sa souche, etc. Et là, on a eu une sélection récente qui a fait drastiquement chuter la diversité dans la moisissure. Et on a pratiquement un seul clone dans tous les fromages bleus du monde entier. Alors qu'avant, on avait une diversité énorme.
- Speaker #0
Oui, donc on comprend bien qu'à court terme, on n'a pas fait ça pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'on produit le rendement des maïs à largement augmenter, mais qu'à long terme, il y a une sorte de fuite en avant.
- Speaker #1
C'est exactement le problème en fait, le plus global. C'est-à-dire qu'on pense qu'à court terme et pas assez à long terme.
- Speaker #0
Eh bien, ce sera le mot d'affaire. Merci beaucoup.
- Speaker #2
Merci à vous.