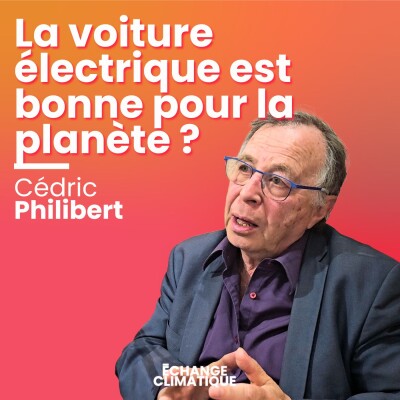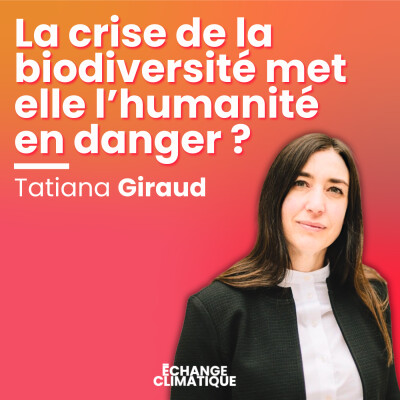- Speaker #0
Un tiers des Français sont climato-sceptiques. C'est ce que révèlent plusieurs études récentes, et cette tendance est en hausse. Une évolution préoccupante, alors même que les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir, et que les connaissances scientifiques sur ce sujet n'ont jamais été aussi solides ni aussi accessibles. Or, en démocratie, les politiques suivent normalement l'opinion publique. Si le doute gagne du terrain, c'est toute la transition écologique qui risque d'en pâtir. C'est pourquoi j'ai voulu consacrer cet épisode à ce phénomène. qui sont les climato-sceptiques ? Pourquoi le sont-ils ? Et surtout, peut-on les rallier à la cause climatique ? Pour en parler, je reçois Amélie Deloffre, cofondatrice de Parlons Climat, une association qui cherche à mieux comprendre les liens entre les Français et la transition écologique. Qui sont les climato-sceptiques ? C'est le thème de cet échange climatique. Bonjour Amélie Deloffre. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
- Speaker #1
Alors je m'appelle effectivement Amélie Deloffre et je suis la cofondatrice de Parlons Climat. Parlons Climat c'est une organisation qui a aujourd'hui deux ans et demi, qu'on a monté avec mon associé qui s'appelle Lucas, et qui vise à mieux comprendre, documenter un peu l'opinion, on appelle ça l'opinion publique mais en fait la relation qu'entretiennent les Français avec la transition écologique. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui avance, quelles sont les crispations en fait. Et notre but, c'est de documenter et de mieux comprendre, notamment les individus qui ne sont pas ou peu engagés dans la transition, voire complètement défiants, donc de discuter avec eux, de faire des sondages, de mieux comprendre. Et puis ensuite, d'atterrir sur quelle stratégie d'information et de communication on pourrait mettre en place, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans les discours sur la transition pour engager plus de gens.
- Speaker #0
Et parmi ce qui ne marche pas dans la transition ou ce qui freine la transition, il y a notamment le climato-scepticisme. Vous venez de sortir une étude dessus il y a quelques mois, pourquoi vous avez décidé d'approfondir ce sujet ?
- Speaker #1
Alors pour plein de raisons. Déjà effectivement c'est notre cœur de mission de comprendre un petit peu ces oppositions. On les dit de plus en plus nombreux, on a vu les chiffres un peu augmenter ces dernières années. Aujourd'hui on est à peu près sur un tiers des français, c'est quand même assez important quand même. S'il y a un tiers des français qui sont opposés à la transition, autant comprendre pourquoi. C'est aussi un sujet en fait qui a été peu étudié. on a un chercheur français qui a étudié ça, qui s'appelle David Chavallarias, j'en reparlais peut-être tout à l'heure, mais qui a étudié le climato-scepticisme vu de Twitter, qui est un réseau mais qui n'est pas représentatif de la France ni des Français. Et souvent, ça crée une confusion un petit peu dans le débat public où on parle des climato-sceptiques via ce prisme-là, Twitter, et aussi via des propos un peu presque dénalistes qu'on entend chez Trump, chez quelques représentants politiques, etc., qui sont... qu'on appelle de la désinformation. Et ensuite, on fait lien avec ce climato-scepticisme-là en disant qu'il y a un tiers des Français qui sont climato-sceptiques. On s'est dit, est-ce que c'est le même ? Est-ce que c'est vraiment les mêmes personnes ? Dans ce cas-là, ça serait très grave. Jetons-y un oeil. Et puis aussi parce que ça envoie quand même un signal dans l'opinion publique, un signal aussi politique pour nos décideurs. On attend quand même que les décideurs prennent des initiatives pour faire avancer la transition. Si on pense, si on a à l'esprit qu'un tiers des Français... sont ennemis du climat ou ne croient pas au changement climatique, comme on fait le raccourci en termes de définition, on n'est pas très bien.
- Speaker #0
C'est vrai que cette définition, elle est un peu floue. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais, s'il te plaît, définir le climato-scepticisme ou les climato-scepticismes ?
- Speaker #1
Oui, donc ce n'est pas ma définition. C'est vraiment la définition aujourd'hui scientifique qu'elle est acceptée et en fait mesurée dans les sondages. Le climato-sceptique, c'est donc un individu qui émet des doutes sur l'existence ou la cause anthropique. du changement climatique, par cause anthropique on entend, qui met en doute que l'homme, les activités humaines, soient la cause principale du changement climatique. Et donc il y a dans ce doute sur l'existence et les causes, grosso modo c'est plutôt sur les causes que se porte ce doute. On fait un raccourci généralement en disant, les climato-sceptiques ne croient pas au changement climatique. Or, ce doute sur l'existence est vraiment très minoritaire, on appelle ça le dénialisme. Donc si tu veux, le négationnisme ou le dénialisme, c'est une petite partie. vraiment marginale des Français, de la population. Effectivement, le reste, c'est du doute sur... Quand on creuse, et ce qu'on a fait en faisant des entretiens, c'est de l'ambivalence, c'est du doute, c'est aussi un phénomène naturel, on ne sait pas trop se positionner. Il y a tout ça, en fait.
- Speaker #0
Oui, il y a plein de nuances. Et il y a des chiffres qui circulent sur le nombre de climato-sceptiques en France. Tu disais un tiers, parfois on entend 10%. Où est-ce qu'on en est par rapport à ceux qui dénient complètement le changement climatique ou alors ceux qui dénient seulement la cause anthropique ? Et comment cela évalue avec le temps, puisque maintenant ça fait quelques années qu'on a ce genre de sondage dans la population ?
- Speaker #1
Effectivement, on a beaucoup parlé de climato-sceptique selon cette mesure. Donc c'est une question de sondage qu'on pose dans les sondages. Selon vous, à quoi est dû le changement climatique ? Effet naturel, cause anthropique ou n'existe pas ? En fait, il faut savoir déjà, avoir à l'esprit qu'il y a une absence de standard sur cette question. Donc les modalités et la manière dont on pose la question, elle a vachement évolué, notamment ces trois dernières années, où on s'est dit que le doute augmentait. Donc on a proposé, si tu veux, des modalités de réponse différentes, plus étoffées dans la négative, à savoir on ne peut pas savoir, je ne sais pas, le changement climatique n'existe pas, etc. Et à mesure qu'on a proposé plus de nuances, on a vu aussi augmenter leur nombre. Est-ce que c'est que ça ? Non, parce qu'objectivement, quand même, il y a une tendance haussière. Cela étant, il y a quand même des effets méthodologiques. L'ADEME a un baromètre depuis 25 ans qui s'appelle les représentations sociales du changement climatique, qui fait référence là-dessus parce que 25 ans quand même, qui a cette même question. Et effectivement, ils ont changé la méthodologie en 2022, je crois, et on est passé de 18 à 36%. Et ce qui a eu un bon x2 de climato-sceptique, où il y a quand même un effet méthodologique, il y a certainement un peu des deux. On peut dire aujourd'hui, les sondages selon la modalité de réponse qu'on propose sont entre 30 et 40-42 pour ceux qui ont les résultats les plus hauts. Donc il faut juste se dire que nous on s'arrête à un tiers, qu'il y a une tendance haussière à confirmer, à suivre, sachant que sur 25 ans, au sein de l'ADEME, au sein du baromètre, on voit que ça évolue. Ça n'a jamais été, si tu veux, linéaire. On assiste à une petite montée, il faut la suivre, il faut comprendre pourquoi.
- Speaker #0
Donc une tendance haussière, malgré les impacts du changement climatique toujours plus présents. Et c'est ça que... Ce que je trouve intéressant dans votre rapport, c'est que vous allez chercher les causes de ça, et puis en comprenant les causes, on comprend mieux pourquoi finalement il y a ce paradoxe qui peut-être n'en est pas ça. On va le voir, je pense. Donc, qu'est-ce qui caractérise spécifiquement les climato-sceptiques, ou en tout cas chaque groupe de climato-sceptiques que vous avez identifié ?
- Speaker #1
Alors, je dirais qu'il y a quelque chose qui est un petit peu latent, qu'on retrouve un petit peu chez tous les climato-sceptiques. Effectivement, on en a trouvé plusieurs profils. Je dirais qu'il y a une forme d'anti-écologiste qu'on entend. On a entendu une petite musique comme ça. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a fait. Quand je dis j'entends, c'est parce qu'on a fait aussi des entretiens semi-directifs. On avait 24 entretiens d'une heure avec des climato-sceptiques. Donc ça, c'était une composante qu'on a cherché un petit peu à mieux comprendre. Et surtout, on parle souvent de portrait robot. Alors moi, avant d'entrer dans un portrait robot, j'aime bien rappeler que vraiment, on retrouve les climato-sceptiques vraiment dans chaque classe de la population. Chaque classe d'âge, sexe, etc. Il y a des déterminants. Il y a des facteurs sociodémographiques où on en retrouve, il y a des endroits dans la société où on retrouve plus de climato-sceptiques, mais vraiment le grand message qu'il faut garder quand même en tête, c'est qu'il y en a un peu partout. Voilà, c'est pas focalisé. Là où il y a un petit effet en termes de sociodémographique, effectivement il y a un petit effet âge, il y a plus de climato-sceptiques chez les plus de 65 ans. Voilà, à mesure que... Il y a ça, il y a un effet un peu diplôme, effectivement aux extrémités vraiment de la population, entre les études supérieures, diplômés du supérieur, et des gens qui n'auraient pas de diplôme du tout. Effectivement, il y a une différence en termes... Il y a plus de climato-sceptiques chez les gens qui n'ont pas de diplôme. Ça se recoupe avec l'effet âge, puisque quand les personnes âgées avaient moins de diplôme, avaient accès au diplôme. Et puis, il y a un effet aussi positionnement politique, qui est le plus fort, effectivement. À mesure qu'on regarde à droite de l'échec qui est politique, le nombre, la part de climato-sceptiques au sein de ces électorats augmente.
- Speaker #0
Comme tu disais, les gens plus à droite ont tendance à être... plus climato-sceptiques. Or, les valeurs de droite, ça va être des choses comme l'ordre, l'identité nationale, le mérite, la méritocratie, etc. Qu'est-ce que vient faire là-dedans, une espèce de fake news qui va complètement contre la science ? C'est bizarre de retrouver ça, en fait.
- Speaker #1
Effectivement, sur le rapport politique, le positionnement politique, t'as raison. On voit que ce qui explique le plus notre croyance au changement climatique, En tout cas, notre rapport au climat, c'est nos valeurs, les lunettes qu'on porte pour voir le monde. Il faut savoir qu'en fait, à droite et à l'extrême droite, on a des sujets clés qui sont l'immigration, la sécurité, la croissance économique. C'est hyper important. Et à gauche, tu as d'autres valeurs et d'autres préoccupations qui sont un peu phares et qui ne bougent pas, quel que soit le contexte, que sont les inégalités, l'environnement, etc. C'est presque un petit peu identitaire, en quelque sorte. c'est des choses qui ne boutent pas, quel que soit le... pouvoir d'achat, ça fluctue selon le contexte. Et du coup, l'écologie s'en fait un sujet de gauche, qu'on le veuille ou non, parce que portée, incarnée, en fait, dans des programmes de gauche, majoritairement. Donc, dès lors que je suis à droite ou d'extrême droite, je me reconnais moins. là-dedans. Et en plus, pour moi, c'est moins une priorité. Et puis, pour ce qui est de l'extrême droite, je pense qu'on peut aussi chercher une réponse dans la composition même des électorats. À gauche, on a un électorat qui est plus jeune, qui est plus urbain, il y a plus de CSP+, etc. Quand tu regardes l'électorat, par exemple, de l'extrême droite, on a des personnes plus âgées, en milieu rural, moins diplômées et moins riches. Ce qui fait qu'en fait, aussi, tu peux expliquer qu'il y a un peu plus de climato-scepticisme Euh... à l'extrême droite. Mais je pense qu'effectivement, dans la manière d'incarner et même les solutions proposées, c'est très interventionniste. Si tu regardes les politiques climatiques qui sont proposées aujourd'hui, c'est taxé. C'est interdit. C'est obligé à rénover la rénovation. Et en fait, la vision très interventionniste de l'État, c'est une vision de gauche. Et aujourd'hui, la droite ni l'extrême droite, personne n'incarne de solution qui pourrait résonner avec ces valeurs. Et ça peut exister. Nous, on pense que ça peut peut-être exister. De fait, il y a une crispation et cette crispation qu'on entend, je t'en parlais, la petite musique anti-écologiste et pas anti-écologie, elle vient un petit peu de là. C'est je ne me reconnais pas dans les valeurs que vous portez, dans l'incarnation ou les personnes qui portent ce discours qui vont être plutôt, qui représentent peut-être une sorte d'élite diplômée urbaine et qui est déjà, tu vois, qui crée déjà une crispation. On le voit au sein de l'électorat du RN, par exemple. Une forme d'anti-élitiste. On parle de populisme ou quoi. Tout ça se recoupe, en fait. La transition, elle prend appui sur un antagonisme politique, sur des inégalités, d'où la transition qui est perçue comme venant d'en haut, dominante, qui est moins acceptée. Tout ça, en fait, un peu les cassures dans notre société, on les retrouve, en fait, dans la relation que les Français entretiennent avec la transition écologique.
- Speaker #0
Est-ce qu'on peut quand même imaginer que ces thèmes gagnent tous les partis ou alors... Ou alors il y aura toujours ce clivage Ausha ?
- Speaker #1
C'est difficile d'anticiper. Je ne sais pas si tout est perçu de gauche. Je ne pense pas à les gestes, le tri, tout ça c'est bien accepté. Il faut garder en tête que...
- Speaker #0
La biodiversité de manière générale.
- Speaker #1
La biodiversité et même les politiques publiques, elles sont assez consensuelles. À part tout ce qui touche à la voiture et à l'interdiction de la voiture, parce qu'il y a un sujet quand même voiture en France et qu'il y a un lever de bouclier là-dessus, elles sont majoritaires. Le soutien aux politiques climatiques dans tous les sondages, elles sont majoritaires depuis des années.
- Speaker #0
Même si on est climato-sceptique ? On n'est pas plus contre les mesures de transition écologique que la population normale, à part pour les climato-sceptiques durs, durs, d'analyse.
- Speaker #1
Ce qu'on a mis en exergue sur ces climato-sceptiques, c'est assez contre-intuitif, mais il y a quand même 30% qui sont presque des alliés du climat. Nous, on les a appelés les sceptiques convaincus. Et en fait, on a vu que la perception de l'origine du changement climatique, est-ce qu'il est un phénomène naturel, est-ce que c'est la cause de l'homme, était peu liée en fait. à une écologie du quotidien. On peut très bien se dire, c'est plutôt un phénomène naturel, ça me semble évident, j'ai vu qu'il y avait des variations, j'ai entendu dire qu'il y avait un âge glaciaire, je ne sais pas trop. Il y a ça comme discours. Et puis à côté, être évidemment anti-surconsommation, anti-pollution, évidemment la voiture électrique, etc. Et donc il y a 30% de notre échantillon, des climato-sceptiques, qui en fait ont le même niveau d'opposition que les Français, c'est-à-dire que tu n'as jamais un Français qui est ouvert sur tous les curseurs. On a tous un peu nos antagonismes, des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Elle n'est jamais consensuelle à 100%. Donc, en cela, il ressemble à l'ensemble des Français.
- Speaker #0
Mais donc, ce refus d'accepter l'origine anthropique du changement climatique, c'est le fait que si ça l'est, alors c'est les modes de vie, c'est mon mode de vie qui est impacté directement. C'est ça, pour toi, le cœur du sujet ?
- Speaker #1
Alors, le cœur du sujet, effectivement, c'est que ce n'est pas un manque d'information. Oui.
- Speaker #0
Et ça c'est intéressant de le dire Parce que longtemps les scientifiques du climat ont cru Qu'en allant prêcher Leurs recherches et leurs résultats De recherche dans les médias Ils allaient réussir à convaincre tout le monde, en fait pas du tout Tout à fait,
- Speaker #1
c'est un peu ce qu'on C'est l'apport majeur aussi De ce qu'on dit là-dedans C'est aussi Les médias et les scientifiques se font un travail Absolument remarquable Depuis des années pour porter cette cause Et il faut absolument qu'ils continuent et on leur dit merci etc Donc on ne dit pas que... mais on dit juste que ça ne peut pas suffire. Est-ce qu'on va réussir à embarquer tout le monde avec des fresques du climat et de l'information ? En fait, on se rend compte que non, parce qu'en creusant, ce n'est pas que les gens ne sont pas exposés. Sinon, une petite partie des climato-sceptiques, plutôt coupées de l'information, plutôt classe populaire et qui sont en retrait, qui ont une méconnaissance qui nous rien doute, certes, mais la majeure partie des climato-sceptiques, ce n'est pas un manque d'information. Ce n'est pas ça. Et c'est pas non plus une sorte de... On pourrait les décrire comme conspirationnistes. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est pas tant ça. C'est vraiment... C'est un mode de défense. C'est... Est-ce qu'on... On peut se féliciter, quand j'entends ça, je me dis, on peut se féliciter qu'en fait la transition, elle a infusé dans notre société. C'est jamais assez, ok, en termes de passage à l'acte, on est bien en dessous, les solutions n'arrivent pas, etc. Je pense qu'on peut mettre le doigt sur plein de choses, l'urgence climatique, on n'est pas à la hauteur, certes. Si aujourd'hui, un tiers des climato-sceptiques s'en défendent, parce que le climato-scepticisme, c'est ça, c'est la transition telle que vous me la proposez, elle impacte mon mode de vie, elle stigmatise mes pratiques, la moto, l'avion, la chasse, etc. elle est dominante, elle me rend impuissant, je me sens impuissant face à ça, tout seul. C'est des Français qui s'en défendent. Or, si tu as quand même un tiers des Français qui s'en défendent, ça veut dire que quand même, la contrainte, la transition, c'est qu'elle est perçue quand même. Elle est perçue, elle a un fusée, si bien que quand même, il y a un tiers des Français qui se disent je la mets à distance. Et effectivement, on a vu qu'il y avait un raisonnement qui était presque inversé qui est, ok, parce que vous stibatisez mon mode de vie, vous me demandez d'arrêter l'avion, etc. C'est trop dur. Alors, peut-être que l'homme n'est pas responsable du changement climatique. Parce que je vois bien que ce que je fais, mes petits tris de déchets, etc. Ça ne résout pas le problème. Je me sens impuissant. Alors, si moi, je n'ai pas d'impact, c'est que peut-être qu'on n'est pas responsable et qu'il n'y a pas de problème.
- Speaker #0
C'est ça. Et pas le cheminement inverse. mais ça les gens ils vous l'ont pas dit banco vous l'avez déduit
- Speaker #1
C'était assez clair dans nos analyses. Parfois, ça se tenait d'un bloc. Vraiment, ce que je viens de te dire, c'est presque mot pour mot un verbatim de « je ne me sens pas puissance, alors ça se trouve, je ne suis pas responsable » . Et qui plus est, après, on a travaillé avec Melusine Bounfaller, on a présenté nos résultats à plusieurs chercheurs, pour se dire, parce que nous aussi, on est tombés des nues, on ne s'attendait pas à ça, quand on a fait ce renversement de compréhension. Et puis, en creusant en sciences cognitives, donc elle est chercheuse en sciences cognitives, en fait, tout se tient.
- Speaker #0
Mais le problème, c'est que quand on sait ça, on a tendance à se dire bon, alors il ne faut pas cubabiliser, il ne faut pas interdire ceci, il ne faut pas taxer cela. Mais en même temps, on continue d'émettre des gaz à effet de serre et malheureusement, il y a des solutions qui ne sont peut-être pas parfaites, mais il n'y en a pas non plus 36. Du coup, on ne sait plus trop sur quel pied danser, comment on dit les choses, parce que si on ne dit rien et si on ne cherche pas à confronter les gens, il ne se passe rien en fait.
- Speaker #1
Alors, la réponse est extrêmement difficile. Plus je travaille sur le sujet, plus je me dis... Enfin, c'est difficile de trouver une solution qui convaincrait l'ensemble des Français. Je crois qu'il faut oublier. Beaucoup d'études en ce qu'on appelle en climate communication, donc la science d'étudier la meilleure manière d'impacter les gens et de leur expliquer le climat, montrent qu'en fait, entre un discours alarmiste et un discours positif, avec des solutions, innovation, etc., ils ont montré qu'en termes de résultats et d'incitation au passage à l'action, c'était les mêmes. Parce que si t'es trop alarmiste, t'engages une petite partie de la population qui se dit « Il y a urgence, il faut y aller » , mais en même temps, tu fais peur à d'autres gens. Et si t'es trop positif, pareil, tu ne motives pas assez de personnes. Donc vraiment, sur ce qu'est-ce qu'il faudrait faire, on est tous en train de chercher. Globalement, on est tous en train de chercher. Mais donc, un mix des deux. Nous, on atterrit un petit peu en termes de recommandations, et c'est ce qu'on se dit, en fait, c'est la même chose. On pensait atterrir sur une nouvelle stratégie de communication pour parler au climato-sceptique. Notre étude, on s'est dit, on va travailler avec nos partenaires pour se dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les climato-sceptiques ? On s'aperçoit qu'en fait, ils ont les mêmes freins que la population française. Donc, il n'y a pas de stratégie spécifique. Sinon, on peut faire quelques petites choses. Évidemment, ce que je te disais un petit peu, prendre conscience que l'écologie est encore aujourd'hui un entre-soi. On ne va pas se blâmer pour ça. On dit merci. On n'a pas à se blâmer pour ça. Juste en prendre conscience qu'il faut qu'elle mute. quand aujourd'hui tu as par exemple Jean-Marc Jancovici ? qui prend la parole et qui propose des choses, etc. Je ne pense pas qu'il soit militant écolo. Il a des positions sur le nucléaire, etc. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il a le mérite, il est ingé. Il a amené, avec la décarbonation, un discours qui est très technique, d'ingénieur de CO2. Il a porté ce sujet qui est de l'écologie à un autre milieu, tu vois, qui n'aurait pas été adressé par les militants écolos. Et après, qu'on ne soit pas d'accord sur les solutions, le nucléaire, on peut en discuter, mais au moins émerge quelque chose, tu vois. Si on avait des visions, des solutions, des incarnations qui viennent de milieux populaires, de milieux ruraux, Et disons... de la droite qui viennent d'autre part et qu'on puisse au moins parler des solutions, ça serait génial. Or, aujourd'hui, tout ça est à gauche et on voit que ça tend. Donc, comprendre qu'on est dans un entre-soi, accepter qu'elle mute, qu'elle soit portée par d'autres gens et peut-être d'autres types de solutions, même si, nous, ça choque un peu nos valeurs, soit on prend conscience qu'on a des valeurs différentes dans la société et on se dit, ok, on a un sujet global, on a un sujet commun qui est l'écologie, comment ça résonne chez l'un et chez l'autre ? Soit on se dit, mes valeurs sont les mieux que les vôtres, et donc on est sur un débat de valeurs, et on est sur une guerre culturelle de valeurs. Et dans ce cas-là, on ne fait pas avancer l'écologie. Donc voilà, il y a ce truc-là. Et pour tout ce qui est discours, on tend à se dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'écologie, il y a une sorte d'habituation. On voit les catastrophes naturelles à la télévision, on voit que ça ne déclenche pas plus de mise en action. On a une nécessité aujourd'hui de se réinventer et constamment de chercher de nouveaux leviers de communication et d'information. Il y a ce qu'on peut déduire quand même, nous, quand on parle avec des gens qui sont plus écartés du sujet et de l'information. On a un sujet de complexité. On parle beaucoup de décarbonation, de CO2. On voit que c'est un sujet qui n'est pas du tout du vocabulaire qui n'est pas du tout utilisé par toute une partie de la population française, qui a aussi une vision pas forcément systémique. Donc, c'est un sujet très technique. Il ne faut peut-être pas parler que de CO2, le rapprocher des gens par les qualités de vie. Ne pas tout recentrer que sur l'écologie, dans une séquence où on est très anti-écologisteux, ne pas mettre l'écologie au centre comme si c'était peut-être tout, mais en faire un projet de société, tu vois. On parle, nous, de co-bénéfice. C'est aussi faire des économies, c'est aussi bon pour la santé. Aujourd'hui, on a une séquence qui est très pouvoir d'achat quand même catastrophique. Beaucoup de gens sont stressés par comment boucler les fins de mois. Tu ne peux pas leur demander en plus de faire des efforts pour mieux rémunérer les agriculteurs, par exemple. C'est difficile parfois à entendre. Donc, il y a besoin de mixer l'écologie. avec d'autres enjeux, et de montrer en quoi c'est un projet de société, un projet et une qualité de vie où tu y gagnes. Voilà. Rapprocher des gens, plus accessibles parfois, incarnés par d'autres, c'est des pistes.
- Speaker #0
Et dans votre rapport, il y a aussi une autre solution que vous proposez, c'est donner du pouvoir d'agir, et c'est logique parce que vous dites que une des causes du climato-scepticisme, c'est un peu l'impuissance auquel font face les gens, et c'est bien compréhensible parce qu'à notre échelle... Le problème est tellement vaste qu'on a parfois du mal à voir ce qu'on peut y faire, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut y faire ?
- Speaker #1
Alors, ce frein de l'impuissance, là, on le retrouve pas mal. Et notamment, il faut garder à l'esprit qu'il y a une partie des Français, quand même, qui se sentent peu maîtres de leur vie, qui ont peu matière à réinventer leur vie, à prendre des décisions, à pouvoir changer de travail, etc. Ça, on l'a... pas souvent en tête, mais du coup l'écologie se rajoute. Donc ça fait encore quelque chose qui est extrêmement anxiogène, que je ne maîtrise pas ou on m'impose des choses. Et ça, c'est difficilement entendable et recevable. On a besoin de montrer les solutions individuelles, mais aussi collectives, pas tout faire reposer sur l'individu. Montrer aussi que d'autres se bougent en France, mais aussi dans le monde, parce qu'effectivement, un des arguments qu'on entend beaucoup. Mais moi, si je ne fais rien, parce qu'en fait, les élites, les jets privés et puis les Chinois, ils polluent. Ça, c'est un truc qui revient quand même assez souvent. Et pareil, les études en Climate Communication ont montré quand même qu'on s'engage que si on a l'impression que chacun fait sa part, qu'on est dans une dynamique. Quand on est seul dans son groupe social à faire, on ne passe pas à l'action. Et puis, montrer que ça a des effets. mieux expliquer les effets, que ce soit encore une fois des gestes individuels ou collectifs qui peuvent faire changer les choses. Je crois que la Terre au Carré a fait il y a quelques semaines une review de toutes les victoires écologiques remportées par les militants, en montrant à quoi ça sert d'aller en manif, par exemple, ou de bloquer pour te signifier que tu n'es pas en accord avec ce projet, que ce soit, je ne sais plus si c'était l'autoroute et tout, il y en avait plein, il y avait 62 victoires. Parfois, tu te demandes à quoi ça sert de signer des pétitions. Tu ne vois pas, tu vois à quoi ça sert de signer une pétition. Et donc, il y a tout un travail à faire là-dessus, parce qu'effectivement, on est des gouttes d'eau. Donc, parfois, il faut montrer l'océan.
- Speaker #0
Cette recrudescence du climato-scepticisme, est-ce qu'elle ne s'explique pas non plus aussi par juste le changement de politique ambiant qu'on observe un peu à l'échelle planétaire avec la réélection de Donald Trump, par exemple, qui... qui suit aussi un peu, avant c'était un anti-covid, c'était un anti-vax, puis après c'est devenu pro-russe lors de la guerre en Ukraine. Et en fait, ces leaders d'opinion aussi, on a l'impression qu'ils emportent avec eux leur base. Et finalement, leur base, elle passe d'un complotisme à l'autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez perçu lors de votre étude ?
- Speaker #1
Non, assez peu. Et en fait, j'en discutais avec des journalistes dernièrement. On se disait, nous, on analyse vraiment l'opinion publique. La désinformation, c'est un fait. Et effectivement, les postures, les discours anticlimato-sceptiques sont presque dénalistes. Là, j'attends, il y a un distinguo. Antivax et conspirationnistes, effectivement. Donc, il y en a beaucoup sur Twitter, avec une armée qui attaque les scientifiques, etc. Et effectivement, ils sont de plus en plus médiatisés. Et en plus, sur certaines chaînes de télévision. Et donc on se dit forcément que ça va avoir un impact et ça va infuser, nous, sur l'opinion publique. Je pense qu'il est un poil tôt pour vraiment avoir une masse assez importante à étudier et se dire « Wow, beaucoup de Français sont conspirationnistes, anti-vax et compagnie. » Donc effectivement, c'est un phénomène qu'on observe beaucoup sur Twitter, notamment qui a été documenté par David Chevalarias, qui a montré qu'en fait, effectivement, les gens, toute la sphère anti-vax, en plus il y a des bottes, etc., pro-russes, c'était déporté. sur la partie dénaliste, anti-climat, et attaquent les scientifiques. C'est trop tôt pour voir ça, j'espère qu'on ne le verra jamais au sein de la population française. Il y a, nous, dans notre échantillon, on a mis au jour 25% de climato-sceptiques durs, donc en opposition aux climato-sceptiques mous, qui sont ceux dont on a parlé tout à l'heure, qui sont en fait des alliés du climat, qui ne se distinguent pas, et qui regroupent dans ces durs, dans les 25%, effectivement, tu as deux types. qui sont effectivement les opposants politiques d'extrême droite, qui est effectivement un peu ce qu'on disait tout à l'heure, je suis d'extrême droite, il y a une forme de détestation de la gauche et des écologistes, mutuelle, une forme de détestation, et donc l'un et l'autre on s'envoie la balle en se disant ce que tu proposes c'est nul et je suis contre, ce que tu proposes c'est nul et je suis contre. Il y a un peu ça. Et de l'autre côté tu as effectivement une forme de, nous on les appelait les smart climato-complots. des individus aussi un peu plus âgés, très informés, etc., qui effectivement ont une forme de conspirationnisme et de complotisme, à savoir penser qu'il y a des intérêts supérieurs en place dans le monde, il y a des géants qui œuvrent à leurs propres intérêts, et nous ne sommes que des pions, et effectivement le climat est manipulé par la géoingénierie et compagnie, et il y a un peu ça, effectivement, il y a ça dans le climato-scepticisme dur, on ne peut pas le nier, c'est juste que ce n'est pas représentatif de la population française actuellement. Et on ne peut pas savoir comment ça va évoluer.
- Speaker #0
Puisqu'on repart des parties politiques, on a quand même acté qu'il y avait beaucoup plus de climato-scepticisme à droite, et notamment quasiment l'ensemble des DUR. Dans votre rapport, vous parlez aussi des climato-sceptiques de gauche, donc même partie comme Europe Écologie des Verts, il y en a je crois 10%, ce qui est le plus bas total, mais on pourrait se dire qu'il y en aurait zéro. Il y en a aussi au PS, il y en a aussi à la LFI, comment on espère ? explique que ce qu'on pensait être une valeur de gauche, finalement, ne fait pas complètement l'unanimité dans ses parties.
- Speaker #1
Alors, tout se tient pas, je pense, au fait que ça soit un sujet de gauche qui rentre dans les valeurs, effectivement, de la gauche.
- Speaker #0
C'est compatible avec les valeurs de gauche.
- Speaker #1
Oui, c'est compatible avec les valeurs de gauche, mais aussi, tu vois, dans les valeurs de droite, tu as quand même aussi le patrimoine, le territoire, etc. Tu as d'autres leviers quand même. Justement, on s'exprime ici, donc on a effectivement sur du 12, 15, 20% sur les différentes parties de gauche. C'est pour ça que j'aime bien rappeler que ce n'est pas du tout vraiment circonscrit à l'extrême droite ou à la droite. Il y en a un peu partout. Et là, on est vraiment sur une ambivalence. J'ai un peu entendu des deux. Ça me semble aussi être un phénomène naturel. Certes, on l'accentue. Est-ce que l'homme sait majoritairement ? Évidemment, on l'accélère avec nos activités, la pollution, etc. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se positionner. Et ça ne les empêche pas, en fait, par ailleurs. Effectivement, on regarde chez les écolos, je crois que c'est 12%. C'est quand même... Tu as un écolo sur 10. Et en fait, on voit que ce n'est pas bloquant de se dire... Peu importe si c'est un phénomène naturel ou si l'homme est majoritairement responsable, il faut changer plein de trucs. Évidemment, c'est flagrant que dans notre société, il y a des choses qui ne marchent pas. Je veux moins de pollution, je veux plus d'égalité, parce que l'écologie et les inégalités, on essaye de les lier quand même dans cette transition, soit sociale et environnementale. Mais ouais, c'est justement le point.
- Speaker #0
Surprenant. Dernière question. Est-ce que tu as changé d'avis entre le moment où tu as commencé cette étude et le moment où tu l'as finie ? Est-ce que, j'ai changé d'avis sur le climato-scepticisme et sur les climato-sceptiques, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement étonnée, que tu as découvert ?
- Speaker #1
Ouais, j'ai été... On est souvent surpris, parce que nous on fait pas mal d'études sur des publics cibles, comme je te disais, peu engagés ou défiants. Ça nous demande en fait de... au fur et à mesure, on déconstruit. On se rend compte qu'on a... c'est normal. Nous-mêmes, dans nos stratégies, on pose ce qu'on appelle des personas, des profils types, tu vois. Et en fait, on s'aperçoit que parfois, c'est un peu caricatural, alors qu'évidemment, l'humain est extrêmement complexe. Quand on a compris qu'on pouvait, ce qu'on a dit tout à l'heure, avoir des doutes sur l'origine anthropique du changement climatique et en même temps être engagé au quotidien dans des associations, on s'est dit comment ça se tient tout ça. Donc moi, mon travail m'apprend vraiment à chaque fois à mettre de la nuance et à comprendre que tout est beaucoup plus complexe. Même si dans notre travail on a quand même besoin de poser des blocs, de bien comprendre des dynamiques et donc de grossir un peu les traits, c'est normal pour pouvoir agir. Mais on a été pas mal surpris par beaucoup de choses, par les sciences cognitives, le fait qu'effectivement les faits ne suffisent pas. Quand on met l'usine Bonnefaleur, on nous dit que l'être humain n'est pas mu par la recherche de vérité. Les faits ne suffisent pas. On est mu par nos valeurs, on est mu par nos croyances, on a des biais de confirmation, on ne lit que ce qui nous p***. confirme dans ce qu'on pense déjà. Une fois que tu mets le nez là-dedans, tu dis, mince, comment on va faire après pour communiquer et aller tous ensemble ? Ça complexifie énormément après quand tu cherches des solutions. Mais ouais, moi, j'adore me dire que... Moi, j'ai parlé avec plein de climato-sceptiques qui, par ailleurs, sont des humains ordinaires, qui sont sympathiques par ailleurs, et qui... et qui sont complexes. Et notre relation à la transition écologique, je pense qu'elle est complexe. Elle titille, mais même chacun de nous. Personne n'est parfait sur tous les points. Voilà.
- Speaker #0
Oui, elle est complexe, mais le problème touche tellement d'aspects de nos vies, tellement tentaculaires que finalement, c'est... C'est presque logique avec l'euro. Une fois qu'on a lu ça, on se dit c'est presque logique. Ça nous touche tellement. Et puis on a des vies tellement différentes et on nous touche tellement de manières différentes.
- Speaker #1
Et quand tu regardes bien, la transition, c'est hyper ambitieux en fait ce qu'on demande. On demande de changer nos modes de vie. Ça va très vite. On demande de changer, on croyait vraiment, la consommation. C'est la base de notre société, la croissance. On demande du budget parce que tout ce qu'on propose, il faut faire... voter des budgets, ça demande de l'argent. Quand tu y penses, tu te dis, waouh, c'est vachement ambitieux. Et je discutais avec une, il n'y a pas longtemps, avec une collègue qui a travaillé sur la communication en transition écologique au Québec. Et elle disait, je suis arrivée en France, je suis extrêmement surprise parce qu'elle est énorme, votre transition. Ça joue sur plein de leviers. Nous, on a fait transition énergétique. Nous, c'est que la voiture électrique. donc on a fait des subventions, tout le monde s'est mis à la voiture électrique, il y a eu Il y a très peu de crispations par rapport à la France. Vous êtes dans un truc, vous êtes sur tous les piliers en même temps. Alors c'est beaucoup moins ambitieux, du coup ils ne sont pas intéressés à la rénovation des logements, etc. Mais je trouve ça hyper intéressant aussi d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Et il ne faut pas oublier qu'en France on a un terrain social. Alors l'inflation ça touche tous les pays, enfin beaucoup de pays dans le monde, mais on a eu les gilets jaunes, tu vois. En 2018, on a un contexte qui est tendu avec... les élites, ceux d'en bas, qui sont moins écoutés, on leur impose des choses, quand même ça partait de la voiture, les gilets jaunes. Donc en fait, tout ça, c'est le terreau sur lequel doit s'appuyer la transition. Et on le sait aujourd'hui, tout à l'heure tu as notifié la défiance. On a une défiance aujourd'hui dans notre société qui est hyper accrue. On regarde la confiance dans le gouvernement qui est aussi basse, qui est retombée le plus bas, comme au niveau des gilets jaunes. On a de la méfiance envers les journalistes. Et puis de la méfiance interpersonnelle, quand on demande aux gens « est-ce que vous faites confiance à votre prochain ? » Non, on est dans un monde dangereux. Dès lors, quand tu n'as pas confiance dans tes institutions, dans les gens qui te donnent de l'information, et dans les gens autour de toi, comment veux-tu faire société et te mobiliser collectivement autour d'un sujet qui te demande à toi de bouger et de faire des concessions ? C'est hyper dur.
- Speaker #0
Merci beaucoup, Amélie Deloff.
- Speaker #1
Merci à toi.