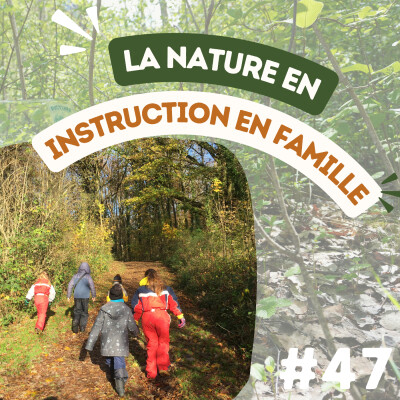Speaker #0Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pratiques et Terrains dans lequel nous allons poursuivre notre série consacrée Ausha du lieu d'accueil pour accueillir des enfants en extérieur. Dans le premier épisode, on a vu l'importance de prendre le temps d'observer et d'analyser le lieu dans son ensemble. Dans ce deuxième volet, je vous propose de nous interroger sur un sujet important qui concerne tous les lieux d'accueil, que ce soit un lieu public ou privé, un parc, un jardin, un bout de forêt, qu'on y aille tous les jours, une fois par semaine ou une fois par mois, qu'on soit propriétaire du lieu ou simple occupant. C'est un sujet qui est essentiel, sur lequel il est essentiel de s'interroger. Quand on accueille des enfants en extérieur, il s'agit de la gestion des risques présents sur le lieu puisque l'objectif quand on est dehors, c'est de passer un bon moment et non de se mettre dans des situations périlleuses. Et c'est une question qui se pose davantage quand on est dehors que lorsqu'on est entre quatre murs puisque l'extérieur n'est pas un milieu... qu'il peut y avoir des éléments naturels ou artificiels qui présentent des dangers. Dans l'épisode précédent, j'avais indiqué que j'aborderai la gestion des risques et l'impact environnemental dans un même épisode, mais finalement je vais plutôt grouper l'impact environnemental avec l'aménagement du lieu dans la troisième partie du sujet. parce que la gestion des risques que l'on va aborder aujourd'hui est un gros morceau et il va suffisamment nous occuper pour aujourd'hui. Donc, parler de risque et de sécurité, la sécurité en nature, c'est un grand sujet et je dirais même la sécurité de manière générale est un grand sujet dans une culture où l'on cherche à tout prix à... protéger les êtres humains de tous les dangers. C'est d'ailleurs une des raisons qui expliquent la diminution de la fréquentation des espaces extérieurs par les enfants au cours de ce dernier siècle, parce qu'on a peur que les enfants fassent des mauvaises rencontres. Et merci aux rubriques faits divers dans les médias qui mettent dans la tête des gens qu'on peut faire des mauvaises rencontres à tous les coins de rue. Donc peur de la mauvaise rencontre, peur que les enfants se perdent, peur qu'ils se fassent mal, qu'ils s'empoisonnent s'ils touchent une fleur ou un champignon. Bref, bon nombre d'adultes craignent de laisser des enfants jouer dehors et encore plus si c'est un espace qui est naturel et plus ou moins sauvage. parce que dans l'imaginaire collectif actuel... La nature est un endroit assez hostile. Alors oui, bien sûr qu'il y a des dangers en nature et il est sain de se préoccuper du bien-être des enfants mais il y a un équilibre à avoir entre d'un côté les protéger d'absolument tous les dangers et de l'autre leur permettre de prendre des risques mesurés parce que la prise de risque apporte plein de bonnes choses pour les enfants. tant d'un point de vue de la motricité que de leur dépassement, de leur répanouissement. Je pense que je ferai un épisode entièrement consacré à la prise de risque mesurée par les enfants en nature, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup et qu'il y a beaucoup à dire. Mais pour l'heure, on va se concentrer sur la prise de risque, enfin la gestion des risques présents sur le lieu. Sinon, on va en avoir pour trois heures. D'abord, petit point de définition parce qu'il y a parfois des confusions entre deux notions qui sont très proches qui sont le danger et le risque. Le danger, c'est la source potentielle d'un dommage ou d'un accident. Et le risque, c'est la probabilité que ce danger entraîne un accident. Alors pourquoi faut-il porter une attention particulière sur les différents dangers et les risques qui en résultent lorsqu'on choisit un lieu d'accueil pour ses activités avec les enfants ? Eh bien parce qu'un environnement extérieur, aussi riche et stimulant soit-il, peut comporter des éléments dangereux, des éléments naturels ou artificiels. Pour n'en citer que quelques-uns, ça peut être de nombreuses racines qui dépassent du sol et qui peuvent être soit glissantes, soit qui dépassent et qui du coup font que les enfants peuvent trébucher et tomber. Ça peut être des branches fragiles dans les arbres, la présence d'un cours d'eau, des barbelés, un espace qui serait entouré de barbelés, la présence d'animaux, de plantes, de champignons toxiques. etc. Donc plein de facteurs, plein d'éléments à prendre en compte, à connaître et à mesurer pour assurer la sécurité des enfants tout en leur permettant d'explorer librement. L'objectif dans cette gestion des risques, ça n'est pas d'éliminer tous les risques mais bien de les identifier pour mieux les gérer. Pour analyser ces risques, on commence. Encore une fois, comme pour la découverte du lieu, par adopter une posture d'observateur, d'observatrice attentive. Et c'est là que, justement, la première étape que j'ai évoquée dans l'épisode précédent prend tout son sens. Pour commencer cette observation, je reprends le plan que j'ai initialement dessiné, c'est-à-dire sur lequel j'ai indiqué tous les éléments naturels ou artificiels qui me sautait aux yeux quand je faisais une observation générale du lieu. Et cette fois-ci, je vais me concentrer sur les éléments à risque que je vais dessiner sur ce même plan ou que je vais repasser en rouge si ces éléments-là apparaissaient déjà dans mon plan initial. En gros, je prends un crayon rouge et tous les éléments à risque que j'identifie je les indique sur mon plan avec ce crayon rouge. L'intérêt, c'est d'avoir une vision globale de tous les dangers présents sur le lieu et peut-être qu'en faisant ça, déjà je vais déterminer des zones dans lesquelles il sera particulièrement risqué de passer du temps ou en tout cas des zones dans lesquelles je ne laisserai pas les enfants jouer librement sans adultes. Pour continuer dans cette observation des risques, je vais réitérer quelque chose que j'ai déjà fait lors d'une première étape, lors de la découverte ou redécouverte du lieu. Si vous vous souvenez, j'expliquais que je commençais mon observation du lieu en me mettant à hauteur d'enfant, dans la peau d'une enfant. C'était essentiellement pour m'imprégner de l'environnement. et de l'explorer d'un point de vue plutôt sensoriel. Là, pour l'analyse des risques, je fais la même chose, je me mets dans la peau d'une enfant, mais cette fois-ci, mon objectif est différent, puisque en me plaçant à hauteur d'enfant, je vais tenter d'imaginer les différentes interactions possibles que les enfants pourront avoir avec l'environnement. Par exemple, si un arbre dispose de premières branches qui sont suffisamment basses pour que des enfants y grimpent, je vais imaginer que des enfants auront envie d'y grimper. Donc je me mets vraiment dans la peau d'une enfant et j'essaye d'observer tous les éléments qu'il y a et d'imaginer quels sont les jeux, ce par quoi ils pourraient être attirés et ce qui pourrait leur passer par la tête. Bien que, des fois... Ils nous surprennent, on ne peut pas anticiper tous les comportements bien sûr, mais ça permet quand même de dresser une première liste de zones à risque. Ce qui va résulter de cette observation, c'est une liste de dangers et de leurs risques associés. Et donc pour ça, je fais un tableau dans lequel je note dans la première colonne les éléments dangereux. Et dans la deuxième colonne, les risques associés. Exemple, présence d'une falaise sur le lieu. Donc ça, c'est le danger. Et le risque, c'est... la chute dont il va résulter des conséquences plus ou moins graves, évidemment selon la hauteur de la falaise. Je donne un autre exemple sur mon lieu d'accueil, le Bois-Rieur. Il y a un torrent qui est assez profond et surtout qui a un courant extrêmement fort. Donc ce torrent, c'est un danger et le risque qui est associé, c'est la noyade. À ce stade-là, je ne fais que lister tous les dangers et les risques associés que j'identifie sur le lieu, à la fois en procédant à une observation générale du lieu et en imaginant ce que les enfants pourraient bien y faire. Mais je ne m'arrête pas là, parce que mon objectif, c'est de permettre aux enfants d'explorer leurs capacités, de développer des compétences d'analyse, d'observation, d'évaluation, de connaître leurs limites, celles de la nature aussi. Donc ce n'est pas parce que je vais identifier un danger que je vais à tout prix le supprimer. Certains dangers présentent des risques qui sont suffisamment faibles et sans gravité pour les laisser. D'autres nécessitent qu'on agisse pour éviter que les enfants se retrouvent dans de graves situations. Et c'est là qu'on va vraiment rentrer dans une évaluation des risques. On va mettre des échelles à nos différents risques. Deuxième étape donc de cette analyse des risques, l'évaluation. Cette évaluation, je vais l'ajouter dans mon tableau en mettant en troisième colonne la gravité du risque et en quatrième colonne la probabilité que ce risque arrive. S'agissant de la gravité, je prends une échelle à quatre niveaux. Premier niveau, le risque est faible. Deuxième niveau, le risque est modéré. Troisième niveau, le risque est élevé. Et enfin quatrième niveau, le risque est très grave, voire mortel. Pour la probabilité, je pose trois niveaux. Faible, moyenne, élevé. Donc Dans mon tableau, je vais écrire les chiffres correspondant à mon estimation. Pour prendre un exemple, je vais prendre l'exemple de la grimpe dans les arbres. Le danger, ce sont les branches qui sont à hauteur d'enfants et qui du coup permettent aux enfants de grimper dans l'arbre. Le risque, c'est que les enfants tombent et que par conséquent, ils se blessent. Et là, au niveau des blessures, on peut préciser fractures, traumatismes crâniens, voire encore plus graves selon la hauteur à laquelle arrive la chute. Donc pour ce danger-là et ce risque-là, j'estime, moi, que la gravité, elle est élevée. Parce qu'il y a risque de fractures et de traumatismes crâniens. Et la probabilité que ça arrive sur la grimpe d'arbre... généralement, moi je place la probabilité à 2,5, ce qui est assez élevé, mais parce que je prends en compte le fait que certains enfants sont très à l'aise avec la grimpe d'arbre, donc pour eux, la probabilité qu'un risque survienne, qu'un accident survienne, elle est faible, elle est plutôt faible, elle sera entre faible et moyenne. Par contre, un enfant qui n'est pas du tout habitué aux arbres et qui grimpera aux arbres pour la première fois, la probabilité de l'accident, elle est plus élevée. Donc, je préfère mettre une fourchette un petit peu haute pour ce genre de cas de figure et du coup de placer à, voilà, entre 2 et 3, donc je mets 2,5, la probabilité que le risque arrive. C'est un exercice qui est... Plus ou moins difficile à faire, notamment quand on n'est pas habitué à toutes ces notions et qu'on procède à ces premières évaluations. Mais petit à petit, à force d'accompagner des enfants, d'observer leur comportement, de connaître aussi le lieu et de maîtriser les différents espaces qu'on a identifiés comme étant des zones à risque, l'évaluation des risques se fait de plus en plus facilement. Pour vous aider à évaluer ces risques, j'ai tout de même une liste de questions à vous partager qui peuvent faciliter cette évaluation. Premièrement, après avoir identifié l'élément qui pourrait être source de danger, on peut se demander si ce danger est permanent. Ça sera le cas, c'est le cas du torrent par exemple sur mon lieu d'accueil. Ou si c'est un danger temporaire. Par exemple, une branche qui a été fragilisée après une tempête. On peut également se demander si ce danger est facilement repérable. ou au contraire plutôt discret et difficile à voir. Est-ce que ce risque concerne tous les enfants ou seulement certains groupes d'enfants selon leur âge, leur capacité et leur expérience de nature ? C'est ce que je disais il y a quelques minutes, un enfant qui va grimper dans les arbres pour la première fois. Le risque qu'il en tombe sera plus élevé que pour un enfant qui est habitué à le faire, qui grimpe toujours dans le même arbre. Le risque n'est pas le même et du coup les mesures qu'on va prendre ne sont pas tout à fait les mêmes. Est-ce que ce risque évolue au fil des saisons et des conditions météorologiques ? Par exemple, si sur mon terrain j'ai un espace qui présente une pente importante, et bien Pendant l'été, le sol sera sec, donc a priori ça devrait être assez praticable. Par contre, à l'automne et au printemps, quand il pleut beaucoup, il y a des chances pour que cette pente soit glissante. Donc les dangers et les risques ne sont pas forcément les mêmes tout au long de l'année. Je vous invite aussi, dans toutes ces questions que vous vous posez, à vous interroger sur votre rapport personnel. risques et de le faire pour chaque risque parce que cette évaluation des risques au départ elle est assez subjective et on tend de plus en plus vers une évaluation objective à mesure qu'on pratique et qu'on observe les enfants. Mais au démarrage elle est assez subjective parce qu'on n'a pas les mêmes expériences de nature. Certaines personnes vont être vont avoir des peurs importantes sur certains risques et beaucoup moins sur d'autres. Il y a des traumatismes qui peuvent être présents. Donc on a tous et toutes un rapport au risque qui est différent et des inquiétudes qui sont différentes. Typiquement, moi je travaille en binôme, j'ai toujours travaillé en binôme. Et au départ, un des points sur lesquels j'étais assez sensible, c'était... l'utilisation des outils coupants et tranchants. J'entends par là pas l'opinel enfant, l'opinel à bourron, ça j'étais assez à l'aise avec ça, mais c'était plutôt l'utilisation d'outils très coupants et très tranchants comme par exemple une scie japonaise. Ces outils-là m'inquiétaient et j'avais tendance à avoir beaucoup d'appréhension. à l'idée que les enfants prennent le risque de manipuler ça. Concrètement, je fais une parenthèse, je ne laisse pas des jeunes enfants manipuler une scie japonaise. J'ai pris l'exemple de la scie japonaise parce qu'elle est particulièrement tranchante. Mais voilà, c'était pour illustrer le fait que moi, mon point faible, mon point sensible plutôt, c'était l'utilisation d'outils très coupants et très tranchants. Alors que Mathias avec qui je travaille était... assez à l'aise avec ça. Donc on n'avait pas tout à fait la même approche du risque et la même sérénité et donc la même évaluation du risque. Moi j'avais tendance à surévaluer le risque. D'ailleurs si vous êtes seul sur le projet d'accueil, je vous invite vivement à solliciter un regard extérieur après avoir procédé à votre évaluation des risques. pour vous aider à prendre du recul sur l'évaluation que vous avez faite et peut-être du coup à mettre en évidence des points qui pourraient être sensibles pour vous. Et c'est quelque chose qui est à mon sens important à faire parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais la posture que l'on a en tant qu'accompagnant et accompagnante vis-à-vis de la prise de risque par les enfants, elle est essentielle. Et donc si je permets à des enfants de prendre un risque avec lequel je ne suis moi-même pas du tout à l'aise, il y a un truc, il va y avoir un couac. Soit je vais mal guider les enfants, mal les accompagner parce que je vais... être un peu parasité par ma peur, soit je vais transmettre cette peur aux enfants et du coup ça ne va pas les encourager à aborder cette prise de risque sereinement. Donc interroger son rapport personnel à la prise de risque, c'est quelque chose de très intéressant à faire à partir du moment où on a listé tous les risques présents sur le lieu. A ce stade... On a fait état de tous les dangers et les risques présents sur le lieu, mais il reste une étape fondamentale qui est celle de prendre des mesures pour minimiser ces risques. Comme je le disais tout à l'heure, notre objectif, ça n'est pas de supprimer tous les dangers et tous les risques parce que la prise de risque a un réel intérêt pour les enfants. Mais notre objectif, c'est d'aller le plus possible vers une gravité qui est faible. Et c'est là qu'on parle de prise de risque mesurée. Je reprends mon exemple de grimpe dans les arbres. Si je veux totalement supprimer le risque qu'un enfant tombe d'un arbre parce qu'il grimpe, eh ben j'interdis tout simplement aux enfants de monter dans l'arbre. Si je voulais carrément supprimer le danger, il faudrait que je coupe l'arbre. Mais on va... On va y aller mollo, on va rester soft dans nos mesures. Donc si je voulais totalement supprimer le risque, j'empêcherais tout bonnement les enfants de grimper dans l'arbre. Seulement, je sais que grimper dans l'arbre, ça présente de nombreux bienfaits pour les enfants. Ça renforce la motricité globale, la force musculaire, ça améliore l'équilibre, la proprioception. Ça renforce la concentration, ça encourage les enfants à la prise d'initiative, au dépassement de soi. Bref, c'est génial de laisser les enfants grimper dans les arbres, donc je ne veux pas les empêcher de le faire. Alors oui, je vais laisser les enfants grimper dans les arbres et oui, ils prendront des risques lorsqu'ils le feront, mais je vais prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser... un maximum la gravité et la probabilité que ce risque arrive. Là encore, je vous partage quelques questions qui peuvent aider à déterminer les mesures les plus appropriées à mettre en place. Premièrement, ce que j'évoquais à l'instant, le bénéfice apporté par la présence de cet élément versus le risque encouru. Est-ce que le bénéfice apporté... par cette prise de risque est plus élevée que le risque en lui-même. Deuxième question un peu dans la même veine, est-ce que je peux supprimer le danger sans altérer l'expérience des enfants ? Par exemple, si je veux éviter qu'un enfant se coupe avec un couteau et que je veux carrément supprimer le danger, je vais l'empêcher de manipuler un couteau. Comme pour l'arbre, si je veux éviter que l'enfant grimpe dans l'arbre, je vais supprimer l'arbre ou interdire totalement l'accès. Sauf que en faisant ça, j'empêche l'enfant de manipuler le couteau et donc de travailler sa motricité fine. Je ne lui permets pas de créer des choses avec ses mains. Je ne lui permets pas d'avoir une véritable exploration sensorielle avec la matière, avec le bois brut. Donc, dans ma balance, est-ce que vraiment ça vaut le coup de supprimer le danger par rapport à toute l'expérience que ça peut offrir aux enfants. Ensuite, est-ce que je peux modifier l'environnement pour réduire le risque ? Par exemple, du marquage au sol ou avec de la rubalise. Le fait de couper des branches, si je vois qu'il y a des branches fragiles dans l'arbre en question, eh bien, je vais peut-être couper ces branches-là ou les identifier avec un ruban ou de la rubalise pour que... pour indiquer aux enfants que cette branche-là, elle est fragile. Donc est-ce que je peux modifier l'environnement pour réduire le risque, sans pour autant le supprimer ? Est-ce que je peux adapter mon encadrement pour mieux gérer ce risque ? Exemple, toujours pour la graine d'arbre, je peux par exemple prévoir qu'il y ait toujours un adulte aux côtés des enfants qui grimpent dans les arbres. Et enfin, dernière question, est-ce que... je peux préparer les enfants à gérer eux-mêmes ce risque en posant notamment des consignes claires. En répondant à ces cinq ou six questions, normalement on arrive à avoir une liste de mesures concrètes à prendre. Et vous l'aurez compris, ces mesures peuvent être des mesures physiques, une barrière, de la rubalise, la présence d'une personne, mais ce sont aussi des mesures qui vont relever d'une certaine pédagogie en apprenant aux enfants à identifier les risques. à les évaluer et en posant des limites, en posant des consignes claires. Et on touche là à un point qui, pour moi, est hyper important. Quand on permet une certaine prise de risque à une personne, on l'éduque au risque. C'est pas simplement « vas-y, je suis là, je m'assure de tout, aie confiance, tu peux grimper dans l'arbre » . C'est pas éduquer au risque. il faut que l'enfant Mais c'est pareil pour les adultes. Il faut que la personne que j'accompagne dans cette prise de risque ait conscience du risque qu'elle est en train de prendre. Un, parce que dans l'immédiat, ça va diminuer la probabilité que l'accident arrive. Typiquement, si j'ai conscience que dans les arbres, il peut y avoir des branches fragiles, je vais à chaque fois observer les branches, regarder leur état. avant de poser mon pied dessus ou de m'accrocher à elle. Et de cette façon-là, je minimise le risque parce que j'ai appris à grimper dans les arbres et on m'a expliqué ce qu'il fallait faire pour grimper dans un arbre le plus en sécurité possible. A l'inverse, si je grimpe dans un arbre pour la première fois et que je n'ai même pas conscience qu'un arbre, que les branches d'un arbre parfois se cassent, peut-être que je vais y aller franco sans réfléchir, sans analyser quoi que ce soit et peut-être poser mon pied sur une branche qui est fragile et qui casse. Donc le fait d'éduquer au risque, d'expliquer à la personne, de lui présenter les différents risques qu'elle prend et de lui indiquer ce qu'elle peut faire pour minimiser ses risques, ça permet de diminuer la probabilité que... un accident survienne. Deuxième intérêt d'éduquer au risque, c'est que ça permet tout simplement à plus ou moins long terme de rendre la personne autonome dans sa prise de risque. Une personne qui a appris enfant à grimper dans les arbres, au bout de quelques années, arrivé à l'adolescence puis évidemment après à l'âge adulte, elle n'aura plus besoin qu'il y ait quelqu'un qui l'assure au pied de l'arbre. Quand on a fait tout ça, qu'on a fait cette analyse et cette évaluation des risques et qu'on a posé des mesures adaptées pour minimiser ces risques, on dispose d'un lieu qui permet aux enfants d'explorer et de jouer librement, le tout en prenant des risques mesurés. Petite précision quand même, parfois certains dangers sont à éliminer. Ils ne sont pas juste à... Il ne suffit pas simplement de minimiser les risques. Il y a des fois, il faut supprimer totalement, il faut éviter qu'il y ait le moindre risque qui soit pris. Là, pour la grimpe d'arbre, on peut évaluer qu'on a des mesures qui permettent de diminuer la gravité et la probabilité du risque, mais pour d'autres dangers, aucune mesure ne sera suffisante pour que le risque reste acceptable. La falaise, j'en ai parlé tout à l'heure, si sur mon lieu il y a une falaise de plusieurs dizaines de mètres de hauteur, je ne vais pas permettre aux enfants de s'approcher de la falaise pour qu'ils puissent profiter de la vue. Dans ma balance bénéfice-risque, le bénéfice est beaucoup plus faible que le risque qui lui est très très élevé parce qu'un enfant qui tombe d'une falaise de plusieurs dizaines de mètres de haut risque d'en mourir. Donc dans ce cas-là... J'estime que le danger et le risque est trop élevé et trop grave. Donc je vais vraiment éviter totalement que des enfants prennent un risque. Voilà, je le précise parce que je ne voudrais pas qu'on se dise que tous les dangers sont acceptables et que tous les risques peuvent être minimisés. Ça fait partie de la diminution des risques que d'empêcher l'accès. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de se gratter, de se mouiller à tous les risques pour vivre des expériences extraordinaires. Il y a certains dangers qu'il faut vraiment éviter. Et d'ailleurs, je profite d'aborder ce point. Je disais tout à l'heure que de s'interroger sur le public que l'on accueille par rapport aux risques qui se présentent à nous est important. Ça l'est d'autant plus quand il y a des risques très élevés, dont la gravité est élevée, parce que pour certains publics, la notion de limite est difficile. Et il y a des enfants qui ont tendance à avoir besoin de se confronter aux dangers, d'aller tester leurs limites, mais c'est même des enfants qui parfois n'ont pas conscience. de leurs propres limites. Et donc, ce sont des enfants qui peuvent se mettre en danger, gravement. Et donc, quand on identifie des dangers qui sont importants, des risques qui sont très élevés sur notre lieu, il faut vraiment les mettre en balance avec le public qui va être accueilli, parce que pour un certain public, par exemple, pour la falaise, une simple... barrière au sol avec un tronc d'arbre, ça va suffire pour éviter que les enfants n'aillent au-delà. Et voilà, le groupe d'enfants va très bien saisir cette limite et s'arrêter là. Pour d'autres enfants, cette barrière au sol, elle va être insuffisante. S'ils peuvent la franchir, ils vont y aller. Et donc dans ce cas-là, il va peut-être falloir carrément clôturer, mettre un grillage de 2 mètres de haut pour éviter que... que l'enfant ne passe au-delà de la limite. Donc si vraiment il y a un danger qui est important, s'il y a un risque qui est grave, dans la réflexion pour supprimer ce risque, il faut aller jusqu'au bout, vraiment, en réfléchissant au public qui sera peut-être confronté à ce risque pour être sûr qu'il n'y ait aucune prise de risque sur des dangers aussi graves. Voilà. C'était une parenthèse que je trouvais importante de faire. J'ai donc un tableau d'évaluation des risques présents sur le lieu qui est complet. Et c'est un document que je peux alors transformer en plan de gestion des risques avec des protocoles. Concrètement, ça donne, je reprends encore mon exemple de grimpe dans les arbres, petit 1. Grimpe dans les arbres. Donc en dessous, je note danger identifié de point arbre disposant de branches basses situées à tel endroit. Dessous, les risques associés chute, fracture, traumatisme crânien. En dessous, les mesures préventives. Donc par exemple, expliquer les techniques de grimpe d'arbre. présence d'un adulte à chaque fois qu'un enfant monte dans l'arbre, grimpe possible jusqu'à 2,50 m maximum. Voilà, toutes les mesures que je mets en place pour éviter qu'il y ait un accident. Et en dessous des mesures préventives, les mesures d'urgence qui sont celles à prendre dans le cas où un accident arrive. Puisque, vous le savez, on cherche à minimiser les risques, mais tant qu'on ne l'a pas. pas supprimé, le risque reste présent. Donc il peut toujours y avoir un accident. Et cette idée-là, eh bien, il faut l'accepter. Ce n'est pas si facile, mais il faut l'accepter. C'est pour ça que c'est bien de s'interroger sur son propre rapport au risque. Donc là, dans les mesures d'urgence pour en cas d'accident suite à une chute d'un arbre, il peut y avoir la prise en charge de l'enfant par un adulte formé au premier secours. Puis l'appel des secours par un adulte si la situation le nécessite, etc. Là, en faisant ça, j'ai un plan de gestion des risques avec des protocoles qui posent à la fois des mesures préventives et des mesures d'urgence. C'est un outil qui m'est destiné puisque c'est moi qui suis garante de la sécurité du groupe et qui vais donc... utiliser ce plan de gestion des risques. Mais ce que j'aime bien faire avec les enfants et tous les adultes que j'accueille sur le lieu, lors de leur première venue, je commence évidemment par faire une visite du lieu, par faire un tour du lieu, ce qui permet de montrer les espaces dans lesquels les enfants peuvent circuler librement et donc par conséquent les limites de ces espaces-là. Et une fois qu'on a fait cette visite du lieu, je leur présente un plan, une carte du lieu qui matérialise tous ces différents espaces. Donc le cercle de rassemblement, les toilettes, etc. Et sur cette carte sont indiquées les limites. Et je trouve que c'est un outil qui est particulièrement intéressant à présenter aux adultes qui accompagnent. Parce que, alors que ce soit des enseignants, des parents, des assistantes maternelles, etc. Parce que ça permet de rappeler les limites et les zones à risque. Parce que moi je connais très bien le lieu, j'ai procédé à une évaluation des risques, donc j'ai tout en tête. Mais quand une personne vient pour la première fois et qu'elle découvre le lieu, il est possible qu'elle ne retienne pas tout et qu'en plus elle n'ait pas encore bien à l'esprit le plan du lieu, la disposition du lieu. Ce plan-là, cette carte-là, elle est affichée dans le bois et elle est présentée aux enfants et aux adultes. Comme ça, tout le monde a bien en tête les zones libres, les zones dans lesquelles les enfants ne peuvent aller qu'en étant accompagnés et les zones interdites. Pour terminer sur ce sujet de l'évaluation des risques présents sur le lieu d'accueil, il y a une chose qui est importante à mettre en œuvre. notamment quand on accueille du public plusieurs fois sur un même lieu, c'est de procéder à une réévaluation du lieu et donc des dangers et des risques associés puisque c'est ce qui nous intéresse. Parce que je ne vous apprends rien si je vous dis que la nature évolue au fil des saisons, elle évolue aussi en fonction des conditions météorologiques et également Ce sera le sujet de la troisième partie. La nature peut subir des modifications du fait de notre présence. Ce qui fait que d'une année sur l'autre, il peut y avoir de nouveaux éléments à risque et au contraire d'autres qui disparaissent. Donc une fois par an, moi je reprends mon tableau d'évaluation des risques et je me repose toutes les questions que je me suis initialement posées en les mettant en place. parallèles avec ce que j'ai pu observer durant l'année écoulée. Est-ce que le risque que j'ai identifié est déjà survenu ? Est-ce que, si oui, quel était le niveau de gravité ? Est-ce que c'est arrivé plusieurs fois ? Pour savoir si la gravité et la fréquence que j'avais évaluée au départ est juste par rapport à la réalité. Évidemment, c'est du bon sens mais je préfère le dire pour... qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas parce qu'un accident n'est jamais arrivé que le risque n'existe pas et qu'on peut lever du coup toutes les mesures. Au contraire, ça signifie sûrement que les mesures qui ont été prises sont adaptées et proportionnées puisque notre objectif, rappelez-vous, c'est de minimiser les risques. Donc s'il n'y a pas eu d'accident, ça veut dire qu'on a atteint notre objectif. Cette réévaluation-là, elle est là pour interroger ces mesures parce que parfois on va constater qu'elles étaient insuffisantes, mais ça souvent on le constate parce qu'il y a eu accident et donc généralement on modifie, on renforce les mesures tout de suite. On n'attend pas de faire la réévaluation annuelle pour changer les mesures. Mais bon parfois voilà on va constater que les mesures sont insuffisantes ou mal adaptées. D'autres fois, on va finalement se dire que la gravité et la fréquence étaient peut-être surévaluées. Ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est souvent le cas au démarrage. On a tendance à surévaluer et parfois, en prenant un peu de recul et à force de pratiquer et à force d'accompagner, on va sentir que finalement, c'est pas aussi grave que ce qu'on avait... estimé ou en tout cas on n'en a pas la même perception. Et puis dans le meilleur des cas, on conclut que l'évaluation et les mesures prises sont parfaitement adaptées aux risques et dans ce cas là on ne change rien. Mais c'est vraiment important de faire cette réévaluation des risques parce que il y a plein de changements dans le lieu. On a, nous-mêmes, on évolue sur ces questions de risque. Et c'est aussi intéressant de faire cet exercice pour se rafraîchir la mémoire, parce que c'est comme pour les gestes de premier secours. Tant mieux si on n'a pas besoin de reproduire ce qu'on a appris lors des formations PSC1 ou SST. Mais le problème, quand on ne pratique pas, c'est qu'on oublie. Et bien, pour les protocoles qu'on a posés, notamment pour les mesures d'urgence, Si je ne relis pas de temps en temps ce que j'ai posé dans mes protocoles et qu'aucun accident n'arrive, si un jour il y a quelque chose qui arrive, certainement que je n'aurai pas tout mon protocole, toutes mes mesures d'urgence en tête. Donc le fait de faire cette réévaluation, ça nous pousse aussi à nous rafraîchir la mémoire. Voilà pour la gestion des risques présents sur le lieu d'accueil. Si vous ne l'avez pas encore faite et que vous accueillez déjà des enfants dehors, je vous encourage vraiment à prendre le temps de faire cette évaluation des risques et à poser clairement toutes les mesures adaptées, qui sont certainement du coup des mesures que vous faites déjà, mais peut-être que vous n'êtes pas allé tout au bout de la réflexion et en tout cas le fait de le poser à l'écrit, ça permet d'avoir... Un plan de gestion des risques et des protocoles qui sont clairs. Et surtout, moi le gros bénéfice que je vois à ça, c'est que ça permet de renforcer une confiance. Confiance en son encadrement, confiance envers les enfants et confiance envers le lieu. Et plus il y a de confiance, plus on tend vers une prise de risque mesurée qui est sereine. sereine. Et ça... c'est un magnifique cadeau que l'on fait aux enfants je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à une prochaine fois pour parler cette fois-ci de notre impact sur l'environnement et des aménagements qu'il est possible de faire pour enrichir l'exploration des enfants