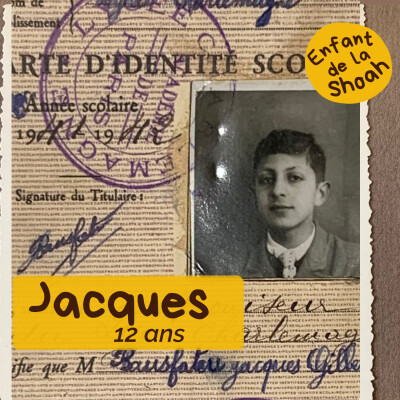Speaker #0Donc en 1940, on est arrivé à Paris. Nous avons vécu à Paris rue Pajol, numéro 56, une pièce qui fait ça la manger, à côté une chambre à coucher et une toute petite cuisine. Donc mon oncle et ma tante dormaient dans cette chambre à coucher. Mon frère, moi et ma mère, nous dormions dans cette salle à manger. Tous les jours, on mettait par terre un matelas. Et nous sommes restés toutes ces années à vivre comme ça, rue Pajol, dans ce petit appartement. Mon oncle et ma tante sont partis à Lyon. Donc nous sommes restés, ma mère, mon frère... moi dans cet appartement. Je pense qu'on recevait une allocation de la France en tant que mon père était prisonnier de guerre, je crois. Ça n'avait pas été une fortune. Donc en 1943, je crois, deux flics arrivent, tapent à la porte, ouvrez, la police, police, police, ouvrez. Donc ma mère ouvre, prenez une valise et puis on vous emmène. Pourquoi vous rendez... Madame, c'est comme ça. Donc, on est partis avec ces deux policiers, qui nous emmènent dans un endroit où il y avait d'autres personnes qui étaient là déjà. Et il se trouve que ma mère est venue avec... On avait une correspondance avec mon père en temps de prisonnier de guerre. Et elle montre cette correspondance et on lui dit, Madame, vous êtes libre, femme de prisonnier de guerre. Donc, on rentre chez nous. La vie continue. Moi je vais à l'école, mon frère va à l'école aussi. Ma mère fait des ménages, je crois, pour vivre un peu. On voit des gens, des amis à nous qui partent, soit en zone libre, soit déportés. Que la police arrêtait. Et puis nous on était tranquilles. Femme de prisonnier de guerre, extraordinaire. Février 1944, re la police. Il tape à la porte, 6 heures du matin, on ouvre. Madame, ouvrez, ma mère qui commençait à hurler, à pleurer, on les compte, c'est pas possible, enfin, bon bref, on suit femme de poison. Regardez, femme de poison de guerre, vous vous trompez, il y a une erreur. On verra ça, bon bref, on est emmenés. Et puis finalement, à ce moment-là, le statut de femme de poison de guerre ne donnait plus d'espoir de ne pas être déportée. On nous emmène à Drancy. C'est un rectangle, un immeuble en rectangle, brut de décoffrage, il n'est pas terminé encore, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte. J'ai vu mon premier suicide à Drancy. Le camp de Drancy, c'est un immeuble de trois étages. J'ai vu un homme se jeter sur la terrasse du premier étage. C'était le premier suicide. Ben Drancy, c'est le commencement de la fin. Donc nous sommes restés trois mois à Drancy comme ça, les gens qui partaient. étaient déplacés et la dernière nuit on les faisait dormir dans ce bâtiment là. Et le matin, 6 heures du matin, les autocars arrivaient et partaient à l'est pour travailler. Au bout de trois mois ça a été notre tour. On a été transférés dans un bâtiment du côté gauche de Drancy et le matin, 6 heures du matin, les autocars sont là et nous partons à l'est. Les femmes doivent travailler. Bref, on arrive à la gare de l'Est. Le train, c'est le silence. Les gens sont mutiques. Ils ne parlent pas. Les gens pleurent. C'est triste. C'était vraiment dégueulasse. Il n'y avait pas d'hygiène. Il n'y avait pas d'hygiène. Mais on va à l'Est encore. Ce n'est pas la mort. Le train arrive, les nazis sont là à nous attendre avec les chiens, Schnell, Haus, Hunter, Schnell, bon, les premiers coups arrivent, et puis on monte dans un autocar, dans un camion, qui nous amène à Berg-Nolzen, c'est pas loin, c'est 2-3 kilomètres, la gare est à 2-3 kilomètres du camp, donc on arrive dans ce camp, On voit les barbelés qui s'ouvrent. Moi, je vois au fond du camp une cheminée. Je me dis, c'est quoi cette cheminée ? Finalement, c'était une cheminée où on brûlait les cadavres. Tous les jours, une charrette passait dans le camp, traînée par des déportés, qui ramassait les morts. Avant que cette charrette arrive, les morts étaient comme des stères de bois. Donc cette charrette ramassait les morts et les amenait au four cramatoire, qui était au bout du camp. Le camp de Baganezen, c'est une immense clairière dans une forêt, mais séparée par des barrières. Donc vous avez ici le camp des Russes, le camp des... je ne me rappelle plus, le camp des Belges, le camp de l'Etoile. C'était nous, le camp de l'Etoile. Donc il y a plein de petits camps, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Et le four comme à toi est au bout. Alors on nous emmène dans le camp de l'Etoile. On nous donne une baraque, on rentre dans cette baraque. Dans cette baraque, c'est des lits à trois étages, comme à Auschwitz, si vous avez vu Auschwitz. C'est les mêmes baraques et les mêmes lits à trois étages. Ma mère, mon frère et moi, nous étions dans un lit au troisième étage. Imaginez quand même un homme de dix ans. Dix ans, ça ne réfléchit pas comme un adulte. On n'a pas les mêmes sensations qu'un adulte. On sait qu'on est dans une prison, enfin une prison à ciel ouvert. Pourquoi on est là ? On ne sait pas pourquoi on est là. Alors, les toilettes, c'est une baraque, une immense baraque, comme les baraques où on dormait, avec un siège immense et des trous. Des trous. Et on s'assoit sur ces trous. L'eau, il n'y avait pas de l'eau tous les jours, l'eau est très froide, et Bergen-Belsen, je ne sais pas si vous savez, mais ça se trouve dans le nord de l'Allemagne, l'été il fait chaud, mais l'hiver il fait très froid. On a nos vêtements, c'est pas comme en Auschwitz, on nous donne pas de vêtements. On a nos vêtements et à la longue, nos vêtements se usent, c'est évident. On prenait le vêtement des cadavres. L'estomac c'est un deuxième cerveau. On a faim 24h sur 24. On se lève avec la faim, toute la journée on a faim, on se couche avec la faim, on dort avec la faim. On a faim, sans arrêt. Alors le matin c'était une espèce d'eau noire, enfin un petit café mais tout. A midi il y avait une soupe, le soir il y avait un petit bout de beurre avec un bout de pain je pense. C'est tout. Enfin je raconte, j'ai mangé le goudron. Au milieu de notre petit camp de Berg-Limazanne, il y avait une espèce de grande chaudière où il y avait du goudron pour mettre sur les toits des baraques. Je mangeais ce goudron. J'étais dehors, à côté des barbelés, et l'autre côté des barbelés, c'était le camp des Russes. Et j'ai vu... Vraiment, comme je vous vois maintenant, un Russe se jetait sur un cadavre et croquait, essayait de manger de la chair. Et il n'a pas eu le temps parce que le Dumirador, le nazi qui était là, envoyait une balle de mitraillette et il est mort. 6 heures du matin, appel. Qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, il faut sortir et appel. Donc on est rangé par 5 et on attend que messieurs les officiers allemands arrivent. Ça peut attendre un quart d'heure, ça peut être demi-heure, ça peut être une heure. Mais on attend toujours. Donc ils nous comptent et puis ils se trompent. C'est compliqué de nous compter parce que le nombre de personnes qu'il y a à l'appel va être celui de la veille, moins les morts. Donc si on oublie les morts, ça ne marche pas. Donc le compte est faux. Bref, quand ils arrivent à avoir le compte, l'appel est terminé, les adultes vont travailler et nous les enfants, on traîne, on ne fait rien. On survit. Avec la faim, et puis on se gratte, et puis bon, c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas cette histoire-là. Mais bon, c'est le froid, la faim, les cadavres, le typhus, on s'habitue, enfin on s'habitue, on vit avec ça. On sait que demain ce sera pareil, et après-demain ce sera pareil. Sans espoir, on n'a pas d'espoir, on ne pense pas à l'avenir. On vit au jour le jour. C'est la vie, on vit tant qu'on vit. On est resté dans ce camp de la gamme Mersenne pendant un an. A la fin, on voyait les avions passer, donc on se disait la guerre va bientôt terminer. Et puis... Comme les Allemands sentaient qu'ils perdaient la guerre, parce que les Anglais approchaient trop de Bergen-Melsen, donc ils ont décidé de nous évacuer. Ils nous ont redéportés. Un jour, ils nous ont dit, on part, donc il faut aller à la gare. Donc il n'y avait pas de car pour aller à la gare, à pied. Ma mère, qui était malade, elle avait des jambes énormes comme ça, pleines d'eau, elle ne pouvait plus marcher déjà. Donc on a fait ces 2-3 kilomètres. jusqu'à la gare à pied. On est arrivés à la gare, donc le train nous attendait, et nous sommes partis avec ce train. Donc c'était la fin de Bergen-Belsen. Nous sommes restés 15 jours dans ce train. Donc le train avançait, il y avait les Américains, il y avait par là les Anglais, il y avait la Russie, vous ne savez pas d'où aller. Donc pendant 15 jours, quand le train s'arrêtait, on descendait du train. On n'avait rien à manger. On descendait du train et puis on mangeait ce qu'on trouvait, de l'herbe, n'importe quoi, enfin. Les morts, on les jetait. On les jetait sur le ballast pendant que le train avançait. Ben nous, les vivants, on se débarrassait des morts. Et puis au bout de quinze jours, il y avait les Russes. Des troupes de chocs russes. Donc pendant la nuit, les Allemands ont pris la locomotive. et sont partis. Ils devaient faire exploser le train, ils n'en ont pas eu le temps parce que les Russes sont arrivés. Donc le train était aux abords d'un petit village qui s'appelait Trubitz. Donc les allemands étaient partis, ils n'avaient pas eu le temps de faire exposer le train. Les russes nous ont libérés et nous ont dit rentrez dans le village, rentrez dans les maisons, si jamais ils ne veulent pas vous ouvrir, vous venez nous le dire et on les tue. Vous savez c'était le trouble de choc, c'était les mongols. Ils n'ont pas se gêner, ils avaient raison les Allemands. Mais je veux dire que, à ce moment-là, à mon âge, donc j'avais 11 ans à cette époque, si j'avais eu une mitraillette, je me serais amusé à mitrailler les Allemands. Avec plaisir, j'aurais tué les Allemands. Donc, on est descendu du train, ma mère, incapable de marcher, j'ai trouvé une brouette, on l'a mise dans la brouette. Et on l'a trimballé du scouviage de Trubitz. Je crois qu'on l'a mis dans une espèce de clinique ou d'hôpital, je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Je me souviens, oui, je me souviens qu'elle était allongée sur un lit où elle avait des jambes énormes et elle avait mis des chiffons autour des jambes, de ses deux jambes. Et une femme enlevait les chiffons et des dizaines de poux sortaient de ses chiffons. Et puis, je tombe dans les pommes. Je me suis évanoui. Et je me suis évanoui par le typhus. Ça veut dire que j'ai eu le typhus 15 jours avant, il y a eu l'incubation de 15 jours, et il s'est déclaré à ce moment-là. Coup de chance, coup de chance. Le destin, le hasard, la chance, appelez ça comme vous voulez. J'ai survécu.