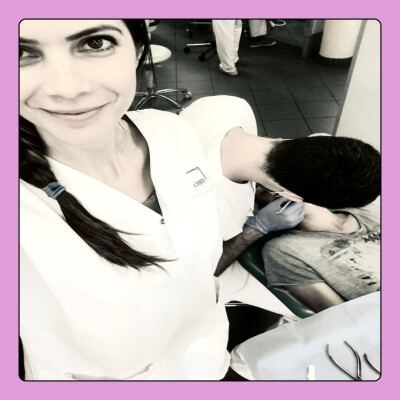- Speaker #0
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui parle d'humains dans le monde dentaire. Aujourd'hui, nous allons explorer une thématique à la fois intime et sociologique, celle des transclasses. Ces personnes qui, au fil de leur vie, franchissent les lignes sociales tracées dès l'enfance. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir la docteure Manon Serre. Orthodontiste à Montpellier, elle est née en Ardèche dans une exploitation agricole et a grandi loin des codes des milieux qu'elle intégrera plus tard. Le terme transclasse, proposé par la philosophe Chantal Jacquet, désigne ce passage d'un monde social à un autre, sans le juger, ni en termes d'ascension, ni de trahison. Ce n'est pas une promotion, c'est un déplacement, un franchissement, avec tout ce qu'il implique. Écart de langage, de goût, de repères. Ce déplacement, Jacquet le décrit comme une puissance d'agir en situation, une capacité à se construire dans un contexte donné, en composant, avec une combinaison de facteurs, modèles alternatifs, rencontres, ressources affectives et parfois politiques publiques. Le récit de Manon, c'est cela, une histoire de transclasse, de cohésion familiale, de travail acharné, de fierté et de décalage. Tout au long de cet épisode, nous alternerons témoignages personnels, regards philosophiques et sociologiques, notamment ceux de Chantal Jacquet, Pierre Bourdieu ou encore Annie Arnault, qui, en se décrivant comme une immigrée de l'intérieur, parlait de transfuge de classe, un terme plus ancien que transclasse. Là où le transfuge insiste souvent sur le déchirement, la rupture, le mot transclasse proposé par Jacquet vise une lecture plus neutre et complexe. Il met l'accent non sur la fuite, mais sur la traversée, la recomposition, la coexistence des mondes.
- Speaker #1
Musique Moi je suis originaire d'Ardèche, j'ai grandi en Ardèche et je suis restée jusqu'à mes 18 ans. Je suis l'aînée d'une fratrie de trois et mes parents sont agriculteurs. Donc j'ai grandi sur une exploitation agricole avec un gros sens du travail, c'est-à-dire... qu'on vivait dans cette exploitation et on vivait pour l'exploitation. À partir de mes 7 ans, j'ai commencé à travailler dans les champs jusqu'à mon internat.
- Speaker #0
Ce que Manon raconte ici, Pierre Bourdieu l'aurait pensé en termes d'habitus, un ensemble de dispositions sociales incorporées très tôt par le corps et l'expérience quotidienne. Grandir dans une exploitation agricole, c'est apprendre à vivre selon un rythme, des gestes, une logique d'efficacité qui ne dit pas son nom. L'habitus, c'est ce que l'on intègre sans même y penser. La manière de parler, de se tenir, de se représenter l'avenir. C'est une seconde nature qui vient de la socialisation.
- Speaker #1
C'est-à-dire que je retournais même l'été pour travailler sur l'exploitation et ça c'était quelque chose d'important parce que trouver de la main d'oeuvre, ce n'était pas forcément évident. Et puis on nous faisait quand même comprendre qu'on avait vraiment besoin de nous. Donc, vraiment... Merci. Mon parcours initial, c'est ça, c'est le parcours de la terre, de l'agriculture. Et quand on n'était pas à l'école, on était dans les champs quasiment. On partait très peu en vacances parce qu'on ne pouvait pas. Et après, c'était notre façon d'être, notre façon de vivre. Donc, on ne se rendait même pas compte que ça aurait pu être sympa de partir en vacances. On travaillait, on travaillait tout le temps.
- Speaker #0
C'était quoi comme exploitation qu'ils avaient, tes parents ?
- Speaker #1
Alors c'était une exploitation où on avait des vignes et aussi beaucoup d'arbres fruitiers type pêche, nectarines, prunes, pommes et aussi tout ce qui est maraîchage, fruits et légumes de saison d'été avec une boutique de vente directement sur l'exploitation. Donc moi à l'âge de 7 ans j'ai commencé avec mon petit frère qui en avait 5, on ramassait les courgettes, donc on était responsable d'un petit champ de courgettes. Donc, on ramassait les courgettes tous les matins. Mais bon, à ces temps, c'est déjà très complexe d'être autonome sur des choses comme ça. Et puis ensuite, en année, on a diversifié avec des haricots, des tomates, des choses comme ça. Et à partir de 14 ans, j'ai commencé le ramassage des pêches et des nectarines, qui est assez technique. Et là, c'était des horaires beaucoup plus intenses. Donc, ça, c'était sur les vacances d'été. Donc, on travaillait à peu près... près de 6h du matin. On avait une pause pour faire une petite sieste entre midi et 15h. Et puis après, l'après-midi, c'était le calibrage des fruits. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi d'autres choses, de maintenance, aussi de l'exploitation. Et puis, à partir du moment où je suis arrivée en dentaire, là, j'ai eu une activité différente, j'ai pu être à la boutique de frais légumes. Donc, c'était un petit peu moins fatigant. Mais c'est vrai qu'il y avait... En tout cas, je travaillais avec mon frère et ma sœur, et il y avait cette cohésion. Alors après, même, j'ai une amie qui est venue faire les saisons avec nous. Et donc, ça nous a permis, ça m'a permis en tout cas, moi aussi, de voir Comment on travaille en équipe, comment on manage une équipe. J'ai eu une sorte d'immersion professionnelle très précoce.
- Speaker #0
La responsabilité, t'es montée en grade aussi. Voilà,
- Speaker #1
c'est ça, au fur et à mesure des années. Au début, je ne sais pas si on se rend compte, mais le ramassage des pêches, c'est hyper technique. C'est-à-dire qu'on ramassait à maturité, donc il faut choisir le calibre, la maturité, etc. Au début, c'était un enfer. Je me suis dit, je ne vais jamais m'en sortir. Je trouvais ça extrêmement dur, extrêmement... fatigant et je me suis accrochée, j'ai vu que d'année en année ça se passait de mieux en mieux et après effectivement je gérais un peu l'équipe, je gérais les ramasseurs on repérait les coins qu'on pouvait ramasser, voilà donc ça j'ai vu, déjà j'ai compris que des fois les situations galères peuvent s'améliorer avec un peu de boulot et puis petit à petit ce qui était une contrainte est devenu quelque chose de plutôt positif avec mon frère, ma soeur, mes amis c'est devenu un peu ludique finalement À l'école, en fait, c'était plutôt homogène, c'est-à-dire que c'était que des enfants d'ouvriers. On avait aussi pas mal d'enfants, comme l'école, c'était une école de village, c'était une école très petite, le maire de l'école, il faisait construire des HLM pour avoir des familles un peu, on va dire, plutôt défavorisées, qui avaient un grand nombre d'enfants qui viennent sur le village pour pouvoir permettre de maintenir les classes. C'est vrai qu'on avait toute forme de personnage dans cette école, mais on n'avait aucun enfant de catégorie socio-professionnelle plutôt supérieure, on va dire. Quand je regarde un peu le parcours des personnes qui étaient avec moi, alors moi j'ai plutôt des très bons souvenirs de cette école. On était du CP au CM2, tous dans la même classe, on était à peu près 20 au total. et quand je regarde, quand même, il y en a... Il y en a quand même trois depuis qui sont en prison. On a eu des trajectoires qui sont quand même assez opposées. Il y a quand même pas mal de monde qui est resté en Ardèche. Je ne m'en rendais pas du tout compte à l'époque, mais c'est vrai qu'on était tous un peu issus de la même catégorie. Au lycée, après, je suis allée sur Ausha, qui est une plus grande ville. Et là, par contre, il y avait beaucoup plus de mixité. On était 2000 dans le lycée, donc c'était complètement différent.
- Speaker #0
Et là, du coup, tu te rendais compte de certains ados qui partaient en vacances, qui n'avaient pas toute cette charge de travail à faire ?
- Speaker #1
Je me rendais compte quand même avant, parce que mon père avait des amis qui étaient médecins et dentistes. Donc, je voyais ses amis qui venaient en vacances en Nord-Ège, qui nous racontaient qu'ils prenaient l'avion, etc. Donc, ça, je le voyais. Et puis, j'ai commencé à voir aussi que mes amis ne travaillaient pas l'été. Ils avaient des activités. Donc ça, je le voyais, mais comme je ne savais pas ce que c'était, je ne voyais pas non plus ce que je perdais. C'était comme ça et je n'ai jamais eu de regrets, de rancœurs et je n'en ai toujours pas d'ailleurs. Je pense que mes parents ont fait comme ils ont pu, comme ils ont voulu. J'ai la chance maintenant de pouvoir faire ce que je n'ai pas fait avant. Mais bon, pour moi, j'ai toujours eu une sorte de... Voilà. fatalité un peu, c'est comme ça. De toute façon, je n'ai pas trop d'autres possibilités.
- Speaker #0
Le lycée, pour beaucoup de jeunes issus des classes populaires, c'est un premier moment d'éveil. Ce que Bourdieu appelait capital culturel et capital économique devient perceptible. C'est voir ce que les autres savent, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils possèdent. C'est aussi parfois prendre conscience du manque.
- Speaker #1
J'ai une certaine fierté à venir de ce milieu-là. Je trouve que c'est un beau milieu, c'est un beau métier. après c'est vrai que je pense, alors je vais parler un peu à sa place, mais je pense que mon père avait une forme de complexe. Quand on voyait les amis médecins ou des amis qui avaient un meilleur niveau de vie, je voyais qu'ils discutaient, qu'ils rigolaient et tout, mais quand on rentrait à la maison, ils parlaient de ce que les gens avaient, du fait qu'ils allaient beaucoup au restaurant, qu'ils ne s'embêtaient pas. Donc ça, je l'entendais en off, moi, tu vois. Donc je le percevais comme finalement une certaine jalousie de un peu « regarde-eux tout ce qu'ils ont et regarde-nous tout ce qu'on n'a pas, finalement » . Et c'est vrai que j'entendais clairement le fait d'avoir... C'est ce qu'on me disait. Je ne sais pas si ça correspond à une réalité ou pas, mais en tout cas, je comprenais que nous, on n'avait pas beaucoup d'argent. C'est ce que j'entendais en filigrane dans la discussion que mes parents pouvaient avoir. Quand j'étais petite, j'avais une âme un peu d'artiste. C'est-à-dire que j'ai... J'étais assez rêveuse, assez dans le dessin, etc. Et j'avais très envie de me trouver un talent. J'avais très envie de ça. Tu vois, tu as toujours des gamins qui sont exceptionnels, qui savent bien chanter, bien danser et tout. Mais bon, je ne me suis jamais vraiment trouvée de talent particulier, malheureusement. J'étais plutôt une enfant comme ça, plutôt artistique. Et mon père, si tu veux, pour lui, le côté artistique, ça ne lui parle pas du tout. Ça ne vaut rien. Tout ce qui est culture, etc., ça ne vaut rien. Dès qu'il voyait un artiste à la télé, il changeait de chaîne, il parodiait volontiers un artiste qui allait parler de sa carrière en disant que c'était un con. Donc, il n'avait pas ce côté-là. À chaque fois que je parlais un peu de cette envie de partir sur un côté un peu artistique, il me disait non, non, mais ça, ça ne vaut rien. Il faut que tu aies un métier stable. Donc, j'ai très vite compris que pour moi, je n'irais pas de ce côté-là. Et ensuite, sur mon envie de faire des études, ça, c'est quelque chose que j'ai décidé assez tôt. Ça a été très motivé par le parcours de ma mère, je dirais. Donc, c'est vrai que là, avec le recul, j'ai grandi vraiment dans une famille patriarcale, qu'on appelle patriarcale. Alors, c'était souvent le cas, tu vois, avant, il y a 20-30 ans. Donc, c'est-à-dire que c'est mon père qui décidait de tout. Si on n'était pas d'accord, la seule option qu'on avait, c'était de se taire. Et c'était pareil pour ma mère. Ma mère était mère au foyer. Elle bossait quand même un petit peu sur l'exploitation. Elle a arrêté ses études pour m'avoir.
- Speaker #0
Qu'est-ce qu'elle faisait comme études ?
- Speaker #1
Elle faisait des études de biologie. Et mon père, je voyais que c'était lui qui décidait de tout, que ma mère... Du fait de son statut, il lui faisait bien comprendre qu'elle ne ramenait pas d'argent à la maison et qu'elle n'avait pas le droit au chapitre. Et je la voyais et je voyais qu'il profitait un peu, de mon point de vue toujours, il la rabaissait beaucoup. Et je me disais, mais c'est fou en fait de voir une femme aussi intelligente qui se retrouve dans cette situation. où elle est complètement prisonnière de ce statut tiraillé entre ses enfants, son mari. Et elle ne pouvait rien faire. Et donc, pour moi, j'ai très vite compris que mon indépendance et ma liberté, c'était de faire des études. Donc ça, c'était clair. Je ne savais pas quelles études, mais je voulais m'accrocher à ça. Ça, c'était important pour moi.
- Speaker #0
Chez Chantal Jacquet, un des moteurs du passage de classe, c'est la ressource affective. Ici, c'est l'exemple d'une mère silencieuse, brillante, contrainte au renoncement. L'étude devient alors un levier d'émancipation et de survie symbolique.
- Speaker #1
Après, j'ai fait mon parcours classique. J'étais bonne élève, j'étais dans le trio de tête, mais pour mon père, ce n'était jamais assez. Il fallait toujours être le meilleur du meilleur du meilleur. Il y a toujours ce truc de « tu aurais pu faire mieux » . Et donc, quand je suis arrivée au lycée, ça s'est plutôt bien passé pour moi au début. Et en terminale, le bac, je ne sais pas, j'étais hyper stressée par cet examen du bac. Et arrive l'épreuve de maths du bac, je rends quasiment aux copies blanches. Donc là, forcément, ça ne se passe pas super bien. Mais méga coup de stress, tu sais, mais vraiment, genre, j'ai dévissé pendant l'épreuve. Et donc, finalement, j'ai mon bac avec mention assez bien. Voilà. la déception ultime de mon père. Ça a été, je pense, un coup très, très dur pour lui. Et moi, le coup dur, ce n'était pas d'avoir la mention assez bien. Finalement, c'était de l'avoir déçu, tu vois. Dans la foulée, je rate mon permis. Alors là, j'étais 18 ans, j'étais au bout du rouleau, mais vraiment. Et là-dessus, comme je ne savais pas trop ce que j'allais faire, Mon père me dit, écoute, la fac de médecine, ça peut être une bonne idée. Et là, j'arrive en fac de médecine, je me dis, bon là, tu as déçu tout le monde. J'étais vraiment, j'avais envie, si tu veux, de me dire, essaye au moins de réussir un truc. Et j'arrive en fac de médecine, donc j'étais à la CTU à Nîmes. Donc la CTU à Nîmes, c'est deux espèces de tours jumelles où tu es dans des chambres de 9 mètres carrés avec des douches mixtes, des toilettes mixtes. Tu n'as même pas de cuisine. C'est quand même un peu hardcore, mais bon, ça m'allait bien. J'étais autonome comme ça. Et là, j'arrive le premier jour de fac de médecine. Et là, je comprends qu'il y a les cours de pré-rentrée, le bizutage, le machin. Donc ça aussi, tu vois, c'est des trucs. Quand tu es issue d'un milieu de médecin ou de dentaire, tu sais comment ça se passe. Quand tu arrives le premier jour, un peu la fleur au fusil, c'est là, c'est très, très étrange. je crois.
- Speaker #0
Ce que Manon traverse Bourdieu le décrit comme un décalage entre habitus et champ. Le corps socialisé dans un monde n'est pas spontanément adapté à un autre. Cela crée un sentiment d'inconfort, une inégale aisance face au code implicite. Le champ, chez Bourdieu, c'est un espace social avec ses propres règles, ses enjeux, ses rapports de force. Le champ universitaire, par exemple, exige un langage, une posture, un rapport au savoir, souvent étranger aux habitus populaires. D'où le décalage, parfois douloureux, à l'entrée dans ces mondes.
- Speaker #1
Et donc là, je me dis, j'ai 9-10 mois devant moi d'études. Et si j'arrive à faire ça, je suis assurée d'avoir quand même un boulot sympa. Et donc là, je me dis, tu lâches pas, tu bosses à fond. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis... C'était presque plus réussir l'examen sans trop y croire non plus quand même parce qu'on me dit tellement c'est super difficile. Je ne pensais pas vraiment être à la hauteur de ça. Mais en tout cas, j'avais l'envie et la motivation.
- Speaker #0
Et tu l'as eu du premier coup ?
- Speaker #1
Je l'ai eu du premier coup. Donc, en fait, le premier semestre, j'étais un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire que je bossais, j'apprenais les cours, mais je ne me rendais pas compte. Il y a une philosophie du concours à comprendre. Et tant que tu ne l'as pas compris, je pense que tu ne peux pas le réussir. Et en fait, dans la première partie, j'ai bossé un peu comme un bœuf à prendre mes cours, etc. J'ai eu la chance de me faire une amie qui s'appelle Naïda, qui était, elle, pareil, issue d'une classe sociale ouvrière. Et on est restées toutes les deux et on s'est boostées ensemble. C'est-à-dire que quand il y en avait une qui n'allait pas bien, c'était l'autre qui l'a récupérée, etc.
- Speaker #0
Dans ses premiers mois difficiles, l'amitié avec Naïda joue un rôle crucial. Toutes deux issues d'un milieu populaire, elles s'entraident, se motivent, se soutiennent. Chantal Jacquet insiste sur l'importance de ces rencontres structurantes, qui permettent de tenir dans un monde où l'on ne se sent pas toujours légitime.
- Speaker #1
Et donc, premier semestre, je suis dans les 400 premiers, à ma grande surprise, parce que c'est vrai que tant que tu n'as pas passé le concours, tu ne sais pas vraiment ce que ça donne. Et là, je me dis, bon, tu as une chance. J'ai capté comment ça fonctionnait. Et finalement, deuxième semestre, j'ai dentaire.
- Speaker #0
Et Naïda, elle a eu ?
- Speaker #1
Elle a eu médecine brillamment. Donc du premier coup aussi. Et donc on est toujours en contact, on se voit moins. Donc elle est médecin et elle a une petite fille là récemment, elle va plutôt bien.
- Speaker #0
Et dentaire, tu l'avais envisagé ou pas du tout ?
- Speaker #1
Eh bien, je ne l'avais pas forcément envisagé parce que je ne savais pas trop. Je n'avais jamais, enfin j'étais très surprise, tu vois, de pouvoir accéder à ça. Et dentaire, il se trouve qu'en fait j'ai un parcours dentaire absolument chaotique en parallèle de ça. C'est-à-dire qu'à l'âge de 7 ans, je tombe dans la cour du masque chez moi, je me casse une incision centrale, la 11, et là s'en suit un parcours de soins absolument impressionnant. C'est-à-dire que je pars sur un traitement en dos, retraitement en dos, résection apicale, re-résection apicale. Je suis chez le dentiste quasiment tout le temps, provisoire qui tombe. À 15 ans, on m'enlève mon insu central. Et là, je me retrouve avec un appareil amovible. 15 ans, horrible. Et à l'internat, je posais ma dent dans un verre d'eau le soir avant de coucher. En plus de mon problème d'incisive, j'avais des dents, mais c'était un chantier de ouf. J'avais un pote qui m'appelait le piège à loup, tu vois. Donc j'avais des dents, mais horribles. Donc je dénotais complètement dans le truc.
- Speaker #0
Est-ce que ça a pesé dans la balance aussi, l'idée que c'est des études plus courtes que médecine et économiquement, du coup, un ratio peut-être plus favorable ?
- Speaker #1
Ce concours de médecine, ça a déclenché une passion pour les études pour moi. Je ne sais pas comment te dire, je ne sais pas, ça m'a... En fait, ça a été tellement valorisant pour moi de réussir ça. Enfin, de moi à moi, tu vois, après, je n'avais pas envie de me la claquer auprès des gens. Je comprends, oui. Mais de moi à moi, ça m'a fait tellement du bien de me dire, tu as réussi ça, qu'après, je me suis dit, bon, peut-être que tu as un petit truc pour ça, tu vois, peut-être que tu as... Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai passé l'internat, après. Je n'avais pas... pas envie que ça s'arrête, ces études. Et puis, je n'avais pas trop envie non plus, au début, de rentrer dans le milieu du travail, parce que travailler, je l'avais fait beaucoup. Et donc, je n'avais pas vraiment envie, je n'avais pas encore cette envie de cabinet libéral et tout. Et après, sur le côté financier, comme tu me disais, moi, j'ai eu la chance de bénéficier des bourses plus APL. Et en plus, je bossais l'été, donc je redivisais l'argent que je gagnais l'été, donc ça me rajoutait un petit peu d'argent aussi. Donc, je ne faisais jamais de choses extravagantes, mais ça me convenait bien, j'étais bien comme ça.
- Speaker #0
Manon le dit clairement, sans les bourses, sans l'APL, sans ces petits boulots d'été, elle n'aurait pas pu faire ses études. Ce qu'elle pointe ici, c'est le rôle fondamental des politiques publiques dans certains parcours transclasses. La mobilité sociale ne repose pas que sur le mérite individuel. Elle dépend aussi des filets, des aides, des soutiens qui rendent la traversée possible.
- Speaker #1
Et c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai fait des études. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours assumé. Je n'ai vraiment jamais eu honte de ce que j'étais, de où je venais. Pourquoi ? Pourquoi j'aurais eu honte ? Je n'ai rien fait de mal. Déjà, tu vois, j'arrive le jour de la rentrée. Je comprends que tout le monde est rentré depuis une semaine dans des écoles privées au stage de pré-rentrée. Et je suis là, mais OK. Donc là, en fait, j'ai déjà un train de retard. Donc, premier semestre, je faisais le tutorat qui était vachement bien. Les étudiants de médecine, tu sais, de deuxième année. Je dois. C'est super bien. Et au deuxième semestre, j'avais pris... Je ne sais plus ce que j'avais pris. J'avais pris quand même un ou deux cours que je m'étais financée pour... Je ne sais plus. C'est de la physique ou de la biologie, un truc comme ça. Donc, au deuxième semestre, on était dans le game avec Naïda. On avait pris nos cours. Alors, moi, j'avais le permis, mais pas Naïda. Donc, je la trimballais partout, aux cours, à la fac. Enfin, on était tout le temps ensemble. Sauf quand... Elle était au quatrième étage, moi au neuvième. Et donc, c'était les moments où on bossait, on ne se voyait pas, mais on faisait nos pas ensemble. C'était vraiment très, très réconfortant de la voir. Les gens se reconnaissent entre eux. Les meufs, c'est les sacs. Les mecs, c'est les bagnoles. Enfin, voilà. Donc, ou les vacances aussi. Toi, t'es allée où ? Voilà, moi, j'avais rien en commun avec ces gens-là. Je suis arrivée à la fac. Je me suis dit, bon, là... t'arrives dans le grand monde. Donc, je me suis dit, je vais aller m'acheter des petites chaussures, etc. Bon, c'était complètement ridicule. J'étais ridicule, j'étais déguisée à mon entrée à la fac. Bon, ça a un côté mignon, d'un côté, j'avais fait un effort, mais j'étais absolument ridicule.
- Speaker #0
Manon se décrit comme déguisée lors de son entrée à la fac. Cette scène illustre ce que Bourdieu appelait la violence symbolique des codes sociaux. L'effort sincère pour faire bonne figure se heurte au ridicule perçu par les autres. Le sentiment de ne pas être à sa place s'inscrit alors dans les moindres détails du corps et du vêtement.
- Speaker #1
Et les premiers temps, je vois qu'en fait, c'est comme si j'étais transparente. Je n'ai rien à dire à ces gens, je n'ai rien à partager. J'ai l'impression que j'ai dit des trucs, ça tombe à plat. Je me dis bon, ok, là, tu vois qu'il y a un fossé et je me dis, je vais observer. Donc, je parle beaucoup moins. Et j'observe, je vois, tu vois, j'observe un peu la promo et tout. Et donc, effectivement, tout ça, ça se fait malgré eux. Je n'en veux pas aux gens du tout, parce que c'est comme ça, c'est la société qui est comme ça. Et après, finalement, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis de me montrer. Et là, j'ai rencontré une amie qui s'appelle Louise, qui a accepté cette différence, cette simplicité. Et ça a été aussi une amitié très importante pour moi. dans ce parcours de non-faire. Mise à l'écart ? Peut-être un peu, parce que de toute façon, je ne connaissais personne. Mais en tout cas, j'avais envie, moi, de m'intégrer. J'avais envie de... Donc, j'ai toujours un abord assez positif. Je ne voulais pas me victimiser en me disant pourquoi ils me font ça et tout.
- Speaker #0
Tu as des anecdotes de choses peut-être marquantes qu'on t'a dit, que tu as vécues, où là, tu t'es sentie en décalage complet ?
- Speaker #1
En troisième année, j'ai été invitée à une soirée chez un assistant de la fac. J'arrive dans la soirée, le mec m'ouvre la porte, je lui fais la bise, c'était le serveur. Bon, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Moi, je n'avais jamais imaginé qu'il puisse y avoir un serveur dans une soirée, tu vois. Mais ça, ça me fait beaucoup rire. Quand j'ai une amie proche qui était avec moi aussi ce jour-là, on en rigole encore, si tu veux. mais je pense que finalement Ce côté-là de se dire « bon, c'est pas grave finalement » , ça m'a apporté parce que j'ai pas lâché, si tu veux. Je me suis dit « c'est pas grave, je continue, c'est pas un problème » .
- Speaker #0
Quand Manon fait la bise au serveur, croyant saluer l'hôte, c'est une scène à la fois drôle et cruelle. Elle révèle le défaut des codes partagés, ce qu'on appelle parfois l'ignorance légitime. Ce n'est pas un manque d'intelligence, mais d'accès préalable aux règles implicites du milieu fréquenté.
- Speaker #1
À un moment, j'étais avec des nanas qui étaient toutes habillées comme des mannequins, qui étaient belles comme des mannequins, etc. Et donc, moi, j'étais à côté et forcément, je jurais, si tu veux, j'étais habillée comme j'étais. Je m'habillais beaucoup à l'époque chez Jennifer, la halle aux vêtements et tout, très bonne, je ne sais pas si ça existe toujours, la halle aux vêtements, mais ce n'était pas le référentiel de la fac dentaire, si tu veux. Et je me dis... Donc c'est mes 20 ans et là ma mère m'offre une montre Dolce & Gabbana. Donc c'était le truc à l'époque, le truc Dolce & Gabbana, c'était le truc de reconnaissance sociale. Et j'arrive à la fac avec ma montre Dolce & Gabbana, j'étais hyper fière d'avoir pour une fois un truc qui était à la mode on va dire. Et là j'ai une de mes potes qui me dit mais attends où est-ce que t'as trouvé ça ? Genre c'était impossible que moi j'ai un truc comme ça. et donc je lui dis c'est ma mère qui me l'a offert pour mon anniversaire et elle me dit c'est une copie donc tu vois genre c'était tellement inconcevable que forcément j'avais pas pu me payer un truc comme ça et donc je lui dis bah non non non c'est vrai donc le groupe se dissipe un peu et elle se repenche vers moi tu sais tu peux me le dire si c'est une copie genre elle a tout même encore aujourd'hui tu leur parles C'était impossible qu'une pouillasse comme moi ait cette montre. Et je l'ai toujours d'ailleurs, cette montre.
- Speaker #0
Mais tu n'as plus la copine par contre.
- Speaker #1
Je n'ai plus la copine. Par contre, j'ai plus cette copine. Je fais partie des gens qui sont restés... Sur le carreau. Sur le côté.
- Speaker #0
Être trans classe, c'est parfois être suspectée, même lorsqu'on a les signes extérieurs de la réussite. Ici, la montre d'Otché Gabana devient un symbole de l'écart. Posséder l'objet. ne suffit pas à être reconnue comme légitime. Et tu vois, pendant les études, tu avais l'impression que le sujet de l'argent, c'était quelque chose qui revenait souvent quand même dans les discussions. Pas forcément l'argent qu'ils avaient, parce que quand on est étudiant, on a l'argent que nos parents nous donnent ou les boulots peut-être qu'on fait pour ceux qui bossent les étés. Mais par contre, de l'argent futur, comme un critère de réussite important. Oui.
- Speaker #1
Alors moi, tu vois aussi, tu me disais pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as choisi ce métier. L'argent, gagner de l'argent, j'ai assez vite aussi étiqueté que c'était important. Parce que je voyais que nous, c'était un facteur limitant de ne pas avoir d'argent. On ne pouvait pas partir en vacances parce qu'on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas avoir ça parce qu'on n'avait pas d'argent. Donc je me suis dit, ça serait bien que tu trouves un métier où l'argent, ça puisse être quelque chose qui ne soit plus limitant pour toi. Ça a compté quand même, je pense, dans mon choix, même si ce n'est pas forcément tendance ou clean de dire un truc comme ça, tu vois. Mais pour moi, je voulais me mettre à l'abri de ça. Et par extension, je voulais aussi mettre à l'abri mon frère et ma sœur. Je ne sais pas pourquoi, depuis toute petite, j'ai ça. Et depuis toute petite aussi, j'avais une extrême peur d'être au chômage. Je ne sais pas pourquoi. J'avais cette peur-là de la précarité, de me retrouver en galère. Ça a toujours été quelque chose de très présent. J'étais une enfant super anxieuse, j'avais des problèmes de sommeil. Après, mon père m'avait toujours dit, de toute façon, à 18 ans, on ne vous aidera plus, on ne vous donnera plus rien. J'avais ce truc, ce stress. Donc, pour moi, ça a été un élément de me dire, au moins, tu vas faire un métier qui te permette aussi d'être confortable.
- Speaker #0
Le rapport à l'argent chez les transclasses est souvent ambivalent. Il n'est pas moteur de carrière, mais antidote à la peur. Ce que Manon exprime ici, c'est l'envie de s'abriter du manque et d'en protéger les siens.
- Speaker #1
Et après, pendant les études...
- Speaker #0
J'en entendais parler, mais je ne voulais pas que ça soit au centre de tout non plus. Pour moi, j'ai compris que j'allais être dentiste, je savais que les dentistes gagnent quand même plutôt bien leur vie, c'est quand même une profession qui est connue pour ça. Mais après, et même encore aujourd'hui, je ne veux pas que l'argent soit le président de ma vie. Mon père voulait que je reste à la fac. Donc mon père n'était pas du tout chaud pour que je m'installe. Mais à ce moment-là, c'est vraiment le moment où je me suis dit, en fait, là, tu vis ta vie. Ça suffit de toujours vouloir essayer d'impressionner ton père, d'essayer de faire ce qu'on te demande, ce qu'on attend de toi. Moi, je savais que mon avenir, il n'était pas à la PAC à ce moment-là. Donc, je me suis dit, bon, je partais plutôt sur une carrière libérale. Et là, j'ai un pote qui me dit, mais... Il y a un petit cabinet qui se vend à Montpellier, aux Arceaux, tu devrais appeler. Je dis franchement, je ne me sens pas. Il me dit, je crois que tu ne te rends pas compte, ça va marcher. Si tu te lances, ça va marcher. Et c'est Spot, si tu veux, qui me donne un peu l'élan de départ. Donc j'appelle le cabinet. Je voulais avoir un plateau technique. Je ne voulais pas partir de zéro, une création, ça m'angoissait. Ça ne me fait pas du tout kiffer d'être dans les catalogues, à choisir des trucs. Je voulais direct être opérationnelle. Et donc, je décide d'acheter ce cabinet. Sauf que je n'en parle pas à mes parents. Parce que je sais très bien qu'ils vont s'opposer. Donc, je fais toute la démarche toute seule. Donc là, c'est un moment assez difficile de ma vie parce que je suis vraiment solo. Je suis solo, mais je me dis, l'avantage, c'est que quand t'as rien, t'as rien à perdre. Je me dis, les banques me suivent. Je sais que je suis quand même plutôt sérieuse. Je paye pour voir, tu vois. D'un côté, je vais voir. Mais ce n'est quand même pas exclu que ça marche. Donc, je suis dans un moment où je suis solo dans mon truc. Et je me dis, tu as envie de faire ça. Tu prends toi, tu le fais et tu verras comment ça se passe. Et là, j'annonce à mes parents que j'ai acheté le cabinet. Et là, mon père me dit, mais tu as fait une grosse connerie. Non, mais tu ne peux pas… tu ne peux pas. Et il fait encore ce qu'il a fait toute sa vie, c'est-à-dire que plutôt que de me soutenir, il me dit, tu ne vas pas y arriver. Et là, il me dit, tu vas te planter, ça va. Et donc là, je dis, stop, on se rappellera quand je serai lancée. De toute façon, tout était signé, donc je n'allais pas rétro-pédaler. Donc là, ça a été une grosse scission avec mon père parce que j'ai fait mon truc. Lui, en fait, si tu veux, dans son référentiel, il est agriculteur en Ardèche. Déjà, de vivre à Montpellier, il ne comprend pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il vient à Montpellier, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu te fais chier à vivre ici ? » Déjà, il est dans un truc, il ne fait pas la démarche d'essayer de comprendre ce que je vis. Il est dans le jugement. Et après, pour lui, l'orthodontie, ça le dépasse complet. Il ne comprend même pas le bénéfice d'aligner des dents. Mon métier n'a aucun sens pour lui. la neuroprévention Pourtant,
- Speaker #1
c'est concret, tu vois.
- Speaker #0
C'est concret, mais il est dans un truc où ça n'a aucun intérêt pour lui d'aligner des dents.
- Speaker #1
C'est superficiel, quoi. Ouais,
- Speaker #0
voilà. Et là, en fait, ça nous a vachement éloignés parce qu'il n'était pas forcément obligé de juger ce que je faisais, tu vois. Il aurait pu se dire juste, c'est cool, elle a fait ça, voilà, ça lui plaît et tout, c'est bien. Non.
- Speaker #1
La réussite n'efface pas l'écart. Elle peut même le raviver. L'incompréhension du père de Manon. illustre ce que Chantal Jacquet appelle le stigmate du franchissement, ne plus être reconnue par ceux de son monde d'origine.
- Speaker #0
Tu vois, je fais vachement gaffe à ça avec mes enfants. C'est-à-dire que parfois, tu as l'impression que tes enfants vont se planter. Et donc, pour leur éviter l'échec, tu les mets à l'écart du truc. Et en fait, en les mettant à l'écart, tu leur empêches de vivre des choses et même tu leur donnes une mauvaise image d'eux-mêmes. Et je pense que mon père a fait beaucoup ça avec moi, de me dire « tu ne vas pas y arriver, si tu fais ça, tu ne vas pas t'en sortir » . Et je l'ai cru pendant quelques temps. Et à partir du moment où je ne l'ai plus cru, j'ai vu quand même que j'arrivais à faire certaines choses. Et donc là, le cabinet, finalement, ça a marché. En fait, ça a été beaucoup les amis, beaucoup les potes qui m'ont aidé dans ce moment-là. C'est vrai que là, les concepts ont un peu évolué. Avant, on parlait d'ascenseur social. Alors, ascenseur social, ça avait un côté assez dégueulasse pour deux trucs, je trouvais. C'était que l'ascenseur social, ça signifiait que tu laissais tes potes initiaux, ta famille et tout en bas, tu vois. Et tu leur disais, allez, salut les gars. Et toi, tu prenais l'ascenseur et tu montais, tu t'élevais dans la société. Donc ça, je déteste ça. Parce que ça a un truc genre, je suis mieux. que les autres. C'était un gros problème dans ce concept-là. Et ensuite aussi, ça signifiait qu'il y avait juste à prendre l'ascenseur pour monter, alors que clairement, ce n'est pas ça non plus. Donc, c'est vrai que c'est bien que les concepts aient évolué. Après, le fait d'être trans-classe, trans-fuge de classe et tout, ce n'est pas un truc auquel je pense tous les jours. C'est sûrement beaucoup présent dans ma vie sans que je m'en aperçoive maintenant, parce que ça fait quand même plus de... Ça fait 20 ans que j'ai le concours à peu près, même plus de 20 ans. Donc maintenant, c'est devenu ce mélange entre mes deux classes sociales, ma classe d'origine et ma classe d'adoption. C'est un mélange en permanence. Donc c'est mes retours en Dardèche, mon quart au téléphone et le dentiste que je vais avoir au téléphone aussi. Donc toutes mes journées, toute ma vie. et un mélange, en fait, un voyage permanent entre ces deux classes sociales sans qu'il y en ait une qui soit mieux qu'une autre, selon moi.
- Speaker #1
Manon rejette l'idée d'un sensoire social trop linéaire, trop hiérarchique. Le concept de transclasse, tel que le propose Chantal Jacquet, est plus juste. Il reconnaît la complexité des parcours sans les figer dans une logique de mérite.
- Speaker #0
Après, tu vois, je n'y pense pas tout le temps, mais quand là j'ai été amenée à lire des choses sur le sujet, C'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont fait du bien, tu vois, dans des témoignages, des gens qui sentent. C'est vrai que parfois, je me sens complètement à côté de la plaque ou comme on dit, alors c'est un peu clair, mais le cul entre deux chaises, tu vois. C'est toujours un peu inconfort, c'est-à-dire que des fois, quand… Alors, par exemple, j'ai des potes d'Ardèche qui sont des amis d'enfance du collège qui, d'un coup, ont arrêté de me parler parce qu'en fait, ils ont estimé que maintenant, j'étais dans d'autres sphères, que j'évoluais. Alors. Je ne sais pas, tu vois. Peut-être que j'ai absolument fait un cas où je suis devenue complètement égocentrique. Je n'ai pas l'impression. En tout cas, eux, ça leur posait un problème de m'avoir dans leur vie encore maintenant. Je ratais quand même pas mal d'événements parce qu'on n'est plus au même endroit. Mais je n'ai pas eu l'impression de leur avoir manqué de respect ou quoi. Mais ça les gênait, je pense, cette différence de cadre. Ça leur posait un problème à eux. Pas à moi, mais à eux. Donc... C'est vrai que c'est réconfortant des fois quand tu lis des témoignages de personnes qui vivent un peu la même chose que toi, ce truc de te dire, par exemple, dans le relationnel aussi avec certains dentistes, je vois que je n'ai pas les codes, je n'ai pas les codes de communication. Alors, je les ai de plus en plus parce que ça s'apprend et j'ai cette volonté-là. Et même maintenant, quand je rencontre des gens, par exemple, à l'école de mes enfants qui ne savent pas d'où je viens, ils pensent que je suis Montpellierenne. Donc, j'ai été quand même… Ça y est, je me suis fondue un peu dans le décor, sans le vouloir parce que ça n'a jamais été un but non plus. Mais voilà, je ne veux pas renier ce que je suis, parce que je suis très fière de ça. Je suis très fière de mes origines et tout. Mais j'ai quand même évolué. Je suis un peu tout ça, finalement.
- Speaker #1
Annie Ernaux parlait d'être déchirée entre deux mondes. Ce que vit Manon, c'est une position de l'entre-deux. Jamais totalement ici, plus tout à fait là-bas. Ce trouble identitaire est l'un des coups invisibles de la mobilité sociale.
- Speaker #0
Ceux qui sont restés autour de moi, il n'y a pas eu de changement. Et quand je suis... Déjà, je déteste parler de mon boulot en dehors du boulot. C'est vraiment un truc que j'aborde peu. Ou sinon, par exemple, je vais parler de choses, mes techniques, ou demander un conseil à mon frère ou à ma sœur pour un problème que j'ai. Ça va être sous cet abord-là. J'aurais du mal à dire... j'ai eu une réussite professionnelle. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense qu'il y a eu quand même le côté matériel, c'est incontestable. C'est-à-dire que je voyais bien que pendant toutes mes études où je n'avais pas trop de moyens, je n'étais pas habillée comme tout le monde, je n'avais pas les mêmes choses que les autres, etc. Et qu'à partir du moment, je me rappelle le premier jour, j'étais toujours à découvert sur mon compte. le premier jour où je reçois mon salaire le premier salaire d'orthodontiste je me dis ça y est t'es arrivé non pas vraiment finalement c'est un truc de dingue ce premier salaire tu te dis j'y suis arrivé et forcément le fait de peut-être de de s'habiller différemment, d'avoir des activités aussi un peu différentes et tout, c'est des composantes en fait.
- Speaker #1
Oui, tu sais qu'au-delà de la sécurité financière, c'est surtout un statut, un titre, une reconnaissance. Tu le sens tout ça en fait.
- Speaker #0
Dans les étapes, il y a aussi la thèse.
- Speaker #1
La thèse, oui.
- Speaker #0
La thèse, c'est vraiment une étape. La thèse, même si on sait que tu as des thèses qui sont un petit peu biblio, etc. Ce n'est pas comme une thèse de science, c'est sûr. Mais le fait d'avoir toute la famille qui vient à la fac, les invités, les profs, les trucs, et puis le titre de docteur, c'est quand même un truc, c'est assez impactant. Et puis moi, c'était la première fois que ma famille venait à la fac, qu'ils n'étaient jamais venus avant, qu'ils voyaient les profs, que les profs, généralement, ils disaient des trucs plutôt sympas. Je pense que ça t'assoit dans quelque chose de nouveau pour toi, mais aussi pour les gens qui sont présents. La vie a fait que ça s'est passé comme ça pour moi, mais je me trouve vraiment épanouie dans mon boulot. Pas tous les jours, parce que je n'ai pas envie de... les gens se disent « ah non mais pas moi » , parce que tu sais quand tu parles, t'as une responsabilité quand même pour les gens qui t'écoutent parce qu'un risque, tu dis « ah, trop de la chance, moi je me sens pas épanouie tous les jours » , non, non, tous les jours je me sens pas épanouie, il y a des trucs qui me gonflent etc, c'est pas une longue ligne droite.
- Speaker #1
T'as déjà éprouvé le fameux syndrome de l'imposteur c'est-à-dire cette sensation que tu dois constamment prouver ta valeur et Et prouver que tu mérites d'être là où tu en es aujourd'hui.
- Speaker #0
Oui, oui, oui. Ça, c'est très fréquent. C'était peut-être plus vrai au début de mon exercice. J'avais l'impression de ne pas être légitime. Donc, de me dire, mais pourquoi moi ? Pourquoi pas un autre ? Oui, ça m'est arrivé. Là, maintenant que je suis un peu plus installée, ça m'arrive moins. Mais je pense quand même que j'ai un rapport au boulot qui reste là-dedans. Le fait d'avoir finalement bossé toute ma vie, parce que même quand on était petit, on bossait aussi. J'ai l'impression que si j'arrête de bosser, tout va s'arrêter. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est très fréquent, et d'autant plus quand on est transfuge de classe. Ce qui est sympa quand tu as connu plusieurs milieux sociaux, c'est que tu es à l'aise avec pas mal de monde. Donc ça, c'est bien. C'est que tu peux, tu arrives à avoir les codes un peu, tu es un peu plus caméléon, tu vois. Je trouve que ça, c'est un côté très sympa parce qu'on est toujours en train de se dire, enfin, j'ai l'impression que le transfuge de classe, on a un abord un peu négatif, genre c'est une galère d'être transfuge de classe. Moi, je ne trouve pas que ça soit une galère, c'est juste une particularité. comme il y a plein de particularités et il faut s'en accommoder. Par contre, c'est un aspect positif, c'est que moi, tu peux me mettre avec l'agriculteur du coin ou le fils de je ne sais pas qui, je vais m'en sortir de la même façon et avec grand plaisir. Donc ça, c'est cool.
- Speaker #1
Manon rappelle que le fait d'être transclasse peut être aussi une force, une capacité d'adaptation, une finesse relationnelle. Il ne s'agit pas seulement d'une blessure à portée, mais d'une complexité à habiter.
- Speaker #0
Après, pour l'accès aux soins, pour les enfants, on a un peu moins ce problème-là parce que c'est quand même plutôt bien pris en charge l'orthodontie jusqu'à 16 ans. C'est plutôt les cas adultes où là c'est plus complexe et c'est vrai qu'il n'y a aucune prise en charge pour les adultes, ce qui est quand même un peu scandaleux parce que tu as vraiment des traitements complexes, tu as des chirurgies, etc. Et là, tu vois que tu as plein de gens qui sont dans des situations hyper compliquées, qui n'ont pas de moyens et qui ne peuvent pas accéder à l'orthodontie.
- Speaker #1
Merci à Manon Serre pour la confiance et la sincérité de son témoignage. Merci aussi à Pauline Bussy pour le montage de cet épisode. La musique de cet épisode est Asi Road de Nicolas Deferrand et Laurent Verneret. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez contribuer à la cagnotte participative dont le lien est disponible dans le descriptif de l'épisode. Rendez-vous sur entretienavecunentiste.com pour retrouver tous les épisodes et les informations complémentaires. Et pour ne rien manquer, abonnez-vous sur Instagram, LinkedIn ou Facebook à Entretien avec un dentiste. A très bientôt pour un prochain épisode.