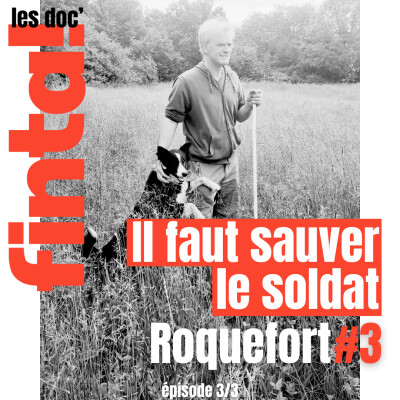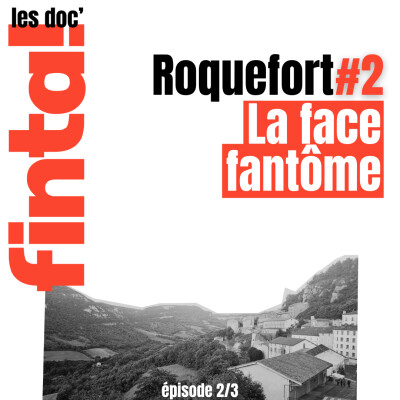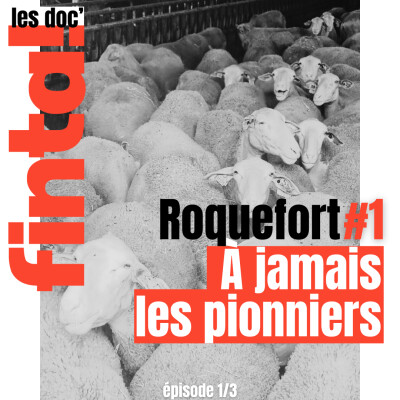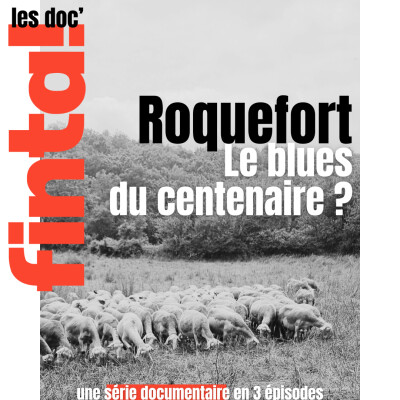- Speaker #0
Et si la journaliste Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-il un de plus ? C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. Après Marie-Thérèse Lacombe, Nicole Fage-Galtier, Daniel Dastug, Daniel Puech, Sarah Sengla, Emmanuel Gazel et Josette Hart dans la première saison, Ginette Marchive, Pauline Broca, Audrey Dussutour et Catherine André dans la deuxième saison, Je vous propose d'embarquer pour une troisième saison de Pionnières. Aujourd'hui pour un épisode exceptionnel à titre posthume avec Jeanne Agar.
- Speaker #1
Je ne suis pas française. Je suis née en Amérique du Sud, à Piyoué. Piyoué, c'est une colonie de français. Et alors cette colonie de français, elle a été là-bas. Parce qu'on leur disait qu'il y avait des grands espaces de tout et qu'ils pouvaient faire beaucoup de blé et tout ça. Et que personne ne le travaillait. Alors ils sont partis là-bas.
- Speaker #0
Nous avions rendez-vous dans un salon de sa maison de retraite dans le centre-ville de Rodez. C'était en avril 2023. Jeanne Agar avait 96 ans. Elle s'est éteinte moins de deux mois plus tard. Recroquevillée dans son fauteuil roulant, Jeanne Agar avait sa petite voix fluette. Elle rebondissait du français à l'espagnol, mélangeant ces deux cultures et quelques détails de sa longue vie. Avant que nous nous quittions, elle m'a demandé de me faire un messager auprès des cousins de Pigoué, cette colonie avéronnaise en Argentine où elle est née. Il me fallait leur dire que Juanita Munguia allait bien et qu'elle pensait tous les jours à eux. Si vous avez déjà entendu Jeanne Agar dans la série documentaire de Finta consacrée à Pigoué, c'est une autre partie de sa vie qui l'a fait entrer des deux pieds dans cette collection dédiée aux pionnières en Aveyron.
- Speaker #1
Vous n'avez pas compris ?
- Speaker #2
Dites-moi la traduction.
- Speaker #1
Oui. Dans le ciel, les étoiles. Dans les Ausha, les épines. Les épines. Mais au milieu de mon cœur, la République argentine.
- Speaker #0
Jeanne Agar a été, à 22 ans, la première femme photographe professionnelle à Rodez. Parmi les centaines de clichés parus dans la presse, les milliers de photos de classe et de... portraits de famille, on doit à Jeanne Agar des clichés qui ont valeur d'archives pour la ville. C'est elle qui a documenté l'occupation allemande à Rodez alors qu'elle vivait clandestinement et n'avait pas encore 18 ans. C'est elle aussi qui a saisi le massacre de Sainte-Radegonde quelques instants après la fusillade allemande qui coûta la vie à 30 prisonniers français. C'est elle encore qui a figé sur papier la libération de Rodez, l'allégresse et l'épuration qui suivra. Pourtant, La vie de la jeune Jeanne Agar a d'abord été une succession de séparations, de drames et de hasards. Rien ne la prédestinait à devenir photographe, encore moins la Rodèze, elle qui était née en 1927 dans la province de Buenos Aires. Elle n'a que 12 ans quand sa vie d'adolescente percute avec fracas la grande histoire. Repartons dans le temps. Août 1939. La jeune Juanita embarque avec sa maman Louise pour une traversée de l'Atlantique. Jamais elle n'était allée sur les terres qu'avaient quittées ses grands-parents, Marie et Henri Calmels. Le couple avait suivi les traces des 164 Aveyronais qui ont fondé une colonie dans la Pampa Argentine quelques années auparavant. Fuyant la misère du Rouergue à la fin du XIXe siècle, Marie et Henri Calmels se sont installés comme agriculteurs. Ils ont eu cinq enfants. dont Louise, qui s'est mariée avec un émigré espagnol, Juan Munguia, installé comme épicier à Pigüé. Les grands-parents, quand sonne l'heure de la retraite, ont choisi de rentrer en France. Mais peu de temps après, la maladie rattrape Marie et Henri Calmels. Une lettre en informe Louise, sa fille, qui décide d'aller au chevet de sa mère, en portant avec elle la petite Juanita. Ses deux autres enfants resteront avec leur père, à Pigoué. Et voilà les deux femmes embarquées pour un voyage sur l'Atlantique, qui durera un mois.
- Speaker #1
Les grands-parents ? En revenu de là-bas, il voulait mourir en France. « Oh, aime-moi, mon ami, aime-moi un bateau. » Vous savez qu'à ce moment-là, j'avais 15 ans, et alors je trouvais le talent au bateau, c'est très joli, mais vous voyez que la mer est le ciel. Je disais vivement qu'on arrive en France, que de ce pays, comment ça lui est bien. Eh oui, oh oui. Et alors toute ma famille est restée là-bas. Et papa aussi. Et il n'aimait pas voyager.
- Speaker #0
30 août 1939. Après avoir accosté à Marseille et poursuivi le chemin en train, Louise et Juanita Munguia arrivent en gare de Rodez dans la soirée. Mais la nouvelle les assomme. La grand-mère est décédée pendant leur voyage. Convaincue que son père est trop âgé pour vivre seule à Rodez, Louise se met en tête de le faire revenir avec elle à Pigoué. Elle n'aura pas le temps d'engager les démarches, car le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Les frontières se ferment, les bateaux restent à quai. Le courrier aussi. Voilà la petite Juanita et sa mère bloquées à Rodez. Mais pour combien de temps ?
- Speaker #1
Ah oui, alors là. Il y a eu la guerre ?
- Speaker #0
Début septembre, malgré la guerre qui pointe, les rutinois ont la tête à la rentrée scolaire. La congrégation religieuse de l'école Sainte-Geneviève accepte de scolariser la jeune Juanita. Traitée comme une étrangère par ses camarades, peinant à apprendre le français, on moque Juanita Colombi venue d'un pays de sauvages et d'Indiens à plumes. Mais la jeune écolière se démène pour être une bonne élève. Fin 1941, la Véron est encore en zone libre. La guerre prend la forme, pour les Aveyronnés, de restrictions seulement. Elle se lie aussi sur les visages des réfugiés qui fuient l'envahisseur et trouvent refuge dans le coin. C'est le moment, en décembre 1941, où parvient un télégramme apprenant à Juanita la mort de son père. Le malheureux a été foudroyé par une crise cardiaque. Qui va s'occuper des deux fils restés au pays ? C'est un nouveau drame qui meurtrit Louise et sa fille. A peine quelques mois plus tard, les bottes allemandes arrivent dans Rodez. À 96 ans, Jeanne Agar se souvient encore de ce bruit, de ces milliers de bottes qui frappent la rue Béteil. L'hôtel du Binet, qui avait été le point de ralliement des colons de Pigoué avant leur grand départ, est désormais marqué du drapeau à Croix-Gamay. Étrangère sur le sol français, Louise refuse de se signaler aux Allemands. Mais la directrice d'école de Juanita ne peut plus prendre le risque de l'accueillir. Les Allemands ont assuré qu'ils viendraient contrôler les élèves prochainement et les étrangers sont les premiers recherchés. Voilà Louise et Juanita contraintes de basculer dans une vie clandestine. Juanita a 15 ans, elle est embauchée par les sœurs de Saint-Vincent de Paul à qui elle prête main forte comme auxiliaire de santé dans le quartier de Saint-Amant. ne pouvant plus aller à l'école. Et très vite, elle apprend qu'un photographe, un certain M. Durand, installé rue Neuve, recherche un apprenti pour assurer le développement en chambre noire. Il ferme les yeux sur les papiers de Juanita, la voilà embauchée. Mais les Allemands rodent toujours.
- Speaker #1
Il venait chez mon patron, et il dit « Devois cette personne-là ! » « Ah ben oui ! » disait le patron. Et j'avais dit « Faites attention ! » à ce que vous dites. Alors, si vous demandez, vous voulez me voir, je ne suis pas là. Alors, quand il venait, papyr, pas papyr, pas papyr, et comment pas papyr ? C'est obligatoire. Ben oui, mais je n'ai pas les papiers de la base. Pas de papyr, non. Il revenait avec un gradé plus grand. Je faisais peur. Alors moi, j'ai fait des grands sourires. J'étais jeune fille. Eh, j'ai fait des grands sourires, monsieur. Merci monsieur, au revoir monsieur, j'étais contente. Ouh, il était dans le mangradé, le patron me disait, vous êtes plus gentil avec les allemands qu'avec moi. Et j'ai dit, écoutez, je ne peux pas vous saluer quand même comme ça. Oh, c'est drôle de... temps. J'avais peur. Je passais dans les petites rues pour aller chez moi, dans les petites rues où les Allemands ne faisaient pas... Ils faisaient la ronde. Et quand ils voyaient une jeune fille toute seule, automatiquement, papire. Les papiers. Alors, pour les éviter, Je faisais une tour à l'intérieur de... Je passais place à bas de l'Aide et je faisais une grande tour derrière la cathédrale pour aller chez moi rue du Val. Ah oui, c'était des drôles de temps. Les mamans, elles tremblaient à la maison et les temps ont retard pour arriver à la maison. Elle ne s'est pas faite arrêter au moins. Quand j'arrivais, elle me sentait au cou. Elle me disait « Oh ma fille, j'avais peur pour toi » .
- Speaker #0
Dans le film qu'il a consacré à Jeanne Agar, Jean-Philippe Savignoni raconte cet événement. Un soir, peu avant la fermeture du magasin de M. Durand, un dernier client pousse la porte. C'est un Allemand, de la Gestapo. Il a des travaux à confier discrètement après les heures d'ouverture au photographe. Juanita est pétrifiée. Elle se trouve dans la chambre noire avec cet officier qui exige de rester à ses côtés pour le développement. Peu à peu, les clichés apparaissent dans les cuvettes de développement. Tous montrent des corps meurtris, torturés, l'horreur. Quand l'homme s'en va, il est 22h, le couvre-feu est en place. Juanita craint de rentrer chez elle. Elle sera finalement escortée par six soldats allemands. Quand ils arrivent rue du Bal, la mère de Juanita est morte d'inquiétude. Cela fait déjà trois heures que sa fille aurait dû rentrer. Et la voilà qui apparaît sous ses rideaux encadrée par la patrouille. Louise est persuadée que sa fille a été arrêtée. Et puis, dans les mois qui suivent, d'autres photos de torture seront entre les mains de la jeune Juanita. Elle n'hésite pas à en faire tomber quelques-uns quand la Gestapo tourne le regard. Elle sait déjà que ces photos auront valeur d'archive. 18 août 1944. Le téléphone sonne au magasin. C'est la préfecture de l'Aveyron qui informe le photographe que les Allemands sont partis. Ils ont rebroussé chemin. Mais sur leur route, à Sainte-Radegonde, ils ont fusillé 30 jeunes prisonniers. La préfecture n'a pas encore tous les éléments, mais il est question d'un véritable massacre. Monsieur Durand est réquisitionné pour photographier la scène de la fusillade. Et c'est Juanita qui se propose d'y aller. Son appareil photo autour du cou, elle part pour Sainte-Radegonde en vélo. Elle n'a que 17 ans, l'âge du plus jeune des fusillés, mais elle n'hésite pas à s'approcher au plus près des corps. Elle sait que ses photos permettront le souvenir.
- Speaker #1
Ah ben là, les fusillés, c'était des pauvres gens, surtout des hommes. Et alors les pauvres, s'ils étaient français, il ne fallait pas les fusillés, mais les allemands. Ramasser tous les hommes. et aller, comme ça ils n'allaient pas faire la guerre contre eux. Et tatatata, bon matin, alors mon patron me dit, je ne vais pas y aller, et lui il tremblait, je ne peux pas y aller, mais il faut quand même des photos pour qu'on voit ce qui s'est passé. J'ai dit, monsieur, donnez-moi un appareil. Et facile à régler, je vais vous y aller, il m'a dit vous croyez ? Je lui ai dit oui. Une femme, que voulez-vous qu'on lui fasse ? Alors je l'ai été, j'ai fait les photos, toutes ces photos, oh mon Dieu, c'était pas drôle.
- Speaker #2
Son patron ne voulait pas y aller, mais il a été réquisitionné par la préfecture, mais il ne voulait pas y aller tout seul. Et elle s'est proposée. Donc déjà, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose. Parce que je lui dis, est-ce que vous saviez ce que vous alliez voir ? Eux, pas bien ! Mais enfin, elle allait voir des fusillés.
- Speaker #0
Le jour des funérailles, organisée sur la place d'Armes, Juanita grimpe au sommet de la cathédrale. C'est de là-haut qu'elle capture ses 30 cercueils blancs, disposés en art de cercle. Cette photo fait partie des plus précieuses archives iconographiques de Rodès. Et puis... L'horreur laisse rapidement place à l'euphorie. Dans Rodez, le départ des Allemands donne lieu à des moments de liesse. Juanita est encore là pour immortaliser ces moments d'histoire. Elle documente aussi la rage qui la sera place à l'épuration, menée contre ceux qui ont collaboré et les femmes qui ont entretenu des relations avec les Allemands. Celles-ci seront tendues. Pourtant, il n'est pas encore possible pour Juanita et sa mère de reprendre un bateau direction l'Argentine. Il faut encore attendre un peu. Ronita a 18 ans. Libérée de la peur, elle grappille des moments de joie dont son adolescence l'a privée. Elle écume les fêtes et les bals. Et c'est sur la place du bourg, lors d'un bal, qu'elle rencontre celui qui deviendra son époux, Adrien Agar. Lui revient tout juste du STO en Allemagne. Tandis que les deux tourtereaux roucoulent dans leur idylle naissante, Louise vient d'obtenir son passeport pour rentrer à Pigoué. Nous sommes en décembre 1945. Elle propose à Adrien de rentrer avec elle. Il pourra reprendre l'épicerie de son défunt époux. Tout semble prêt pour les accueillir et leur permettre de s'installer heureux, ensemble enfin, à Pigoué. Mais Adrien Agar, échaudé par ses années en Allemagne, préfère rester auprès des siens. C'est décidé, Juanita reste à Rodez avec lui. Ils se marient au début de l'année 1946 à Saint-Amant. Voilà Juanita Munguia, devenue Jeanne Agar. Louise, sa mère, Elle, rentre seule à Pigoué retrouver ses fils, laissés orphelins. Dans l'immédiat après-guerre, la vie reprend à plein poumon. Et face à une activité croissante au magasin, Jeanne Agar choisit de monter sa propre affaire. Elle trouve un local, rue du Bal. Il est petit, mais il fera l'affaire. Non loin de l'appartement où elle se cachait avec sa maman. C'est là qu'elle ouvre son commerce en 1949. Et c'est elle. qui forment son mari à la photographie. Les voilà tous les deux à la tête de leur petite entreprise.
- Speaker #1
Eh oui, alors on a beaucoup travaillé, on s'est agrandi, et on faisait après, maintenant. Et maintenant, je faisais que les développements, et le magasin, au lieu qu'avant, on sortait dehors. photographier tous les événements qui se passaient. Il y avait des manifestations, il y avait des... Alors, on allait les photographier et on les affichait. Et les gens venaient voir. Et quand je ne les avais pas affichés, ils me disaient, mais vous avez bien photographié. Vous ne les affichez pas ? Si, je suis en train. Parce que... On les affichait, mais pas en petit format, en grand format. Et alors on les vendait en grand format, par une.
- Speaker #0
Des générations entières ont connu le studio des Agarres et avaient l'habitude de se masser devant cette vitrine qui donnait les nouvelles en images. Combien de classes ont-ils photographiées à eux deux ? Dans combien de banquets de famille ont-ils installé leurs trépieds ? Peut-être faites-vous partie de ceux qui conservent une photo signée de Jeanne Agar dans votre salon ou celui de vos grands-parents, dans vos archives à minima. Mais c'est aussi les archives collectives que Jeanne Agar a largement contribué à alimenter. Et si la vie ne l'a pas épargnée dans ses premières années, tissée de déchirement en déchirement, c'est sur cette vie menée avec panache qu'elle a été fière de poser des mots. Tout comme ses photos, elle savait que ses morceaux de vie faisait partie du grand puzzle collectif. Quelques années avant de se livrer au micro de Finta, la vie de Jeanne Agar a été superbement mise en image par Fiasco Productions et avec la complicité du conteur du patrimoine Jean-Philippe Savignoni. Leur film a été produit par Rodez Agglomération. L'œil malicieux de Jeanne Agar y est enregistré comme une précieuse archive. Et c'est Jean-Philippe Savignoni, justement, que je retrouve désormais. Il est accompagné d'Anne Charbonnier, La fille de Jeanne Agar.
- Speaker #2
Moi je dirais qu'elle a déjà un caractère, Jeanne. Et ce caractère-là, elle devait l'avoir déjà, ce tempérament-là, ce caractère, elle devait l'avoir déjà peut-être enfant. Et ça s'est forgé, et aux aléas, aux vicissitudes de l'histoire, ça s'est durci. Et donc ça, ça lui a permis de dire aux soldats allemands qui venaient faire développer des photos de torture qu'ils faisaient à la Gestapo qu'ils aillent fumer dehors. Ici, on ne fume pas, c'est un laboratoire. Dehors, on fume. Vous voyez ce genre de caractère qui fait que la peur, c'est... Alors, je ne dis pas qu'elle n'a pas eu peur, mais il y a quelque chose qui prend le dessus par moments et qu'on appelle, alors peut-être pas le courage, mais le caractère. Et avec ça, on traverse des épisodes. On a 22 ans, on décide de monter son propre magasin de photographes, de se marier, de donner le nom du magasin, effectivement, parce que les étrangers ne pouvaient pas s'établir comme ça. Et que par la suite, elle gagnera. dans une espèce de loto d'assurance, son mari voulait de cet argent acheter une voiture, et que non, c'est mon argent, tu ne le touches pas. Tu vas aller chercher des billets et nous partons en Argentine. Donc ça, c'est des femmes qui sont au gouvernail de leur bateau. Donc déjà, je dis, parce qu'au XXe siècle... Des femmes qui dirigent, qui prennent comme ça une assise, une importance dans le destin, dans le chemin de leur vie. En général, on le sait, elles ont voté tard, elles étaient plutôt la femme 2. Rouhani Tamungui, elle a tout de suite dit qui elle était, ce petit morceau, ce petit bout de femme, maintenant que l'on voit. était une femme déjà qui avait son tempérament et qui menait sa barque. Et ça, c'est un destin de femme, je trouve, un peu hors du commun pour l'époque. Donc je dis que ça lui a permis ce tempérament, aller photographier des gamins. fusillé par les nazis à Saint-Radegonde, alors de pleurer, de pleurer, mais de tenir son appareil photo, d'appuyer, de décider de monter sur la cathédrale pour photographier 30 cercueils des 30 fusillés de Saint-Radegonde et d'avoir l'idée de monter à la cathédrale pour avoir l'alignement en demi-cercle des 30 cercueils, de voir ce moment de grand silence comme une chape de plomb qui tombe... de tristesse, de désarroi de ce qui s'est passé, de cette guerre, et d'être là en disant je vais monter là, je vais faire les photos. Et puis donc il y a les photos de la libération, il y a les photos de l'épuration aussi, qui est une période aussi à Rodez, comme ailleurs, mais qui est une période... qui est insupportable à voir dans ces documents, mais qu'elle a photographiés aussi, de ces femmes tendues, de ces femmes qui ont été fusillées, qu'elle n'a pas photographiées, mais qui ont été fusillées vers les anciennes casernes. Cette période noire, et la photo est un témoin, et donc elle a participé d'archives qui sont des archives... qui sont des archives précieuses. À la fois le soleil éclatant de la libération et le soleil noir de l'épuration. Et tout ça, elle n'est pas écrivaine, elle n'est pas auteur-écrivaine, je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas, elle était photographe et par sa façon d'être là lors des événements, elle a raconté, elle a témoigné, elle a conservé. Et donc ça, c'est précieux pour nous, effectivement, ça ne s'oublie pas. De quel bois est-elle faite ? de quelle, je ne sais pas, moi je suis impressionné, mais elle n'est pas la seule à avoir résisté, à avoir supporté l'insupportable. Mais bon, je dis chapeau. Et puis bon, il y a effectivement, comme Annie le disait, sa maman, la séparation, le choix. Parce que c'est tout un océan qui vous sépare, comme dit la chanson. Et ce n'est pas rien un océan qui sépare. Ce n'est pas rien.
- Speaker #0
C'est la fin de ce nouvel épisode, ajouté à titre posthume dans le cadre de la série de Finta dédiée aux pionnières en Aveyron. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous conseille chaudement de voir le film de fiasco production produit par Rodès Agglomérations, dédié à Janaga. Il est régulièrement diffusé dans le département. Et si l'histoire de Pigoué, cette histoire des Aveyronnés, partie colonisée la Pampa argentine, vous intrigue, je vous renvoie vers le documentaire sonore inédit de Finta, publié en décembre 2023. C'est une série en trois épisodes qui retrace cette histoire avec les précieux témoignages de nombreux témoins d'hier à aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Pionnières et tous les précédents épisodes de Finta sur fintapodcast.fr. sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts et de musique. Finta est aussi sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Merci de votre fidélité et à très bientôt. D'ici là, restez curieux.
- Speaker #2
Moralité, enregistrez vos parents et vos grands-parents, parce que finalement, il arrive que les grands-parents racontent leur histoire. à des enfants qui ont des âges où ils s'y intéressent peu ou pas du tout. Mais il y a un moment où plus on vieillit et plus on se rapproche de ses parents, plus on finit aux archives. Les archives, c'est du papier. Le papier, c'est intéressant, mais ce n'est pas de la chair. Alors tant que vous avez quelqu'un qui peut vous raconter, il faut les harceler jusqu'à ce qu'ils vous racontent leur histoire. Et sinon, qu'ils l'écrivent. Et plus tard, ce récit, effectivement, ça permet à la famille de savoir et de répondre aux questions des enfants ou des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui posent toujours des questions après. Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi ? Je vous dis ça parce que moi, je ne l'ai pas fait avec les miens et ça me manque. C'est un trou d'air. On n'a pas de mémoire. Notre mémoire, c'est une machine à effacer. Elle ne garde que très peu de choses. Alors effectivement, d'avoir enregistré, de faire ce que fait Lola avec son émission, ça permet de garder et d'archiver. Et ça, c'est très précieux. Ce sont des petits cailloux blancs qui permettent à tous les petits poussés qui viendront après à retrouver leur chemin dans la grande forêt du souvenir.
- Speaker #1
Et merci beaucoup à cette émission qui les gardait en souvenir. D...