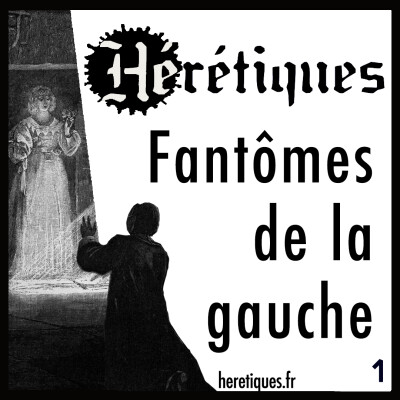- Speaker #0
La révolution culturelle de 1960 à 1990. Première partie.
- Speaker #1
Nous recevons Jean-Pierre Le Goff, bonjour.
- Speaker #0
Bonjour.
- Speaker #1
Nous interviewons aujourd'hui à propos d'une grande partie de son œuvre, et dont un dernier livre qu'il vient de sortir, en 2023, Mes années folles, révolte et nihilisme du peuple adolescent après mai 68 Mais auparavant, vous avez, durant une vingtaine d'années, plus de vingt ans, On a publié une série de livres extrêmement éclairants qui ont aidé certains d'entre nous à alimenter leurs réflexions. Je parle notamment de La barbarie douce, de Metz 68, l'héritage impossible. de la France morcelée, de Malaise dans la démocratie, ou de La gauche à l'agonie, en 2017, qui est une réédition du livre de 2011, La gauche à l'épreuve. Rien que la réécriture du titre dit beaucoup de choses. Et vous faites partie de ces sociologues qui ont un regard sur la société assez lucide. Voilà, sans construire un système, vous avez, décennie après décennie, tenté de porter une critique qui vaut toujours aujourd'hui, et c'est à ce titre que l'on vous invite ce soir. Est-ce qu'en introduction, vous pourriez vous situer dans le champ de la sociologie ? C'est ce que vous faites rarement, en réalité.
- Speaker #0
Oui, enfin, d'origine, je suis de formation philosophique. Je passais une licence de philosophie. Mais très vite, dans ces licences, à l'époque, après 68, il y avait ce qu'on appelait un certain nombre de valeurs en sociologie. La sociologie, celui, je veux dire, qui m'a ouvert la sociologie, c'est Claude Lefort, qui, à l'époque, dirigeait l'Institut de sociologie de la faculté de Caen, où il y avait également Paul Lyonnais, Marcel Gaucher, Alain Caillé, etc. Alors... Cette sociologie, elle est un peu particulière. Je dirais que c'est une sociologie qui est ouverte sur la dimension anthropologique et philosophique. Alors, en quoi consiste-t-elle ? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué chez Claude Lefort, mais c'est aussi chez Cornelius Castoriadis, c'est la dimension... qu'il n'y a pas de naturalité pure et simple du social. C'est-à-dire que le social, là je reprends une formule de Claude Lefort, Les faits comportent beaucoup de représentations. Les représentations, c'est quelque chose qui est différent et qui est très difficile à analyser de façon critique, puisque les faits, on peut les mettre à distance, alors que les représentations, elles vous habitent d'une certaine façon, sans que vous en ayez forcément conscience. Et l'univers social, le monde social, est un univers, pour reprendre l'expression de Castoriadis, de signification imaginaire ou de représentation. Et donc c'est une analyse de la société qui prend en compte ces représentations. Je dirais qu'il y a d'autres auteurs importants, mais là ça nous amènerait très loin, qui est l'anthropologie culturelle américaine, avec Margaret Mead notamment. Donc j'allais dire, ma formation première à l'université, en même temps que la philosophie politique, c'est cette sociologie. Elle se distingue de courant. qui à la fois le courant, on pourrait dire fonctionnaliste des espères, c'est-à-dire qui consiste à analyser tel ou tel secteur particulier de la société, Pour essayer d'analyser les différents dysfonctionnements, ce qui peut aller très vite vers le conseil ou l'audit, et avec des espères à n'en plus finir, c'est sidérant le nombre d'espères dans des domaines particuliers. On les voit tous les jours maintenant sur les plateaux de télévision, il y en a des dizaines et des dizaines. On peut apprendre un certain nombre de choses parce qu'il y a des dimensions aussi fonctionnelles. Mais de l'autre côté, vous avez une dimension très critique et très militante de la sociologie, où vous avez la figure qui, à un moment donné, a dominé, qui est Bourdieu. Entre ces deux positions-là, mon approche de la sociologie, c'est une approche qui consiste à analyser les mécanismes et les principales représentations qui sont portées par des acteurs ou des catégories sociales. dont ils n'ont pas forcément conscience, et ce que j'appellerais un creuset culturel de représentation, d'affect, de passion. Et ce creuset culturel, il est plus ou moins transmis consciemment. on en hérite d'une certaine façon. Les générations nouvelles naissent, sont élevées, sont éduquées sur ce terreau-là, qui n'est pas simplement un terreau dans le sens matérialiste. Cet objet, ce n'est pas simplement un objet qu'on met à distance, c'est quelque chose, on baigne nous-mêmes dedans. Et le sociologue doit être conscient de sa position elle-même. Donc c'est cette position critique. critique, mais qui ne verse ni dans l'audit, ni le conseil, ni dans l'expertise, ni dans la critique radicale de la société. C'est-à-dire essayer de trouver, et ce n'est pas facile, une juste mesure dans l'analyse critique qui ne soit pas simplement, dans une optique, enfin, en ce qui me concerne, d'une alternative qu'il faudra à tout prix proposer en alternative à la société existante. Déjà, en démonter les mécanismes imaginaires. Déjà, en souligner les principaux thèmes dans lesquels on baigne sans en avoir conscience permet un recul réflexif et critique qui me paraît tout à fait participer, j'allais dire, des lumières au sens du terme, y compris sur ses propres représentations qu'on porte en soi.
- Speaker #1
Donc la sociologie, en fait, en tant que voie d'émancipation, à la fois individuelle... pour le sociologue, est collective, c'est-à-dire qui renvoie à la société l'image qu'elle a d'elle-même, les valeurs qui sont implicites, les idéologies qui la traversent, de manière à ce qu'elle puisse s'en saisir et s'en émanciper éventuellement. Oui,
- Speaker #0
je pense que c'est dans cette optique-là. C'est pour ça que, par exemple, Alain Caillé, dans une optique, est proche. Bon, lui, il est parti sur la question du mot, ce qui était un auteur très important pour moi et pour d'autres dans les années 70. Mais c'est cette même démarche qui marche. de mise à distance et de recul. Alors évidemment, ça n'a pas une fonction, ça peut aider, l'objectif n'est pas d'aider à améliorer le fonctionnement performant de la société, c'est pas ça. Mais c'est peut-être aussi voir, toujours introduire la distance par rapport à son imaginaire, j'allais dire presque ses fantasmes. Et donc c'est une conception de la sociologie, à l'époque je vous ai parlé, qui était ouverte sur l'anthropologie culturelle, mais qui était ouverte aussi sur la psychanalyse. Parce qu'à l'époque, dans les années 70, que ce soit Claude Lefort ou Castoriadis, étaient très marqués par la psychanalyse. Pas simplement parce qu'ils avaient fait une analyse, parce que la psychanalyse était aussi vue comme une... une théorie qui mettait au centre l'imaginaire, le fantasme, pas simplement les idées intellectuelles, et des représentations. Et c'est pour ça que cette approche, pour moi, m'a beaucoup marqué. Je n'étais pas le seul. Bon, il y avait Paul Lyonnais qui a été marqué. Et c'est une... J'ajouterais une dernière peut-être dimension. C'est une démarche sociologique qui se démarque du marxisme. Dans la mesure... où vous ne raisonnez pas en termes d'infrastructures économiques ou de superstructures économiques. Vous voyez le dichotomie. Et je pense que cette façon de raisonner marxiste a pesé très longtemps, et continue de peser dans des analyses, en disant qu'il y a une cause première qui est dans l'ordre de l'économique et au social, auquel se rajoute une superstructure avec des représentations. Or l'économique et au social, d'une certaine façon, ils baignent déjà dans un univers de signification. On comprend la notion de besoin par exemple, elle correspond à un moment donné à telle étape de la société, on peut les voir de telle manière, et à un autre moment social historique, un autre... Pour reprendre une expression de Castoriadis, les besoins ne sont pas vus de la même façon. Donc même l'économico-social, vous ne pouvez pas le mettre à part en disant qu'il n'y a pas de représentation, qu'il n'y a pas de signification qu'on lui donne. Donc c'est cette façon-là, parce que je pense que le marxisme, au-delà même du contenu, j'allais dire militant ou révolutionnaire, avait ce schéma d'interprétation qui a pesé très très lourdement dans l'analyse. Ou alors vous avez l'autre... L'autre interprétation qui était celle de Bourdieu, qui était dominant-dominé. Et donc vous ramenez tout à des dominants ou à des dominés. Alors non pas qu'il n'y ait pas des dominants et des dominés, mais les dominants et les dominés, ils sont eux-mêmes pris dans un système de représentation. Ils peuvent même partager un creuset culturel sans s'en apercevoir et entrer en conflit sur ce même creuset culturel. Donc pour moi, le travail sociologique, c'est prendre sa distance et ouvrir au questionnement philosophique et à la question de la finalité. Mais ouvrir la question philosophique et la finalité, je ne le fais pas au départ. Pour moi, la réalité, si vous voulez, ce n'est pas l'exemple empirique de conception philosophique. C'est-à-dire la démarche philosophique, quand les philosophes s'intéressent à la société ou à l'histoire, ils ont tendance, évidemment, à considérer l'histoire à partir d'un certain nombre de concepts. Moi, j'ai une démarche beaucoup plus inductive, si j'ose dire, plutôt que déductive. C'est-à-dire que partir et analyser les mécanismes qui sont en œuvre au sein de la société, les représentations, les valeurs, la culture, pour ouvrir à partir de cette analyse-là, mais pas avant, un questionnant d'ordre philosophique et je dirais éthique, dans le sens des finalités. C'est pour ça que, et je pense que mai 68 a joué beaucoup sur ça, en deux mots, parce que j'ai vécu l'événement, je faisais de la philosophie, je suivais des cours de philosophie qui étaient à un niveau très correct, mais mai 68 est arrivé, j'ai été pris dans ce mouvement, et après ça je ne pouvais plus faire de la philosophie comme avant. C'est-à-dire que je ne pouvais plus considérer la réalité. comme un exemple empirique dans les dissertations, si j'ose dire, de conceptions philosophiques. Non pas que ces conceptions philosophiques n'étaient pas valables, je pouvais les retrouver, mais en passant d'abord par l'analyse de la réalité sociale, si vous voulez, pour ensuite ouvrir. Vous voyez, c'est une démarche... Il n'y aurait pas eu 68, je continuais dans des démarches philosophiques, où, y compris d'ailleurs, il y a une dimension de prise en compte de la réalité ou de l'événement historique. Vous ne pouvez pas le déduire simplement d'une théorie. C'est pour ça que quand on parle de mai 68, moi personnellement dans mon parcours, on m'a dit vous êtes engagé Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que vous êtes d'abord emporté par un événement historique. Je n'étais pas du tout politique au départ, je ne m'intéressais assez peu à la société. J'étais dans mon univers philosophique, avec une position très aristocratique des philosophes à l'époque, y compris dans la métaphysique, vous voyez ? Et donc je me suis trouvé emporté par ce mouvement. Et ce mouvement m'a amené à découvrir, mais ça c'était très charnel, j'allais dire, c'était la rencontre avec d'autres catégories sociales que votre propre origine de classe, j'allais dire, votre propre catégorie, et découvrir qu'il y avait des gens, ben ils ne pensent pas comme vous, ils sont différents, il y a des contradictions qui existent dans la société, il y a des conflits, voilà. Et donc à partir de là, il était impossible pour moi de continuer à faire des études philosophiques qui ne soient pas ouvertes sur la dimension sociologique.
- Speaker #1
Alors, 68 a été une ouverture pour vous, et même une double ouverture, puisque aujourd'hui vous faites un retour très critique de ce moment 68, de ces années 68. que vous voyez à l'origine d'une grande partie de l'évolution de notre société.
- Speaker #0
Oui, alors je pense que par exemple pour les jeunes générations, c'est vraiment de la préhistoire. C'est un peu pour ma génération ce qui était peut-être 14 ou 1870, c'est vraiment une grande coupure. Je pense qu'il faut revenir à la base. Quand on parle de mai 68, de quoi parle-t-on ? C'est tout bête. Vous savez, par exemple, il m'est arrivé de discuter avec beaucoup de jeunes. Ils vont vous parler assez spontanément du féminisme ou de l'écologie, par exemple. Or, il se trouve que si vous prenez le moment 68, les journées de mai-juin, il n'y a pas de féminisme, c'est un mouvement machiste, d'une part. D'autre part, l'écologie, vous n'en trouvez pas. Vous allez, par contre, c'est ensuite, après mai Dans les années 70, que ces deux courants vont monter en puissance d'une certaine façon. Alors il y a bien un lien, puisqu'il y a eu mai 68, mais en mai 68 vous ne le trouvez pas. Donc mai 68, si vous voulez, il faut le prendre comme un moment, les journées de mai-juin, l'événement, c'est mai-juin. Mais moi j'analyse l'ensemble de la révolution culturelle 68-arde sur une période beaucoup plus longue, avec différents laps de temps ou d'étapes. Il y a d'abord les conditions qui ont rendu possible mai 68. Ça, je l'ai développé dans la France d'hier. On ne peut pas comprendre, à mon sens, l'événement mai-juin 68 sans prendre en compte la transformation extrêmement rapide de la société française dans l'après-guerre, dans l'après-seconde guerre mondiale. Le bouleversement opéré avant 68 est considérable. Même vous prenez quelqu'un par exemple à droite comme Pompidou, reconnaît une crise de civilisation. Il dit mais on a changé complètement le monde. Il y a la France d'hier et la nouvelle France. Il y a un bouleversement y compris du côté des religions. N'oublions pas Vatican II avant 68. Donc on est dans ce bouleversement extrêmement rapide et pour moi mai 68 c'est un moment... en France, parce que je reviendrai sur le mouvement international, parce qu'il est beaucoup plus archi en France, mais il a pris une forme particulière en France, c'est un moment de catharsis. Et c'est pour ça qu'il est, j'allais dire, à un moment iconoclaste. parce qu'il m'est arrivé beaucoup de faire des conférences sur mes 68, et à chaque fois, j'avais beaucoup d'intervenants qui disaient, écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que moi, j'étais lycéen, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, j'étais ouvrier, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, j'étais un autre. Chacun a tendance à avoir mes 68 à sa porte. Or, le problème qu'il faut essayer de penser, c'est qu'est-ce qui unit le tout ? Puisque effectivement, vous avez des textes lycéens, vous avez la commune étudiante, vous avez la grève générale. Mais enfin, quand vous prenez l'ensemble, par exemple un slogan comme vivre sans temps mort et jouir sans entrave qui est pour moi la formule adolescente par excellence.
- Speaker #1
Qui est d'origine situationniste.
- Speaker #0
Qui est d'origine situationniste. À côté de Pompidou des Sous, vous voyez, ce n'est pas évident comme extrême. Et vous aviez de tout, vous aviez aussi les gens de l'ORTF. Et tout ça... C'est une libération de catharsis de la parole et en même temps de la formation d'une forme d'autonomie au sein de la société par rapport à l'état gaullien. Avec une question, ça c'est peut-être la question, je ne vais pas dire le bon héritage, mais une question qui reste dans l'héritage. Après ce mouvement qu'on a connu, voyons, sommes-nous heureux ? C'est-à-dire, on a connu le progrès, on nous a dit que la technique amenait le progrès. Et cette question-là, elle est posée dans ce 68. Pour moi, c'est, si vous voulez, ce qui reste d'héritage, de questionnement, qui me semble, qui est posé. Mais c'est un moment de pause. Alors, à l'intérieur de ce moment de pause, qu'est-ce qui fait l'unité de tous ces points de vue ? Eh bien, vous n'allez pas la chercher dans le contenu. Parce que quand vous regardez le contenu de la parole, elle est vraiment multiple. J'ai oublié les mouvements catholiques de gauche, j'ai oublié les mouvements d'éducation populaire, chacun aimait son... Eh bien, c'est précisément ce qui fait l'unité, c'est pas le contenu, c'est la catharsis. C'est le moment avec ce questionnement qui me semble intéressant. Le questionnement, voyons, sommes-nous héros ? Où va-t-on ? Avant, on avait une autre société, tout a été bouleversé. Il y a eu des choses, d'où d'ailleurs beaucoup de formules. Apprenons aux enfants, beaucoup de formules sur les enfants qui apprennent à jouer, y compris dans les caniveaux. Je ne sais plus comment sont les formules. Retrouvons le sens de la fête ancienne. Il y a une espèce d'angoisse et de questionnement sur la nouvelle société dans laquelle on est entré. Et l'élément véritablement nouveau qui s'est passé d'ailleurs avant 68, c'est l'entrée dans une nouvelle étape historique des sociétés démocratiques européennes, notamment. On avait ça avec le modèle de vie américaine auparavant. C'est-à-dire qu'en gros, d'ailleurs, il y a l'angoisse. On venait passer à un mode de vie américain. C'est quoi ? C'est société nouvelle. Ça, Aron le dira, Raymond Aron le dira à sa façon en parlant de révolution introuvable. Il dit on est passé à une autre étape où on en a fini avec une lutte de classe où l'une doit l'emporter et faire mourir l'autre et dominer l'autre. Et c'est quoi cette nouvelle société ? On va l'appeler société de consommation et des loisirs parce que les loisirs sont très importants. Et ce moment particulier il intervient au tournant des années fin 50-60 au moment où la période de reconstruction de l'après-guerre touche à sa fin. Au moment où vous avez les premiers biens de consommation, automobiles, machines à laver, télévision, électrophones qui se développent dans les foyers, et où vous avez une importance de plus en plus grande, dès avant 68, des loisirs. Il y a un numéro qui est très important pour comprendre ce moment-là, qui date, si je ne me trompe pas, de juin 59, qui s'appelle la civilisation des loisirs, avec un sociologue qui est aujourd'hui totalement inconnu, mais qui n'était pas à l'époque, qui s'appelle Geoffre Dumasier. qui avait écrit un livre sur précisément les loisirs. Quelles questions sont posées à ce moment-là, et qui sont très bien posées dans la revue Esprit, qui questionnent des militants de gauche ? Pourquoi ? Parce qu'antérieurement, vous aviez le travail comme la centralité du travail. Elle reste, il ne s'agit pas de dire à l'époque, elle est là, la centralité du travail, mais on voit poindre déjà à ce moment-là Comment dire ? Un changement de centre d'intérêt chez des gens, c'est les premiers clubs méditerranéens par exemple, et des gens qui vont dire, mais finalement, je travaille toute l'année pour pouvoir me payer le mois où je suis tout à fait en dehors des contraintes sociales. Je vis les fameux villages de vacances où vous vivez dans une espèce d'utopie, où tout le monde est pareil, etc. Je ne dirais pas qu'à l'époque, c'était le centre de la vie, parce que le travail compte beaucoup. Mais déjà, vous voyez apparaître ça. Et une question très angoissante pour les militants dès cette époque, avant 68. Mais que va devenir le citoyen ? Lui, parce qu'antérieurement, le temps libre, c'était le temps pour l'éducation militante. Et les militants vont commencer à s'interroger. On a affaire à une nouvelle société. L'individu qu'on a en face n'est plus le même déjà. que celui qu'on avait entre les deux guerres en 1936. Alors vous avez un lien, puisque ça commence en 1936. Mais en 1936, les loisirs sont vus dans une dimension d'émancipation collective, comme une espèce de marche de l'histoire et du progrès. Les loisirs modernes qui commencent à arriver avant 1968, c'est précisément dans une dimension hédoniste, individualiste et industrielle. Et oui, avec le tourisme de masse, avec l'Espagne, etc., qui va commencer à se développer. Donc, dès avant 68, vous avez cette interrogation-là qui arrive, vous voyez ? Nouvelle société. Et donc, tout ça va exploser, toutes ces contradictions qui se sont nouées dans la période. Je parle des paysans, parce que la classe qui a été véritablement concernée, je ne dis pas éliminée, mais restée peu, c'est les paysans plus les anciennes couches moyennes. C'est-à-dire les commerçants, les bourgs, les... Tout ça va être complètement... Il reste la classe ouvrière encore à l'époque. Mais la classe ouvrière elle-même est déjà avec les comités d'entreprise dans une logique, j'allais dire, de consommation. Ce n'est plus la classe ouvrière de 36 à casquette, si vous voulez. Il y a les voitures, il va y avoir les loisirs, il y a le bricolage chez soi. Et la revue que je citais d'Esprit en juin 59 le décrit très très bien. Et 68 c'est un drôle de mélange. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette catharsis qui arrive et en même temps la commune étudiante notamment va rejouer sur un mode révolutionnaire toute une histoire passée. C'est-à-dire l'histoire des barricades de 1848 mais c'est aussi Victor Hugo etc. On rejoue ça.
- Speaker #1
On a parlé de psychodrame.
- Speaker #0
De psychodrame et ça entre parenthèses Aron l'avait vu en partie. C'est-à-dire qu'on remet sur la scène historique quelque chose qui est en train de mourir, mais on le met de façon caricaturale et c'est le peuple adolescent qui le porte. C'est ça. Donc, pour finir sur mai 68, vous apercevez que sur le moment, ces journées de mai-juin sont vues à gauche comme une divine surprise. Pourquoi ? Parce que beaucoup, et ce n'est pas simplement la commune étudiante, beaucoup d'anciens révolutionnaires ou d'ex... Attendez la révolution antistalinienne, d'une certaine façon. Sartre, entre autres, mais pas que Sartre. Ça y est, la voilà. D'une certaine façon, je dirais que le fort est Castoriadis aussi. Chacun va avoir tendance à projeter sur l'événement des conceptions qui ont été formées avant. Là, j'ai cité, alors évidemment, il y a tout le courant des conseils ouvriers qui va avoir une nouvelle modalité des conseils. Sauf que ce n'est pas Budapest, c'est des étudiants et des comités d'action. C'est un mélange entre la société de consommation et de loisirs et les anciens remakes révolutionnaires. Déjà, à ce moment-là, c'est quelque chose d'assez hybride, déjà. Vous voyez ? Et alors Esprit, la revue Esprit, va y voir, tout en soulignant aussi, il y a quelques aspects nihilistes. Ils disent, mais quelque chose qui ne va pas dedans. Mais ça y est, le personnalisme, ce qu'avait prévu Mounier, arrive. Chacun va projeter dessus. D'ailleurs, en disant des choses qui vont éclairer l'événement. Mais qu'est-ce qui est loupé ? Qu'est-ce qui est loupé fondamentalement dans le neuf ? Il y a, à mon avis, deux auteurs qui ont compris véritablement, qui sont sortis des schémas préconçus. et qui ont saisi quelque chose d'inédit historiquement. C'est Raymond Aron et c'est à mon avis Edgar Morin, chacun étant d'un côté de la barricade. Raymond Aron, Révolution Introuvable, on est dans une nouvelle société avec une dimension de psychodrame révolutionnaire. et à mon avis Edgar Morin, à l'époque, un 1789 socio-juvénile. Et à mon avis, je pense que là, c'est véritablement la nouveauté, elle est là. C'est-à-dire que pour la première fois, l'historique, un nouvel acteur social historique arrive sur la scène. arrive sur la scène politique et je dirais médiatique, et il ne va plus la quitter. C'est le peuple adolescent. C'est quoi le peuple adolescent ? Il faut se remettre en amont de mai 68, c'est-à-dire une classe d'âge nombreuse, mais d'autre part, une classe d'âge qui va de pair avec le prolongement de la scolarité, c'est-à-dire la période antérieure de l'adolescence, qui a été une période très courte pour la masse. de la population. Il restait des étudiants, mais très minoritaires. Eh bien, les études, le secondaire, dans le secondaire, le nombre de lycéens va considérablement augmenter, le nombre d'étudiants va considérablement augmenter, on va arriver à peu près en 68 à 550 000. Mais au-delà de ces dimensions quantitatives, qu'est-ce qui est en jeu ? C'est que cette période de la vie est très particulière. Elle est propre. Il y a d'abord la révolte. C'est le moment traditionnel de la révolte contre l'autorité. Et si vous ne vous révoltez pas à ce moment-là, vous pouvez toujours vous révolter plus tard, mais enfin c'est quand même l'âge de la révolte et de la rupture. Ensuite, pour pouvoir former votre autonomie, si vous voulez, ça passe par ce moment-là. Et d'autre part, il y a une place très grande liée pas simplement à la sexualité, mais à l'imaginaire. Il y a une évacuation dans l'imaginaire avec une espèce de difficulté à sortir du moment de l'enfance. Vous n'êtes pas adulte, vous êtes dans une situation intermédiaire, un peu flottante. Et le milieu étudiant, et notamment les campus en tant que tels, c'est un milieu où le peuple étudiant, j'allais dire, est sous cloche. C'est-à-dire qu'il vit dans l'entre-soi avec des dimensions, d'ailleurs j'en parle, semi-délinquantes. C'est la bohème, si vous voulez. Il y a la dimension de la bohème, il y a le quartier latin, il y a un monde en soi qui s'est construit autour du peuple adolescent et de la bohème. Et c'est ce nouvel acteur qui entre en scène à ce moment-là et qui semble porter le drapeau de la révolution, aussi paradoxal que ça puisse paraître, puisque cet acteur est issu de la nouvelle société de consommation et de loisirs, dans une étape nouvelle du développement. Et ça, Edgar Morin, à mon avis, c'est lui, avec 1789 socio-juvénile, je trouve que c'est très parlant. Et quand vous regardez, il en parle dès 68, on ne sait pas encore le destin. que va avoir cette 1789 socio-juvénile. Alors voilà pour le moment lui-même. Maintenant, quand je parle, moi, de révolution culturelle 68-âge, il faut prendre beaucoup plus de champ.
- Speaker #1
Vous parlez de la période, en fait, 1960-1990. Voilà,
- Speaker #0
à peu près, oui. Pour donner des dates schématiques.
- Speaker #1
Où s'est déployé tout un imaginaire justement autour, qui s'enracine en tout cas dans ce moment fondateur.
- Speaker #0
Oui, parce que vous apercevez que cette révolution culturelle va toucher un ensemble de pays dans un laps de temps qu'elle-même en gros. Ça part des Etats-Unis, on va dire Berkeley, ça traverse l'Atlantique très vite. Et ça prend une forme nationale spécifique selon l'histoire propre des pays. En Angleterre... Par exemple, vous n'allez pas avoir les barricades comme en France, parce qu'on est un vieux pays révolutionnaire, etc. Vous allez avoir la pop culture. Et là, vous avez une révolution culturelle contre la morale du XIXe siècle, contre les mœurs anglaises, etc. En Allemagne, ça va prendre une autre tournure. Pourquoi ? Parce qu'il y a le nazisme, il y a le poids du nazisme. En Italie, il y a le poids du fascisme italien. Nous, on est dans une situation très particulière. On a quelqu'un qui s'appelle De Gaulle en face, qui n'est pas tout à fait, qui ne correspond pas. au fascisme, même si la commune étudiante va le traiter de tous les noms, si vous voulez. Donc je veux dire par là qu'il y a un mouvement. de révolution culturelle menait. Le point commun, c'est le peuple adolescent et le mouvement étudiant et lycéen. C'est ça, la réalité nouvelle. Alors, cela dit, je ne nie pas l'importance de la grève ouvrière, la grève générale en France. D'ailleurs, on peut se demander ce que serait devenu le mouvement de la commune étudiante s'il n'y avait pas, à un moment donné, si ce mouvement n'avait pas embrayé sur une grève générale qu'il y a donnée. Une dimension vraiment très très forte.
- Speaker #1
Il a donné une dimension très forte et qui en même temps l'a dénaturé en quelque sorte. Cassio Radis, dans son texte La Révolution Anticipée, fait une remarque intéressante. Il dit que c'est une révolution à l'envers. D'habitude, on commence une révolution par... On demande du pain, une diminution des prix, on demande de meilleures conditions de travail, et on finit avec des utopies et la mise en place d'un nouveau régime. Mais sans doute a été exactement le contraire. On commence avec des mots d'ordre extrêmement radicaux et on finit en fait par négocier les accords de Grenelle qui ont été un rattrapage de l'inflation.
- Speaker #0
La dimension de la commune étudiante était coupée du monde ouvrier parce que le monde ouvrier ne voulait pas la révolution. Moi je fais partie de ceux qui ont cherché à tout prix jusqu'au bout à retrouver une classe ouvrière révolutionnaire si vous voulez. Bon elle n'était plus là. Et alors le problème, c'est l'illusion qui consiste à se penser comme des nouveaux acteurs de l'histoire. et de penser que la jeunesse est le nouvel acteur de l'histoire qui va faire une révolution, qui va reprendre le flambeau qui n'a pas marché antérieurement. C'est ça la grande illusion sur laquelle moi je vais entrer dedans, si vous voulez, par le militantisme, je vais passer par le maoïsme, je vais aller dans le nord, chercher à la recherche de la classe ouvrière perdue, si vous voulez, qui en fait n'est plus là. Alors ça c'est le premier moment. Maintenant ce qu'il faut voir, si vous prenez l'ensemble du processus, Il y a les conditions qui l'ont rendu possible. La France d'hier a le bouleversement d'après-guerre. Les journées de mai-juin... Et puis vous avez le lendemain de mai 68 ce que j'ai appelé la flambée du gauchisme sous la forme de l'extrême gauche. Et vous avez la seconde moitié des années 70 où l'extrême gauche... est en échec, d'une certaine façon, par rapport à son projet révolutionnaire, où le gauchisme culturel, ce que j'appelle le gauchisme culturel, qu'il faut définir précisément, qui était déjà présent en mai, tout ça était mélangé. Le premier moment, c'était une espèce de marmite bouillonnante du gauchisme, à la fois sous la forme d'extrême-gauche et sous la forme du gauchisme culturel. Mais dans la seconde moitié des années 1910, on assiste à la montée de l'écologie et du féminisme, qui vont devenir ce qu'on va appeler les nouveaux mouvements sociaux, avec les lycéens, etc. Et beaucoup à gauche vont essayer de théoriser ça.
- Speaker #1
Des immigrés aussi.
- Speaker #0
Alors, avec les immigrés, vont théoriser ça en disant ça c'est des nouveaux mouvements sociaux qui vont régénérer la gauche. C'était ça l'idée. Notamment, alors avec l'idée, ça va régénérer, y compris le PS, ça c'est Touraine, si vous voulez. Mais vous prenez Bourdieu plus tard, il y a l'idée d'un mouvement social. Lui, il rajoute aussi la fonction publique, qui confond un peu avec la classe ouvrière. Enfin bon, il y a tout, il y a le privé, il y a le public, il y a les lycéens, il y a les femmes, il y a les homosexuels. Tout ça forme un nouveau mouvement social qui, à terme, doit changer tout ça.
- Speaker #1
Ça a été repris même par Terranova, qui en a fait le programme du PS à partir de 2011, je crois. En disant que le public maintenant des socialistes n'était pas du tout la classe ouvrière ou des employés, des petits boutiquiers, etc. Mais c'était les femmes, les immigrés, les homosexuels.
- Speaker #0
Si vous voulez, moi j'insiste beaucoup sur la dimension du gauchisme culturel. Par gauchisme culturel, il faut voir que... On retrouve des dimensions du gauchisme classique dans l'extrémisme, dans la façon de voir l'État, etc. Mais c'est très particulier. Ça déplace la question sociale vers les questions culturelles. Les questions culturelles, à savoir l'école, l'éducation des enfants, qui est très important, la question d'écologie et la question du féminisme. Et à l'époque, dans les années 110, sous une forme de radicalité très gauchiste. C'est pas le droit A. On ne s'adresse pas à l'État pour lui demander des droits. On est critique contre l'État, contre les normes, contre les interdits. Et il y a même un discours que je stime nihiliste, antinorme. Carrément antinorme.
- Speaker #1
Mais qu'on retrouve aussi aujourd'hui, de manière beaucoup plus récente, dans le wokisme. Dans ce qu'on appelle le wokisme.
- Speaker #0
J'y viendrai juste pour terminer. Sur ça, c'est la période 110. Maintenant, la dernière étape qui, à mon avis, est extrêmement importante, c'est les années 80. C'est-à-dire ce courant qui, partant de loin, va être institutionnalisé. C'est ça. Et du coup, il va être institutionnalisé par la gauche quand elle arrive au pouvoir. C'est très bizarre cette chose. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'anciens militants de 68 vont adhérer au Parti Socialiste ou vont se recouvertir dans le journalisme militant dans les médias. On en connaît même encore...
- Speaker #1
Libération, par exemple.
- Speaker #0
Oui, alors libération, c'est totalement typique, si vous voulez, de ça.
- Speaker #1
Les trotskistes qui font de l'entrisme dans les partis.
- Speaker #0
OPS.
- Speaker #1
Julien Drey, Jospin.
- Speaker #0
Et là, vous avez un changement quand même qui est très important. Je dirais que c'est la deuxième génération de cette révolution parce que c'est à la fois les anciens qui sont encore présents, mais il y a des nouveaux qui... C'est pas pareil d'avoir 20 ans en 68 ou d'avoir 15 ou 16 ans, si vous voulez. C'est des différences d'âge qui peuvent... Je sais pas quel âge avait Geoffrin, par exemple. Mais il a écrit un livre d'ailleurs qui est très intéressant. Je sais pas si je vais vous le retrouver à l'époque. Je vais vous lire sa citation où il dit explicitement en 80, je sais plus en quelle année c'était. C'était dans les années 80. où il dit explicitement Nous allons reprendre la relève des anciens 68 heures Les anciens 68 heures se sont cassés la figure sur la dimension de la révolution, au sens de la révolution classique, c'est-à-dire la prise du pouvoir par la violence, changeant de société. Par contre, nous, on reprend le flambeau sous une forme qui n'est plus celle-là, qui est une forme à la fois qui va se centrer sur la dimension culturelle, et là on a déjà l'idée d'une génération morale. Une génération morale, qui est la deuxième génération gauchiste d'une certaine façon qui arrive. Or, s'il y a bien une différence, c'est que la première génération originaire de 68 était tout sauf morale. C'était la transgression avec des formes de nihilisme. Alors là, on se présente... sous cette dimension-là. C'est le moment aussi où il y a SOS Raciste qui se crée. Et là, on voit surgir une nouvelle problématique qui est dans la continuité, mais aussi qui est dans la discontinuité par rapport au mouvement 68 Arts 1er, à travers le slogan Black Blamber, qui s'oppose d'ailleurs de fait au bleu-blanc-rouge. C'est vécu comme ça. Et là, vous avez quand même un discours qui s'amorce à ce moment-là, qui va prendre des dimensions identitaires, qui commence à prendre des dimensions identitaires. Dans l'ordre de la politique, vous avez évidemment le représentant du gauchisme culturel institutionnalisé qui s'appelle Jacques Lang. Alors ça ne veut pas dire que ce ne sont pas simplement les arts d'avant-garde que va mettre en... Il va financer beaucoup de choses, Jacques Lang. Mais c'est la notion de culture. C'est-à-dire qu'en gros, avec Jacques Lang, c'est la notion anthropologique de la culture qui va s'attaquer à la notion de la littérature et des arts. En gros, tout devient culture, si vous voulez. Donc, alors... On peut le comprendre d'un point de vue anthropologique, mais ça veut dire qu'en même temps, il n'y a plus de hiérarchie dans la création des œuvres. Boire du vin, etc., écrire un livre ou faire une peinture, tout ça c'est de la culture. Vous avez ça à l'école, vous avez l'introduction des méthodes pédagogiques, placer l'enfant au centre, qui sont déjà présents dans le gauchisme culturel dans les années 70, qui vont pénétrer l'école et qui vont être d'ailleurs instrumentalisés. sous la forme d'outils d'évaluation de compétences. Qu'est-ce qu'on va, par exemple, évaluer à l'époque ? L'autonomie. L'autonomie devient une compétence opérationnelle et très prisée, y compris dans les entreprises.
- Speaker #1
C'est ce que vous décrivez, justement, de manière très précise dans La barbarie douce, où vous parliez de ce management dans les entreprises, qui est très pervers, dans les entreprises et dans l'école, où on va utiliser, justement, tout un langage d'émancipation. en cherchant à autonomiser, en racontant qu'on veut autonomiser le travailleur et l'élève, et en réalité, on travaille à une sorte d'auto-asservissement, puisqu'on nie la hiérarchie tout en exerçant une hiérarchie.
- Speaker #0
C'est très pervers. C'est très pervers et c'est les plus faibles qui sont les victimes de ça. C'est-à-dire le discours soyez autonome et responsable C'est un discours paradoxal qui, on peut dire, c'est rendre les gens fous, puisque... C'est un double-bind. Voilà, c'est le double-bind. ou celui qui est en haut vous dit soyez responsable Et la responsabilité devient une bonne norme de comportement, avec des tas d'outils d'évaluation. C'est l'époque un peu folle où on fait signer sur des jeunes qui sont quand même assez désocialisés, un peu perdus, des engagements. Ségolène Royal reprendra cette dimension-là avec des objectifs, je m'engage à… etc., des choses absolument extraordinaires. Et tout ça vient de l'idée d'une autonomie et d'une responsabilité dont on voit… Si vous voulez, l'origine lointaine, si j'ose dire, dans mai 68, et qui est instrumentalisée, qui va devenir un élément de la gestion de l'État, de l'éducation, vous voyez, avec aussi des générations de parents. Je parlerai du livre Libre enfant de Sommerie qui est quand même... C'est l'autogestion appliquée aux enfants, si vous voulez. Donc c'est tout ce qui est plus faible. J'irai même plus loin. Je pense qu'il y a une dimension nihiliste qui est présente dans 68. Je ne dis pas que mai 68 est nihiliste de part en part, mais il comporte, y compris dans la dimension du gauchisme culturel, un aspect nihiliste dans la transgression de toutes les valeurs et de la mise à bas de toute forme d'institution, de toute norme ou de tout interdit. Et cette dimension de... Eh bien, bizarrement, c'est ça le paradoxe, cette dimension-là va être intégrée à l'État, comme une espèce, comme un nouveau mode de gestion. Mais de gestion de quoi ? De l'anomie. Et c'est ça le... Et à ce moment-là, l'héritage impossible, parce que c'est ce moment très important, va acquérir une hégémonie. Il avait déjà commencé à se répandre dans la société. Mais par l'État, par sa diffusion dans l'État, il va s'étendre d'abord à gauche, parce que je pense que, malheureusement si j'ose dire, la gauche a été à un moment donné à l'avant-garde de ce gauchisme culturel, sur fond de crise de sa doctrine ancienne, comme substitut à la crise de sa doctrine socialiste ancienne, si vous voulez. Et donc elle a été à l'avant-garde de ça, mais vous vous rendez compte que... Si vous allez aux années 90-2000, ça s'étale dans la société, ça pénètre l'école, et ça pénètre l'État, ça pénètre beaucoup d'institutions, et la droite, et une partie de la droite, va aussi... va être prise aussi dans ce gauchisme culturel. Et pour moi, un certain nombre de lois sociétales, je ne peux m'empêcher de faire un lien même lointain. avec ce gauchisme culturel. Donc voilà l'évolution. Quand je parle de révolution culturelle 68-Arde, il faut prendre l'ensemble des séquences et voir comment, de 1968 ou même avant, jusqu'aux années 90, le résultat et les effets de cette révolution, on a du mal à l'admettre, sont, à mon avis, extrêmement importants. C'est pour ça que je n'hésiterai pas à parler de faire des rapprochements avec ce 89. Ce n'est pas du tout la même chose, mais du point de vue des effets, L'effet fondamental, d'une part, c'est la rupture de la transmission. Il y a un moment donné où il y a rupture dans la transmission. Et ce qui est quand même un peu, je vais dire, paradoxal, c'est que les premiers acteurs de 68 ont mis à bas l'héritage, alors que c'était des héritiers. C'était des héritiers rebelles, mais des héritiers quand même. Et le problème, c'est qu'ils ont laissé derrière eux un champ de ruines, si vous voulez. Et je prends souvent l'image suivante des jeunes générations qui vont venir après. C'est qu'ils sont dans un champ de ruines. C'est un peu comme s'il y avait, vous voyez, des pierres accumulées à droite à gauche. Je prends une pierre. Elle est verte, un peu d'écologie. Je prends une pierre, elle est rouge. Je les superpose comme ça. où je prends une pierre, elle est bleue à droite, si vous voulez. C'est le patchwork. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de colonne vertébrale ni d'idéologie structurée. Sur les ruines morcelées, vous reconstruisez le système patchwork. D'où d'ailleurs beaucoup de difficultés, un fossé des générations, qui je crois est peut-être plus important que celui de ma génération par rapport à mes parents ou nos générations antérieures. Pourquoi ? Parce que nous, j'étais, nous étions, une partie de ma génération, habités par un souci de cohérence même un peu fou à travers l'idéologie. Tout devait être cohérent, il y avait une cohérence entre ses paroles, dans la cohérence du langage, même très rigide d'une certaine façon. Mais là, on est passé carrément de l'autre côté. C'est-à-dire, le problème, c'est celui de la colonne vertébrale. Et donc, ce qui est très désarmant, c'est quand des génomes de génération vous posent la question, vous leur faites remarquer que ce qu'ils disent n'est pas cohérent, ils vous disent mais où il est le problème ?
- Speaker #1
C'est une sorte de pensée éclatée.
- Speaker #0
C'est une pensée éclatée. Je pense que d'ailleurs, Castoriadis, là-dessus, à mon avis, a saisi ça.
- Speaker #1
Lui parle même d'une mutation anthropologique.
- Speaker #0
Alors, mutation anthropologique... Je pense qu'il y a un type d'individualisme qui vient de loin. Je ne vais pas reprendre Tocqueville sur l'individualisme, avec ses deux faces. C'est-à-dire un désengagement par rapport aux appartenances premières qui existaient, où les ordres anciens, on se dégage comme individu, et ça, ça me paraît émancipateur. Mais de l'autre côté, vous avez une tendance de l'individualisme qui va s'accélérer. beaucoup, qui est un repli sur la sphère privée, et je veux dire, on pourrait presque dire un individualisme narcissique autocentré, qui va développer un rapport à l'institution, à l'État, très paradoxal. qui va demander à l'État qu'il réponde à ses besoins au plus vite, sinon c'est un agent de domination à son égard. Et c'est la logique des droits à. En même temps, c'est un agent d'oppression, mais je ne peux m'empêcher que de m'adresser à lui, si vous voulez. C'est un peu sous la logique du client révolté, mais client roi. C'est un peu ça.
- Speaker #1
Et sa disparition de l'intérêt collectif.
- Speaker #0
Alors le problème, oui, c'est cet individualisme, je l'appelle ça un individualisme radical, où il y a une forme de déliaison, si vous voulez, c'est ça.
- Speaker #1
Mais alors là-dessus, Castoriadis vous dirait, et là-dessus il est assez clair qu'il n'y a pas du tout d'individualisme aujourd'hui, il vous dirait qu'il y a plutôt du conformisme. et uniquement du conformisme.
- Speaker #0
Je vois pourquoi, parce que c'est l'individu qui a l'impression d'être absolument individu.
- Speaker #1
En fait, se comprendre comme une masse. Toutes différentes,
- Speaker #0
tous pareils. C'est un slogan publicitaire qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Toutes différentes et tous pareils. Chacun revendique son individualité, mais participe du même conformisme.
- Speaker #1
Et au fond, il n'y a pas d'individu.
- Speaker #0
Donc même le terme d'individualisme serait discutable. Je pense que... comment dire si je pense qu'il y a un individualisme narcissique auto centré c'est-à-dire que tout ce qui le transcende Et ça, ça fait partie de l'héritage impossible. Tout ce qui est extérieur à moi est un élément de domination à mon égard. Et il n'y a pas quelque chose qui me dépasse ou pour lequel je serais prêt à m'oublier. C'est ça, si vous voulez, ce type d'individualisme qui est très problématique du point de vue des rapports sociaux, j'allais dire. Il existe. Alors, en contrepoint, aujourd'hui, mais ça c'est une nouvelle étape, vous avez des replis communautaristes. Dans l'ère du vide face à cet individualisme, là où avant vous aviez par exemple l'idée de nation, qui existait et qui était un élément, à mon avis, pas simplement politique, mais anthropologique, on pourra en discuter, il y a une histoire d'une collectivité historique donnée.
- Speaker #1
Une classe même,
- Speaker #0
une classe sociale. Mais où les classes sociales, vous aviez tout ça à sauter, et dans ce cadre-là, vous avez à la fois cet individualisme radical, et en même temps un nouveau repli qui est le repli communautariste, avec un retour des fondamentalistes, tout ça dans cet air du vide. On l'appelait comme ça dans les années 80. L'Hipovetsky. Oui, l'Hipovetsky. Et le règne de l'insignifiance, d'une certaine façon. C'est dans ce creuset vidé, mais à la suite de cette révolution culturelle. Et je pense que... Alors, je viendrai à votre question du wokis. Il y a une nouvelle étape. Qu'est-ce que le wokis par rapport à tout ça ? Je pense qu'il y a des éléments de continuité, des éléments de rupture, si vous voulez. Pour moi, on pourrait le prendre comme vraiment les derniers feux de la comète. On pourrait le prendre comme ça. Mais les éléments de continuité, d'abord. D'abord, le wokisme, il y a un point, j'allais dire, sociologique, ça se développe où ? Le public est essentiellement étudiant et dans les facultés de lettres et sciences humaines. Or, il se trouve que le gauchisme des années 68, c'était aussi le public étudiant des sciences humaines. D'autre part, dans les formes d'action, notamment dans l'interruption. des cours. Par exemple, pour l'interdiction de parler, vous aviez ça. Je revois l'espérance que j'ai eue à l'université de Caen, l'interruption des cours, l'interdiction de parler, etc. Donc vous trouvez ces formes d'extrémisme. On peut aussi y voir une logique de déconstruction, avec Derrida, avec aussi la référence à Foucault, etc. Mais je pense que, alors je vais venir sur les différences, mais disons il y a ces rappels formels. Quels sont les... Quelles sont les différences ? A mon avis elles sont très importantes. Pourquoi ? Parce que d'abord le contexte socio-historique n'est pas du tout le même. A l'époque, 68 et début 70, nous étions dans la période des Trente Glorieuses. Il y avait le sentiment de participer d'une dynamique historique d'émancipation. Le mouvement de la jeunesse n'était pas simplement en France, il était que nous nous sentions portés par un mouvement général d'émancipation. N'oublions pas aussi les guerres, la fin des guerres dites de libération nationale avec le Vietnam, etc. Donc on avait le sentiment d'être portés par l'histoire. Aujourd'hui... Vous n'êtes plus porté par l'histoire. L'histoire, elle semble complètement en panne.
- Speaker #1
C'est discutable parce que de l'intérieur, les woke donnent l'impression de vivre une très grande aventure mondiale. Les woke d'un côté, les décoloniaux, sur les questions de genre, sur les questions de race, sur les questions de religion, ils ont l'impression d'appartenir. a un très grand mouvement. Et pour le coup, les franges musulmanes du wokisme, on l'a pour le coup entièrement raison. Elles sont dans le sens de l'histoire.
- Speaker #0
Je n'en suis pas persuadé, parce que je vais vous dire, nous-mêmes, quand j'étais dans les années 70, nous avions l'impression que le monde entier tournait autour du mouvement étudiant. Le monde entier. Je ne me demande pas s'il n'y a pas une illusion, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps.
- Speaker #1
C'est une illusion, mais ils en sont persuadés.
- Speaker #0
Quand vous êtes dans l'aquarium, dans la bulle, sur le campus, je raconte ça dans mon dernier ouvrage, on était sous cloche, et on était persuadés que la société nous suivait. On était dans l'idéologie.
- Speaker #1
Là, c'est une similitude, je pense.
- Speaker #0
Alors là, il y a un point commun, si vous voulez. Mais l'autre point commun, les ouvriers ne nous suivaient pas. La masse de la population ne nous suivait pas. Elle était ailleurs, mais on ne voulait pas le voir. Et je pense qu'il y a un phénomène aussi commun chez les Waukes. Mais alors, quand même, il y a quand même des points différents. Je vous parlais de la situation de l'époque, mais il y a aussi quelque chose qui allait avec, c'est le sentiment d'être porté par une dynamique historique dans les années 60, début 70. Eh bien, d'une certaine façon, il allait de pair avec beaucoup de transgressions, mais j'appelle ça des transgressions jubilatoires. C'est-à-dire que, bizarrement, on transgressait, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à transgresser, il y avait encore des interdits, des tabous. Donc il y avait une dynamique même de la transgression, y compris si cette transgression comportait des dimensions nihilistes. Elle en comportait, mais bizarrement, elle était joyeuse. Ça, c'est un truc qui est très difficile à comprendre pour les jeunes générations. Les Wokes sont, excusez-moi, sont sinistres. Il n'y a pas un poil d'humour. C'est des gens qui sont extrêmement ennuyeux, même quand ils contestent. Ils se prennent au sérieux et ils ont une dimension morale que nous n'avions pas. Nous étions presque des nihilistes actifs joyeux, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Là, j'ai affaire à autre chose, à un nihiliste que j'appellerais d'affaissement. Il n'y a plus l'utopie qui pouvait nous porter, il n'y a plus la dynamique historique. qui pouvait nous porter. Il y a une logique de déconstruction et il n'y a rien à mettre à la place. On est dans une vision très sinistre où on n'en finit pas de déconstruire et de dénoncer pas simplement les inégalités, les discriminations. Et c'est un mouvement qui va... Alors l'avenir de ce mouvement, si vous voulez, moi je pense que... En France, il est important dans les universités, mais il y a un problème, c'est l'écho qu'ils rencontrent dans un certain nombre de médias et les réseaux sociaux par rapport à la réalité de l'ensemble de la société française. Je n'ai pas vu en France beaucoup de statuts, par exemple, déboulonnés. Il y en a eu peut-être, je ne sais pas, mais très peu. Et ils ne se rendent pas compte, nous parlions, ils vivent dans leur milieu, ils ne se rendent pas compte que la société, la masse de la société est ailleurs. Simplement, le... Le problème qu'il faut se poser, c'est pourquoi les élites qui sont dans les institutions et pourquoi notamment les médias leur donnent une telle place. Il y a une disproportion médiatique, je dirais presque politique par certains, entre la réalité de ces woke ou de ces gauchistes post-modernes, on va dire, ce qu'ils représentent vraiment est la surreprésentation qu'ils ont dans les médias. La vraie question des woke, c'est pourquoi les élites ont cédé si facilement.
- Speaker #2
Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Jean-Pierre Le Goff, la révolution culturelle de 1960 à 1990. Rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie de l'entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site heretico-pluriel.fr. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.