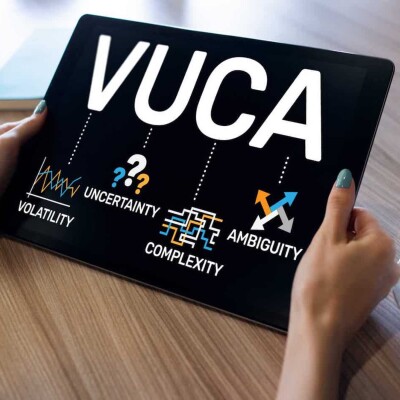- Speaker #0
Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts sur le management d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous ! Si vous avez écouté notre épisode sur le management VUCA, vous savez déjà que le monde dans lequel nous évoluons est profondément instable. Aujourd'hui avec Francis, on pousse le curseur un cran plus loin. On ne va pas seulement chercher à tenir le cap malgré les tempêtes, on va apprendre à en sortir renforcé. Inspiré des travaux de Nassim Taleb, Le management antifragile n'est pas une méthode miracle, mais une posture audacieuse. Bonjour Francis. Bonjour. En préparant cet épisode, tu me disais que plus les entreprises cherchent à protéger leurs collaborateurs, plus ils les rendent fragiles et qu'il faut les stresser un petit peu. Cette idée est à contre-courant de tout ce qu'on entend en entreprise et peut-être même de l'idée de bien-être en entreprise. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ?
- Speaker #1
Oui, alors moi j'observe un... espèce de paradoxe d'un côté les entreprises et les salariés d'ailleurs sont très anxieux d'être dans un environnement totalement instable imprévisible, un peu comme dans le VUCA et de l'autre côté on continue encore à prendre des mesures de protection de renforcement du bien-être et si l'on écoute et si l'on considère les propos de Taleb, vouloir justement apporter du confort et du bien-être ne permet pas de bien vivre les crises donc la question qu'on doit se poser c'est Merci. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que le plus important, c'est de bien vivre les crises et auquel cas, est-ce qu'apporter du confort est une solution ? Ou est-ce que le plus important, c'est que les salariés soient heureux et soient bien et du coup fragiles lorsque les crises arrivent ? C'est vrai qu'on est dans un pays où on a plutôt tendance en ce moment à être focus sur le bien-être. Je pense que c'est une bonne chose. Mais un paradoxe, c'est que du coup, on crée des zones de confort qui fait que quand l'inconfort arrive, on n'est pas du tout à l'aise.
- Speaker #0
Alors en parlant d'être plus à l'aise... avec les crises. Tu me disais également que les Français n'ont aucun problème à générer du chaos. Par contre, ils n'aiment pas du tout le subir, le chaos.
- Speaker #1
C'est un espèce de paradoxe dans notre pays, parce qu'on est quand même réputé pour être le pays des grèves. Je remarque que les Français n'ont aucune difficulté au nom de la liberté de pouvoir générer du chaos. On l'a vu avec notamment les Gilets jaunes ou toutes les grèves qu'on peut voir à Ausha droite, on est un petit peu habitués. Mais d'un autre côté, ils ne supportent pas avoir... trouve injuste et anxiogène des crises qui sont initiées à l'extérieur. Par exemple, on l'a vu avec la pandémie ou la guerre en Ukraine ou récemment l'élection de Donald Trump. Donc, on n'a pas de problème à générer des crises au nom de nos droits individuels, mais on n'aime pas du tout vivre des crises qui nous sont imposées par notre environnement. Et pourtant, une entreprise fait partie d'un environnement, donc elle doit apprendre aussi à évoluer dans un contexte chaotique et composé de crises qui se succèdent et qui s'entremêlent en plus.
- Speaker #0
Ok, mais pourquoi les Français en particulier ont du mal avec la crise qui leur a imposé ?
- Speaker #1
C'est vrai qu'on n'est pas à l'aise avec les crises. Il y a plusieurs raisons, moi j'en ai retenu trois. La première, c'est la pensée cartésienne qui est très très prégnante en France, qui nous dit que pour résoudre un problème, il faut d'abord avoir analysé le problème. C'est ce que nous invite à faire Descartes, avec son doute méthodique qui part du principe posé que je ne peux trouver la solution qu'après avoir compris le problème. Sauf que quand on a affaire à une succession de crises, on ne comprend pas le problème. Donc du coup, ça sous-entend qu'on ne pourra pas trouver de solution tant qu'on ne l'aura pas compris. Et ça, ce n'est pas une bonne manière de procéder dans un monde dans lequel on est. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est plutôt par rapport à la pensée de Nietzsche qui nous dit qu'il y a une tendance que peuvent avoir les êtres humains, et en France c'est assez présent, c'est ce qu'il appelle l'outre-monde. C'est-à-dire que lorsque l'on vit une crise, on peut se dire que cette crise n'est pas normale, ne devrait pas être... en état, et donc ce qu'on appelle le devoir-être, et ça provoque un espèce d'état d'esprit où encore une fois on va attendre, parce qu'on considère que cette crise ne devrait pas exister, et on va attendre que ça passe. Or ça passe pas. Et le troisième point qui me semble propre à la France aussi, c'est ce côté, et c'est la raison pour laquelle je pense que Taleb a raison en disant qu'il faut s'entraîner un petit peu au stress, la troisième raison c'est que lorsqu'il se produit une crise dans notre pays, la première réaction des français c'est d'aller chercher le coupable, Et en général, le coupable, il est assez désigné rapidement, c'est l'État, ce sont nos représentants. 68% des Français considèrent qu'en cas de crise, c'est au gouvernement de trouver des solutions. Donc, je n'accepte pas la crise, je cherche un coupable, j'attends qu'il trouve la réponse. Et ça, c'est l'héritage que nous avons de notre monarchie, de la centralisation du pouvoir, un peu de Napoléon, voire de De Gaulle, qui a instauré un État en disant, vous inquiétez pas, nous on va trouver la solution. C'est une espèce de quoi qu'il en coûte, si ça te rappelle quelque chose. Donc... L'inconvénient, c'est que pendant ce temps-là, les citoyens sont attentistes, ils ne bougent pas, ils attendent que l'État et ses représentants trouvent des solutions. Et en plus, il y a une autre particularité, c'est quand ils ont trouvé des solutions, mais il est critique, parce qu'il ne leur fait pas confiance. Donc on voit bien qu'en France, la crise est quelque chose de relativement mal vécu, pour ces raisons-là, puis il y en a d'autres encore qu'on va développer, ce qui laisse à penser que nous avons à apprendre de la manière dont nous pouvons mieux vivre, et surtout, c'est l'intérêt d'Antifragilité de tirer parti et profiter des crises que nous vivons.
- Speaker #0
Alors j'entends que les Français ont un état d'esprit particulier par rapport à la crise. Pour autant, français ou pas français, quelles sont les différentes réactions ? Comment on réagit à une crise ?
- Speaker #1
On pourrait dire qu'il y a quatre types de réactions par rapport à une crise. Vous avez la première, qui sont des entreprises que l'on pourrait qualifier de fragiles, qui part du présupposé que le monde doit rester sous contrôle. Donc l'idée, c'est que nous devons garder le contrôle. Donc le réflexe managérial que nous avons, c'est de tout verrouiller, d'éviter les erreurs. On considère le risque comme étant une menace absolue qu'il faut absolument éviter. Et quand on la rencontre, on est un petit peu paralysé parce qu'on n'est pas prêt, on a tendance à vouloir la fuir, avec une croyance qui est qu'il ne faut pas dévier de ce qu'on a prévu parce que c'est trop risqué. Quand on est dans ce type de culture-là, selon Taleb, on est fragile. La crise peut nous faire vraiment du mal. Ensuite, vous avez une autre manière d'appréhender la crise. Une autre catégorie d'entreprise qu'on appelle les entreprises résilientes, en tout cas le management résilient plus précisément, qui part du principe que le monde est instable mais c'est temporaire, avec l'idée derrière de résister et d'essayer de retrouver un retour à la normale. Donc l'objectif c'est d'encaisser les chocs pour rebondir et principalement essayer de retrouver ce qu'on a perdu. Puis dernièrement on a travaillé aussi sur l'entreprise ou le management robuste. Alors là c'est un peu différent, c'est pas la résilience, mais ça y ressemble quand même. qui dit que le monde est incertain, mais c'est tolérable. C'est un peu du Rocky Balboa. On va apprendre à se prendre des coups, et puis après ça va aller mieux. L'idée c'est d'encaisser, mais on ne change pas ce qu'on fait. Du coup, l'objectif c'est de tenir coûte que coûte. On va résister, mais on ne va pas se remettre en question, et du coup on ne va pas tirer profit de la crise. L'antifragilité, c'est une quatrième posture, qui est nouvelle. D'ailleurs, Taleb ne parle pas de management antifragile, il parle d'antifragilité. Donc moi, j'ai trouvé ça intéressant de transposer au monde du management. Là, c'est un autre paradigme. Ça part de l'idée que le monde est chaotique, mais il est fertile. Ça veut dire que je peux tirer profit du chaos, je peux tirer profit de la crise. Les crises vont légitimer une transformation de l'entreprise, avec derrière une idée que pour pouvoir tirer parti de cette crise, il faut qu'on soit coutumier de la crise, il faut qu'on la fasse un petit peu sienne, il faut que ce soit une certaine normalité, et non pas... comme dans les trois précédents cas où on considère que la crise est anormale.
- Speaker #0
Donc si je résume, l'entreprise antifragile, c'est non pas une entreprise résiliente, mais une entreprise où on grandit dans le chaos.
- Speaker #1
Sans pourtant tout révolutionner, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas du tout d'aller dans des concepts tels que l'entreprise libérée ou l'entreprise opale qui prône l'autogouvernance, parce que quand on est en situation de crise, et on l'a vu avec le confinement, je pense, des entreprises libérées, il n'y en a plus beaucoup. Peut-être tout simplement parce qu'en temps de crise, les êtres humains ont besoin d'être rassurés. Et en général, celui qui rassure, ce n'est pas le copain, c'est l'autorité. Donc le concept d'antifragilité n'est pas de remettre en question les modes de management, ni même les organisations. C'est plus d'acculturer une nouvelle forme de rapport à cette incertitude et à tout ce qu'on a vu dans le monde Vika.
- Speaker #0
En quoi, selon toi, aujourd'hui, l'antifragilité est un concept qui est transposable au management ? Et sur quoi il repose ?
- Speaker #1
En fait, à la lecture de cet ouvrage, je me suis dit qu'il y avait trois principes qu'évoquait Taleb, et il en évoque d'autres, mais en tout cas, c'est trois qui pourraient être intéressants en termes de management, qu'on dénonce un peu barbares, parce que le premier, ça s'appelle l'asymétrie favorable, donc je vais expliquer un peu ce que c'est. Le deuxième, il est pire, ça s'appelle l'hormèse organisationnelle, donc je suis allé voir dans le déco ce que ça voulait dire. Le troisième était un peu plus simple, ça s'appelle mettre sa peau en jeu. Avec ces trois principes-là, on peut vraiment se l'approprier en termes de management pour... permettre aux entreprises et aux salariés d'être plus à l'aise lorsqu'ils vivent des crises.
- Speaker #0
Très bien. Alors, on va commencer par la première barbarie, l'assimétrie favorable. De quoi on parle, Francis ?
- Speaker #1
Pour Taleb, il y a deux types d'assimétrie. Il y a l'assimétrie favorable et défavorable. L'assimétrie favorable, c'est essayer d'initier des actions qui ne coûtent pas beaucoup, mais qui peuvent rapporter gros. Concrètement, ça voudrait dire... Je suis une entreprise, je consacre un budget de 100 000 euros, dont la vocation sera de permettre aux salariés de prendre des initiatives, de faire preuve un peu d'audace, mais je pars du principe que j'ai déjà perdu les 100 000 euros, et que le pire qui puisse m'arriver c'est d'avoir Jackpot, et de laisser le reste de l'entreprise fonctionner comme elle est habituée de fonctionner. Et l'exemple qui est donné, que je trouve intéressant, c'est, il dit, puisque c'est un ancien boursier, Taleb, il nous dit, c'est comme si vous aviez un portefeuille d'actions, vous mettez 10% dans des actions à haut risque, au pire vous perdez, au mieux vous êtes millionnaire, et 90% de vos actions sur des valeurs un peu plus sûres. Donc ça, ça se traduit dans les pratiques, il y a une entreprise qui le fait pas mal, il y en a beaucoup, il y a eu dans un premier temps Google. Google qui dédie un budget dont la vocation c'était de permettre aux salariés d'expérimenter des nouveaux projets, des nouveaux sujets. C'est de là que sont les Google Earth et d'autres choses. Il y a aussi une pratique qui est adoptée chez Amazon, que je trouve intéressante, qui s'appelle les One Widers. Je traduis en français, c'est les portes à sens unique. C'est-à-dire que Bezos dit, voilà, il y a deux types de décisions. Il y a des décisions qui doivent être prises par la direction générale parce qu'elles sont lourdes de conséquences et on ne pourra pas revenir en arrière. Donc ça, ça reste dans le périmètre de la hiérarchie traditionnelle. Et puis il y a une deuxième prise de décision qu'il appelle les portes à double sens, où là ce sont des décisions qui sont confiées aux collaborateurs, et on va leur laisser la latitude totale d'expérimenter des nouvelles idées. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on les protège, on les rassure, parce qu'au moins ils ont essayé, et si ça marche, à ce moment-là, c'est jackpot pour l'entreprise et pour le collaborateur. C'est d'une certaine manière aller dans cette logique de sérendipité. La sérendipité, c'est trouver des trucs qu'on n'imaginait pas. Et ça nécessite de la part du management d'être vraiment dans une culture de l'autorisation, voire de l'incitation à prendre des risques, à tenter des nouvelles choses. Parce que de toute manière, comme on part du présupposé qu'on a déjà perdu, ce n'est pas grave.
- Speaker #0
Donc l'assimétrie favorable, c'est s'autoriser à investir dans des activités, dans des possibles à haut risque et de perdre éventuellement son investissement. Et le deuxième principe, l'hormèse organisationnelle, c'est quoi cette bête-là ?
- Speaker #1
L'hormèse organisationnelle, il y a deux choses. Il y a hormèse, hormèse, ça vient du latin hormesis, qui signifie stimulation, mettre en mouvement. L'idée, c'est de stimuler un organisme. Organisationnelle, c'est stimuler l'organisation. Alors, qu'est-ce que l'hormèse organisationnelle selon Taleb ? C'est un principe de biologie qui consiste à provoquer des micro-agressions pour renforcer l'organisme. C'est exactement ce que l'on vit quand, par exemple, on a un vaccin. Quand on se fait vacciner, c'est une microagression, c'est l'injection d'un petit virus. C'est la même chose quand on fait du sport aussi, voire quand on jeûne. C'est-à-dire qu'on va malmener l'organisme pour justement lui permettre de se renforcer. Et donc ça, c'est assez intéressant. Et du coup, ça va à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que l'idée, c'est comment peut-on imaginer agresser un petit peu ? Alors l'idée, c'est pas de les faire souffrir, les salariés, mais... C'est juste de les entraîner au stress. Parce que si on n'est pas habitué au stress, quand la crise arrive, là on est complètement démuni et on devient fragile.
- Speaker #0
Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on cherche systématiquement à diminuer son stress et toi tu nous dis qu'il faut s'entraîner au stress. Pourquoi ?
- Speaker #1
Je vais prendre un exemple. L'idée de l'entraînement au stress, c'est de bien vivre les crises et de ne pas stresser, en tout cas de moins stresser lorsqu'elles arrivent. Je vais prendre quelques exemples. On prend l'exemple de deux amis. Il y en a un qui est dans une bonne situation, qui est dans une entreprise, qui a une belle petite famille, adorable, tout est sous confort, tout est contrôle. Et puis il a un autre ami qui lui est plutôt chauffeur de taxi. Ses journées, il ne peut pas les maîtriser, il ne peut pas les planifier, il est dans l'instabilité permanente, il rencontre des problèmes tout au long de la journée. Quand la crise arrive, il est évident que le chauffeur de taxi sera beaucoup plus à l'aise parce qu'il est habitué. que ce cadre supérieur qui peut même être licencié. Et là, dans ces cas-là, tout est remis en question, ce qui ne sera pas le cas avec le chauffeur de taxi, parce que comme il est habitué à ces micro-crises-là, il va peut-être mal le vivre, mais en tout cas, il va rebondir très très vite. C'est d'ailleurs ce que nous précise Taleb en nous disant que face à une crise, il y a deux types de réactions selon son statut social. C'est-à-dire que si vous êtes salarié, surtout en France, vous êtes protégé, vous n'êtes pas préparé à vivre cette situation-là, et donc vous allez mal le vivre. Non seulement vous n'êtes pas préparé, mais en plus vous allez vous plaindre parce que quand on est salarié notamment en France, le pire qui puisse nous arriver, je m'en excuse, c'est peut-être pas corporate, mais c'est de toucher les allocations chômage. Ce qui n'est pas le cas de l'indépendant. Lui, il risque de perdre son entreprise. Donc on voit bien qu'en fonction de son statut, on va avoir une réaction à la crise qui est complètement différente. Il y a un exemple qui est intéressant pour justement comprendre la nécessité de s'entraîner au stress. C'est un exemple de l'amérissage forcé qui a eu lieu dans l'autorne le 15 janvier 2009. Si on s'en souvient, avec l'Airbus A320 de l'US Airways, où le commandant de bord, donc Sinenberger, qui, au décollage de la Guardia, a été confronté à un vol d'oiseau qui sont venus percuter leur moteur. Là, il avait une décision à prendre. Et ce qui est intéressant, c'est la prise de décision, parce qu'il avait à peu près 4 minutes pour prendre une bonne décision. Soit retourner à la Guardia, et c'est d'ailleurs ce qu'ont mis en avant les simulations, soit d'amérir dans l'autorne. Donc il a pris la deuxième décision, ce qui lui était reproché dans un premier temps. Et quand on a commencé à lui dire, maintenant que vous avez pris la mauvaise décision, vous auriez pu avoir le temps de retourner à l'aéroport. Il a dit, mais attendez parce que dans votre simulation, il va falloir que vous preniez la dimension humaine. A savoir, quand on est dans une situation de crise, on a des émotions, on a du stress, tout ça, ça prend du temps. Donc j'ai pris la décision d'amérir. finalement il a pris la bonne décision et s'il a pris cette bonne décision c'est parce que c'était un pilote qui avait vécu tout un tas de situations de crise et c'est ce qui fait que son cerveau il était habitué qu'il n'a pas vraiment réfléchi, il savait qu'il fallait le faire.
- Speaker #0
Instinctivement finalement.
- Speaker #1
Voilà, c'est à dire que la neurosciences nous apporte comme information que plus vous allez vous entraîner dans des situations de stress, plus le cerveau va apprendre quand la situation de stress arrive, c'est plus le néocortex qui prend le dessus, donc c'est plus la réflexion, c'est l'instinct. Et c'est aussi ce qu'a révélé un pompier, Mike Kiyo, qui a été photographié en train de remonter les escaliers des immeubles qui étaient en train de s'écrouler lors des attentats du 11 septembre 2011. Quand on l'interrogeait, il dit « Ben non, moi je ne suis pas héros, bien évidemment j'avais peur, comme tout le monde, mais comme j'ai été entraîné, je n'y ai pas réfléchi. » Et c'est un petit peu ça l'idée de l'hormèse organisationnelle, c'est d'entraîner le cerveau à des situations chaotiques ou de crise pour que le moment où ça arrive, Il y ait moins de peur, parce qu'il y a toujours de la peur, mais qu'on compose avec. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est vécu avec les militaires. Les militaires s'entraînent tout le temps pour justement que le jour où un conflit émerge, il soit préparé.
- Speaker #0
Très bien, donc l'hormèse organisationnelle, c'est comment s'entraîner pour être prêt, même si on a peur en cas de crise, à avoir les bons réflexes finalement. Et le troisième pilier consiste à mettre sa peau en jeu.
- Speaker #1
Oui, alors Taleb appelle ça mettre sa peau en jeu parce qu'il considère que nul ne devrait avoir le pouvoir de décider pour les autres s'il n'est pas lui-même exposé aux conséquences de ses choix. Ça veut dire que dans le milieu de l'entreprise, il n'y a pas de corrélation directe entre mes actes et les conséquences de mes actes. Ce que dit Taleb n'est pas à nouveau, Max Weber le disait déjà en son temps, puisqu'il opposait deux éthiques, l'éthique déontologique et l'éthique de responsabilité. L'éthique déontologique, ça consiste à prendre des décisions sur la base de ses valeurs, de ses principes, quelles que soient les conséquences. Et l'éthique de responsabilité, c'est prendre des décisions avant tout en fonction des conséquences que ça va avoir. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte que si on prend deux codes, le code du travail et le code pénal, le code du travail, il est fondé sur l'éthique déontologique, c'est-à-dire qu'il va soutenir des droits inaliénables comme L'égalité homme-femme, comme les organisations syndicales, on n'y touche pas, quelles que soient les conséquences dans la relation. Alors que ce n'est pas le cas dans le droit pénal, par exemple. Dans le droit pénal, on va plutôt être sensible sur l'éthique de responsabilité. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que quelle que soit la raison de l'acte que tu as commis, mettons, si ton mari ou ta femme t'a trahi, ça ne légitime pas et ça n'excuse pas le fait que tu lui aies coupé un bras. C'est un peu sordide, mais c'est juste pour imager. Un peu sordide, oui. Et du coup, nous, on va juger en droit pénal la conséquence de l'acte, alors qu'en entreprise, on va plutôt juger la déontologie de l'acte. Et ce que rappelle Taleb, c'est qu'il faudrait pour que les personnes soient plus à l'aise en situation de crise, qu'il y ait un meilleur lien entre ce que je fais et la conséquence de ce que je fais. Ce que dit Taleb, et ce que je trouve intéressant pour le monde de l'entreprise, c'est que... Je peux prendre des décisions, quel que soit mon statut en entreprise, et ça n'aura aucun impact sur ma vie perso. A titre d'exemple, on peut citer l'exemple de Jean-Marie Messier, si certains s'en souviennent. Il a quand même fait perdre 30 milliards d'euros au groupe Vivendi pour partir avec un parachute doré de 20 millions d'euros. A l'époque, ça avait scandalisé tout le monde.
- Speaker #0
Alors très bien, tu parles justement de responsabilité. Et justement, un récent sondage fait état du fait que 87% des salariés demandent aujourd'hui plus d'autonomie au travail, et seuls 34% cherchent à avoir plus de responsabilités. Comment est-ce que tu expliques ce phénomène en France ?
- Speaker #1
Il y a un phénomène qu'on appelle l'étage antique en psychologie sociale, qui dit qu'à partir du moment où je te demande de respecter une instruction, je t'enlève ton libre-arbitre, et donc c'est totalement légitime de considérer que la personne estime que comme elle n'a pas participer à la définition de ce qu'elles devaient faire, elles ne s'en sont pas responsables, et elles ne doivent pas, même d'ailleurs, inventer la responsabilité. Ça, c'est le premier point. Il y a une deuxième théorie ici qui est intéressante, qui est la théorie de l'engagement de Kisler, qui dit que, pour répondre de ses actes, il y a trois critères qui doivent être réunis. Le premier critère, on vient d'en parler, c'est le libre-arbitre, c'est à dire je réponds des mêmes actes si j'en suis à l'origine Il y a aussi un deuxième critère qui est l'importance. Je réponds dans mes actes s'ils sont importants pour moi. Il y a un autre critère qui est important mais qu'on n'évoque pas beaucoup, c'est la déclaration publique. C'est-à-dire que je réponds dans mes actes si je l'ai déclaré publiquement. Donc on se rend compte que plus je vais déclarer un engagement, une intention au plus grand nombre, plus je me sentirai obligé d'assumer la responsabilité de mon engagement. Ce qui ne va pas tellement dans le sens de ce que l'on connaît aujourd'hui, où on a plutôt tendance à fixer des objectifs dans un bureau en one-to-one. Donc ça c'est au niveau sociétal. On voit bien qu'on a un écosystème qui est assez infantilisant et pas du tout responsabilisant. Et puis après il y a les individus. Il y a des individus qui peut-être aujourd'hui considèrent que le plus important pour eux, c'est de trouver leur équilibre de vie, et à ce titre-là, pouvoir bénéficier de davantage d'autonomie. L'autonomie, c'est laisser moi la capacité de m'organiser comme je le veux pour atteindre votre résultat. Mais il faut une contrepartie parce que si moi, employeur, je te laisse la latitude de t'organiser comme tu veux, je veux quand même avoir une garantie que tu respectes ton engagement, donc tu réponds de tes actes. Et là-dessus, on a vraiment du progrès à faire parce que l'autonomie, oui, mais pas sans responsabilité. Donc, il faut vraiment renforcer la responsabilisation des collaborateurs au sein des entreprises. Et on voit bien que dans notre système, ça ne marche pas bien. parce qu'il suffit juste d'aller du côté du code du travail. Le code du travail ne dit pas que les salariés sont responsables. Il considère que c'est l'autorité qui est responsable. Ça s'appelle le lien de subordination unilatéral hiérarchique qui dit que quoi qu'il se passe, c'est l'autorité et ses représentants, donc les managers, qui sont responsables de tout. Et donc ça devient difficile de mettre sa peau en jeu quand on est dans un écosystème qui a plutôt tendance à déresponsabiliser le salarié. Alors que Taleb nous dit, si vous voulez vraiment bien vivre les situations de crise, il faut que vous soyez davantage impliqué, concerné, engagé et responsable. C'est à cette condition que vous allez vous approprier progressivement les conditions d'une certaine sérénité quand la crise viendra.
- Speaker #0
C'est peut-être aussi une des raisons qui justifient qu'on ait de moins en moins de personnes qui veulent devenir manager, parce qu'ils doivent porter non seulement la responsabilité de leur poste et de leur rôle, mais peut-être aussi les responsabilités non prises par leurs équipes.
- Speaker #1
Oui, c'est pour ça que le management est de moins en moins attractif. C'est-à-dire que non seulement je dois assumer ma responsabilité à moi, mais en plus je dois assumer la responsabilité de l'autre qui ne veut pas être responsable. Ça devient un peu cordélien. C'est pour cela que je défends depuis quelques années l'idée de la co-responsabilité. Moi je dis toujours que dans une relation à deux, on est trois. Donc si ça ne va pas avec quelqu'un, j'ai trois leviers d'action. Soit je peux agir sur moi et donc changer un peu le système et ça dépend que de moi. soit je peux agir sur la relation que j'entretiens avec l'autre, ma manière de communiquer, et ça je peux le faire, c'est dans mon pouvoir d'action, mais je ne peux pas agir sur l'autre. Donc l'autre a sa responsabilité, il faut la lui laisser, et je ne pense pas qu'un manager ait pour responsabilité d'assumer la responsabilité de quelqu'un qui ne veut pas l'assumer. Je ne sais pas si je suis clair, parce que des fois quand je parle, je ne suis pas très clair.
- Speaker #0
Je crois que tout a été résumé au départ. Prendre la responsabilité qui ne sont pas les siennes, ça commence à devenir compliqué. En résumé, le management antifragile repose sur trois principes prioritaires. 1. Prendre des risques, mais mesurés. 2. Entraîner les équipes au stress, pour qu'elles soient prêtes le jour J. 3. Être courageux et répondre de ses actes.
- Speaker #1
C'est cela. En fait, on se rend compte que s'engager dans un management antifragile, tel que c'est nommé, c'est changer un peu la culture d'entreprise. Concernant la symétrie favorable... Le rôle du manager, c'est vraiment de soutenir ses collaborateurs dans les initiatives, dans la prise de risque et de les protéger. Quand on est dans leur messe organisationnelle, son rôle c'est de les entraîner, de les préparer à des crises, par des mises en situation par exemple, et de voir en quoi elles sont à l'aise ou pas à l'aise, et trouver des actions pour qu'elles soient plus à l'aise, et ne pas attendre le moment de la crise. Et puis concernant le fait de mettre sa peau en jeu, c'est peut-être d'évoluer d'une relation parent-enfant qu'on connaît bien. à une relation adulte-adulte, ce qui sous-tend d'inviter et de soutenir des collaborateurs qui veulent plus de responsabilités. Peut-être laisser les autres si ils n'en veulent pas, puisqu'on a vu qu'il n'y en avait finalement pas beaucoup. Mais en tout cas, le fait de s'engager dans cette dynamique-là va permettre à l'entreprise d'être beaucoup plus à l'aise, alors que le management traditionnel a plutôt tendance à vouloir l'éviter, ces crises-là.
- Speaker #0
Tu le disais, ce n'est pas une nouvelle forme de management, mais c'est une nouvelle façon de... poser le regard sur le management qui demande de vrais changements. Tout ça pour quoi ? Quels sont les bénéfices de faire ce pas de côté ?
- Speaker #1
Quand on s'approprie ce type de management, on se rend compte qu'il y a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est de s'apercevoir qu'il y a peut-être des rôles qui, en fait, sont inutiles et inadaptés. Vous avez aussi le rapport à l'erreur. Il y a l'échec qui peut être intéressant, puisqu'on va inviter les collaborateurs à prendre des risques. Quand on prend des risques, on fait des erreurs. On est plutôt sur une logique de valorisation positive de l'erreur. On met un peu de côté la responsabilité uniquement sur les épaules des managers et de donner la parole à ceux qui sont le plus proche du terrain parce que ce sont eux qui vont vivre ces moments-là, ce sont eux qui vont vivre le plus d'anxiété. Donc c'est vraiment de leur permettre de trouver un peu de sérénité lorsque les crises successives arrivent et peut-être aussi valoriser les prises de risques qui sont importantes en temps de crise alors qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à valoriser la conformité et l'évitement des erreurs.
- Speaker #0
Est-ce qu'aujourd'hui finalement il existe déjà des entreprises qui ont mis en place ce type de management antifragile ?
- Speaker #1
Il y a déjà des entreprises qui sont assez acculturées avec ce type de management, même si ce n'est pas le terme qu'ils connaissent. Je vais prendre par exemple Decathlon. La particularité de cette ancienne, c'est que les directeurs de magasins disposent d'une large autonomie sur la stratégie locale. L'intérêt, c'est que comme ils ont cet espace de liberté, ils voient le lien direct entre ce qu'ils font et l'impact que ça a sur l'entreprise. Vous avez Michelin aussi, qui a plutôt tendance à associer les collaborateurs à la préparation et à l'analyse des décisions. Là, on passe d'une relation « je subis la décision » à « j'ai contribué à ce choix, donc du coup je m'en sens plus responsable » , ce qu'on a évoqué un peu tout à l'heure. Et puis chez Beubla Car, vous avez des espaces d'expérimentation protégés qui sont instaurés, qui s'appellent les safe zones, où les collaborateurs sont invités à tester des idées en dehors des enjeux opérationnels. C'est fait de telle manière que s'ils font des erreurs, ils sont protégés. Et c'est ce qui leur permet justement de s'acculturer à ce que moi j'appelle la valorisation positive de l'erreur.
- Speaker #0
Merci beaucoup Francis. Finalement, loin des recettes toutes faites, ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est une invitation à penser et à diriger autrement. Pas en espérant un retour à la normale, mais en apprenant à grandir dans la normale. Il y en a qui l'ont déjà fait, donc c'est possible.
- Speaker #1
Tout à fait.
- Speaker #0
Merci beaucoup.
- Speaker #1
Merci.