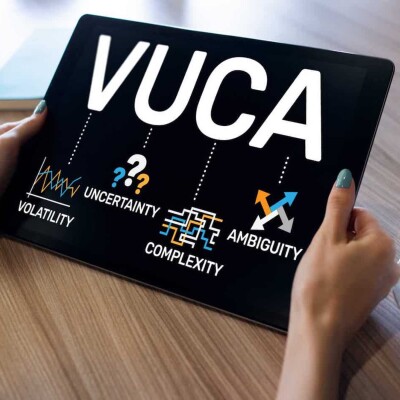- Speaker #0
Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts sur le management d'aujourd'hui et de demain. Avec Francis Boyer, ancien DRH devenu consultant, coach et conférencier en innovation managériale, nous vous invitons à faire un pas de côté pour repenser vos pratiques à la croisée de la sociologie, de la psychologie, de la philosophie des neurosciences et bien évidemment des pratiques du terrain. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast sur le management juste. Peut-on vraiment être un manager juste ? L'idéal de justice en entreprise est-il vraiment atteignable, notamment dans un monde vu cas qui est complexe et incertain ? Dans un monde du travail traversé par des attentes de plus en plus fortes de reconnaissance, de transparence, d'équité, cette question n'est plus seulement philosophique, elle devient stratégique. Bonjour Francis.
- Speaker #1
Bonjour Maria.
- Speaker #0
Un sondage de l'Ipsos souligne qu'en 1993, 54% des salariés considéraient que leur rétribution était proportionnelle à leur contribution. En 2022, ils ne sont plus que 39%, donc ils se sentent perdants. Comment peux-tu nous expliquer ce phénomène ?
- Speaker #1
Avant d'aller sur l'explication, je pense intéressant de bien différencier trois notions qui sont à peu près similaires en apparence, mais vraiment différentes dans les faits, les notions d'égalité, d'équité et de justice. Si on prend la notion d'égalité, ça vient du latin « equalitas » qui signifie « de même mesure ou quantité » . L'idée de l'égalité, c'est d'accorder les mêmes droits ou les mêmes ressources ou les mêmes opportunités à tous sans aucune distinction. Le principe d'équité est différent puisqu'il vient du latin « equitas » qui renvoie à la notion d'ajustement. Être équitable vise à tenir compte des différences individuelles afin que l'accès aux mêmes résultats soit possible. Donc on est plutôt dans une régulation ou un ajustement quand on a constaté une égalité. Par exemple, ça consisterait en entreprise à fournir un fauteuil ergonomique à un saraï qui souffre du dos alors que les autres ne souffrent pas de dos. La justice a une racine un peu différente puisqu'elle vient de justitia et ça évoque l'idée d'harmonie et de droit commun. Elle englobe non seulement l'égalité et l'équité, mais elle suppose aussi la mise en place de principes moraux ou juridiques pour trancher ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Pour bien comprendre ces différences, je vais utiliser une image qui est assez connue, qui tourne sur le net depuis un certain nombre d'années d'ailleurs. Au sein de laquelle vous avez trois personnages, vous avez un enfant, un adolescent et puis un adulte qui regardent un match de football, qui ont devant une barrière qui les empêche de voir convenablement le match de football. La première image consiste à attribuer à chacun un caisson de même taille. C'est égalitaire puisqu'ils bénéficient tous du même caisson, mais ce n'est pas équitable parce que l'enfant ne voit pas le match. C'est pour ça qu'il y a une deuxième image qui présente cette notion d'équité, qui consiste à redistribuer en fait des questions de manière à ce que tout le monde puisse voir le match de foot. Donc l'adulte qui est le plus grand, qui n'a pas besoin de ce caisson, va redistribuer le caisson à l'enfant pour qu'il puisse voir le match. Et sur la dernière image, on constate qu'il n'y a plus de barrière. Et c'est ça en fait le principe de la justice, c'est que la barrière qui était à l'origine du problème a été complètement supprimée. Donc contrairement à l'équité dont le but est de réparer une inégalité, la justice elle vise à transformer le système pour qu'il n'y ait pas d'inégalité ou d'inéquité.
- Speaker #0
Très bien, donc tu nous expliques aussi, Francis, que la justice n'est pas universelle, mais toujours relative à une culture, un contexte et une époque. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
- Speaker #1
On commence à rentrer gentiment dans le sujet, parce qu'on se rend compte que la justice est complètement relative, c'est un sentiment. Je vais prendre un exemple. Selon les pays, un même événement peut être considéré comme juste ou injuste. Si on prend par exemple la redistribution des richesses par l'impôt, vous êtes en Scandinavie, c'est considéré comme étant juste, puisqu'il paraît légitime que les plus riches redistribuent aux plus pauvres. En revanche, si vous prenez les États-Unis ou la France, cette mesure est perçue comme étant injuste et même une sanction de ceux qui gagnent de l'argent.
- Speaker #0
Finalement, est-ce qu'il est concevable d'imaginer une société totalement juste ?
- Speaker #1
Si on en croit Aristote, dans l'éthique Anicomax, ça paraît un peu compliqué puisqu'une société est toujours en train de chercher un juste équilibre entre ces deux notions, la notion d'égalité et la notion d'équité. Prenons l'exemple du système de santé français. En France, tout le monde bénéficie du même montant de remboursement des frais médicaux, sans distinction de revenu, quelle que soit sa classe sociale. Là, on est sur le principe d'égalité, mais en fonction d'actes, moi par exemple, je me suis fait poser des implants dentaires il n'y a pas longtemps, c'est beaucoup plus cher, et donc ça nécessite des dépassements d'honoraires. Ce qui est, d'une certaine manière, un peu inéquitable, parce que moi j'ai la chance de pouvoir le prendre en charge et j'ai une bonne mutuelle, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on est dans un système qui à la fois se veut égalitaire, mais qui en même temps est inéquitable. Et si on creuse un petit peu plus loin, ça peut être inéquitable du point de vue du chirurgien qui considère que ces déplacements non horaires sont justifiés compte tenu des études, compte tenu de l'investissement qu'il a fait. J'ai pris cet exemple juste pour illustrer le fait qu'une société ne peut pas être totalement juste car elle doit en permanence trouver un compromis entre cette notion d'égalité à savoir les mêmes droits et ressources pour tous, et d'équité, à savoir adapter les ressources aux besoins de chacun.
- Speaker #0
Donc tu nous dis que la société par nature est difficilement juste, mais est-ce qu'il y aurait des possibilités, et sous quelles conditions elle pourrait le devenir, d'après toi ?
- Speaker #1
Il y a une théorie qui est intéressante qui s'appelle le voile d'ignorance, qui a été proposée par le philosophe John Rawls, qui nous dit que pour qu'une société soit vraiment juste, il faudrait que les fondateurs ignorent complètement le rôle qu'ils joueront dans cette société. Ils ne devraient pas savoir si ce sont des hommes ou des femmes, s'ils sont d'origine modeste ou issus d'une famille riche ou qu'ils soient en bonne santé ou en mauvaise santé. Et on voit bien que ça me paraît difficilement réaliste parce que si on regarde un peu notre pays, ne serait-ce que les élections par exemple en France, si je suis de droite, je vais avoir tendance à construire une société de droite et si je suis de gauche, je vais avoir tendance à construire une société de gauche. Donc ça paraît assez utopique mais en tout cas ce qui est intéressant... c'est de s'interroger sur le niveau de neutralité des fondateurs. Et c'est ça, en fait, qui va faire que ça semble difficile de créer une société qui soit totalement juste. D'ailleurs, quand on y réfléchit, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement de savoir si on peut créer une société qui soit juste, mais plutôt d'essayer de comprendre ce que l'on peut faire pour la rendre la moins injuste possible.
- Speaker #0
Pour résumer, les sociétés dans lesquelles on vit sont difficilement justes. On peut prendre des décisions pour qu'elles le soient le plus possible, mais pour autant, les personnes qui vont avoir à subir ces décisions peuvent les ressentir comme étant injustes. Quel est l'impact, Francis, du sentiment d'injustice, commençons par l'injustice en entreprise ?
- Speaker #1
Le sentiment d'injustice est particulier parce que quand on ressent de l'injustice, ça active des zones du cerveau de la douleur, comme une douleur physique. Donc quand on vit une douleur physique, on n'a qu'une envie, c'est de ne plus souffrir. l'injustice en entreprise provoque ce sentiment qui est particulier, contrairement à des sentiments comme le manque de respect par exemple, où la personne qui se sent lésée veut obtenir réparation. Si elle ne l'obtient pas, elle va commettre des actes qui vont aller à l'encontre de l'entreprise, comme par exemple de la rétention d'informations ou des bruits de couloirs. Elle va faire tout ce qu'elle considère normal pour elle pour réparer le préjudice qu'elle considère avoir subi. Donc il faut faire très attention aux sentiments de justice et d'injustice en entreprise. Et à ce titre-là, il faut bien prendre conscience que dans l'entreprise, Même si on se veut égalitaire et équitable, ce n'est pas pour autant juste.
- Speaker #0
En tout cas, ce n'est pas vécu forcément comme étant juste par ses salariés. Et ça peut coûter cher à l'entreprise, de ce que j'entends.
- Speaker #1
Ça coûte très cher à l'entreprise parce que c'est un des rares cas où des salariés vont avoir des comportements qui vont être contraires aux intérêts de l'entreprise.
- Speaker #0
Dans nos échanges en préparation de ce podcast, tu m'expliquais également que parfois, certaines décisions que l'on peut prendre en entreprise... sous-jouent d'égalité peuvent créer de l'injustice.
- Speaker #1
C'est le paradoxe parce que d'un côté, les entreprises ont été conçues sur le principe d'égalité. Si on prend par exemple les conventions collectives, tout le monde a droit au même droit ou selon sa catégorie socio-professionnelle. Mais il faut différencier cette notion d'égalité des droits et d'égalité des chances. On peut avoir les mêmes droits, mais ne pas avoir la même chance de pouvoir y accéder. Je vais prendre un exemple. On décide de mettre en place au sein de l'entreprise la semaine de 4 jours. J'ai écrit un ouvrage sur le sujet. On fait voter les salariés sur leur désir de passer à 4 jours. Sur 30 salariés, moi je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, 29 disent oui, nous nous voulons passer à 4 jours. Et puis il y a une salariée qui dit non, moi je ne veux pas passer à 4 jours. Donc ça pose un petit problème décisionnel. Qu'est-ce qu'on fait ? Et quand on demande à la personne les raisons pour lesquelles elle nous dit je n'ai pas envie de passer à 4 jours, elle nous dit c'est simple, moi je n'ai pas envie de travailler plus longtemps parce que je dois aller chercher mon enfant à l'école à telle heure. et Quand on se met du côté de cette salariée, on peut considérer légitime de sa part qu'elle considère injuste que l'entreprise passe à 4 jours parce qu'elle ne l'a pas demandé. Mais quand on se met aussi à la place des 29 autres salariés, on peut assez légitimement considérer qu'ils estiment injuste de ne pas passer à 4 jours parce qu'il y a une personne qui ne le désire pas.
- Speaker #0
Finalement, garantir le même cadre à tout le monde ne produit pas les mêmes bénéfices pour tout le monde. Alors, si on allait un peu plus loin, est-ce qu'il faudrait prendre davantage de décisions qui soient équitables ? Est-ce que ça changerait la donne ?
- Speaker #1
On voit bien qu'adopter un mode de pensée qui se veut égalitaire entreprise produit l'injustice. On pourrait donc imaginer que la stratégie serait d'aller vers un principe d'équité. Mais malheureusement, l'équité aussi est source d'injustice.
- Speaker #0
Dans quel sens ?
- Speaker #1
Si on prend le principe de l'équité, l'objectif de l'équité, comme on l'a évoqué, c'est de réparer une inégalité. Je vais prendre un exemple très concret d'entreprise qui sont par exemple les quotas, des quotas de recrutement, qui sont des mesures qui se veulent équitables parce que par exemple si une entreprise se rend compte qu'elle n'a pas assez de seniors ou qu'elle n'a pas assez de femmes, elle va adopter une politique dont la finalité serait d'avoir un peu plus de femmes et un peu plus de seniors.
- Speaker #0
Les favoriser donc.
- Speaker #1
Voilà, et donc on va signer des accords au nom de l'égalité hommes-femmes, des seniors, etc. ce que font beaucoup d'entreprises. Sur le principe, ça se veut équitable, mais dans la pratique, c'est souvent perçu comme étant injuste, de la part même des deux populations. On va prendre par exemple les seniors, le fait d'avoir des mesures qui les concernent peut pour certaines personnes être considérées comme étant stigmatisées et n'acceptent pas l'idée qu'elles aient ce genre de privilèges, peut-être aussi par rapport au regard des autres. Et on peut aussi partir du principe que ceux qui ne bénéficient pas de ces mesures considèrent cette disposition comme étant injuste. Pourquoi toi qui as plus de 50 ans, tu as plus de droits que moi qui ai 30 ans ? C'est pas juste. On sait qu'en France, il y a deux tiers des Français qui considèrent les mesures ou toutes les actions antidiscriminatoires comme étant injustes. Donc on voit bien que l'égalité ne produit pas de justice, et quand on veut réparer l'inégalité et aller dans de l'équité, ça peut provoquer aussi des sentiments d'injustice.
- Speaker #0
Allons un peu plus loin. Un sondage qui a été publié en 2022 fait état du fait que 57% des salariés aujourd'hui en entreprise estiment ne pas être connus à leur juste valeur. Alors pourquoi, d'après toi ?
- Speaker #1
Alors là, on est encore sur un sentiment. Donc c'est important que les managers prennent vraiment conscience et intègrent les différents types de sentiments d'injustice qui peuvent être ressentis par les collaborateurs. Et à ce titre-là, moi j'aime bien utiliser la théorie de la justice organisationnelle de Greenberg qui dit qu'en fait, en entreprise et dans la vie en général d'ailleurs, Il y a trois sentiments d'injustice. L'injustice distributive, l'injustice procédurale et l'injustice relationnelle. Et ces trois sentiments, c'est important que les managers les prennent en considération, tout du moins les connaissent, pour essayer de faire en sorte qu'ils arrivent le moins souvent possible.
- Speaker #0
Est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans un premier temps qu'est-ce que c'est ce sentiment de justice relationnelle ?
- Speaker #1
On ressent le sentiment quand on considère qu'on n'est pas traité de la même manière que les autres. Je vais prendre un exemple. Si j'interviens à une réunion et puis que dans les débats de la réunion, je me rends compte que Paul... mon patron l'écoute tout le temps alors que moi, dès que j'essaye de parler, je suis totalement interrompu. Je vais considérer que je suis injustement traité et donc je vais extrêmement mal le vivre.
- Speaker #0
Le sentiment d'injustice relationnelle, finalement, c'est lorsque je ne me sens pas traité comme les autres, si je comprends bien. Et le sentiment de justice distributive, c'est quoi ?
- Speaker #1
C'est le sentiment d'injustice que je ressens lorsque j'estime que ma rétribution n'est pas proportionnelle à ma contribution et souvent je vais comparer avec les autres. On va prendre l'exemple des augmentations de salaire. Je me rends compte que moi je bénéficie d'une augmentation de salaire de 1%. Alors j'ai travaillé comme un acharné. Et puis Roger, lui qui n'a pas foutu grand chose, a une augmentation de 5%. Donc je ne vais pas comprendre pourquoi. Et assez rapidement, je vais considérer cette situation comme étant injuste. Donc dans ce cas-là, j'ai deux options. La première consiste à demander réparation et avoir le même augmentation, voire plus que celui de mon collègue pour établir ce sentiment de justice. Ou la deuxième option, ce qui arrive parfois dans les entreprises quand je sais que je ne peux pas avoir ce résultat-là, c'est de diminuer ma contribution pour être au niveau de la rétribution.
- Speaker #0
Et tu nous disais, il existe une troisième forme de sentiment de justice qui est le sentiment de justice procédurale.
- Speaker #1
Il intervient quand on ne comprend pas les critères qui sont à l'origine des décisions. On va prendre l'exemple d'Emilie qui a postulé pour un job qui coche toutes les cases et elle n'est pas recrutée. Elle n'est pas sélectionnée et elle apprend par hasard que c'est un de ses collègues qui l'est. Et quand elle demande les raisons pour lesquelles elle n'a pas été sélectionnée, on lui répond que c'est un choix stratégique. Donc c'est une réponse qui est totalement floue. Donc là va s'opérer le sentiment d'injustice procédurale parce que la personne va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles elle n'a pas été choisie, sachant que de son point de vue, ce n'est pas légitime et ce n'est pas fondé. Donc c'est toujours intéressant de prendre en considération que les salariés sont prêts finalement à... accepter n'importe quelle décision à partir du moment où ils connaissent les critères qui sont à l'origine de ces décisions. L'expérience démontre qu'être un manager juste, c'est dans un premier temps définir les critères qui motivent les décisions. On voit très très bien que les salariés sont prêts à accepter n'importe quelle décision à partir du moment où ils connaissent les critères. Même si ça ne leur plaît pas, ils l'acceptent. En revanche, si on ne leur explique pas les raisons pour lesquelles telle décision a été prise, ça va tout simplement augmenter la méchéance et altérer la confiance qu'ils peuvent avoir en leur manager et en leur entreprise.
- Speaker #0
Et créer un sentiment d'injustice potentiel.
- Speaker #1
Tout à fait.
- Speaker #0
Si je devais résumer, j'entends que le sentiment d'injustice peut apparaître soit lorsque je ne me sens pas traité et considéré comme les autres, soit lorsque je n'ai pas accès aux mêmes droits salaires que les autres, à et fort égal, à mon sens en tout cas, ou alors que je ne comprends pas les critères qui sous-tendent certaines décisions. À partir de ça, qu'est-ce que tu proposes aux managers pour diminuer ce sentiment d'injustice ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?
- Speaker #1
Il y a une solution qui est extrêmement simple, c'est de sortir un peu de cette notion de common control où c'est la hiérarchie qui décide de tout, et peut-être d'associer davantage les collaborateurs dans les prises de décision, parce qu'on voit que le sentiment d'injustice diminue lorsque la personne a pu s'exprimer. Je vais prendre un exemple qui est l'entretien annuel. Beaucoup d'entreprises, chaque année, évaluent leurs collaborateurs. Il y a plusieurs manières de s'y prendre. Si par exemple l'évaluation repose uniquement sur l'évaluation du manager sans prise en considération de l'avis ou du point de vue du collaborateur, il y a fort à parier qu'il y a un sentiment d'injustice parce que je n'ai pas pu m'exprimer. À partir du moment où le collaborateur a pu s'exprimer, le sentiment d'injustice baisse un petit peu. Il baisse encore plus lorsque le processus d'évaluation comprend une étape où le collaborateur s'auto-évalue et donc exprime ce qu'il ressent à son manager avant qu'il prenne la décision. Le sentiment d'injustice diminue de manière encore plus considérable lorsque le système d'évaluation est basé sur un 360°, parce que la personne aura pu bénéficier de points de vue complètement différents. Donc ça veut dire que pour réduire le sentiment d'injustice, la solution est relativement simple en fait. C'est ouvrir le droit à la parole, permettre les échanges, demander un point de vue avant de prendre une décision.
- Speaker #0
Là tu nous partages quelques pratiques possibles pour un manager, mais... Quelles sont les postures, selon toi, qu'un manager doit adopter pour être le moins injuste possible ?
- Speaker #1
On a bien compris que l'enjeu, ce n'est pas d'être juste, puisqu'on voit que c'est très complexe, mais le moins injuste possible. Selon moi, il y a six qualités ou six postures que le manager doit s'approprier ou sur lesquelles il doit être vigilant pour diminuer ce sentiment d'injustice. Le premier, c'est le courage. Le courage, c'est d'oser dire non aux passe-droits ou aux décisions arbitraires qui peuvent arriver de temps en temps dans les entreprises. C'est aussi assumer des décisions qui sont impopulaires, puisqu'on a dit que... à partir du moment où on révélait publiquement les critères décisionnels, et ça c'est le sentiment de justice procédurale, les gens l'acceptaient, même s'ils n'étaient pas forcément contents. Et puis c'est surtout laisser s'exprimer ce sentiment d'injustice pour le comprendre et bien pouvoir le traiter. Moi j'aime bien citer Aristote qui dit « On ne peut pas définir le courage, par contre on peut définir le courage comme étant le juste milieu entre ni trop lâche et ni trop téméraire. » Ça c'est le premier critère. Il y a un deuxième critère qui est l'impartialité. L'impartialité qui répond aux besoins de justice relationnelle. L'impartialité, c'est d'expliquer les raisons qui ont motivé à cette décision. Et c'est aussi de se remettre régulièrement en question en tant que manager pour peut-être identifier ses propres biais cognitifs, parce qu'on est imparfait et parfois on peut prendre des décisions qu'on considère justes, mais qui peuvent être perçues comme étant injustes. Et puis l'impartialité, c'est surtout appliquer les mêmes exigences à tout le monde, quelles qu'elles soient. Ça, c'est pour répondre aux risques de sentiments d'injustice relationnelle.
- Speaker #0
Donc on voit le courage, l'impartialité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
- Speaker #1
Il y en a une qui s'appelle la cohérence. C'est-à-dire qu'il faut éviter de changer d'avis toutes les deux secondes parce qu'il n'y a rien de pire pour créer justement ce sentiment de méfiance et augmenter le sentiment d'injustice. Donc ça veut dire que quand on dit quelque chose, on fait ce que l'on dit. Il ne doit pas y avoir d'écart entre ce que je dis et ce que je fais. Et enfin, être constant dans l'application des règles qu'on met en place et éviter les exceptions. Moi, mon papa m'a toujours dit Merci. L'exception tue la règle. Il y a aussi la transparence. La transparence évite justement aussi ce sentiment de favoritisme. C'est le courage, d'une certaine manière, que j'ai à énoncer clairement les critères qui vont motiver mes décisions, à énoncer clairement les règles, et à ouvrir un débat aussi, là en face de lui, un collaborateur qui considère que ce n'est pas juste.
- Speaker #0
La transparence, elle est réaliste aujourd'hui en entreprise ? La transparence totale ?
- Speaker #1
Alors, ça nous amène sur un autre sujet, c'est est-ce qu'on peut tout dire ? Là, on parle d'être transparent, non pas... en fonction de ce qu'on ressent ou de ce que l'on pense en tant que manager, mais plutôt sur les règles de vie et les règles d'organisation d'entreprise. Très bien. Et l'écoute. Alors pourquoi l'écoute ? Parce qu'en fait, on se rend compte que les personnes ressentent un sentiment d'injustice parce qu'elles n'ont pas réussi à l'exprimer. Soit elles ne se sont pas autorisées à l'exprimer, soit elles n'ont pas eu l'occasion d'exprimer. Alors que si on écoute les personnes, on leur dit « il n'y a pas de problème, si tu sens que tu es injustement traité, tu peux me le dire » , Ça va réduire ce sentiment d'injustice. Le dernier, c'est l'humilité. L'humilité parce que ce n'est pas parce que moi je pense qu'une décision est juste que pour autant elle peut paraître juste pour les autres. Il y a aussi cette notion d'humilité, à reconnaître que l'injustice peut se produire même si on fait tout ce qu'on peut pour que ça ne se produise pas.
- Speaker #0
Francis, est-ce que tu as des exemples d'entreprises à nous partager qui jonglent avec ces postures, ces concepts et qui essayent justement de limiter le sentiment d'injustice de ces salariés ?
- Speaker #1
Je vais citer comme exemple Buffer qui est spécialiste dans la gestion des réseaux sociaux. Elle applique la transparence des salaires, c'est-à-dire que tous les collaborateurs ont accès à tous les salaires. Quand je travaillais dans la banque, quand j'ai commencé, toutes les promotions étaient affichées dans les couloirs, comme ça il n'y avait pas matière à débat. Donc ça, ça me semble intéressant. Pour diminuer le sentiment d'injustice, il faut, comme certaines entreprises comme Netflix, L'Oréal ou d'autres, mettre en place des systèmes de feedback. pour autoriser les collaborateurs à s'exprimer dès qu'ils en ressentent le désir ou le besoin sur ce sentiment d'injustice pour pouvoir le traiter.
- Speaker #0
Et si tu devais donner, Francis, un seul conseil à un manager qui veut progresser vers un management plus juste, ce serait lequel ?
- Speaker #1
Alors, si je devais donner un conseil, je dirais qu'en tout de la complexité du sujet, puisqu'on voit bien que le sentiment de justice est quand même le résultat d'émotions, de biais cognitifs, de plein de choses qui se jouent, qui fait que cette complexité est tellement importante que la seule solution, le seul conseil que je pourrais donner à un manager, c'est forme-toi à cette notion de justice et d'injustice pour que tu sois peut-être un peu plus attentif et vigilant et accepte l'idée aussi que tu ne pourras jamais être un manager juste, mais que l'enjeu, c'est d'être le moins injuste possible.
- Speaker #0
Merci beaucoup Francis.
- Speaker #1
Merci Maria.
- Speaker #0
Vous l'avez bien compris, la justice parfaite en entreprise n'existe sans doute pas, mais cela ne doit pas nous empêcher de viser l'équité, la transparence et la cohérence dans nos pratiques managérielles. Ce n'est pas un objectif figé, mais une dynamique à entretenir chaque jour à travers des postures et nos décisions. Merci encore Francis pour cet éclairage lucide.
- Speaker #1
Merci.
- Speaker #0
Merci.