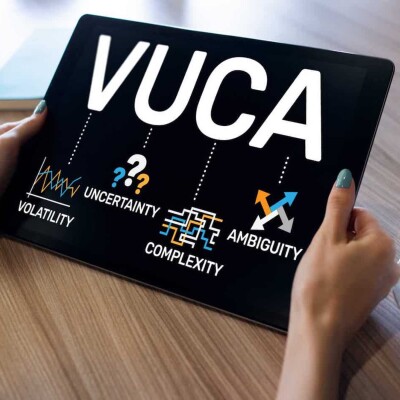- Speaker #0
Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts sur le management de l'aujourd'hui et de demain. Avec Francis Boyer, ancien DRH devenu consultant, coach et conférencier en innovation managériale, nous vous invitons à faire un pas de côté pour repenser vos pratiques à la croisée de la sociologie. de la psychologie, de la philosophie, des neurosciences et bien évidemment des pratiques du terrain. Aujourd'hui, nous allons aborder une idée qui dérange, qui surprend et peut-être qui libère. Et si le rôle du manager n'était pas de motiver ? Bonjour Francis.
- Speaker #1
Bonjour.
- Speaker #0
On est en 2025, on entend partout que le taux de turnover en entreprise est croissant, le désengagement un vrai sujet en entreprise. La question de l'attractivité est devenue centrale pour la majorité des dirigeants. Et les entreprises demandent à leurs managers de motiver au maximum les personnes, non seulement à les rejoindre, mais surtout à rester. Et toi, tu arrives et tu dis, mais en fait, manager, moi, je vous invite à cesser de motiver les personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
- Speaker #1
Oui, parce que je pars du principe qu'on ne motive pas quelqu'un qui n'a pas envie d'être motivé. Je note un réflexe qui est naturel de la part des entreprises, qui consiste à dire, puisque on a du mal à les motiver, on va demander au manager de les motiver. En systémique, on dit toujours plus de la même chose, produit les mêmes effets. Donc souvent, je les invite à prendre un peu de recul en disant, déjà, interroge-nous sur ça veut dire quoi motiver. Donc il y a déjà une différence fondamentale entre motiver et motivation. D'un point de vue étymologique, motiver c'est justifié par des motifs. Donc on demande au manager de trouver les motifs qui vont donner envie au collaborateur de faire ce que les managers attendent. Donc c'est la même racine que manipuler. Je trouve que c'est un peu moche. La motivation, ce n'est pas du tout ça l'étymologie, c'est le motif d'action, ça vient de la personne. L'idée, c'est plutôt de se concentrer sur ce que la personne désire, plutôt que de vouloir essayer de la convaincre et de la persuader de faire ce que l'on veut qu'elle fasse.
- Speaker #0
Alors, ce que la personne désire, je t'arrête juste un instant là-dessus, parce que les dernières études qu'on a pu voir passer disent que finalement, la valeur travail a changé carrément de position ces dernières années. Dans les années 90, la valeur travail était en deuxième position après la valeur famille. Aujourd'hui, elle est passée en quatrième position.
- Speaker #1
C'est là où, en fait, il faut s'interroger. C'est comment expliquer en aussi peu de temps, finalement, parce que ça fait quand même 30 ans, les Français considèrent que le travail est très important, à 24%, loin derrière la famille, bien évidemment, qui est restée à 80%. On est quand même assez loin derrière les relations aux autres et les loisirs. Alors, avant de parler de ces dernières décennies, je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu plus loin en arrière. En quoi le travail est-il motivant et en quoi il est-il important dans notre société ? On voit bien que le travail a évolué, la raison d'être du travail. Au début, le travail, c'était un moyen de survivre. Il fallait que je travaille pour avoir de l'argent pour manger. Ensuite, c'est devenu un devoir. Tu dois travailler, et ça, je vais le développer aussi. Un devoir collectif. C'est par le travail que chacun contribue à l'évolution de la société. Ensuite, le travail est devenu un symbole de réussite sociale. C'est par le travail et notamment l'argent que me procure le travail que je peux m'acheter une belle maison, une belle voiture et donc que j'aurai la reconnaissance des autres. Maintenant, on s'interroge sur à quoi sert le travail. Est-ce que le travail pourrait être une source de bien-être ? Face à cette évolution du rapport au travail, on pourrait légitimement se demander si les Français sont devenus paresseux. C'est un peu ce qu'on a entendu ces dernières années. Alors pas vraiment, parce que s'ils n'estiment que le travail n'est pas très important, ils considèrent quand même que c'est important. Alors de 84%, si on en croit l'étude auquel elle fait référence, il y a même 64% des Français qui disent que même s'ils avaient les moyens, ils continueraient de travailler. N'oublions pas aussi que le travail, c'est un facteur de lien social. Mais si on revient un petit peu plus loin, ce que nous vivons ne me semble pas surprenant. et Je remonterai un peu aux propos de Paul Lafargue, notre ancien député français, qui, dans son ouvrage et son essai « Le droit à la paresse » en 1880, nous disait qu'il y a finalement deux visions qui s'opposent concernant le travail. On a la vision capitaliste, portée par la bourgeoisie et les employeurs, qui érige le travail au plus haut niveau, puisque c'est bon pour eux, parce qu'ils gagnent de l'argent. Et puis, on a la vision socialiste. qui considère que le travail est accessoire et devrait être réduit au minimum, parce que le plus important, ce n'est pas de travailler, c'est de satisfaire ses besoins essentiels. Et on voit bien que ces dernières années, notamment après le confinement, aujourd'hui, ce qui est le plus important chez les Français, ce n'est pas tellement d'avoir de l'argent, ce n'est plus le cas, tout du moins, mais c'est d'avoir un bon équilibre de vie. Et donc ça, ça va changer complètement les donnes, parce que si je demande aux entreprises de motiver leurs collaborateurs alors que leur intérêt à eux... essayer d'avoir plutôt un équilibre de vie plus centré sur la famille et les loisirs, eh bien ça ne colle pas. C'est-à-dire qu'on est en train de taper à côté.
- Speaker #0
Ok, donc ce que tu es en train de dire, c'est que notre rapport au travail évolue, que la manière de motiver aussi peut-être du coup, parce qu'on n'a plus tout à fait les mêmes sources de motivation en travail, évolue actuellement. Mais qu'est-ce qui fait qu'un manager n'arrive plus, ou en tout cas, ça ne marche plus la manière dont on motivait hier ? Par rapport à aujourd'hui ?
- Speaker #1
Il y a un adage qui dit, on ne fait pas boire de l'eau à un âne qui n'a pas soif. Moi, je pense que la première question qu'on devrait se poser à un collaborateur, qui dit ou pas, d'ailleurs, qu'il n'est pas motivé, et d'ailleurs, on peut le faire, ça m'arrive de le faire souvent quand j'interviens, je pose la question, je fais une petite mise en situation, je dis, voilà, je suis un de vos collaborateurs, je viens vous voir, et puis il faut dire, je ne suis pas motivé, ça ne va pas du tout. Donc qu'est-ce que tu répondrais toi si je te posais la question en tant que manager ?
- Speaker #0
De quoi tu as besoin pour être motivé peut-être ?
- Speaker #1
Je te répondrai que je ne sais pas, puisque c'est toi manager qui dois me trouver la solution. C'est ton rôle d'ailleurs. C'est même le code du travail.
- Speaker #0
Bizarrement, je sens qu'il y a un poids sur mes épaules.
- Speaker #1
Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je te transfère une responsabilité qui n'est pas la tienne. Et je te demande de résoudre un problème qui est le mien. Idéalement, il faudrait que le manager réponde, mais as-tu envie d'être motivé ? Et je note que c'est rarement ce qui est fait, puisque... Ça fait des décennies qu'on dit aux managers, vous devez trouver la solution, vous devez motiver, vous devez faire grandir. Ouais, mais à condition que l'autre en face, il ait envie d'être motivé et il ait envie de grandir.
- Speaker #0
Mais on a le droit de ne pas être motivé au travail ?
- Speaker #1
Alors, c'est pas un problème, parce qu'on recherche quoi finalement dans le travail ? On recherche de la production et de la performance. Et on a plein d'études qui démontrent que l'on peut ne pas être motivé et être pour autant efficace. Donc pour moi, c'est pas un souci. Par contre, ce qu'il faut, c'est que le collaborateur déclare officiellement à son manager que ce n'est pas son sujet. Et ça, ce n'est pas évident de dire à un manager « lâche-moi sur la motivation, ce n'est pas mon truc, moi je suis là pour faire un boulot, pour gagner de l'argent, et ma vraie motivation c'est de jouer à la Nintendo Switch » , et aussi au manager d'accepter ce genre de discours. Donc on voit qu'aujourd'hui, il faut avoir un rapport très authentique entre les uns et les autres pour aborder un sujet qui peut être assez délicat.
- Speaker #0
Ok, et si tu as un collaborateur qui est certes performant, mais qui n'est pas spécialement motivé et qui n'a pas besoin d'être davantage motivé, quel est le rôle finalement qui reste au manager ? Quelle est la posture qu'il doit prendre ? Il sert à quoi ce manager ?
- Speaker #1
C'est intéressant déjà de s'interroger sur à quoi sert un manager. Donc on aura un podcast sur le sujet, mais surtout pourquoi on demande aux managers de motiver leurs équipes ? Parce que ça a une histoire. Au début du XXe siècle, ce n'était pas un sujet. D'ailleurs, le disait Très bien d'ailleurs en disant de toute façon, si vous voulez que les gens soient productifs, il faut leur donner de l'argent. Sinon à un moment donné, ils vont arrêter de l'être. On ne parlait pas de motivation à l'époque, on parlait plutôt de satisfaction. Et on partait du présupposé que ce qui allait donner envie aux gens de produire, ce qu'on attendait d'eux, c'était l'argent. Ensuite, il y a eu des études qui ont été faites pour se rendre compte, et ça a été fait à la Western Electric, c'était dans les années 20 je crois. pour se rendre compte que ce qui donnait envie n'était pas forcément le salaire, mais l'attention que l'on portait aux collaborateurs. Donc ça change un petit peu tout, et on a dit aux managers, si t'es attentif, si t'es reconnaissant, si t'es proche de tes équipes, à ce moment-là, ils seront plus satisfaits, plus motivés, et donc plus productifs. Car n'oublions pas, quand même, que ce que voulaient les entreprises à l'époque et ce que veulent encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui, c'est pas forcément que les salariés soient motivés, enchantés, heureux. C'est mieux. Mais c'est surtout qu'ils soient plus productifs et qu'ils fassent ce qu'on leur demande. Donc ça, ça a été une deuxième étape. La troisième étape, c'est notamment le fruit des travaux de Herzberg, un psychologue, qui a découvert qu'en fait, il y avait deux types de besoins en termes de satisfaction, parce que la motivation n'est pas encore un mot qui a été utilisé, qu'il a qualifié en deux catégories, les facteurs extrinsèques, par exemple les conditions de travail, le salaire, la stratégie d'entreprise, et puis les facteurs intrinsèques qui viennent de l'individu, par exemple l'utilité, le besoin de reconnaissance. Il s'est rendu compte que ce qui donnait envie aux personnes d'agir, ce n'était pas les facteurs extrinsèques, c'était les facteurs intrinsèques. On a pris conscience de tout ça et progressivement, on a commencé à se tourner vers la motivation et à s'intéresser aux facteurs intrinsèques. Mais on voit bien qu'en même temps, tout le système répond à l'inverse. Quand je regarde un peu tous les accords qui ont été négociés ces dernières années dans les entreprises pour le bien-être des collaborateurs versus motivation, Ce sont plutôt des facteurs extrinsèques. Le télétravail, l'amélioration des conditions de travail, les primes et les augmentations, toutes ces choses-là sont des facteurs extrinsèques. Alors que si on veut motiver quelqu'un, déjà, un, il faut qu'il en ait envie, et deux, il faut lui demander ce qui le motive, ce qu'il désire.
- Speaker #0
Mais si la motivation, finalement, si je te suis, comment un manager peut continuer à cultiver cette motivation auprès de ses équipes ? Puisque ça ne dépend pas de lui, ni des conditions de travail.
- Speaker #1
Déjà, si le manager a compris que ça ne dépend pas de lui, c'est déjà un grand pas, parce que moi, tous ceux que je crois, sont encore dans l'idée selon laquelle tout dépendrait d'eux. Et là, j'ouvre une parenthèse, c'est exactement ce que nous dit le code du travail, avec le lien de subordination unilatéral hiérarchique, ça met le manager dans une posture parfois insoutenable. surtout quand on est rentré depuis la fin du confinement dans une société extrêmement individualiste. Aujourd'hui les salariés, les français d'une manière générale n'ont plus aucun état d'âme à dire ce qu'ils pensent en bien comme en mal, ça devient un petit peu compliqué. Une grille de lecture que moi je peux donner aux managers pour leur simplifier un peu la vie, être à l'aise par rapport à ça, leur enlever un peu des poids qui sont de point de vue inutilement sur leurs épaules. Et là je fais référence à deux concepts. Le premier concept c'est le locus de contrôle. Le locus de contrôle, c'est un concept en psychologie sociale qui est apparu dans les années 60 par le psychologue Julien de Rutter, qui nous dit quoi ? Il nous dit qu'en fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont en locus de contrôle externe. Alors, le locus, c'est le lieu, c'est d'où vient mon contrôle, d'où je contrôle ma vie. On a vu dans le VUCA qu'on ne pouvait pas s'empêcher de contrôler la vie. Les personnes qui sont en locus de contrôle externe, elles considèrent que ce qui leur arrive vient de l'extérieur. Le hasard, la chance, les autres, le contexte, mais ça ne vient pas d'elles.
- Speaker #0
Ça vient et ça dépend de l'extérieur.
- Speaker #1
Ça dépend de l'extérieur. Donc en fait, elles subissent. Elles subissent puisqu'elles considèrent que ça ne vient pas d'elles et qu'elles ne peuvent pas agir. Et puis vous avez des personnes qui sont en locus de contrôle interne. Les personnes qui sont en locus de contrôle interne considèrent, elles, que la plupart des choses qui leur arrivent dans la vie, ça vient d'elles. Et c'est en développant le locus de contrôle interne qu'on développe la motivation et l'autonomie.
- Speaker #0
Dans une même équipe, on va avoir des personnes qui vont avoir un locus de contrôle externe, d'autres un locus de contrôle interne, plus ou moins fort. Ça veut dire qu'en fonction du type d'état d'esprit que l'on a, le manager va devoir s'adapter à chacun ?
- Speaker #1
Il va devoir demander au collaborateur s'il est plutôt en externe ou en interne. Puis il y a une deuxième grille de lecture qui peut se compléter, un locus de contrôle. interne ou externe. Et là on est sur la philosophie, c'est l'utilitarisme de Bentham. Bentham nous dit depuis la nuit des temps, l'homme est toujours le même, il n'a pas changé, c'est juste l'environnement complètement différent. Il est animé par deux pulsions, l'évitement de la souffrance et la recherche du plaisir. Donc c'est intéressant aussi pour le manager de demander à son collaborateur s'il est plutôt en évitement de la souffrance. Alors l'évitement de la souffrance ça se traduit comment ? Ça se traduit par je suis là pour gagner de l'argent pour manger, mais ton truc ça m'intéresse pas plus que ça. Ou la recherche du plaisir, je suis là parce que ce que tu me proposes me fait plaisir. Et quand vous croisez ces deux notions-là, vous avez une grille de lecture qui est intéressante pour le manager et qui va lui permettre de savoir comment se comporter et se positionner en fonction de chaque individu.
- Speaker #0
Alors ok, est-ce que tu peux nous détailler en fait finalement les quatre situations qui peuvent se présenter à un manager en fonction de son locus de motivation de ses collaborateurs et de cette approche, je ne veux pas souffrir ou je veux du plaisir ?
- Speaker #1
Il y a quatre positions, d'une certaine manière, d'après ce que moi j'ai imaginé. Le plus facile et le plus cool quand on est manager, c'est d'avoir une personne qui a l'obus de contrôle interne, puisqu'elle est autonome, et qui est en recherche de plaisir. Dans ces cas-là, le manager n'a pas grand-chose à faire, puisque la personne s'automotive. Par contre, ce qu'il a à faire, c'est de ne pas le démotiver. C'est plutôt pour ça que je dis souvent, ça sert à rien de motiver les gens, ce qu'il faut, c'est de ne pas les démotiver. Donc là, on est dans la solution idéale où tout manager rêverait avoir une équipe composée de gens qui sont comme ça. Ça c'est... pas la réalité, et tant mieux d'ailleurs, d'une certaine mesure. Vous avez d'autres cas de figure. Par exemple, dans un ordre décroissant, vous avez des personnes qui sont en locus de contrôle interne, c'est-à-dire ça dépend de moi, mais qui sont dans l'évitement de la souffrance. C'est-à-dire je ne m'autorise pas à me faire plaisir. Je suis responsable de ce qui m'arrive, et si je n'ai pas de plaisir, si je ne suis pas motivé, c'est de mon fait. Donc il y a un espèce de sentiment de frustration finalement, et on ne peut pas demander au manager de gérer cette frustration. Parce que ça ne dépend pas de lui. Ça dépend du collaborateur. Et là, ce que peut faire le manager, c'est demander, puisque tu es en locus de contrôle interne, donc tu considères que ça vient de toi, est-ce que tu as envie ou pas de quitter cet évitement de la souffrance pour aller vers la recherche du plaisir ? Et là, moi, je peux t'aider. Mais laisser la personne la liberté, le libre-arbitre de dire « j'ai envie, j'ai pas envie » . Si la personne vous dit « j'ai envie » , c'est super. Essayons de voir ensemble comment je peux t'accompagner, puisque tu me dis que tu en as envie. Et si tu n'en as pas envie parce que tu considères que ce n'est pas ton sujet, Et bien c'est très bien aussi, à partir du moment où tu fais ton travail, moi j'ai pas de soucis. Mais n'attends pas de moi que je te motive, puisque ce n'est pas ton souhait. ça ça peut être un peu violent aussi Mais en même temps, c'est ça, être adulte, on en parlera plus tard, cette posture d'adulte.
- Speaker #0
Est-ce que je peux, je t'attends juste quelques secondes pour vérifier. Si je comprends bien, dans ce cas de figure, tu as une personne qui est autonome dans le sens où elle considère que ce qui lui arrive dépend d'elle, mais qui peut-être est dans un profil extrêmement exigeant vis-à-vis d'elle-même, qui se remet en question, qui doute beaucoup, qui n'est pas forcément dans la recherche de plaisir. Dans quelle mesure et comment un manager peut aider ces personnes-là ?
- Speaker #1
Alors là, on est sur un autre sujet, on n'est pas vraiment... Là, on est sur une vision du monde. Par exemple, il y a un outil que je connais bien qui s'appelle l'inéagramme. Moi, j'en sais l'inéagramme. L'inéagramme, c'est un modèle de description de différentes personnalités. Donc, il y en a neuf, ça vient du Chili, etc. Et l'inéagramme est intéressant parce que, contrairement aux autres modèles de personnalité, il ne décrit pas les comportements, ça c'est la partie visible, mais il va plutôt définir une personnalité au regard de sa motivation. En gros, c'est après quoi tu cours et qu'est-ce que tu suis. Si la personne n'a pas confiance en elle, la question qu'on va se poser c'est est-ce que tu as envie d'avoir confiance en toi ? C'est ce que j'appelle la validation des présupposés. Tu n'es pas motivé, est-ce que tu as envie d'être motivé ? Tu ne te sens pas suffisamment autonome, est-ce que tu as envie d'être autonome ? Donc c'est ça que doivent faire aujourd'hui les managers. Et je note que ce n'est pas du tout ce qu'on leur a appris ces dernières décennies, parce qu'on leur demande d'aller directement à la solution sans avoir validé le problème, le vrai problème. Donc les personnes ont le droit d'être dans l'évitement de la souffrance, ça les regarde. Par contre, ce qui est important, c'est que le manager ait l'information. Parce qu'il y a une autre posture qui est la pire, pour un manager, de mon point de vue. C'est une personne qui a un locus de contrôle externe, c'est-à-dire qu'elle considère qu'elle n'a pas de pouvoir d'action sur ce qui lui arrive dans la vie, et que ça vient de les autres, et qu'en plus, elle est dans l'évitement de la souffrance. On voit bien que ces personnes-là que moi j'ai croisées quand j'étais en entreprise, sont plutôt assez résignées, un peu fatalistes. Et je commettais l'erreur à l'époque, quand j'étais en poste, de vouloir leur apporter un petit médicament, sans en avoir demandé. au préalable, s'ils avaient envie de sortir de cet état-là. Le manager n'est pas un psychothérapeute. Lui, tout ce qu'on lui demande, c'est de faire en sorte de trouver le bon équilibre entre épanouissement et performance. Donc, la seule chose que peut faire le manager, c'est est-ce que tu as envie de sortir de ces états-là, qui sont tes choix à toi ? Et si oui, à ce moment-là, moi je peux t'accompagner. Si tu n'en as pas envie, à partir du moment où le travail est fait et que tu n'es pas en insubordination, restons-en là et si un jour t'en as envie, tu viens me voir et puis moi je respecte le fait que t'en aies pas envie. Mais c'est plus facile pour le manager de se dire je sais qu'avec Roger, par exemple, c'est pas du tout son truc. En même temps, Roger, moi je l'ai vécu dans toutes mes entreprises, il fait bien son boulot, donc pourquoi j'irais l'embêter ?
- Speaker #0
Est-ce qu'il n'y a pas un risque au niveau collectif qu'il fasse sa tâche d'huile ? C'est-à-dire que Roger est peut-être performant, mais il est plutôt résigné, démotivé. Est-ce que ça ne risque pas d'entraîner une résignation plus collective de l'équipe ?
- Speaker #1
Alors ça, c'est un sujet souvent qu'on m'aborde. Moi, j'ai un collaborateur qui, de mon point de vue en tant que manager, est assez déficient et je ne voudrais pas que ça fasse tâche d'huile. Par exemple, j'ai Étienne. Étienne, bon, il a plutôt tendance à être assez critique, à colporter un peu des bruits de couloir, à péter un peu l'ambiance dans l'équipe. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour mieux gérer Étienne ? Moi, je réponds, mais Étienne, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le système dans lequel évolue Étienne. parce que si Étienne a du crédit auprès de ses équipes et donc une influence un peu négative, ça veut dire que ce n'est pas Étienne qu'il faut traiter, c'est le système. C'est qu'est-ce qui fait que les autres accordent du crédit à Étienne et non pas à vous. La plupart des gens sont un peu des moutons, ce que disait Nietzsche, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'ils vont là où c'est plus intéressant pour eux d'aller. L'idée, c'est de dire, dans une entreprise, il y a 3 catégories de personnes, ce que j'avais appris il y a très très longtemps. Vous avez les opposants, ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. il en faut, parce que sinon on n'avancerait pas Mais c'est parfois un peu lourd. Vous avez les alliés, ceux qui sont d'accord avec nous. Paradoxalement, il n'en faut pas trop, parce que si tout le monde est toujours d'accord, on n'avance pas. Et puis, vous avez les hésitants, c'est ceux qui ne sont ni d'accord, ni en désaccord. Et en général, on est surtout sur la ratio 15% d'opposants, 15% d'alliés, 70% d'hésitants. Et quand on est dans les ressources humaines, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris mon travail, et qu'on accepte ce constat-là. La stratégie pour un RH, c'est plutôt d'aller convertir les hésitants en alliés et de laisser les opposants tranquilles. Je suis convaincu que la force du groupe est plus forte que la force de la hiérarchie. Mais en tant que hiérarchie, nous avons un impact sur le groupe parce que je suis aussi convaincu qu'un groupe d'individus a besoin d'autorité hiérarchique. On le voit bien, ça ne marche pas quand il n'y a pas d'autorité hiérarchique.
- Speaker #0
Qu'est-ce qu'on peut faire finalement en termes de posture le manager pour éviter qu'une personne démotive et même compétente ne démotive pas tout le reste de l'équipe ?
- Speaker #1
Alors, une des recettes que je propose, c'est un triptyque qui s'appelle le SVP, S sens V valeur et P principe, qui consiste à mettre en place un socle de référence collaboratif. et d'obtenir l'engagement de chacun des collaborateurs, de son adhésion et de son incarnation de ce socle collaboratif. Par exemple, travailler sur un sens commun, où allons-nous ? Est-ce que vous êtes OK, pas OK ? Ce qu'on ne fait pas suffisamment, parce qu'en fait, comme on est encore très imprégné d'une pensée leadership qui part de l'idée qu'on doit persuader et convaincre ses équipes, on ne demande même pas aux équipes s'ils sont OK ou pas OK. Et ça, c'est une erreur fondamentale. En tout cas, dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça. Et c'est d'ailleurs la définition et l'étymologie de leadership. Un leadership, c'est celui qui est devant. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire de confronter individuellement, est-ce que vous êtes OK avec nous sur la direction que nous voulons prendre ? Après, les valeurs. Les valeurs sont sous-utilisées en entreprise. Beaucoup d'entreprises ont des valeurs. Moi, j'ai le sentiment que c'est plus de la marque employeur qu'une ADN. Et donc, il doit y avoir au niveau de ces valeurs des entreprises. Il y a à un moment donné une valeur qui parle d'authenticité, de confiance, d'honnêteté dans les échanges et d'esprit collaboratif. Parce que si ça, ça existe, on peut très bien confronter la personne qui ne joue pas le jeu et lui dire, tu sais qu'il y a une valeur qui est super importante pour nous chez nous. C'est l'authenticité, c'est l'entraide, la solidarité, la bonne ambiance. Est-ce que tu penses que le comportement que tu as là est en phase avec cette valeur ? Donc moi, en tant que manager, je ne me positionne pas à titre perso. Je m'offre le luxe de recadrer une personne, en tout cas de faire un feedback, non pas en mon nom, mais en tant que représentant de l'entreprise. Et puis après, il y a des principes. Le principe, et j'en vois pas beaucoup dans les entreprises, moi je travaille beaucoup sur ces sujets-là, le principe, c'est une espèce de déclinaison comportementale de la valeur. Si on est par exemple sur l'authenticité, qui est une valeur, l'authenticité, c'est déjà pas facile de se dire les choses, tout le monde n'est pas prêt à entendre, et tout le monde ne le dit pas bien, c'est imaginer un principe Ou par exemple, on autorise les uns et les autres à se dire, quand ça ne va pas, quand je ne me sens pas bien, je le dis, je l'exprime. Venez me le dire, moi je suis à l'écoute. Et c'est si tu ne le fais pas que toi tu es hors cadre. Et en faisant ça, si toute l'équipe, tous les membres de l'équipe ont validé ce sens commun, ces valeurs communes et ce principe commun, normalement c'est assez facile de recadrer, en tout cas de traiter un individu qui ne jouerait pas le jeu, parce qu'en faisant ça, Il s'est mis en dehors des clous, volontairement, et donc il n'a pas respecté, il n'a pas incarné la volonté du groupe.
- Speaker #0
Très bien, il nous reste un dernier cas. Tu parlais des collaborateurs qui ont un locus externe avec une valeur plaisir, enfin en tout cas une motivation à se faire plaisir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
- Speaker #1
Je m'amuse à interroger, par exemple quand je suis en séminaire d'entreprise, et je pose une question, à votre avis, quel est le pourcentage des Français qui se disent heureux au travail, bien au travail ? Alors, bien évidemment, la réponse est 20, 25, 30. Et ça fait 15 ans que je travaille sur ce sujet. On est toujours entre 75 et 85%.
- Speaker #0
Affiché ?
- Speaker #1
Oui, déclaré dans les études.
- Speaker #0
De personnes qui se disent heureuses au travail ?
- Speaker #1
Tout à fait. Ok. Alors, les gens ne comprennent pas. On dit, mais c'est quoi ce délire ? D'où nous sortent ces chiffres ? Après, je leur dis, attendez, quand on pose ces sondages-là, quand on pose ces questions aux Français, aux citoyens... En général, ils savent très bien qu'ils sont bien traités, mais par contre, ils se mettent un peu en mode défenseur, du type, c'est Maria qui ne va pas bien. Elle est maltraitée, elle me l'a dit dans son entreprise. Donc, il y a déjà ce facteur-là. Il y a deux caractéristiques qu'on a en France. On a deux particularités, nous, les Français. C'est qu'on est quand même des champions du monde du pessimisme. C'est pas faux. C'est-à-dire que... Et on aime ça. C'est-à-dire que, quelle planète allons-nous laisser à nos enfants, les pauvres ? Moi, je leur dis, demandez-les. je pense pas qu'ils soient aussi anxieux que vous l'êtes à leur place. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Et la deuxième, c'est quand on propose une solution, l'autre caractéristique des Français, c'est qu'ils sont extrêmement râleurs et critiques. Donc ça donne un espèce de truc du genre, de toute façon, on va tous crever et ça sert à rien. Les idées sont déjà jetées. Ménager les Français, c'est pas facile. Il y a déjà cette prise de conscience-là. Mais on voit bien quand même, dans l'ensemble, les Français sont plutôt bien. Donc j'aurais tendance à dire que c'est pas le sujet. Aujourd'hui, il y a un autre enjeu. Si on part de l'idée... que l'ère post-Covid s'est marquée par la montée de l'individualisme, donc ça se traduit par des PMG, tout pour ma gueule, ça veut dire que mon besoin en tant qu'individu, c'est me faire plaisir à moi. Et on revient à cette notion d'utilitarisme qu'on a évoquée déjà. Et la notion de plaisir, c'est pas la notion de bien-être. Si je demande par exemple quel est le pourcentage des Français qui déclarent éprouver du plaisir au travail, là pour le coup je tombe à 20%. Donc ça veut dire que l'enjeu... n'est pas de travailler sur le bien-être, ça c'est déjà fait, l'enjeu c'est de travailler sur le plaisir. Or, il s'avère que ce sont deux notions complètement différentes parce que produites par deux hormones complètement différentes. Le bonheur, c'est la sérotonine, ça calme et ça apaise. Quand vous refaites la peinture des murs dans un bureau, ça agit sur la sérotonine, ça calme et ça apaise, c'est joli. Assez rapidement, ça devient un acquis social, donc c'est plus sympa, c'est normal. En revanche, le plaisir, c'est la dopamine, ça excite. Et donc, l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, si on veut motiver quelqu'un, motiver, c'est me donner envie. Et ce qui va donner envie aujourd'hui aux Serlés, ce n'est pas forcément d'avoir un baby-foot. Ce qui va leur donner envie, c'est peut-être d'avoir un métier dans lequel ils s'éclatent. Et là, ça nous amène à travailler sur d'autres sujets, comme notamment le circuit de la récompense en neurosciences, et nous interroger sur comment on peut identifier si les activités qu'on confie à nos collaborateurs génèrent de la dopamine chez eux. Donc on voit bien que la motivation n'est pas forcément liée à la compétence, parce que... C'est pas parce que je sais faire que j'aime faire, mais plutôt lié à ce que moi j'appelais la pétance, c'est travailler sur cette notion d'aimer faire. Si je reviens au management, ça suppose quoi ? Ça suppose de la part du manager, une pratique où il va demander régulièrement à ses collaborateurs, en reprenant, je prends un exemple, leur description de poste, moi c'est ce que je fais, vous reprenez la description de poste, vous avez un tableau à double entrée, savoir faire et aimer faire, puis vous allez demander au collaborateur de mentionner les activités dans le cadre de son choix. En Ausha droite, tu mentionnes toutes les activités que tu sais faire et que t'aimes faire. Comme ça, moi, j'aurai accès à ta zone de plaisir et je verrai comment la préserver. En bas à droite, toutes les activités que tu sais pas encore faire, mais que tu vas aimer faire. Ça, c'est ta zone de désir. Et on va travailler dessus pour que je puisse, moi, t'accompagner. Et puis, il y a aussi l'autre côté, l'autre verre de la médaille, les activités que je sais faire, mais que j'aime pas faire. Faut qu'on en parle. Et après, moi, je l'ai appelé Houston. on a un problème, c'est des activités que je sais pas faire, et que j'aime pas faire, parce qu'il faut quand même les faire. On est vraiment dans cette logique de co-responsabilité, où le manager n'a plus à motiver, mais plutôt à responsabiliser. Et l'outil de responsabilisation, c'est la déclaration publique.
- Speaker #0
La déclaration publique par le collaborateur et le questionnement pour le manager. Puisqu'il s'agit, on ne peut pas savoir par avance, qu'est-ce qui peut me motiver moi, qu'est-ce qui peut me motiver Pierre, qu'est-ce qui peut me motiver Julie. Donc il faut aller creuser et il n'y a que le collaborateur qui peut le déclarer, c'est bien ça ?
- Speaker #1
C'est ça, quand on est dans un monde aujourd'hui qui revendique la primauté de l'individu, il faut jouer le jeu et du coup, il faut avoir des outils qui prennent en considération cette dimension individuelle et il faut aller jusqu'au bout. Et quand on a en face de soi de l'individualisme, il faut demander à l'individu de déclarer officiellement ce qui est ok pour lui, ce qui n'est pas ok. Et vous n'avez aucune obligation de résultat, c'est un peu quand même être ça, on a juste une obligation de moyens, parce que n'oublions pas non plus que tout le monde a toujours le choix. Ça s'appelle le libre arbitre, les gens confondent la liberté et le libre arbitre. Et donc c'est plus facile quand on manage à cette époque-là, je pense, de demander aux personnes « et toi, tu veux quoi ? Qu'est-ce que tu veux pas ? » Et c'est pas parce que je demande à quelqu'un « qu'est-ce qui te motive ou qu'est-ce qui te démotive ? » que pour autant je vais faire exactement ce qu'il veut. Parce que je vais quand même lui rappeler qu'il a décidé en tant qu'individu de rejoindre un collectif, qui est une entreprise, et que si on a bien fait les choses, donc si on a un sens commun, des valeurs communes, des principes collaboratifs, Quand il a rejoint l'entreprise, il s'est engagé, en théorie, et ça devrait être en pratique aussi, à respecter ce sens commun.
- Speaker #0
Nous parlons du plaisir au travail, mais tout à l'heure, tu nous as dit que les Français accordent aujourd'hui plus d'importance au temps libre qu'à l'argent. Est-ce que ça veut dire que l'argent n'est plus un moteur ? Et est-ce qu'il n'a jamais été ?
- Speaker #1
À bien y réfléchir, l'argent n'a jamais été un facteur de motivation, mais plutôt un facteur de démotivation. Si je n'en ai pas, je ne suis pas motivé. Mets-toi. Il y a des expériences qui sont peut-être pas connues, qui ont été réalisées par des psychologues dans les années 70, qui sont même allées plus loin parce qu'elles ont démontré que l'argent pouvait altérer la motivation. La première expérience qui est intéressante, c'est celle qui a été menée par un psychologue d'Essie en 1971, où il a réalisé une expérience avec des participants qui devaient faire des puzzles. Donc comment c'est passé ? Il y a eu trois temps. Le premier temps, il a demandé aux gens de faire des puzzles, sans aucune récompense financière, juste pour le plaisir de faire des puzzles. Ensuite, il a pris ce groupe-là, il l'a divisé en deux groupes. Le premier groupe leur a demandé de réaliser les puzzles dans les mêmes conditions. Et le deuxième groupe, il les a informés qu'il y aurait une récompense pour celui qui terminerait le puzzle le plus vite. Donc ceux qui ont terminé en premier ont une récompense. Et après, il a organisé une troisième session avec ceux-là. Et en fait, il leur a demandé de faire des puzzles, mais cette fois-ci, qu'ils n'auraient plus de récompense. Et donc, il s'est rendu compte que les gens ne voulaient plus faire de puzzles parce qu'ils n'avaient plus de récompense. Donc on voit qu'avec cette expérience-là, la récompense peut altérer la motivation et l'engagement. Mais ça peut altérer aussi autre chose qu'est le plaisir, le plaisir à travailler.
- Speaker #0
Quelques années plus tard, il y a deux autres psychologues, qui sont Mark Leeper et David Green, qui ont découvert l'effet de surjustification à travers une expérience réalisée auprès des enfants. Donc en fait, ils ont pris des enfants qui aimaient faire des dessins. Il y a une première étape où ils l'ont laissé faire des dessins pour le plaisir de dessiner. Ensuite, ils leur ont promis une récompense surprise à la fin des dessins, au regard des dessins qui étaient faits. Il y a une information prélable des enfants comme quoi ils auraient une récompense en fonction du dessin qui serait le plus sympa, en tout cas le plus joli. En faisant ça, ils se sont rendus compte que les enfants s'investissaient beaucoup moins dans le dessin parce qu'ils étaient avant tout centrés sur la récompense. Cette expérience a pour objectif d'attirer l'attention que lorsqu'on propose une récompense extrinsèque, et là on rejoint un peu Herzberg, on altère le plaisir intrinsèque. C'est-à-dire que les enfants étaient plus animés par le désir d'avoir une récompense. que le plaisir de dessiner. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à dire que l'argent n'a jamais été un facteur de motivation. D'ailleurs, on le voit bien, parce que suite au confinement, l'hôtellerie et restauration ont connu une pénurie sans précédent de candidats. Et donc ils ont décidé en 2021 de signer un accord de branche avec une augmentation de 16,4%, je crois si ma mémoire est bonne, pour réévaluer les salaires à la hausse. Ça n'a pas marché. L'année qui en a suivi, donc en 2022, ils ont cédé une augmentation de 5,2%. ça Et ça n'a toujours pas marché. C'est-à-dire que l'argent, ce n'est pas suffisant pour motiver les personnes.
- Speaker #1
Donc, ce que tu es en train de dire, en résumé, c'est que le modèle bâton-carotte est contre-productif, finalement.
- Speaker #0
Oui, alors je ne veux pas dire qu'il ne faut pas donner d'argent aux gens. Mais il faut s'enlever de la croyance que l'argent est le principal facteur de motivation, comme le pensait Taylor à l'époque. Il y a plein d'autres facteurs de motivation au niveau du travail qui sont souvent des facteurs de motivation intrinsèques. Alors que l'argent est un facteur de motivation extrinsèque.
- Speaker #1
Est-ce que cette évolution de notre relation au travail était prévisible, finalement ?
- Speaker #0
Je pense qu'on peut le prévoir, et je reviendrai à la Farga. Son questionnement, c'est pourquoi les Français aiment le travail, alors que le travail, ça donne tripalium, il n'y a pas de cohérence. Et en fait, ce qu'il disait, c'est qu'il y avait à l'époque trois influenceurs qui érigeaient la valeur travail au plus haut niveau. Vous aviez dans un premier temps les économistes. Les économistes érigeaient leur travail comme étant important parce que c'est ce qui permettait d'avoir une production des richesses du pays. Vous avez aussi un deuxième influenceur à l'époque, c'était les moralistes. Les moralistes considéraient que le travail était la vertu cardinale car elle permettait de cultiver les qualités essentielles de la vie en société. Il fallait pour les moralistes que tout le monde travaille pour qu'on puisse avoir une société harmonieuse. et qui amène du bien-être. Et puis, vous avez un troisième influenceur qu'on appelle le clergé, qui lui a érigé la valeur travail à haut niveau, tout simplement à titre de rédemption, parce qu'après avoir mangé le fruit défendu, Adam et Ève sont condamnés par Dieu à manger leur pain et à la sueur de leur front, et en transformant le travail en pénitence, les prêtres incitaient ainsi les individus à avoir la souffrance liée au labeur comme une voie de purification et de rédemption. Et quand on regarde un peu tout ça, on se rend compte que les moralistes qui prenaient en fait des valeurs collectives, il n'y en a quasiment plus parce qu'aujourd'hui la valeur fondamentale c'est la liberté individuelle. Donc on n'est plus dans le sens du sacrifice au groupe, c'est plutôt pense à toi mon petit chéri. Donc du coup le travail m'intéresse que si ça m'est utile à moi, donc on voit bien que cette influence sociale ça ne fonctionne plus. Selon les dernières statistiques, en 2021 on aurait 6,6% de pratiquants en France. Alors que dans les années 60, on était plutôt à 40%. Donc on voit bien que ça a baissé. Donc l'influence de l'Église est quasiment réduite à peau de chagrin. Et quant aux économistes, avec toutes les crises qu'on se prend à la tête, ils n'ont plus vraiment de crédit. Donc c'est peut-être ça qui concourt au fait aussi que, dans ces conditions-là, le travail n'a plus autant de valeur qu'il en avait avant. Et qu'aujourd'hui, ce qui est plus important pour les Français, ce n'est pas tellement le travail, c'est plutôt d'être heureux dans sa vie.
- Speaker #1
Si on devait résumer... En trois points, qu'est-ce qu'une entreprise aujourd'hui peut faire pour motiver ou pour maintenir la motivation de ses équipes ?
- Speaker #0
Alors la première chose, c'est arrêter de vouloir motiver. On l'a bien compris. La deuxième chose, c'est instaurer une relation plus adulte-adulte, à savoir plutôt que de vous épuiser à essayer de trouver ce qui est bon pour l'autre. Demandez-lui ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Comme ça, ce sera plus facile pour vous positionner là-dessus. Le troisième point, c'est peut-être d'instaurer des rituels comme celui cité, pour demander régulièrement aux collaborateurs ce qu'ils désirent, ce qui n'est pas ok pour eux, ce dont ils ont envie, et de toujours se mettre dans l'idée que vous n'avez aucune obligation de résultat, juste une obligation de moyens. On va chercher ce qui pourrait te donner envie. plutôt qu'on va trouver une solution qui te donne envie.
- Speaker #1
Et finalement, ça veut dire aussi mettre davantage les collaborateurs en responsabilité de leur choix par rapport à...
- Speaker #0
C'est ça, parce qu'en fait, le plaisir, le bonheur, c'est personnel, c'est individuel. Et c'est pas la peine de se rajouter un poids. Je pense que les managers ont suffisamment de poids sur leurs épaules pour ne pas s'en rajouter, qu'ils ne leur appartiennent pas. Vous êtes responsable de votre vie à 100%, mais vous n'êtes pas responsable de la vie des autres.
- Speaker #1
Merci beaucoup Francis, on l'a vu aujourd'hui, il ne s'agit plus de chercher à faire vibrer les collaborateurs à coup d'outils de motivation, il s'agit de recréer des conditions pour qu'ils aient envie de s'engager par eux-mêmes. Merci encore pour ce regard lucide mais aussi profondément humain sur le rôle du manager et à la prochaine.
- Speaker #0
À la prochaine.