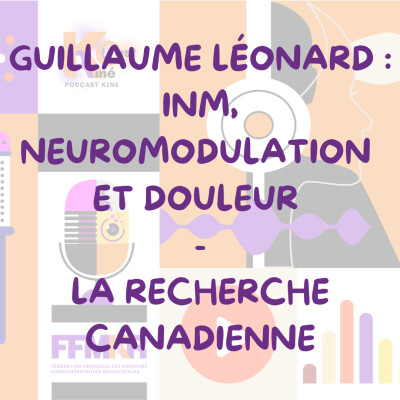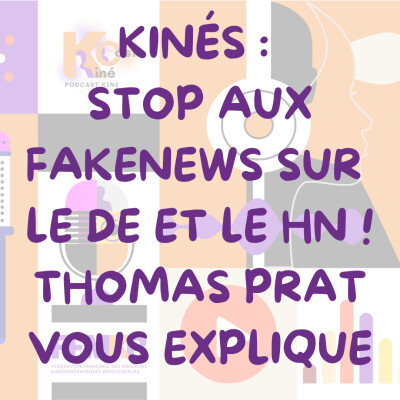- Speaker #0
Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la FEDE, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique, et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la FEDE, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute ! La médicale Un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La Médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur trois en France. Rassurant non ? Des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinecast. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Léonard, qui est physiothérapeute au Canada. et oui je ne dis pas kiné parce que vous le savez, c'est physiothérapeute au Canada et chercheur aussi à l'université de Sherbrooke. Bonjour Guillaume.
- Speaker #1
Bonjour.
- Speaker #0
Je suis ravie d'échanger aujourd'hui avec toi dans le cadre du NPIS Summit à Paris.
- Speaker #1
C'est un plaisir partagé.
- Speaker #0
Merci beaucoup. Alors voilà, j'avais écouté un peu tes interventions, enfin un peu, j'ai écouté tes interventions, excuse-moi, hier. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ?
- Speaker #1
Oui, alors je suis physiothérapeute au kiné au Canada. J'ai été formé et je pratique encore quelques heures par semaine en physiothérapie, en réadaptation. Mais je suis aussi professeur titulaire à l'école de réadaptation de l'Université de Sherbrooke, à la Faculté de médecine et sciences de la santé. Et également chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement. Ce faisant, je m'intéresse beaucoup aux personnes aînées. La problématique de la douleur, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc à la fois avec un regard plutôt mécanistique, on tente de comprendre ce qui se passe dans le système nerveux lorsqu'une personne ressent de la douleur, pourquoi certaines personnes vont être affectées davantage par la douleur, pourquoi certaines vont développer des douleurs chroniques. Et également, si on recentre sur la personne âgée, l'idée de dépister, évaluer et traiter. mieux traiter, mieux prendre en charge la douleur chez ces populations-là. Je pourrais dire à cet effet-là d'entrée de jeu que malheureusement, peu de recherches ont été faites chez les personnes aînées. Lorsqu'on teste l'efficacité de certaines interventions, souvent on va tester chez les jeunes adultes en prenant des raccourcis intellectuels, en disant « bon, si c'est bon chez le jeune adulte, ça doit être bon chez la personne âgée » . Pas nécessairement, il faut valider. Je fais une petite parenthèse ici pour dire qu'on est dans le cadre du NPIS, donc les interventions non médicamenteuses font partie du cœur de ma programmation de recherche comme physiothérapeute, on l'aura deviné. Et les interventions non médicamenteuses sont particulièrement importantes, intéressantes pour les personnes aînées, qui sont déjà souvent polymédicamenteées pour d'autres problèmes de santé, on peut penser au diabète, hypertension et tout le reste. L'idée, ce n'est pas de dire que la médication analgésique n'a pas sa place, mais si on peut trouver des compléments, peut-être pour venir soutenir cette médication-là, réduire peut-être même la médication analgésique chez les personnes aînées, trouver d'autres façons de soulager ces personnes-là, c'est l'idéal. Si on revient au volet plutôt dépistage et évaluation, on peut penser aux personnes qui souffrent de troubles neurocognitifs, comme la maladie d'Alzheimer. Ces gens-là souffrent également, ressentent également de la douleur. Le grand drame derrière ça, c'est que malheureusement, ce n'est souvent pas dépisté, pris en compte par le personnel soignant. Les gens perdent vers la fin de la maladie la capacité à s'exprimer verbalement. Leur façon de dire « ouch, j'ai mal quand tu me prends par le coude » , c'est souvent de repousser. Là, on se met à dire que le patient est agressif, ne collabore pas et tout ça, et on va lui... Proposer une sédation chimique, même une sédation physique, on peut encore dans certains cas tâcher des gens à leur siège parce qu'ils sont violents, agressifs, alors que dans certains cas, je ne suis pas en train d'affirmer que c'est le cas pour tous, mais dans un certain nombre de cas, il y a de très bonnes raisons de croire que c'est la douleur qui vient créer ces comportements-là. Si on était capable de mieux identifier, de mieux dépister la douleur, on serait capable de mieux intervenir et potentiellement même de réduire les troubles d'agitation chez ces populations-là.
- Speaker #0
Alors on va revenir peut-être au début, mais qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser justement aux neurosciences de la douleur ?
- Speaker #1
Ah bien ça, ça remonte dès mon parcours de formation en physiothérapie, en kinésithérapie. Moi j'ai souvenir d'un cours, on avait, c'est bête, on avait trois heures seulement sur la douleur. On avait une autre trois heures où on parlait des médias. mécanisme et puis d'électrothérapie d'ailleurs, d'électromodulation. Mais si on parle de douleur uniquement, c'est un trois heures seulement de cours sur la douleur. Et moi, après ce cours-là, j'ai dit, j'en veux davantage. J'ai besoin et je trouvais ça tellement passionnant. La compréhension. Ah oui, j'ai souvenir d'être allé à la bibliothèque fouiller, lire davantage, parce que je trouvais le sujet passionnant. Et je me disais, c'est pas vrai que ça s'arrête ici. Moi, je veux poursuivre mes études à la maîtrise, au master, au doctorat, au PhD. Pour approfondir, sans nécessairement avoir en tête une carrière universitaire, mais c'était vraiment cette soif de mieux comprendre les neurosciences et la douleur. J'aime me rappeler peut-être un peu tristement que les choses ont changé quand même. Présentement, je suis professeur à l'Université de Sherbrooke. Nos étudiants reçoivent beaucoup plus d'heures de formation en douleur qu'à l'époque. Les cursus de façon générale aussi se sont améliorés. On garde en tête que la douleur reste. en kiné comme en médecine, la principale raison de consultation. Donc, on a si peu d'heures de formation là-dessus. Et j'aime citer des études qui avaient montré, c'était par chez nous au Canada, mais parmi toutes les professions de la santé, avez-vous une idée de la profession qui reçoit le plus d'heures de formation en douleur ? Par curiosité. Je vous laisse tenter quelque chose.
- Speaker #0
Alors, on a déjà échangé ensemble, donc je vous connais la réponse.
- Speaker #1
Alors, je la donne aux autres. Vas-y, je t'en prie. Ce sont les vétérinaires. Donc les vétérinaires, ce sont eux qui reçoivent le plus d'heures de formation en douleur. Alors votre chat, votre chien va être bien pris en charge, bien soulagé. Et c'est parfait, mais on pense que nous aussi, on devrait peut-être être bien soulagé. Et voilà, c'est pour répondre à votre question de manière longue, mais c'est cet intérêt-là, dès le départ, lors de ma formation, qui m'a amené à m'intéresser au contexte, au domaine de la douleur.
- Speaker #0
Alors tu l'as évoqué en préambule, mais voilà, il y a un distinguo entre la douleur chez... l'enfant, l'adulte, mais aussi chez la personne âgée. Alors, quels sont les grands axes, les grandes lignes que tu pourrais nous décrire ?
- Speaker #1
Oui, bien, ce que je pourrais dire, en fait, d'entrée de jeu, c'est que malheureusement, probablement que les deux populations chez qui la douleur est la moins bien prise en charge, ce sont ces deux extrêmes du spectre, à la fois les très jeunes bébés et les personnes aînées. Je vous rassure en disant que les choses changent, évoluent, mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques dizaines d'années, même quelques années. On pratiquait des chirurgies très douloureuses, invasives, chez le nouveau-né, avec cette idée que comme le système nerveux n'est pas encore tout à fait mature, le nouveau-né ne ressent probablement pas la douleur. Donc on se permettait, on se disait de toute façon, les sédatifs, les analgésiques, c'est dur, on préfère ne pas en donner, c'est fort comme substance, on préfère ne pas les donner aux jeunes enfants. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on avait tout faux. Et non seulement le... Le bébé, le jeune enfant peut ressentir de la douleur, mais il y a certains travaux qui ont montré que ça peut avoir des impacts sur le long terme. Ces enfants nouveau-nés, prématurés, chez qui on a fait des interventions douloureuses, lorsqu'on teste leurs mécanismes de freinage de douleur, des mécanismes qui sont là pour venir tempérer la douleur et éviter qu'on développe des douleurs chroniques et persistantes, ces personnes-là ont des mécanismes moins efficaces plus tard à l'âge adulte. Alors, avec ce genre de conception, Ce genre de façon de faire, on a probablement prédisposé un certain nombre d'individus à développer des douleurs chroniques, des douleurs persistantes, tristement. Et à l'autre bout du spectre, c'est ça. On l'évoquait, les personnes aînées qui sont incapables de communiquer. Si elle n'est pas capable de communiquer, c'est peut-être qu'elle ne ressent pas de la douleur. Il y a même certaines personnes qui disaient, oui, avec les troubles neurocognitifs, les changements neurodégénératifs qu'on y voit, peut-être que ces gens-là ne ressentent pas du tout de douleur. Encore une fois, on avait tout. On a des études qui montrent que ces gens-là, avec des troubles neurocognitifs, ressentent effectivement toujours la douleur, avec certaines études qui montrent même qu'ils ressentent probablement un peu plus la douleur que les personnes qui n'ont pas de troubles neurocognitifs. Donc voilà, cette douleur-là, on peut la ressentir à tout moment de notre vie. Et comme professionnels de la santé, je pense que c'est de notre rôle de rester alerte à ces populations qui sont plus vulnérables, peut-être parce qu'elles sont incapables de verbaliser, de communiquer verbalement leur douleur. Ce n'est pas parce qu'une personne ne communique pas verbalement sa douleur qu'elle ne ressent pas de la douleur.
- Speaker #0
Alors, là aussi, tu l'as évoqué, mais pourquoi certains sujets vont être plus sensibles à la chronicité, justement, de la douleur ? Parce que des recherches, justement...
- Speaker #1
Il y en a plein. On pourrait dire que c'est le saint Graal que tout le monde poursuit. On essaie de comprendre pourquoi. De phénotyper.
- Speaker #0
Oui,
- Speaker #1
le phénotypage. c'est comme beaucoup de choses, j'oserais dire, une espèce d'interaction entre eux. Le génétique, l'individu et l'environnement, donc à la fois entre la personne et son bagage génétique, mais aussi l'environnement dans lequel elle va évoluer. On sait que, pour revenir à des facteurs plutôt biologiques... Je parlais tout à l'heure des mécanismes de freinage de douleur. Certaines personnes n'ont pas de mécanisme efficace pour venir freiner une douleur. Un exemple frappant de ça, c'est les gens qui souffrent de fibromyalgie. On a montré que ces personnes n'ont pas de mécanisme de freinage de douleur qui sont efficaces. Et je vous donne un exemple qui est très kiné. Normalement, quand on fait de l'exercice, après avoir fait de l'exercice, on ressent un peu de douleur dans les jours qui suivent. On parle de... Chez nous, de DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness, ou de douleurs post-exercice. Donc c'est normal et c'est même, des fois, moi j'aime bien, j'aime bien ressentir ces petites douleurs. Ça veut dire qu'on a bien fait. Des passions le disent aussi. Oui, c'est ça, on s'est bien entraîné.
- Speaker #0
C'est des douleurs qu'on aime bien.
- Speaker #1
Oui, et moi j'aime d'ailleurs me plaindre auprès de mon épouse. Je lui dis à quel point ça fait mal et à quel point je me suis bien entraîné et tout ça. Mais voilà, nous en plus on ressent ces douleurs-là, mais on a des mécanismes de freinage qui sont là pour nous. tempérer la douleur. Chez une personne qui souffre de fibromyalgie, ces mécanismes-là ne fonctionnent pas de façon optimale, moins bien. Encore là, c'est tout un continuum, mais si on prend une moyenne, de façon moyenne, les mécanismes chez ces gens-là fonctionnent moins bien, si bien que lorsqu'on leur donne des choses relativement simples à faire… En début de carrière, c'est ce que je faisais. J'avais un patient, une dame, un monsieur. C'est souvent les dames qui souffrent de fibromyalgie. Ma dame allait marcher sur un tapis roulant dix minutes. Et puis là, je la revoyais deux, trois jours plus tard en clinique, elle disait « Guillaume, j'ai eu mal pendant des jours, des heures, je n'ai pas été capable de fonctionner. » Et moi, je ne comprenais pas. On a marché dix minutes sur un tapis roulant. Donc, il faut garder en tête que…
- Speaker #0
Que les proposer. Oui,
- Speaker #1
mais là, en fait, comment expliquer ça ? C'est se rappeler que cette personne-là, ces personnes-là, ces mécanismes de freinage ne fonctionnent pas bien. Donc, toutes les douleurs post-exercice sont amplifiées. Et donc, de cette façon-là, ça nous aide à comprendre et à adapter notre programme d'exercice. Donc, pour revenir à votre question, plusieurs facteurs, mais au niveau biologique, c'est un des éléments qui est mis de l'avant, c'est les mécanismes de modulation. Gardez en tête que le message de douleur ne voyage pas de façon linéaire jusqu'au cerveau, jusqu'au niveau des centres supérieurs, mais qu'on a, au contraire, des mécanismes de modulation, un peu comme des variateurs, qui peuvent venir augmenter ou diminuer la transmission du message nociceptif et, ultimement, la perception de douleur. J'en ai et ça peut arriver aussi qu'au point où ce qui se passe dans beaucoup de cas de douleurs chroniques, de douleurs persistantes, c'est que le problème n'est plus au niveau périphérique, au niveau tissulaire. Le message de douleur, si je peux simplifier les choses, c'est enregistré dans le système nerveux. Il y a une espèce de potentialisation ou des synapses à ce niveau-là qui permet un certain apprentissage. Cet apprentissage est présent. pour plein de choses. Quand on va à l'école, on se répète la capitale d'un pays pour dire quelque chose, à force de répéter, on mémorise. C'est parfait et c'est génial. C'est ce qui nous permet d'apprendre tout ce qu'on a appris et d'être où on est aujourd'hui. Malheureusement, c'est un peu la même chose pour la douleur. À force d'être constamment bombardé d'informations douloureuses, le système nerveux finit par apprendre, d'avoir de la douleur et par la suite, même lorsqu'on guérit la blessure, même lorsque la blessure est guérie, la personne peut continuer. à ressentir de la douleur. On a des exemples frappants de ça, des douleurs fantômes. Les gens qui ont des douleurs, un membre amputé, on se doute bien que l'origine de la douleur n'est pas en périphérie, le membre n'est plus là. Mais le message de douleur a été enregistré dans le système nerveux et ça fait en sorte exactement... Des arthroplasties, généralement ça fonctionne bien, je ne suis pas en train de dire que les arthroplasties, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, mais chez un certain nombre de patients, certaines études évoquent un 20% de personnes post-arthroplasties. remplacement de hanches ou de genoux qui vont continuer à ressentir des douleurs. On dit pourtant l'articulation, il n'y a plus rien, il n'y a plus de cartilage, tout est artificiel, mais ça montre encore une fois à quel point le rôle du système nerveux qui est venu enregistrer ce message de douleur est central dans beaucoup de douleurs chroniques. Et le message, je termine avec ça peut-être, c'est important de vous soulager. Lorsque vous avez une douleur, c'est primordial Je ne sais pas si ça nous vient de notre passé un peu judéo-chrétien et vous, comment vous gérez ça en France, mais au Canada, c'est encore un discours qu'on entend. « Ah bien là, j'ai mal, mais il faut que je montre que je suis fait fort et puis j'endure. » Il y a un peu d'orgueil peut-être à travers ça. Ça dépend.
- Speaker #0
C'est un peu générationnel aussi.
- Speaker #1
Oui, effectivement. Effectivement. Donc, je pense que les choses changent de la bonne façon, mais j'en étais un exemple. C'est-à-dire que les premières années, avant de faire mes études en douleur, j'avais des maux de tête. Et je me disais, non, Guillaume, ne prends pas de comprimés, de paracétamol ou d'autres choses. Endure, ta douleur monte. Et je me disais, après un certain temps, pourquoi tu fais ça ? Tu veux prouver quoi à qui ? Maintenant, quand j'ai un mal de tête, je prends un comprimé, puis voilà, à quelques minutes d'après, mon mal de tête est disparu. Je pense que c'est quelque chose qui est ancré chez encore plusieurs personnes, même si heureusement les choses sont en train de changer. Donc il y a des bonnes raisons de se soulager pour notre qualité de vie, mais aussi, je vous dirais, pour éviter que la douleur ne se chronicise. Une douleur aiguë qui est mal soulagée, malheureusement, peut avoir tendance à se chroniciser.
- Speaker #0
Et notre rôle justement, en tant que thérapeute, c'est d'éduquer nos patients à ça, de leur comprendre. Oui, absolument. On ne peut pas forcément comprendre justement... Pourquoi ils ont mal ? Parce que la protéine, ils vont toujours chercher une explication plutôt biologique, en fait, mécanique.
- Speaker #1
Oui, leur expliquer tout ça, leur rappeler l'importance de se soulager. Et oui, j'évoquais le paracétamol pour les maux de tête, mais on est à la NPI, en tant que kinésithérapeute, on a toutes sortes d'options non pharmacologiques, non médicamenteuses, qui sont accessibles, auxquelles on a accès, pour aider le patient à se soulager. Il ne faut pas hésiter à les mettre de l'avant et, dans la mesure du possible, tenter d'autonomiser notre patient. Utiliser un TENS, la neurostimulation périphérique en clinique, bon ça va, mais si on montre à notre patient à l'utiliser chez lui à la maison, qu'il peut se soulager lorsqu'il a des maux de dos le soir, après sa journée de travail, c'est encore mieux.
- Speaker #0
Alors c'est justement une partie de travaux de recherche, la neuromodulation. Explique-nous un petit peu justement comment ça fonctionne et tout ça.
- Speaker #1
Je mentionnais tout à l'heure ces mécanismes de modulation de la douleur, le variateur qu'on a à différents endroits de notre système nerveux. On peut venir jouer, activer ces systèmes de freinage qui vont venir bloquer le message de douleur par l'entremise de toutes sortes de techniques, mais notamment la neurostimulation, la neuromodulation. Le TENS est un bel exemple. Lorsqu'on vient mettre le TENS des électrodes sur la région douloureuse, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient activer des fibres, des grosses fibres myélinisées qui vont activer Merci. Le petit interneurone au niveau de la moelle épinière, c'est la théorie du portillon. Je le précise, je le rappelle avec un peu de chauvinisme, c'est au Québec, à Montréal, que ça s'est découvert. Oui, c'est ça. Dans les années 1960, Millsack et Wall, qui ont montré parmi les premiers que justement, la douleur, ça ne voyageait pas de façon linéaire, ça pouvait être modulé par des mécanismes, et ils mettaient de l'avant le fameux portillon. Et nous, on utilise ces principes-là, notamment avec... la neurostimulation périphérique pour activer l'interneurone au niveau spinal, au niveau de la moelle épinière, qui va venir bloquer le message de douleur. Donc ça, c'est un exemple de mécanisme qu'on peut utiliser au niveau de la moelle épinière. Au niveau du tronc cérébral, il y a d'autres approches. On est en train de tester dans le laboratoire une modalité qui vise à simuler les nerfs crâniens. Donc les nerfs crâniens, comme on le sait, viennent faire synapse au niveau du tronc cérébral. et en venant positionner dans notre cas, on a choisi la langue. Donc, on a conçu avec notre équipe d'ingénieurs un stimulateur qui vient stimuler la langue de façon sécuritaire, on s'entend, et qui envoie des impulsions jusqu'au niveau du tronc cérébral avec notre idée, notre hypothèse, notre souhait que ce genre d'impulsions viennent activer des mécanismes de freinage au niveau du tronc cérébral et puissent venir réduire la douleur. On est présentement en train de tester ces approches. Sinon, le dernier niveau, au niveau des centres supérieurs, au niveau du cerveau, là, on peut penser à la stimulation transcranienne, où là, on vient mettre des électrodes sur le cuir chevelu. Je pense à la TDCS ou à la RTMS, deux approches non-invasives. On peut stimuler ces régions-là de façon invasive. Les neurochirurgiens peuvent ouvrir la boîte crânienne et venir mettre des électrodes au niveau du cerveau, au niveau de la région épidurale. Nous, ce n'est pas notre bague, donc on y va de façon non-invasive. Il y a donc des approches qu'on peut utiliser. Nous, ça se répand au Québec. Il y a des cliniques maintenant qui utilisent la stimulation transcranienne chez leurs patients qui souffrent de douleurs chroniques. Donc, c'est un autre niveau. Mais peut-être si on ressort de la neuromodulation et de la neurostimulation, je pense à ce qui se passe au niveau des centres supérieurs. L'hypnose, c'est une belle façon. Je ne sais pas si vous l'utilisez beaucoup ici en France, mais chez nous, c'est quand même relativement utilisé. Il y a des cliniques qui l'utilisent aussi. Donc, l'hypnose pour venir réduire la douleur. Encore une fois, avec un ancien étudiant français qui était venu faire son master, Adrien Redecart, pour ne pas le nommer, Adrien s'est intéressé à l'auto-hypnose. Donc, est-ce que la personne peut, en écoutant un script, enregistrer avec des suggestions, réussir à réduire des douleurs ? Et dans le cadre de ses travaux, Adrien avait montré que l'auto-hypnose était aussi efficace que l'hypnose en personne avec un hypnothérapeute devant. Donc, je ne suis pas en train de dire que l'hypnothérapeute n'est pas pertinent, n'est pas efficace, mais si ultimement notre but est d'autonomiser notre patient, ça peut être intéressant d'utiliser des techniques comme ça d'auto-hypnose. Il y a toutes sortes d'autres, je pense au centre supérieur, mais l'effet placebo, l'effet nocebo... Je mentionnerais peut-être l'impact que nos mots peuvent parfois avoir sur les patients. Quand on sort des mots qu'on pense savants, qu'on pense précis, mais des fois pour le patient qui reçoit ce... Le phénocébo. Oui, le phénocébo. « Ah, vous avez un syndrome XY, le patient a un syndrome, ça doit être grave si j'ai un syndrome. » Donc, on voit l'anxiété qui augmente, le stress qui augmente. Et moi, j'ai vu ça malheureusement à quelques reprises, des patients qui venaient me voir après être... avoir vu un autre professionnel et on voyait leur douleur augmenter après un diagnostic ou après avoir reçu quelques mots. Donc, je voudrais faire attention aux mots qu'on utilise. Je pense que c'est Kipling qui disait que les mots sont parmi la plus grande médecine. Donc, la façon dont on approche les choses avec le patient, qu'on lui explique les choses, simplifier, ne pas lui cacher des choses, mais dédramatiser, lui aider à comprendre. Quand il nous revient avec un rayon X en disant « Oui, Guillaume, j'ai de l'arthrose partout, j'ai une hernie ici, il n'y a rien à faire avec moi » , et que là on prend le temps de lui expliquer qu'en fait c'est plutôt positif comme rayon X, dans le sens où il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de fracture et tout ça, et que si on prenait une radiographie chez quelqu'un qui marche dans la rue, qui n'a pas de douleur, on trouverait probablement ce genre de choses-là exactement.
- Speaker #0
Et donc, vous combinez ces neurostimulations avec de l'activité physique dans les recherches aussi.
- Speaker #1
Absolument. Et l'idée, je pense qu'en douleur, en douleur chronique, la clé, c'est la responsabilisation, l'autonomisation, on y revient. La neurostimulation, la neuromodulation peut aider à soulager temporairement. Donc un TENS, je le précise ici, le TENS, ça ne guérit pas une lombalgie, ça soulage temporairement la douleur. Et je dirais là-dessus que malheureusement, pendant trop longtemps, en clinique comme ailleurs, en médecine en général, on utilisait mal le TENS. Les gens venaient nous voir en clinique, on leur mettait le TENS et puis on leur donnait quelques conseils. Peut-être qu'on faisait un peu d'exercice, on revoyait la consigne et on les retournait à la maison. Et le patient venait en disant « Mon Dieu, quand je vais voir Guillaume, ça fait du bien, ma douleur diminue, mais une heure, deux heures, trois heures plus tard, je suis de retour chez moi et la douleur est de retour. » Donc, il faut garder en tête que le TENS soulage temporairement. pas dire que le TENS n'est pas efficace. C'est ce qu'on dirait à quelqu'un, arrêtez de prendre vos comprimés analgésiques parce que ce n'est pas ça qui… On sait que ce ne sont pas les comprimés analgésiques qui vont guérir le mal de dos. C'est plutôt la récupération, la réadaptation, le fait de…
- Speaker #0
Multifactoriel, oui.
- Speaker #1
Tout à fait. Mais est-ce qu'on dit, ah, ne prenez pas votre paracétamol parce que de toute façon, ce n'est pas ça. Bien non, la personne a mal. Donc, elle a besoin d'outils pour gérer sa douleur. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'importance de bien soulager sa douleur aiguë. Mais si on peut combiner ça, et on revient au TENS, Aider la personne à recommencer à bouger, à faire sa routine d'exercice. On a quelques projets là-dessus qui ont montré des bienfaits de combiner le TENS pendant une séance d'exercice. La personne a moins de douleurs, plus facile de bouger. On peut penser à l'utilisation du TENS pour une personne qui a des douleurs au dos et qui veut jardiner. On lui installe un TENS et pendant qu'elle jardine, elle peut avoir ses stimulations. Le TENS, c'est un petit appareil qui est portatif, qu'on peut accrocher à sa ceinture. Donc, on peut vaquer à ses occupations quotidiennes. Et l'idée, voilà, c'est de ne pas utiliser le TENS comme « je vous mets ça en clinique, vous venez me voir trois fois par semaine, je vous mets du TENS, je vous retourne à la maison » . Non, pas du tout. Je vous montre à l'utiliser, on vous soulage et à travers ça, on poursuit, on ajoute des exercices qui, eux, sur le moyen et long terme, vont venir faire toute la différence.
- Speaker #0
Et c'est vrai parce que c'est parfois chez certains patients difficilement entendable, en fait, de leur dire, de transmettre le message en disant « bougez, bougez, bougez » . Et ils vont nous dire « mais oui, mais bouger me fait mal » . Donc en fait, par cette neuromodulation, tu vas, voilà, à dénuer et puis justement, tu reprennes.
- Speaker #1
Absolument, diminuer la peur de bouger, la kinésiophobie. Et l'idée, ce n'est pas de blâmer les patients. Je veux dire, moi aussi, si j'avais mal et quand je bouge, mes douleurs augmentent. Je veux dire, là, mon physiothérapeute, mon kinésithérapeute m'a dit de bouger, faire de l'exercice. J'ai essayé deux, trois fois et à chaque fois, ma douleur augmentait. Bien, je m'excuse. J'arrête, hein ?
- Speaker #0
Bien sûr.
- Speaker #1
Donc là-dessus, je pense que c'est aussi important. Il est important de préciser au patient ce qui est attendu dans un premier temps, que ces augmentations de douleurs-là peuvent être normales, mais on vise des augmentations qui sont minimes et qui, rapidement, une heure, deux heures au maximum après la séance d'exercice, devraient revenir au niveau initial. Pas parce qu'on est en train de se blesser. La douleur chronique, ce n'est pas comme la douleur aiguë. Ce n'est pas un message qui nous dit « Ah, vous êtes en train de vous blesser » , mais… Surtout que si je suis pendant 3, 4, 5 heures après ma séance d'exercice à avoir ressenti la douleur, pour mon système nerveux, ce n'est pas une bonne idée. Pour moi, est-ce que je vais vraiment avoir envie de refaire ma routine d'exercice le lendemain ? Pas du tout. J'aime donc, avec mes patients, y aller, et c'est ce que je recommande lorsque j'enseigne, allez-y graduellement. Les personnes qui sont en douleur chronique depuis des années, je ne leur demanderai pas d'aller courir ou même de marcher pendant 20-30 minutes. Je vais leur dire... Commencez par un 2-3 minutes de marche. Les gens disent, sérieusement, 2-3 minutes, pas plus. Vous faites ça quelques fois, ça va bien parfait. Vous augmentez à 4 minutes. Encore quelques fois, à 5 minutes. Et on y va comme ça, graduellement. Pour la personne, ça lui permet de bâtir sur des succès. Elle a envie de refaire son programme d'exercice, mais c'est ça, de bâtir sur des succès en disant, « Ah, bien finalement, j'étais à 2 minutes et maintenant je suis rendu à 15 minutes et je marche et j'ai à peine plus de douleur, donc les choses vont bien. » J'aime dire à mes patients que la fameuse fable de La Fontaine, entre le lièvre et la tortue, eh bien c'est la tortue qui a fini par gagner.
- Speaker #0
Tout à fait. Alors maintenant, on va revenir un peu sur le congrès, sur le Summit. Pourquoi il est important pour toi d'y participer, justement, d'être présent ?
- Speaker #1
Oui, je pense que l'idée c'est de faire valoir la place des interventions non médicamenteuses de façon large, oui en douleur, mais de façon plus large. Ce sont des interventions qui sont plusieurs, largement efficaces. On n'a pas à rougir de ça. Je fais une petite anecdote peut-être pour dire que j'anime quelques clips de lecture à l'occasion. Il y a des fois pour une tendinopathie où on compare nos interventions en kiné comparativement à ce que nous dit la recherche pour les anti-inflammatoires, pour dire quelque chose. Et honnêtement, qu'on se met à comparer. On dit qu'on se compare, on se console. Des fois, on est très critiques envers nous-mêmes. Je vous mets au défi d'aller voir les données probantes sur les effets, les études qui ont montré que les anti-inflammatoires étaient efficaces pour les tendinopathies. Il n'y en a pas tant. Donc, l'idée, je ne suis pas en train de dire qu'on devrait bannir les anti-inflammatoires, mais voilà, on n'a pas à rougir. Il faut, je parle peut-être un peu pour moi, continuer à faire de la recherche pour montrer la pertinence des interventions non médicamenteuses. J'évoquais hier avec des collègues l'importance... peut-être un peu tristement, mais de montrer aussi que ce sont des interventions qui peuvent nous aider à sauver de l'argent. Pour la société, quand je dis sauver de l'argent, ça peut être jusqu'à retourner des gens plus rapidement au travail. Donc, la société, toute la société en bénéficie. Mais je vous dirais que malheureusement, on est peut-être devant cette difficulté-là pour les INM, où c'est facile et prescrire de la médication, c'est assez simple. Nous, souvent, c'est couvert par d'autres structures. Même pour l'hôpital, c'est une certaine enveloppe qui paye pour ça, mais si l'hôpital veut engager un ou deux kinés supplémentaires, là c'est d'autres budgets, puis ça c'est limité, et on est surveillé par le gouvernement, donc c'est malheureusement plus difficile d'engager des personnes, des professionnels de la santé, des kinés, des psychologues, des ergothérapeutes, peu importe, que de dire « parfait, on prescrit telle ou telle médication à notre patient » . Encore une fois, ce n'est pas d'antagoniser, mais de... De mettre de l'avant l'importance qu'on a, comme kinésithérapeute, entre autres, de montrer que notre rôle est important et que nos interventions sont efficaces. Faire avancer ces connaissances-là qui nous permettent de remettre l'humain au cœur de tout. Je pense que c'est la beauté des INM, des interventions non médicamenteuses. C'est qu'elles permettent de remettre l'humain au centre de tout, à la fois l'intervenant et la personne. ses propres objectifs, ses propres visées thérapeutiques.
- Speaker #0
Les travaux de la NPI ont permis de poser ce cadre à l'INM qui manquait indéniablement. On l'a répété. Ça permet maintenant de pouvoir prouver de par ce cadre l'efficacité. Non, on peut très bien se dire... Finalement, ce n'est pas efficace, mais il faut le montrer, il faut le publier,
- Speaker #1
puis on passe à autre chose.
- Speaker #0
Les choses sont faites actuellement, donc maintenant c'est au professionnel de s'en emparer, que ce soit en hospitalier, mais aussi en ville. Oui,
- Speaker #1
absolument.
- Speaker #0
J'aimerais faire une petite aparté justement sur nos deux types d'exercices, en tant que physiothérapeute et kinésithérapeute. Vous, vous avez l'accès direct.
- Speaker #1
Oui.
- Speaker #0
Comment ça fonctionne chez vous et depuis quand d'ailleurs ?
- Speaker #1
Ah, là je serais bien embêté, mais à mon avis, c'est dans les années... 1990, là, mais là, je ne veux pas commettre d'impair. Il faudrait aller vérifier comme il faut les sources. Il y a longtemps, en tout cas. Il y a longtemps, effectivement. Moi, depuis, j'ai gradué comme kiné en 2004. Et depuis ce temps, ce n'était pas nouveau. On avait l'accès direct depuis déjà plusieurs années. C'est pour ça que j'anticipe que c'était probablement au cours des années 90, 1990. Donc oui, ça se passe bien. Les patients viennent nous voir directement. Ça demande évidemment une bonne formation que vous avez aussi, je suis convaincu, en France. Mais il faut être, en étant la première ligne, ou en tout cas cette première porte d'entrée, il faut être alerte en disant « moi, finalement, est-ce que c'est musculosquelettique ou est-ce qu'il n'y a pas derrière ça un cancer ? » ou quelque chose. Dans des cas comme ça, on est capable de référer rapidement vers le médecin. Mais non, on a montré toute la pertinence, puis on étant l'équiné, les physios en général, toute la pertinence qu'ils ont, souvent, peut-être pas le répéter trop fort pour nos collègues médecins, mais on est mieux outillé pour prendre en charge des douleurs musculo-squelettiques, des lombalgies, qu'un médecin généraliste, pour dire quelque chose. Il y a des études d'ailleurs... On montre que des études qui ont été faites par chez nous au Québec, d'avoir un physiothérapeute à l'urgence, plutôt qu'un patient qui a une lombalgie ou une blessure musculo-squelettique voit un urgentologue, il voit un physiothérapeute. Et non seulement c'est moins coûteux, mais c'est également plus efficace. Sur le long terme, le patient se rétablit plus favorablement que celui qui a vu un urgentologue. Et je ne veux pas jeter la pierre aux urgentologues, ils ont tellement de connaissances et de choses à savoir. Nous sommes des experts, dans ce cas-ci, par exemple, du musculo-squelettique. On sait quoi faire avec quelqu'un qui a une lombalgie. L'État aurait tout à fait avantage à nous faire intervenir davantage, à utiliser notre expertise à bon escient pour les patients. L'idée, ce n'est pas d'être corporatiste, mais de dire qu'on est bon pour faire ce genre de choses. Faites-nous confiance, vous allez voir.
- Speaker #0
Pour reconnaître les compétences de chacun, bien sûr.
- Speaker #1
Voilà.
- Speaker #0
Merci pour ces partages.
- Speaker #1
Avec grand plaisir.
- Speaker #0
On se retrouvera encore dans les couloirs du Summit.
- Speaker #1
Certainement, à parler d'intervention médicamenteuse et de kinésithérapie.
- Speaker #0
Merci beaucoup.
- Speaker #1
Merci.
- Speaker #0
Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur trois en France. Rassurant non ? Des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés.