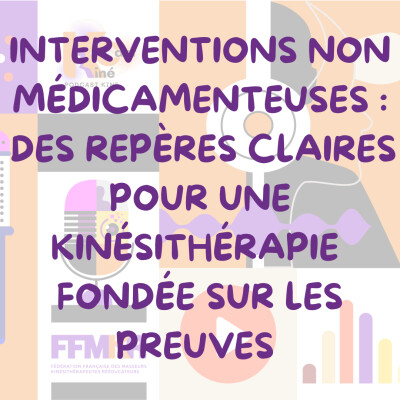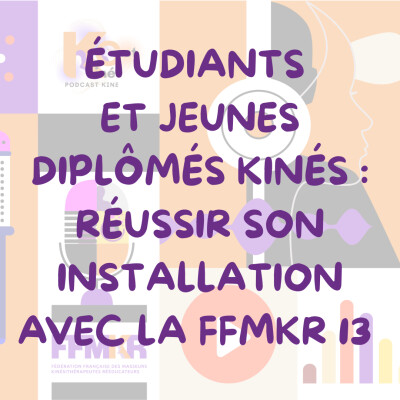- Speaker #0
Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la FEDE, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique, et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la FEDE, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute ! La médicale un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur trois en France. Rassurant non, des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le nouvel épisode de Kinecast. Aujourd'hui, on va parler des interventions non médicamenteuses. Sujet qui est abordé, qui figure dans de nombreux rapports nationaux, internationaux de l'HAS, de l'OMS, mais qui reste encore assez flou. Pourtant, c'est des pratiques qui sont essentielles, notamment pour la kinésithérapie. Pour mieux comprendre ce que sont les interventions non médicamenteuses et leur cadre, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Grégory Nino, professeur à l'Université de Montpellier, chercheur à l'Institut du cancer de Montpellier. président de la société savante Non Pharmacological Intervention Society. Bonjour Grégory. Bonjour Céline. Comment vas-tu ?
- Speaker #1
Très bien.
- Speaker #0
Je te remercie tout d'abord d'avoir accepté l'invitation.
- Speaker #1
Avec plaisir.
- Speaker #0
Et puis, on va rentrer toujours de suite dans le vif du sujet, mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer, voilà, qu'est-ce qui t'a animé, qu'est-ce qui t'a intéressé, pourquoi tu es venu vers les interventions non médicamenteuses ?
- Speaker #1
Alors, je suis un chercheur. Je suis professeur à l'université de Montpellier, j'ai un double cursus en psycho et en STAPS, mais je fais de la recherche en fait sur les interventions non médicamenteuses depuis que je suis rentré à l'université en 1999 et déjà pour ma thèse. Et j'ai travaillé dans la BPCO, notamment sur l'évaluation de ces protocoles de soins qu'on ne savait pas qu'on les appelait des interventions non médicamenteuses, mais des programmes de TP, des programmes de réentraînement à l'effort, notamment chez les patients BPCO. Et puis ensuite, j'ai été recruté par l'Institut du cancer de Montpellier pour évaluer les soins de support qui sont en train de se développer et dont on pensait qu'ils étaient complémentaires, accessoires, secondaires. Et ils sont devenus par la recherche finalement des outils absolument indispensables pour les patients.
- Speaker #0
Est-ce que tu peux donner des exemples d'ailleurs de ces soins de support ?
- Speaker #1
Très concrètement, dans la BPCO, si on prend un exemple dont... Probablement beaucoup de kinés ont l'habitude, mais effectivement c'est une maladie respiratoire qui est notamment due au tabac, à peu près à 80%. Et dans les années 80, l'enjeu était de dire attention si vous avez une dyspnée, une dyspnée d'effort notamment, finalement il fallait absolument rester allongé ou rester assis et ne pas bouger. Et donc tout un travail de recherche a été mené pour faire des programmes de rentraînement à l'effort. au seuil ventilatoire, donc en gros pas en cherchant à forcer, mais au contraire à avoir un niveau d'intensité minimal, mais continu pour avoir une amélioration, en particulier musculaire, puis neuromusculaire, puis finalement une stimulation centrale qui permettait de diminuer la douleur, donc diminuer la dysnée, et d'avoir finalement une augmentation de la qualité de vie, une augmentation de la durée de vie et aussi une réduction de l'hospitalisation. Et donc il y a quelques années, on a publié un papier en montrant qu'on faisait des économies de santé et donc notamment des hospitalisations moins fréquentes pour exacerbation de la BPCO et avec également une amélioration de la qualité de vie, une amélioration de la tolérance à l'effort par ce type de programme. Et donc ça a été quelque chose qui a été finalement beaucoup plus précisé. Donc c'est un programme de rentraînement à l'effort et ce n'est pas l'activité physique, même si on entend parfois parler du sport ou de l'activité physique. Non, c'est un programme qui est ciblé. qui est spécialisée sur cette pathologie et sur laquelle aujourd'hui on a toutes les preuves et toutes les évidences que par la recherche clinique en particulier qu'il faut absolument le prescrire pour les médecins et ce n'est pas toujours le cas, hélas suffisamment. Et potentiellement ces activités de kiné se font soit en cabinet libéral ou potentiellement aussi dans les centres de réhabilitation respiratoire. Et donc aujourd'hui il y a vraiment l'obligation clairement de faire ces réentraînements à l'effort. Parce qu'il y a à la fois des bénéfices médicaux, mais il y a aussi des bénéfices économiques. Il y a aussi évidemment des bénéfices sur la qualité de vie des patients. Et je peux donner d'autres exemples, et donc dans le domaine de la kiné, mais sur le cancer, le cancer du sein en particulier, la chirurgie, va avoir des impacts qui peuvent être parfois conséquents. Et sur lequel des lymphodèmes peuvent apparaître, et sur lequel des protocoles spécialisés par leur recherche clinique ont pu montrer qu'ils étaient bénéfiques. Mais finalement, on ne savait pas les appeler. Et vous allez voir, on va en parler, j'imagine, mais qu'effectivement, depuis qu'on en avait un petit peu évoqué ou subodiré le fait qu'il fallait en faire, la Haute Autorité de Santé, en 2011, a publié un rapport en disant qu'il faut absolument valider et prescrire des interventions non médicamenteuses. Et ce rapport a été un déclenchement pour moi de quelque chose que je faisais depuis dix ans en recherche avec Hospitalière au CHU de Montpellier au départ. Et dans mon laboratoire de recherche, en disant bon sang, mais il faut aller plus loin. Et effectivement, ça s'appelle comme ça. Ce n'est pas un joli mot, peut-être qu'on y reviendra. Mais effectivement, on est parti sur le mot intervention non médicamenteuse. Et on voyait déjà que l'Organisation mondiale de la santé en parlait en 2003.
- Speaker #0
Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à créer justement ? Qu'est-ce qui a motivé la création de l'ANPIS ?
- Speaker #1
Alors, d'une part, donc... À la publication de ce rapport de la Haute Autorité en 2011, on a créé une plateforme universitaire. J'étais directeur adjoint d'une unité de recherche à Montpellier, à l'Université de Montpellier, sur lequel on avait des médecins, sur lequel on avait des paramédicaux, et donc on s'intéressait effectivement à l'évaluation de ces pratiques non médicamenteuses. Mais c'était tellement académique qu'on parlait entre nous, chercheurs. Et on publiait entre nous, dans des revues entre nous, on s'applaudissait en disant on est les meilleurs du monde, mais finalement ça calait souvent des armoires, c'est ce que je disais souvent aux étudiants, et que ça n'avait pas d'impact réel sur la pratique. Et on s'est dit peut-être qu'on a oublié finalement dans la recherche, ce qui aujourd'hui s'appelle la recherche participative, mais en tout cas l'idée qu'il faut associer les patients, il faut associer les professionnels, il faut associer les opérateurs de santé dans une réflexion sur l'évaluation de ces interventions de médicaments. Et donc, j'ai créé avec mes collègues une plateforme universitaire qui était un think tank, quelque chose comme ça, sur les modalités d'évaluation de ces interventions non médicamenteuses. En 2011, aux universités de Montpellier, donc aux deux universités de Montpellier, on était à peu près une centaine à réfléchir, à commencer à faire un congrès au quorum de Montpellier. Puis après, on l'a fait au Canada et autres en disant mais c'est un sujet important et on doit le traiter non pas entre chercheurs, mais il faut aussi qu'il y ait des praticiens. Il faut aussi qu'il y ait des patients qui... qui voit un petit peu comment on pourrait faire des évaluations. Et là, on s'est lancé à l'inventaire des modèles d'évaluation de ces interventions de médicamenteuses, donc de développement et de validation. Et un de mes thésards, qui s'appelle François Carbonelle, qui était médecin généraliste de formation, qui est devenu professeur à l'université de Montpellier, à la faculté de médecine de Montpellier, a dit on va faire un tour dans les littératures, puisqu'on sait qu'il y a un modèle de validation du médicament, un seul. Tout le monde est au courant, les chercheurs, les opérateurs, les patients, il y a un modèle de validation du médicament. Et combien il y en a-t-il pour la validation des interventions de médicamenteuses ? Et on a publié un papier en 2019 en montrant qu'en avril 2019, il y avait 46 modèles, 46 paradigmes d'évaluation. Donc s'il y a 46 paradigmes, finalement... On ne peut jamais savoir ce qu'est une donnée probante. Si on était Québécois, on dirait une donnée probante. Mais c'est quoi une donnée probante ? Finalement, on ne sait pas, puisqu'il y a 46 méthodologies et 46 logiques. Et donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit, sur cette plateforme universitaire, peut-être qu'il faut aller plus loin. Et un de mes maîtres, qui s'appelle Henri Pujol, qui j'en hommage, qui a été un des acteurs majeurs du plan cancer, m'a dit, il faut que vous créez autre chose. qui ait un impact plus important. Et c'est quoi cette autre chose ? C'est une société savante. On ne savait pas, on connaissait, on travaillait avec des sociétés savantes, notamment la SPLF pour les maladies respiratoires. Mais comment créer une société savante sur cette thématique qui est transversale ? En fait, elle touche l'ensemble des pathologies, elle touche l'ensemble des personnes, jusqu'à la perte d'autonomie également, qui touche beaucoup les kinésithérapeutes. Et donc, on a créé cette HPS, non-pharmacological intervention society. Mais avec une réflexion de départ de nos dix ans de travail, en disant mais en fait, un protocole de kiné validé, il est peut-être pour la France, mais finalement, il est identique quelque part dans ses caractéristiques pour la Belgique. Mais en fait, il est peut-être caractéristique de façon identique pour tous les pays européens. Mais finalement, il est peut-être valable également en Chine où il est capable. Il est peut-être valable à l'étranger. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, au sens large du terme, prévoir un... protocole qui soit partageable, qui soit traduit en plusieurs langues et qui soit effectivement diffusé. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé une société internationale, mais dont il a fallu effectivement constituer toutes les pièces pour que on ait un modèle consensuel, mais peut-être qu'on va en reparler, une description et une définition précise de ce mot intervention non médicamenteuse qui, quand on ne le connaît pas, peut-être que les auditeurs qui nous écoutent vont dire, mais intervention non médicamenteuse c'est une chirurgie. L'intervention de médicamenteuse, c'est une mesure de santé publique comme l'augmentation du prix du tabac. Peut-être que l'intervention de médicamenteuse, c'est une CPTS, c'est une organisation de santé. On peut tout imaginer à travers ce mot et on a fait tout ce travail pendant trois ans de façon très collective pour arriver à donner une définition et donner un modèle d'évaluation.
- Speaker #0
D'accord. Donc là, c'est vraiment vos objectifs à la création de la NPIF.
- Speaker #1
Exactement.
- Speaker #0
D'accord. Alors... Comment le travail de la NPIS a abouti à une définition des interventions non médicamenteuses ?
- Speaker #1
On a lancé ce travail coopératif et participatif le 1er décembre 2021 au ministère de la Santé, en disant qu'on fait appel à toutes les personnes s'intéressant aux interventions psychosociales, aux interventions corporelles, thérapie manuelle et autres méthodes de rééducation. et aux interventions nutritionnelles en disant est-ce que vous pourriez collaborer à la construction d'un modèle consensuel d'évaluation des interventions non médicamenteuses, puisqu'il en existait 46. Et donc on a lancé ce travail où, pendant toute l'année 2022, on a fait un brainstorming pour récupérer les meilleures recommandations méthodologiques sur les recommandations méthodologiques au sens du design de l'étude, de la mesure des marqueurs de santé, donc sur les critères. PICO pour faire court, quelle population, quelle intervention. Et donc, il y avait beaucoup de publications, et vous pouvez en voir parfois dans des revues de kinés, sur lesquelles il y a écrit « protocole de kinés » , mais finalement, on ne sait pas ce qu'il y a. Très, très bien, quels sont les exercices, quels sont les enchaînements, y a-t-il des questions de doses, finalement, une séance par semaine ou une séance par mois, ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, il y avait plein, plein de débats, donc on a essayé de préciser, et on a eu et on a publié. soit le papier, ce modèle s'appelle le NPIS modèle, qu'on peut retrouver, qui est accessible partout en ligne, qui permet d'avoir des recommandations méthodologiques et des recommandations éthiques, 77 en tout, concevoir finalement une logique exactement comme pour le médicament, d'une étude exploratoire, donc on appelle une étude prototypique, pour définir quel est le protocole, et donc on invite et on incite les kinés qui sont en collaboration avec des équipes hospitalières, ou des équipes de la médecine de ville également, les MSP, MSPU, il y a de plus en plus de recherches, de dire faites des études prototypiques pour caractériser votre intervention. Et ensuite, une autre étape va être de voir par des études mécanistiques, quels sont les mécanismes d'action qui se jouent, donc identifier au moins un mécanisme d'action. Et ensuite, on a la partie importante qui sont des essais cliniques, et on a fait des recommandations particulières, et on s'est aperçu de choses particulières. notamment que les organisations nationales de santé disaient qu'il faut un essai randomisé contrôlé en double aveugle. Comment voulez-vous faire ? Puisqu'il parle de gold standard, oui, c'est le gold standard du médicament. Mais ce n'est jamais le gold standard d'une intervention non médicamenteuse organisée et administrée par un kiné. C'est impossible. Le patient est au courant qu'il y a écrit sur la plaque, quand il arrive, kiné, et qu'il est en face de lui un kiné. Donc le double aveugle. où le triple aveugle tel qu'on l'évoque était complètement impossible. Donc on a fait ce consensus avec un comité, et je tiens à le remercier, un comité de 22 experts, académie médecine, des mathématiciens, on va dire des biostatisticiens, des spécialistes de gériatrie, des spécialistes de douleur, des spécialistes en bio, en psychosocial, en économie de la santé également. Et on a fait ce brainstorming avec, encore une fois, des représentants patients. des représentants également praticiens, des représentants des organisations de santé et des chercheurs. Et donc on a fait ce brainstorming, donc une année pour faire ce premier brainstorming, et ensuite on a fait des sessions vidéoconférences pour arriver à voir comment on pouvait améliorer l'ensemble de ces recommandations. Et on est arrivé au bout en les présentant aux sociétés savantes, toutes les sociétés savantes qui le souhaitaient, et aujourd'hui donc ce modèle. Encore une fois, le MPIS modèle qui est à disposition en ligne, en français, en anglais et en espagnol. On a effectivement un modèle d'évaluation qui va permettre de développer des interventions, notamment en kiné, et qui vont être partagées parce qu'effectivement, on a des choses qui sont consolidées. J'ai oublié de vous parler des aspects des études cliniques. Il faut également des études d'implémentation. On s'est aperçu que, contrairement aux médicaments, chez nous, on a aussi des contextes culturels spécifiques. Peut-être que ces méthodes de kiné peuvent être validées aux États-Unis, mais le sont-elles en France ? Et donc, on fait une recommandation pour qu'il y ait une étude d'implémentation en France pour identifier les bonnes pratiques d'usage de ces protocoles, parce qu'il y a des astuces, et de les partager finalement à la communauté. Donc, cet enchaînement de logiques de validation. nous permet aujourd'hui d'avoir quelque chose qui est consolidé. Donc 32 sociétés savantes, la cardiologie, la neurologie, la pédiatrie, et donc jusqu'à la santé publique, la nutrition. Donc on a beaucoup, et la société évidemment de physiothérapie également soutient le modèle. L'enjeu c'est de pouvoir porter ce modèle peut-être plus loin, c'est-à-dire au niveau européen et au niveau international, parce que finalement on peut faire la recherche de la même façon. qu'on soit en France, qu'on soit en Nouvelle-Zélande ou en Australie ou ailleurs, et qu'effectivement, on partage les bonnes pratiques pour que les patients soient évidemment mieux soignés, tout simplement.
- Speaker #0
Alors, quelle est cette définition des interventions non médicamenteuses ?
- Speaker #1
Un point très important, c'est que c'est une intervention qui est fondée sur la science. C'est un sujet important et là, tout d'un coup, ce n'est pas la science en général, mais c'est bien ce NPS modèle. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des interventions. qui soit décrite, c'est-à-dire un début, un milieu et une fin, donc ce n'est pas l'activité physique, c'est vraiment une intervention avec ensuite la description d'une indication. Donc il faut qu'on vise quelque chose, on n'est pas là pour dire on va faire du bien, l'approche holistique ça ne veut rien dire. On va viser par exemple l'amélioration de la lombagie chronique, et donc ce protocole il cible, donc je vais continuer dans la description là, mais il va y avoir... des effets potentiellement secondaires, des risques, et donc la recherche va identifier des risques. Il y a peut-être un message important d'un des doyens de la fac de médecine de Montpellier qui s'appelle Jacques Bringer, qui disait « Toute intervention de santé comporte des risques. Si elle ne comporte pas de risques, ce n'est pas une intervention de santé, c'est une activité de divertissement. » Et beaucoup parfois de kinés vont dire « Non mais... » « Ma méthode, elle fonctionne, vous n'en faites pas, vous n'aurez aucun risque. » S'il n'y a aucun risque, attention, le risque, c'est que c'est juste du divertissement. Et donc, la recherche permet de dire qu'il y a potentiellement des risques. Des populations non répondeuses, des populations qui vont avoir des effets secondaires, et sur lesquelles, s'il y a des risques, on peut mettre ou identifier des précautions pour qu'effectivement, ça n'arrive pas. Ensuite, il y a des explications. C'est aussi un élément très important. Une intervention de médicamenteuse, elle doit avoir un rationnel ou des explications physiologiques ou des explications psychosociales ou neuropsychosociales, parce qu'effectivement, on doit y trouver des mécanismes. Même si, contrairement aux médicaments, il n'y a jamais un mécanisme d'action. Il y a des mécanismes qui sont souvent de façon concomitante. Mais en effet, il faut qu'il y ait des études qui aient pu montrer que ça ne vient pas de Mars ou ça ne vient pas de quelque chose d'ésotérique, mais bien d'une intervention explicable. Ensuite, il faut que ce protocole soit, comme je l'ai évoqué, décrit avec un début, un milieu, une fin, avec un cadre particulier, avec un matériel particulier. Il faut qu'un professionnel, et donc souvent quand c'est une intervention de kiné, c'est un kiné qui le met en œuvre. Donc, il est effectivement formé à cette intervention. Et il y a un contexte, et c'est aussi un élément important, ça se passe dans un contexte de santé. Une anecdote, à Montpellier, il y a sur la place particulière, le samedi, des hypnothérapeutes de rue. Je suis désolé, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils font avec une carte de visite en disant « venez chez moi après » ? Je suis désolé, mais le contexte de l'hypnothérapie, si elle existe en tout cas, elle ne se passe pas là. Elles se passent dans un cabinet, dans un contexte ou dans un hôpital. Mais on est là dans des dépassements, dans des risques de dépassement de fonction ou autres qui sont vraiment des atteintes à la personne. Donc voilà la description de cette intervention de médicamenteuse. Et évidemment, tout l'enjeu va être après, une fois qu'on a décrit cette intervention, qu'on l'a expliquée, qu'elle est sûre, qu'elle est implémentable. Ça veut dire qu'elle est implémentable dans un contexte national en particulier. Tout l'enjeu, c'est d'aller plus loin. Et notre société savante, de réflexion de toute l'équipe, parce qu'on a à la fois des collaborateurs australiens, canadiens, de différents pays, mais il faut pouvoir partager la connaissance. La mission d'une société savante n'est pas de pousser à tel ou tel remboursement ou du choix, mais par contre de partager les connaissances sur les bonnes pratiques des interventions de médicaments. Et donc par des recommandations du ministère de la Santé, de l'assurance maladie. de la CNSA et d'une discussion avec, en particulier, la Haute Autorité de Santé, mais après on a échangé avec l'Académie de médecine. Il faut pouvoir créer une plateforme, un portail qui permet de partager ces bonnes pratiques. Et donc là, tout d'un coup, on s'est dit, il faut y aller, effectivement, et associer les sociétés savantes qui le souhaitent à proposer des interventions non médicamenteuses selon les règles dont j'ai parlé, pour les intégrer dans une... Forme de catalogue finalement, c'est vraiment un catalogue qui va permettre de constituer finalement un patrimoine mondial de ces interventions de prévention et de soins. Et effectivement, on a eu un go et donc on fait un congrès qui s'appelle le NPI Summit tous les ans. Il se passe notamment en ce moment à Paris et il va se passer du 15 au 16 octobre. 2025 à la Cité Universitaire Internationale de Paris et sur lequel on veut inviter, inciter des kinés à rédiger des fiches d'intervention non médicamenteuse qui pourraient partager et inscrire dans le référentiel. Tout ça, c'est gratuit, évidemment, mais pour le partager. On s'est rendu compte que des méthodes qui auraient pu être faites, évidemment, dans votre secteur, je vais prendre peut-être un exemple. Peut-être que tu vas me poser la question. Sûrement. Mais effectivement, on est vraiment très surpris de voir que dans certains pays, c'est très connu, il y a des protocoles qui sont très robustes, très bien validés. Mais pour des raisons de langue, pour des raisons d'habitude, pour des raisons de je ne sais trop quoi, en fait, les bonnes pratiques ne se diffusent pas. Or, comme je l'ai dit en introduction, une intervention de médicamenteuse, c'est un protocole de soins, il est validé, il est consolidé, pourquoi ne pas le partager ? Après, que le kiné l'utilise ou pas ? Que le professionnel l'utilise ou pas, ça dépend de son choix à lui, évidemment, de dire « oui, c'est le bon, moi je préfère en créer un » . Ce n'est pas un souci, nous on n'est qu'une société savante, mais au moins qu'il soit au courant que ces protocoles sont bien consolidés. Et peut-être aussi, à travers notre catalogue des interventions non médicamenteuses, le référentiel des INM, c'est aussi l'idée que les patients soient au courant de ces interventions. Et donc là, on a franchi des caps importants avec... les organisations de santé françaises pour dire, mais bon sang, mais vous avez souvent l'occasion d'identifier des actes de kiné. Oui, c'est vrai, des actes, des séances de kiné. Mais la question, c'est qu'une séance pour une séance, ça ne sert pas forcément à grand chose. Ce n'est pas rentrer dans un programme ou dans un protocole de soins. Et donc, tout l'enjeu, c'est de qualifier, de nommer quelle est l'intervention et que le patient, comme le professionnel, soit au courant, mais aussi que l'administration soit au courant de cette intervention. Et donc c'est en train de faire lentement, mais sûrement, chemin dans l'assurance maladie en particulier. Je tiens à remercier notamment Marguerite Gazneuve et madame Catherine Grenier également et toute l'équipe de l'assurance maladie pour dire là on peut avoir finalement des protocoles qui peuvent être tracés parce qu'ils ont un code. Et s'ils ont un code, ça veut dire que demain, dans les IA, parce que je pense que dans votre métier et le métier de demain qui est, pour certains, dit que les humains vont être remplacés par des robots et par des IA, moi je ne crois pas. Je pense que les soins qui soignent les humains, si on arrive à les qualifier en protocole, les IA vont apprendre à intégrer ces protocoles. Mais si elles ne mesurent qu'une séance, donc un acte de kiné, l'IA ne le retrouvera pas. Elle aura juste l'intervention d'un kiné, oui, c'est vrai, qui a pu être bénéfique. Mais finalement, est-ce que l'intervention, elle est aussi traçable que ça ? Ben non, il n'y a rien. C'est comme si on mesurait quelque chose qui est à l'aveugle et on ne sait pas ce qui a été fait dans ces séances. Et pourtant, il y a des astuces, il y a plein de pratiques qui se font. Et ce savoir pratique ou expérientiel doit pouvoir être finalement cumulé dans une fiche à disposition, gratuitement. et sur lequel il y a un code, et ce code va être appris par les IA, et finalement on va pouvoir les repérer, on va pouvoir les tracer, et peut-être qu'on parlera après du remboursement.
- Speaker #0
Donc oui, il y a plusieurs volets qui s'ouvrent justement, que ce soit dans l'identification du praticien qui va implémenter ces INM, il y a aussi le volet... de nos nomenclatures, d'intégration de ces INM dans nos nomenclatures. C'est vrai que ça ouvre des champs et de formation, de validation d'acquis aussi.
- Speaker #1
Tout à fait. Les deux aspects sont importants. La question de la diffusion et de la transmission, et sur lequel quelques-uns de mes amis kinés disaient qu'on a appris des modèles physiopathologiques et on a appris des techniques. Et il y a plein de papiers que j'ai vu passer dans la littérature en disant, vous vous débrouillez avec ces grandes théories physiopathologiques et ces techniques et faites les exercices comme vous voulez. La question, c'est que la combinaison, l'enchaînement, la dose, le contenu, en fonction des indications, on voit que la recherche peut permettre d'avoir des interventions qui sont plus efficaces dans une durée optimale pour permettre aussi l'autonomie. et donc il y a beaucoup d'absurdité quand on entend le sport santé on va rembourser le sport santé non, c'est une activité de loisir en revanche, un protocole de kiné qui va me permettre de reprendre confiance de m'améliorer sur le plan de ma coordination de mon fonctionnement quotidien musculaire, neurophysio, etc oui, effectivement, je vais pouvoir m'en servir pour repartir, c'est un effet starter qui me permet après de faire du sport et le sport que je souhaite Mais là, ces amalgames-là, ils sont permanents. Donc en effet, la formation à ces protocoles dans les écoles de kiné, en formation initiale ou en formation continue, et ce n'est pas notre rôle, nous, société savante, de former évidemment à ces interventions, mais au contraire de dire, regardez, apprenez aussi et discutez de ces protocoles, de leur intérêt, de leurs limites, de leurs indications, et essayez de voir comment on peut faire progresser ce référentiel, parce que ce référentiel va progresser. des retours d'expérience des praticiens comme des usagers sur lequel le créateur de l'INM, on va lui repartager tout ça gratuitement, évidemment. Donc les contenus et les retours d'expérience pour, encore une fois, la partager, l'améliorer, la traduire et autres. Et la deuxième partie, c'est effectivement ce que tu évoques, la question de la reconnaissance. Et là, on a un gros problème, mais on l'a appris un peu naïvement lorsqu'avec l'Inserm, on a fait un forum le 5 décembre 2024 à Bruxelles, sur lequel on s'est aperçu que l'Europe est centrée sur les produits, les médicaments, les dispositifs médicaux.
- Speaker #0
avec beaucoup d'argent là-dessus, et est centré sur des recommandations de santé publique. Manger moins gras, moins sucré, moins salé, et ainsi de suite, les campagnes qui sont importantes. Mais au milieu, les soignants qui soignent, les protocoles d'intervention, ils disent, non, ce n'est pas à nous, c'est au pays souverain de faire ça. Mais pourtant, vous financez bien la recherche médicamenteuse, donc comment se fait-il que vous ne financiez pas ? La recherche non médicamenteuse, donc des humains qui soignent. Donc on travaille avec en particulier Iveta Nagiova qui est aujourd'hui vice-présidente de la NPIS, qui était l'ex-présidente de l'Association Européenne de Santé Publique, pour effectivement consolider et encourager la recherche. Que dès qu'il y ait de l'argent pour étudier précisément tel ou tel protocole et dans quelle indication et comment. Donc cette recherche... amène aussi à la question après du remboursement et de la prise en charge. Parce qu'effectivement, on voit des mutuels qui essayent de se faire la guerre en allant rembourser telle ou telle pratique ésotérique. Mais au moins, ils pourraient au départ rembourser les choses qui sont validées par la science. Ils ont le choix, c'est à eux de faire. On est une société savante, mais effectivement, on dit aux autorités et on collabore avec la haute autorité de santé dans les recommandations qui sont faites. finalement de la Haute Autorité de Santé, notamment sur des interventions nutritionnelles, psychosociales et corporelles, de dire, oui, il y a des pratiques qui sont validées et on va finalement avoir un catalogue. Et donc, ce catalogue de pratiques protocolisées, manualisées, si on était en anglais, en fait, on peut les avoir à disposition et on peut les utiliser et donc les tracer, encore une fois, à une facilitation au remboursement.
- Speaker #1
Est-ce que tu as des exemples, justement, de référentiels qui sont déjà financés ?
- Speaker #0
Alors aujourd'hui, la question ça dépend si elle est sur les pratiques ou si elle est sur le référentiel en lui-même. Est-ce que c'est sur le catalogue ou est-ce que c'est plutôt sur les interventions ?
- Speaker #1
Plutôt sur le catalogue par exemple ?
- Speaker #0
Alors sur le catalogue, effectivement, chacun y va de sa classification. Et on a vu en France fleurir parfois des portails de pratiques. mais sur lequel j'alerte les kinés sur l'écart qu'il peut y avoir entre des portails d'approche non médicamenteuse. Approche non médicamenteuse, ça veut tout dire. Ça peut être une relation, la qualité de la relation, ça peut être... Donc, c'est très, très flou. Et de l'autre, vous pouvez avoir des techniques. Donc, des techniques très, très simples sur lesquelles il y a un catalogue de techniques ou d'exercices. OK, super. Mais un catalogue d'exercices n'est pas un... Une intervention de médicaments, c'est un enchaînement. Et donc nous, on a vraiment centré et on veut co-construire avec les sociétés savantes. On a 32 sociétés savantes, encore une fois, pour l'instant, beaucoup, enfin on en a 30 françaises et 2 européennes. Mais on veut effectivement mobiliser d'autres sociétés et pourquoi pas la société savante. On est en train de discuter en tout cas avec la société internationale de kiné. On a invité à notre congrès Yves Hérotin, qui est un professeur de Liège. qui a s'est spécialisé notamment dans la gériatrie et en kiné et en gériatrie et en rééducation, et sur lequel il a beaucoup de choses à dire. Donc ce catalogue, aujourd'hui, il est financé en partie par la CNSA, donc ce référentiel, et il finance évidemment le développement informatique, mais aussi l'outil pour qu'il soit sécurisé. Et tout l'enjeu, c'est effectivement de dire, maintenant qu'il y a un code, on propose à l'assurance maladie comme au mutuel. de regarder ce catalogue et de dire ok moi je suis prêt à rembourser cette intervention qui est faite là en l'occurrence par un kiné et je suis prêt à penser des modèles tiers payants qui serait compatible la réalité c'est que nous on n'est que société savante on partage une connaissance et c'est maintenant à eux de faire finalement leur marché pour effectivement dire, je vais prendre telle ou telle intervention. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que les mutuelles, elles ont des branches, donc elles sont spécialisées soit dans le bâtiment, soit dans tel ou tel métier, et que finalement, les interventions de médicamenteuses, elles ont certainement à faire des choix parce que certains métiers sont plus à risque sur telle ou telle problématique, et donc il y a des méthodes de kiné qui vont mieux marcher sur telle ou telle population. Mais encore une fois, nous on fabrique simplement un catalogue de pratiques validées par la science, améliorables, implémentables, traçables. Et puis évidemment, tout l'enjeu, c'est qu'eux fassent leur marché, soient au courant de ce qui se passe et peut-être renforcer la qualité, la traçabilité et évidemment, avant tout, la santé des personnes.
- Speaker #1
Alors, dans le domaine de la kinésithérapie, donc, quel par exemple INM a été validé par la NPIS ?
- Speaker #0
On pourrait prendre un exemple très concret pour bien saisir. Vous avez des injonctions en permanence chez les kinés ou ailleurs par l'assurance maladie. Il y a eu un rapport en disant que la chute chez la personne âgée coûte 2 milliards d'euros par an, notamment d'hospitalisation, de chirurgie, et c'est extrêmement problématique. Et la réponse, souvent, c'est d'encourager les personnes de plus de 80 ans à marcher. Le problème, c'est que... Les personnes de plus de 80 ans vont, si elles marchent plus, s'exposer à la chute et donc chuter plus. Et d'autre part, les personnes de plus de 80 ans marchent à vitesse lente, plutôt sur terrain plat et plutôt à faible vitesse, et sur lequel il n'y a pas de progrès physiologique, musculaire, de coordination, et au contraire, elles se fragilisent. Et donc, il y a un monsieur, dans les années... 90, qui s'appelle Campbell, en Nouvelle-Zélande, qui a dit mais c'est plus possible de continuer à faire des recommandations de cette nature-là, bouger plus. Oui, cette recommandation de santé publique, elle est générale et elle est utile, mais là, en l'occurrence, c'est extrêmement dangereux pour les personnes âgées de plus de 80 ans, et je vais penser à une méthode particulière. Et donc, avec sa kiné, chef, dans son hôpital, il monte un programme qui s'appelle le programme Otago. Et le programme Otago est fait pour faire du renforcement musculaire, pour faire de la coordination et pour faire toute une pensée de rééducation finalement avant même la chute. Et il fait les essais cliniques dont je vous parlais, c'est-à-dire des études cliniques, il fait des études médico-économiques, il fait des études également d'implémentation et sur lesquelles il montre qu'il y a 30% de chutes en moins chez les personnes âgées et s'il y a des chutes, elles sont moins graves. Donc on fait des économies dans tous les sens. Et donc il fait un manuel de son programme, qu'il écrit en anglais naturellement, et qu'il diffuse au monde entier en disant « vous pouvez l'utiliser » . Mais c'est un PDF qui traîne dans un coin, et ce PDF, il est repris en Angleterre et il est repris en Hollande parce qu'ils sont très anglophones et très compatibles. Et donc ce programme, il est très connu. En revanche, en France... lorsque j'ai interrogé des kinés, peut-être que tu l'as eu dans tes cours. Non, j'avoue, j'avoue. Mais ce protocole Otago est quelque chose de très connu et sur lequel ils ont fait toutes les preuves. Mais au moins que dans les écoles de kinés, lorsqu'on parle de prévention de la chute chez les personnes âgées, on connaisse en détail ce protocole. Et donc, c'est tout l'objet. Finalement, c'est une illustration, et je pourrais en prendre également dans le domaine du cancer, mais sur lequel des gens ont pensé, ont fait de la recherche. Et donc ce monsieur Campbell est devenu doyen. de la faculté de médecine de Nouvelle-Zélande, d'une édine précisément, et sur lequel il a consacré sa vie à dire, mais regardez, mon protocole marche. Ça ne veut pas dire que les autres protocoles ne marchent pas, mais au moins que vous soyez au courant dans les écoles et ainsi de suite. Et donc notre façon de faire, c'est qu'on les traduit pour l'instant en français et en anglais sur ce portail. C'est accessible, c'est gratuit, et au moins vous avez toutes les publications, Vous avez l'ensemble de... des méthodes de mise en œuvre, en tout cas le cahier des charges de mise en œuvre. Donc, vous avez tout l'aspect pratique pour le mettre en œuvre. Mais effectivement, il y a des questions de dose, il y a des questions d'exercice, il y a des questions de progressivité. Il y a des questions qui ne sont pas uniquement une séance pour une séance. Voilà un exemple classique des INM.
- Speaker #1
Et l'une de vos envies, d'ailleurs, c'est que les praticiens nous fassent des retours d'expérience, aussi contribuent à l'évolution de ces référentiels.
- Speaker #0
Exactement ça. C'est-à-dire que ceux ou celles qui mettent en œuvre... le programme Otago, concrètement, qui est sur la plateforme, soit face en tant qu'usager ou en tant que professionnel, des recommandations en disant, oui, mais j'ai repéré, je vais dire une bêtise, mais que ça marche mieux le matin plutôt que l'après-midi. Tiens, j'ai repéré que pour tel exercice, on voit que si on va un petit peu plus loin, donc des astuces, un savoir expérientiel, un savoir un petit peu qui existe, c'est-à-dire que tout le monde, tous les kinés font des interventions non médicamenteuses parfois sans le savoir. Mais de faire remonter ces informations, c'est une idée de faire une amélioration continue des usages, mais exactement comme ça s'est passé dans le médicament, c'est-à-dire de faire progresser quels sont les bons répondeurs, quelles sont les populations non répondeuses, quels sont les bons contextes d'utilisation, quelles sont les personnes sur lesquelles il faut mettre en œuvre des précautions complémentaires et sur lesquelles, effectivement, on va faire progresser le contenu. Et c'est tout l'enjeu, en effet.
- Speaker #1
Donc il y a cette diffusion auprès des professionnels de santé qui est accessible aussi aux patients. Et je pense qu'on peut aller au-delà même aussi au sein de notre système de santé, de par les financements aussi, mais aussi au sein de... On voit beaucoup dans les réseaux sociaux justement de désinformation. Je pense que ça peut être aussi l'une des missions en fait de cette diffusion.
- Speaker #0
Alors on sait longtemps... Poser aussi cette question. On pense qu'il y a des organismes, les fédérations de professionnels, les organisations professionnelles qui sont là pour lutter au sens de l'obscurantisme et des pratiques charlatanesques et que c'est vraiment un sujet important. Mais que ce n'est pas le rôle d'une société savante. Le rôle d'une société savante, c'est d'informer des pratiques qui sont valides par la science. Et en gros, notre but... où la lutte contre l'obscurantisme, pour nous, elle passe surtout pour montrer et indiquer les pratiques qui ne sont pas obscurantistes, mais qui ont vraiment été fondées sur la science, et qu'effectivement, au moins, vous soyez au courant de ce qui se passe. On pourrait peut-être parler de sujets polémiques, comme l'ostéopathie, mais en disant effectivement, l'ostéopathie en général n'est pas évaluable. Ça ne veut rien dire. Par contre, si un protocole d'ostéopathie a fait la preuve... dans effectivement une intervention particulière, sur une indication particulière, dans une fréquence particulière de son efficacité, de sa sécurité, de son implémentabilité, de sa description, de sa reproductibilité, alors ça peut rentrer dans le référentiel des interventions non médicamenteuses. Donc nous, on ne juge pas, et c'est pour ça que parfois sur les réseaux sociaux, on produit des choses en disant, il faut absolument dire à tous ces gens qui veulent faire la recherche, venez faire la recherche, prouvez que ça marche, mais c'est... Finalement, à vous la charge de la preuve de l'intervention. Et pas d'emblée, ma discipline, elle est efficace pour la santé. Non, ma discipline, ça ne veut rien dire. Par contre, ce protocole dans ces conditions, est-ce qu'il est efficace ? Oui ou non ? Effectivement, là, on pense qu'on va lutter contre l'obscurantisme, mais par une démarche positive, constructive, sur laquelle chacun passe un petit peu sur la paillasse pour aller faire effectivement les études qui conviennent. C'est besogneux, c'est lent, c'est... parfois contre-intuitifs. Et finalement, on arrive comme ça à partager les bonnes pratiques. Et c'est un petit peu le résultat de ce qu'on a et des soutiens qu'on a aujourd'hui. On était hier à l'Organisation mondiale de la santé pour proposer notre catalogue et réfléchir aux formations. Et effectivement, c'est un enjeu qui n'est pas un enjeu juste national, mais c'est bien une innovation française. On est fiers que ce soit quelque chose de collectif. D'avoir mis 1000 Français d'accord sur un modèle d'évaluation, ce n'était toujours pas simple, mais on a réussi. Et l'idée, c'est que ce soit la construction d'un patrimoine mondial de ces interventions immatérielles, parce qu'elles sont immatérielles. Ce ne sont pas des produits, ce sont des services. Mais ces protocoles, finalement, on peut arriver à avoir des preuves sur des actions de prévention, sur des actions de soins.
- Speaker #1
Alors, quelles sont les perspectives, justement, de ces INM ? Comment vous pensez, vous réfléchissez ? Merci. l'accélération justement sur la diffusion de ces INMA ? Alors,
- Speaker #0
plusieurs points. Le premier, c'est mobiliser les sociétés savantes pour, dans leur colloque ou dans leur revue, consacrer une rubrique, un chapitre, à ces interventions de médicamenteuses. Je pense que là, il y a un effort à faire pour que peut-être que des kinés qui disaient « Mais non, la recherche, c'est... » des choses très compliquées qui sont dans des labos et moi, je ne peux pas faire de recherche. Je crois que c'est vraiment inciter les praticiens à dire je peux collaborer à faire de la recherche et pas nécessairement toujours laisser clinique randomisée. Et non, on peut faire aussi des études prototypiques. On peut réfléchir en fait à l'implémentation. Donc, tout le monde peut être un acteur de la recherche. Je pense que là, il y a une action importante, en tout cas, à mener autour des sociétés savantes et autour des revues scientifiques ou professionnelles pour dire devenez des acteurs. des interventions de médicamenteuses et donc aussi reconnaître ce mot. Ce mot, c'est celui-là, ce n'est pas la chirurgie maintenant. On est désolé que ce soit ce mot qui a été choisi, mais on ne va pas en changer maintenant, c'est trop tard. Ça s'appelle INM, je ne sais pas ce que veut dire RATP ou ce que veut dire RER, mais par contre, je sais que je prends le train. Et donc, tout l'enjeu, c'est effectivement d'avoir cette partie-là de sensibilisation, de formation. Et donc, le deuxième point, c'est effectivement la partie formation. Donc... permettre à tous les formateurs dans les écoles de kiné, mais aussi en formation continue, de pouvoir peut-être mieux partager ou plus partager pour discuter du protocole de soins en tant que tel. Et que dans les formations, finalement, on ait des formations continues qui soient ciblées sur l'intervention. Et que là, il y ait des... Et ce n'est pas à nous de le faire. C'est évidemment, donc, en disant ce protocole Otago, pourquoi il n'y aurait pas des formations continues spécifiques sur le protocole Otago en France, faites par... des organismes de formation continue sur ce protocole ou d'autres. Un autre point important, c'est la question de la qualification juridique. C'est la raison pour laquelle on discute avec le ministère de la Santé, qu'on discute avec les organisations professionnelles et autres pour mieux qualifier. Pour l'instant, c'est fou, mais il y a un no man's land sur les services de santé. On ne sait pas trop comment les qualifier. Et donc comment on peut les qualifier veut dire clairement avoir une labellisation ou une qualification juridique qui permet de dire ce protocole, il est décrit comme ça. Et on voit, et donc un de mes amis qui est professeur de droit de la santé à Montpellier, qui s'appelle François Vialla, dit bien qu'il y a des vides juridiques qui se situent en France, mais aussi en Europe et encore plus évidemment dans le monde. Donc comment on peut les qualifier ? Je pense qu'on en fait appel en tout cas à des juristes qui seraient prêts à y travailler, parce que beaucoup de choses se font, mais elles se font de façon encore juridiquement pas bien établie, et sur lequel on pourrait ainsi mieux les qualifier et mieux... reconnaître finalement le travail de recherche qui a été fait en amont. Quand on parle de ce modèle de recherche, dans le médicament, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les industriels sont capables de réfléchir aux investissements à faire pour développer une molécule, la faire valider, la faire reconnaître et la faire après tracer. Là, de la même façon, tous les efforts de recherche en amont qui sont faits, tous les investissements qui sont faits en amont pourraient être finalement par une qualification juridique beaucoup mieux connue, reconnue. et clairement avoir une reconnaissance de la valeur, au sens de la valeur pas forcément que financière, mais aussi de la propriété intellectuelle. On arrive à aller sur Mars, on doit bien être capable, on arrive à créer des chansons, et les chansons, finalement, les chanteurs ont des droits, pourquoi pas, effectivement, dans le soin, ceux qui ont participé ou contribué à la création de ces protocoles, finalement, avoir aussi quelque part une reconnaissance. voilà et donc là toute la rééducation française, c'est un changement culturel. On sait que ça ne se fera pas tout de suite, on sait que c'est long, on sait que la recherche avance lentement. Mais l'avantage, c'est qu'on est là depuis 2011, comme je te l'ai dit, et que la création de la NPIS, c'est 2021. C'est tout récent. Et que c'est tout récent, et que finalement, quand on voit que, voilà, on était à l'OMS, on a également présenté au réseau de recherche clinique européen, qui s'appelle ICRIN. le grand réseau soutenu par l'Inserm en France, sur la recherche clinique. Et donc, ils ont découvert qu'à côté des dispositifs médicaux, donc les medical devices, c'est-à-dire toutes les technos sur lesquelles il n'y a quasiment pas d'intervention humaine, et sur les médicaments, aussi les chirurgies, il y avait à côté les interventions de médicamenteuses. Donc tu vois, on n'en est vraiment qu'au début de l'histoire, mais tout le monde dit que là, on en a absolument besoin. Encore une fois, parce que... On est d'accord, il y a un contexte ou un enjeu post-Covid sur lequel d'un côté il y a des charlatans et il y a vraiment de l'obscurantisme dans tous les sens et on voit beaucoup de patients abusés et de plus en plus. Et de l'autre, on voit apparaître Elon Musk avec ses robots en disant vous n'en faites pas, c'est les robots demain qui vont faire les chirurgies, nous soigner avec des intelligences artificielles et on n'aura plus besoin de soignants qui soignent. J'ai l'habitude dans mes cours de montrer une photo sur laquelle ces boîtes... Il faut les écouter quand même parfois en disant que l'humain ne sert à rien, il est là pour replacer un coussin, mais il n'est pas là finalement pour soigner. Non, nous on pense qu'au contraire, des soignants qui soignent avec des protocoles précis peuvent avoir un intérêt tout à fait majeur en prévention comme en soins.
- Speaker #1
Est-ce que tu as d'autres remises qui sont ajoutées ?
- Speaker #0
Oui, peut-être un dernier, c'est l'enjeu de la prescription. Je sais que les kinés aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations, sont en train de voir des choses évoluer. Et je pense que là, il y a un enjeu majeur aujourd'hui de connaître et de reconnaître les interventions non médicamenteuses, parce que peut-être que dans certains cas de figure, les sociétés savantes font apparaître qu'en première intention, il y a une intervention non médicamenteuse qui peut être parfois meilleure qu'un traitement, ou parfois c'est complémentaire, et que là, ce n'est pas le rôle d'une société savante. Je voudrais aussi insister là-dessus auprès des auditeurs. Le fait que c'est Ausha du professionnel de santé de choisir dans le catalogue des INM La bonne intervention en fonction du bon patient. Et que parfois, ils le choisissent seuls, mais parfois, ils le choisissent en staff, que ce soit en staff hospitalier ou que ce soit dans une MSP ou dans une CPTS, peu importe. Mais en tout cas, que là, la décision doit rester, en fait, au praticien qui connaît bien son patient. Et je pense qu'il faut arrêter de tout mélanger. Et donc, une intervention, c'est une solution de santé. Par contre, c'est bien aux professionnels de santé de garder l'opportunité de combiner, parfois. plusieurs interventions. Il y a des kinés qui font de l'ETP. Je tiens à les saluer parce qu'effectivement, il y a des programmes d'éducation thérapeutique qui sont importants. Et un kiné ne fait pas uniquement que des exercices. Il fait aussi parfois des protocoles d'ETP et que parfois, c'est bien là, il est soit un prescripteur, soit un acteur. Et là, il y a tout un champ aussi à inventer de parfois une vision très centralisée, on va dire française, qui a l'air d'ailleurs, on va constituer des parcours avec. Vous devez absolument faire ça ou ça. Mais dans la réalité du territoire, c'est parfois pas possible. Donc il faut effectivement laisser aussi cette latitude des professionnels de santé de choisir les bonnes interventions pour les bons patients.
- Speaker #1
Oui, c'est ça. Vraiment, il y a aussi ce volet personnalisation du protocole.
- Speaker #0
Oui, exactement. Absolument. Ça veut dire que ce n'est pas une recette. Effectivement, il faut les faire. C'est bien à souligner. En effet, ce n'est pas une recette. C'est un cahier des charges sur lequel, effectivement, la compétence professionnelle va permettre de l'ajuster au mieux aux patients.
- Speaker #1
Et bien là-dedans. Dans le domaine de l'EBP, de l'EBM.
- Speaker #0
Exactement. C'est bien de la pratique fondée sur la science, donc evidence-based medicine ou prevention, mais par contre avec un modèle d'évaluation qui correspond aux pratiques produites par les humains et pas un produit, mais bien un service.
- Speaker #1
Eh bien, merci Grégory.
- Speaker #0
Merci beaucoup Céline.
- Speaker #1
On n'hésitera pas à partager toutes les différentes ressources et différents liens pour que les praticiens retrouvent facilement, que ce soit le site, mais aussi bien sûr les référentiels. Et bien encore un grand merci.
- Speaker #0
Merci infiniment.
- Speaker #1
Et à bientôt. A bientôt. Merci.
- Speaker #2
Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. La médicale. Un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur trois en France. Rassurant non ? Des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés.