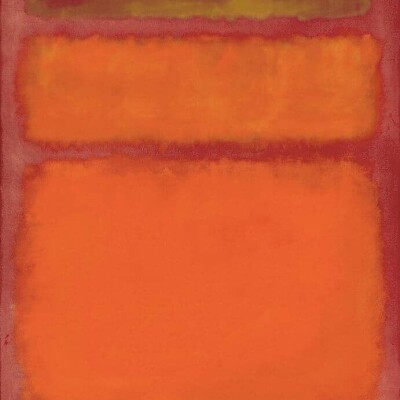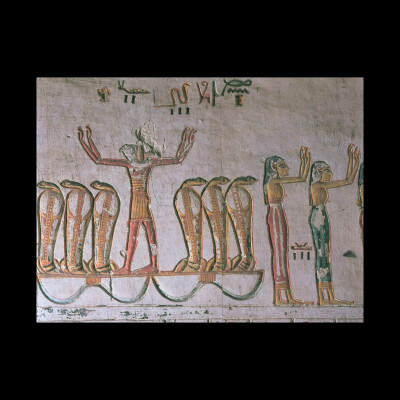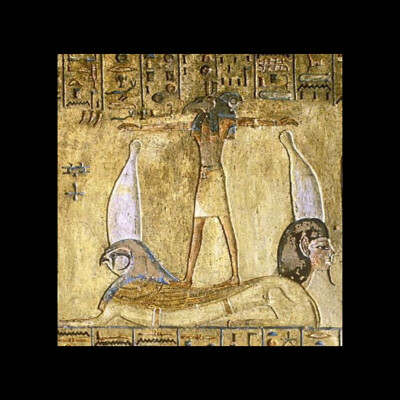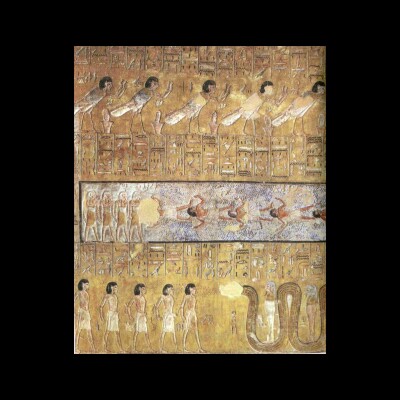Speaker #0Bienvenue dans cette troisième partie. Nous avons dans la première partie abordé le concept de potelage et noté l'importance de respecter le cycle donner recevoir rendre. Dans la seconde partie je t'ai exposé les cinq types de dettes toxiques. On aborde désormais notre dernière partie et je veux te parler de l'urgence de changer de paradigme. Il est grand temps d'arrêter de diaboliser la dette et de sacraliser le don. Il est temps de se rendre compte qu'ils font partie d'une trilogie donner, recevoir, rendre, constitutive de notre société et je dirais même de notre humanité. C'est cet échange réciproque qui fait de notre monde un monde social. Sans obligation envers ceux qui nous ont donné, notre monde deviendrait un monde de choses dans lequel chacun traiterait l'autre comme un objet, disposerait de lui à son gré, un monde où personne ne tiendrait ses engagements envers autrui. Tout d'abord, revenons à l'histoire avec un grand H, celle de nos origines. La capacité de maintenir un équilibre dans nos échanges est ancrée dans notre biologie. Oui, tu l'as bien entendu. Des études en paléoanthropologie montrent que nos capacités de réciprocité et d'assistance mutuelle ont joué un rôle crucial dans notre évolution. Selon des chercheurs comme James Shreve, ce qui a entraîné la disparition de l'homme de Néandertal, pourtant beaucoup mieux bâti pour la survie que l'homo sapiens, c'est son incapacité à former des alliances. Contrairement à ce que les théories de l'évolution stipulent, ce n'est pas le plus fort qui a gagné, du moins dans notre cas. Nous devons notre succès en tant qu'espèce, mais également en tant qu'individu, si tu y réfléchis, à notre capacité de réciprocité et de confiance mutuelle. Nous devons notre succès à notre capacité à créer du lien et à nous montrer loyale. Cette capacité que nous avons de garder en mémoire la contribution des autres, d'en tenir la comptabilité et de tenir nos engagements est la caractéristique de notre humanité. Pour un autre anthropologue, Robin Fox, l'étape la plus importante dans le développement des sociétés humaines est l'invention de la belle famille. Oui, tu m'as bien entendu. Les liens créés par le mariage nous ouvrent la possibilité de former des alliances avec d'autres groupes. C'est la fameuse exogamie dont on a parlé dans l'épisode Anatomie des fêtes de famille auquel je te renvoie. On peut donc, in fine, compter sur leur assistance en cas de besoin. De cette manière, les groupes qui arrivent à échanger des partenaires avec d'autres groupes augmentent leur chance de survie puisqu'ils ont plus d'alliés. Quelles que soient les explications que nous trouvons pour expliquer notre capacité d'altruisme, on ne peut nier qu'elle existe. En tant qu'être humain, nous sommes capables de nous engager dans des actes qui aident les autres et qui ont un coût pour nous. Par contre, ce qui est difficile à expliquer chez l'homme, Ce n'est pas son absence fréquente de vertu, pourquoi il fait du mal, mais c'est plutôt, au contraire, la possibilité qu'il puisse être vertueux. Pourquoi accepter de partager quand on est celui qui possède le plus ? La théorie des jeux de Ridley nous rappelle que si les participants s'engagent dans une relation sur une base de réciprocité positive, si tu me donnes, je te donne, ils pourront collaborer undefined. Par contre... S'ils entrent dans une relation sur la base de réciprocité négative, si tu prends, je te prends, ils s'engagent dans une escalade où chacun tentera de s'emparer des ressources disponibles avant que l'autre se fasse et ça finira mal. De même, le mathématicien Martin Nowak a pu démontrer que la stratégie qui amène le plus de profit est une stratégie du donnant-donnant qui autorise des exceptions Ça veut dire un pardon occasionnel pour ceux qui refusent de coopérer. Alors ça, on le développera plus tard dans la partie sur les clés pour bien recevoir, donner et rendre. Tu pourras donc le constater, nous sommes toujours en train de faire des comptes. Dans la vie de tous les jours, par exemple, nous passons beaucoup de temps à examiner si les membres de notre famille et les personnes qui nous entourent sont dignes de notre confiance. Ça fait partie de notre biologie. C'est uniquement parce que nous pensons que les autres sont capables de réciprociter que nous pouvons rendre le risque de donner sans trop de pertes. Je m'explique. Les chercheurs ont montré que nous avons dans notre cerveau des modules spécialisés dans l'évaluation des dons et contre-dons et qu'ils agiraient comme une sorte de compteur ou de calculette. dont le résultat se lirait en termes de réponses émotionnelles, positives ou négatives vis-à-vis des autres. Ça veut dire qu'en observant, je vais compter les actions positives ou négatives que va faire la personne et en fonction du résultat obtenu, je déciderai si je donne ou bien si je me ferme ou bien si j'attaque. Dans la mesure où nous sommes capables d'éprouver des émotions, nous cherchons à éviter les émotions désagréables et à renouveler les expériences d'émotions positives. Nous apprenons par exemple que certaines actions nous amènent à nous sentir honteux. Le simple souvenir de la honte suffira alors pour que nous décidions d'éviter certains comportements. Plus le groupe est large, plus le bénéfice de la coopération est difficile à évaluer et plus les obstacles sont grands. pour arriver à une situation de coopération qui soit stable. Mais cela démontre que la coopération basée sur la réciprocité existe dans un groupe seulement si un mécanisme permet de punir non seulement ceux qui refusent de coopérer, mais aussi ceux qui refusent de punir. Encore une fois, on est dans une histoire de contes. C'est la fameuse loyauté dont nous avons parlé dans l'épisode sur la famille. Et la loyauté, on en parle dès l'instinct où nous nous mettons à coopérer avec les autres parce que nous appartenons à un même groupe et en coopérant avec un groupe, nous choisissons de défendre ses intérêts plutôt que les intérêts de l'autre groupe. Alors, au-delà de cette approche anthropologique, et pour la compléter, explorons et revenons à cette fameuse dimension morale. L'obligation de donner un bien équivalent au bien reçu est fondamentale dans notre société et constitue, si tu y réfléchis, la base de concepts clés tels que l'aumône et la justice. Cette réciprocité n'est pas simplement une transaction matérielle, mais c'est aussi un engagement moral et social qui renforce les liens au sein de la communauté. Selon Marcel Mauss, le devoir de donner des aumônes aux plus pauvres découle directement du principe de remboursement de la dette. En donnant aux enfants et aux démunis, on donne ce qu'on a reçu de plus qu'eux, on invoque la protection divine, Et on instaure ainsi une sorte de transaction morale. Ça veut dire que si je donne ce que j'ai en plus à ceux qui en ont moins, moralement, éthiquement, je remets de l'équilibre dans les relations. L'aumône est donc perçu comme un devoir moral, une sorte de sacrifice nécessaire, qui va être soutenu par la croyance que des forces supérieures puniraient l'excès de bonheur et de richesse en faveur de l'équilibre et de la justice sociale. La quête de justice... Chez l'homme, il faut le noter, elle se distingue par sa complexité et sa profondeur qui va transcender les lois de la nature. En effet, si tu observes les animaux, il n'y a pas de notion de justice et d'équité. C'est la loi du plus fort qui prime. Le plus fort, c'est celui qui va tout décider, c'est celui qui va manger en premier, et peu importe pour les plus faibles. Chez l'homme, la justice va au-delà de la simple rétribution. Elle s'étend aussi aux injustices impersonnelles, pour te montrer la complexité des choses. Face à des catastrophes naturelles, ou dans des situations, par exemple, comme la guerre ou la dictature, où les coupables sont intouchables. Nous ressentons de la responsabilité collective. Nous sommes affectés par ces malheurs. Nous nous sentons redevables par le simple fait de ne pas vivre autant de malheurs que ces personnes. Et en fait ça c'est notre humanité qui va nous rendre sensibles à ce qu'éprouvent les autres et qui va nous inciter à aider parce qu'on se sent en dette de malheur. Et donc pour rééquilibrer cette injustice, on va... payer notre dû. Cette empathie universelle nous conduit à agir, à donner, pour atténuer ou tenter, je dirais, d'atténuer les souffrances d'autrui, établissant un sens de la dette morale qui va dépasser les interactions individuelles pour englober des réponses collectives à l'injustice. Alors, arrêtons, je le répète encore une fois, de ne pas vouloir compter. Il est essentiel de compter pour pouvoir avoir un rapport de réciprocité saine. Refuser de compter, c'est valider la domination. Je te renvoie encore au film, il reste encore demain. Et si je reprends l'exemple de Delia, on se rend bien compte qu'il y a un problème de compte. Elle donne tout ce qu'elle a pour son mari, pour son beau-père, ses enfants, et récolte en retour des coups, des injures, des jugements. Personne n'ose rien dire au sujet de ce déséquilibre flagrant. Certes, la famille est le premier lieu du don. On donne, et cela compte beaucoup. Le bébé dès sa naissance reçoit une infinité de choses. Un patrimoine génétique, symbolique, culturel, affectif, idéologique. Mais aussi un corpus de savoir, de savoir-faire, de grilles de lecture, du monde, des croyances, des valeurs, des règles, des traumatismes, des non-dits, des secrets, des rituels de fête, des deuils plus ou moins faits. Bref, toute une névrose familiale. Les dons impliquent le meilleur comme le pire. Bien qu'en partie invisibles, voire inconscients, ils instituent cependant d'importantes contraintes de développement et vont modeler les relations. Mais la famille n'est pas que le lieu du don. Il est, et quelque part il doit être, mais géré de façon positive, le premier lieu d'apprentissage de la dette. Car les dons créent des dettes. Les parents, conscients de leur pouvoir et des difficultés qui attendent leurs enfants dans le grand monde, doivent les aider doucement à se détacher d'eux. Grandir, c'est faire à chaque étape le deuil de ceux qui faisaient les délices de l'étape précédente. Mais renoncer à devenir adulte entraînerait une mésestime de soi. En demandant au moment adéquat à l'enfant d'aider ses parents, avec de menus services adaptés à son âge bien entendu, on lui montre qu'il peut lui aussi donner, être donateur. Il apprend ainsi 1. que ses parents ne sont pas des entités destinées à satisfaire uniquement ses besoins et n'ayant eux-mêmes aucun besoin, Mais il se rend compte aussi qu'il peut être utile et en se sachant utile, il se sent valorisé. Et la valorisation, les rapports sains, les rapports d'échange sont constitutifs d'une relation saine. Alors j'aimerais finir mes exemples avec Les Misérables de Victor Hugo et la scène entre Jean Valjean et Mgr Myriel, parce que je trouve que c'est un excellent exemple pour illustrer la réciprocité, mais surtout l'usage très malin de la dette. Alors le contexte, si tu ne connais pas, Jean Valjean... Il vient de sortir du bagne et il est accueilli par le religieux qui va se montrer extrêmement sympathique. Celui-ci va lui offrir gratuitement le gîte et le couvert alors que l'ex-détenu lui propose plusieurs fois de payer. Celui-ci est quelque part ultra étonné d'être aussi bien accueilli et que le curé n'ait pas peur de lui. Ce fameux curé lui raconte que sa seule richesse, ce sont deux chandeliers et des couverts en argent. Après le repas, tout le monde va se coucher. Le curé se lève le matin et que s'est-il passé ? Eh bien, Jean Valjean a disparu avec tout le butin. Il est arrêté par la police qui vient le livrer à Mgr Miriel et écoute ce qui se passe.
Speaker #0Valjean se sent obligé de répondre à ce don par un changement radical de comportement et par des actes de bonté qui reflètent ceux du prêtre. Ce don initial de Mgr Miriel établit une dynamique de réciprocité qui dépasse le matériel pour entrer dans le domaine de l'éthique personnelle. Jean Valjean poursuit sa vie en cherchant des moyens de rembourser cette dette à travers ses actions. Il va adopter Cosette, il va s'assurer de son bien-être, il va protéger Marius, il va essayer de faire le bien autour de lui sans jamais chercher de reconnaissance ou de récompense. Dans ce contexte, la réciprocité n'est pas instantanée, mais elle va se manifester tout au long de la vie de Jean Valjean. Cela montre une autre dimension du don. Lorsque le don est de nature profondément personnelle et morale, la dette peut ne jamais être entièrement remboursée. mais elle engendre une chaîne de bons actes et de transformations personnelles, illustrant ainsi l'impact profond et durable que peut avoir un don sur les destins d'une personne. Nous voici arrivés au terme de notre exploration sur la complexité des interactions entre le don et la dette qui forment le tissu de nos relations sociales et personnelles. Voici un bref résumé des points clés. Premièrement, chaque don implique une dette, créant une dynamique de réciprocité essentielle à nos interactions sociales. Deuxièmement, il est crucial de bien gérer ses dettes pour maintenir l'équilibre social et personnel. Troisième point. Une gestion inappropriée peut conduire à des troubles relationnels et psychologiques quand la dette est sous-estimée, surestimée ou bien niée. Quatrième point. Il existe des dettes négatives, à l'inverse des dettes bienfaisantes, qui obéissent au même mécanisme mais se soldent différemment. Enfin, dernier point, nous avons vu que les pratiques autour du don et de la dette varient, mais elles reposent sur des principes universels de réciprocité et d'équilibre constitutifs à la fois de notre biologie, mais aussi de notre humanité. Il est temps de passer au défi. Cette semaine, je t'invite à mener une introspection plus approfondie sur ton propre rapport au don et à la dette. Voici quelques premières pistes pour guider ta réflexion. Est-ce facile pour toi de donner ou bien ressens-tu de la réticence ? Comment te sens-tu lorsque tu reçois ? Est-ce accompagné d'un sentiment de gratitude ou bien de malaise ? Pense à une situation récente où tu t'es senti redevable. Qui était impliqué ? Quel don ou service a été échangé ? Quel sentiment as-tu éprouvé ? Réfléchis à des relations où les attentes ne sont pas clairement exprimées. Quelles tensions cela crée-t-il ? Pour aller plus loin, je vais te demander de creuser, tu connais ma passion pour cela, quelle éducation, quelle valeur t'ont transmis tes parents au sujet du don et de la dette ? Quelles sont les phrases, les leitmotivs qu'on n'arrêtait pas de te répéter ? Comment cela influence-t-il tes relations, tes actions ou tes réactions dans certaines situations ? Et enfin, si tu veux aller encore plus loin, je t'invite pendant une semaine à tenir un journal où tu vas noter tous tes actes de générosité et tous ceux que tu reçois. Examine à chaque fois ce que cela procure chez toi. Si possible, engage une conversation avec quelqu'un de proche. au sujet de la perception qu'il a des dons et des dettes dans votre relation. Cela va certainement t'ouvrir des perspectives nouvelles et t'apprendre à comprendre comment tu gères avec cette personne vos dynamiques communes. Grâce à ce défi, tu vas explorer plus en détail les nuances des interactions quotidiennes et comprendre comment elles façonnent tes relations. Toutes ces observations vont te préparer pour nos prochains épisodes où nous discuterons des clés pour donner, recevoir et rendre de manière saine. Et je finirai par te partager le cas détaillé d'un coaché qui ressent une immense dette envers ses parents pour leurs nombreux sacrifices. Si tu as des questions, des expériences à partager, écris-moi. Tu trouveras mon adresse dans le descriptif de cet épisode et je pourrai ainsi enrichir la suite. Si tu veux creuser dès maintenant les racines de ton rapport à la dette et aux dons, n'hésite pas à booker une séance avec moi. Idem, tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Enfin, pour me dire merci, pense à laisser un commentaire sur ton appli podcast. C'est le meilleur moyen de le faire connaître et surtout de me récompenser, de me donner quelque chose pour ce travail. Comme d'habitude, on finit en musique. En tant qu'être humain, nous sommes tous issus de la même lignée et en ce sens, nous sommes tous liés par le sang. Comme nous le verrons la prochaine fois, être redevable n'est pas qu'une chaîne qui nous attache. Ce don de vie vient de bien plus loin que nous et se poursuivra bien au-delà. Nous ne sommes que des passeurs. Quand nos enfants prennent le relais, nous avons accompli une grande part de notre tâche. Car la vie, nous ne savons pas d'où elle vient et nous ignorons où elle va. La temporalité de l'être humain est toujours en tension entre un passé qu'il faut revisiter et un futur qui reste à créer, un héritage qu'il nous appartient de modeler et de transformer pour le meilleur.