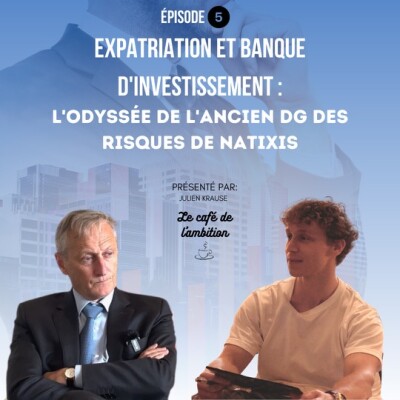- Speaker #0
Bienvenue à tous sur le Café de l'Ambition, le podcast sur lequel nous discutons avec les leaders français d'aujourd'hui, pour les leaders d'automne. Hello à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode du Café de l'Ambition. Pour cet épisode, je serai accompagné d'une personne au sein de l'enseignement. Il s'agit de Claire Rossi, la présidente de l'UTC, l'UTC étant l'école d'ingénieurs que j'ai effectuée. C'était marrant d'enregistrer cet épisode parce qu'actuellement je suis en stage de fin d'études et finir une partie de ma scolarité en interviewant la directrice de mon école, j'ai trouvé ça amusant. Claire Rossi, elle préside une école de plus de 4500 étudiants avec des activités de recherche et autres. Ce qui m'a particulièrement marqué lors de cet échange, c'est la présence d'une vision scientifique sur un rôle où je ne m'y attendais pas forcément. On a aussi eu l'occasion de pouvoir discuter du système grande école à l'international, qui, je le rappelle, est unique à la France. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est en compagnie de Claire aussi. Donc c'est un peu marrant, moi je suis en école d'ingénieur, et je viens de finir mon dernier semestre d'études. Et je vais finir finalement ma scolarité au sein du bureau de ma directrice. Donc bonjour Claire aussi. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement en cinq minutes, histoire qu'on puisse comprendre votre parcours et l'ensemble de vos expériences ?
- Speaker #1
Alors, je suis actuellement la directrice de l'Université de Technologie de Compiègne, mais j'ai eu un parcours, on va dire un peu académique standard. Je suis ingénieure. Ingénieur chimiste à la base, j'ai fait un DEA en agro-ressources, ce qui était l'équivalent du master à l'époque. Et puis ensuite, j'ai décidé de faire une thèse. J'ai fait une thèse à l'Université de Technologie de Compiègne, je suis diplômée de doctorat de l'UTC, à l'interface entre la biotechnologie, la biochimie, la biophysique et puis la chimie supramoléculaire. J'ai ensuite fait un post-doctorat au Max Plant Institute de Mayence. en Allemagne. Et ça, c'était une expérience internationale intéressante. Je suis revenue ensuite comme maître de conférence en génie biologique, professeure en génie biologique. Je me suis investie dans les instances, vice-présidente du conseil d'administration. Et ensuite, ça a été la séquence où j'ai été directrice par intérim deux fois, suite au départ des directeurs, directrice adjointe et finalement directrice de l'établissement.
- Speaker #0
Ok. Et ? Il y a une question que j'aime bien poser après que la personne soit présentée. C'est maintenant que vous êtes présentée de manière formelle, si je puis dire. Si vous deviez vous présenter à un enfant, comment vous vous présentiez ? Vous vous présenterez.
- Speaker #1
Alors, quel âge ?
- Speaker #0
Un enfant assez jeune, je vais dire 10 ans.
- Speaker #1
Alors, ce n'est pas un exercice facile, ça. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Que j'ai commencé à étudier... La chimie, c'est-à-dire tout ce qui est réaction, qui influe dans la vie, dans le vivant, qui fait changer les couleurs, qui permet qu'on modifie les éléments. Et puis ensuite, je me suis destinée à l'enseignement, c'est-à-dire j'enseigne à des étudiants plus grands, majeurs. Et puis j'ai une composante qui est la recherche. Alors la recherche ça ne parle pas souvent aux enfants, mais c'est essayer de comprendre les phénomènes, comprendre pourquoi les choses arrivent, comprendre pourquoi ça se passe. Donc ça, ça a été une grande partie de ma vie. Et puis maintenant, j'essaye de faire au mieux pour que ça se passe bien avec une structure de presque 5000 personnes au total. Un peu plus. Je ne sais pas si je suis très bonne à expliquer ce que je fais, mais c'est très abstrait, je pense, pour des enfants.
- Speaker #0
C'est très bien. Ce qui m'a marré aussi, c'est que certaines personnes, parfois, quand ils doivent se... Pour les deux personnes avec qui j'ai pu le faire pour le moment, ils choisissent totalement un autre axe qui n'est pas forcément leur vie professionnelle. Et je trouve ça amusant. Moi, dans votre parcours, il y a un point... C'est le premier point, c'est la première question qui m'est venue. C'est... Vous avez fait un PhD, un doctorat, et pourtant aujourd'hui vous gérez une structure de plus de 5000 personnes comme vous l'avez dit. Pour moi, un doctorat c'est vraiment une expertise dans un domaine, et donc finalement passer dans un management et une gestion de structure, comment finalement vous êtes passé ? d'une experte à gérer l'université de technologie de Compiègne, une école d'ingénieurs de plus de 100 000 personnes.
- Speaker #1
En fait, le doctorat, c'est certes une expertise très pointue dans un domaine qui n'est pas forcément applicable, mais c'est une expérience qui est de la gestion de projet. Dans le doctorat, on développe ses capacités d'analyse, ses capacités d'acquérir des connaissances sur lesquelles, finalement, on part de zéro. et c'est des fois le cas dans des dossiers de l'établissement où on n'a pas les prérequis, on lance quelque chose de totalement nouveau. C'est donc pouvoir aussi développer des projets. Une thèse, c'est un projet en trois ans avec des jalons, des rendus. Et donc de se dire, je ne sais pas, par exemple, là on a fait très dernièrement le schéma directeur de l'amélioration de la vie étudiante. On part de zéro. Comment est-ce qu'on fait pour faire travailler les gens ? Comment est-ce qu'on met les hypothèses de base ? C'est quasiment un projet scientifique. qu'est-ce qu'on attend, comment les gens réagissent, comment on adapte par rapport à la réaction des gens pour arriver à un rendu qui fait adhérer le maximum de personnes. Donc ça, c'est ce qu'on apprend dans le métier pendant un doctorat. Et puis, c'est apprendre à se remettre en question. Le doctorat, c'est faire des expériences, et ça ne marche pas la plupart du temps, et de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux corriger, et acquérir, apprendre de ses erreurs. ou en tout cas analyser et reproposer. Finalement une direction c'est mouvant tout le temps, il y a toujours des contraintes qui arrivent, des demandes qui arrivent, des exigences qui viennent de l'extérieur. On essaye une méthode, on propose quelque chose, finalement ça ne marche pas aussi bien qu'on voudrait, donc on analyse, on se rend compte que finalement... Ce qu'on a proposé, ce n'est pas ce qui était attendu ou ce qui n'était pas entendable au moment, et donc on retravaille. Et c'est cette capacité d'adaptation et d'agilité et d'ouverture d'esprit qui m'est très utile et que j'ai appris en doctorat notamment.
- Speaker #0
Vous avez encore une vision très scientifique, ce qui est plutôt normal étant votre parcours. Mais quand vous avez dit que finalement le doctorat c'est de la gestion de projet, alors je ne compte pas faire de doctorat, je ne sais pas exactement comment ça se passe. On est amené à travailler avec beaucoup de monde lorsqu'on fait un doctorat ?
- Speaker #1
Ça va dépendre, il y a une partie solitaire, parce que quand on fait ses expériences et qu'on les analyse, on est en général dans une équipe, donc on interagit avec les autres expertises. Quand on fait un doctorat interdisciplinaire, comme j'ai pu le faire, on est obligé de travailler avec des experts des autres domaines. Donc de savoir expliquer son problème sous différentes formes et à différentes autres disciplines, donc ça demande un travail de formalisation. Et c'est un exercice très particulier d'un chimiste qui explique à un physicien ce dont elle a besoin, pour savoir utiliser les mots, etc. Et puis de travailler, dans ma thèse j'ai eu l'occasion de travailler avec l'Institut Pasteur notamment, donc travailler avec des autres équipes, j'ai pu aller à l'étranger. On apprend aussi beaucoup à restituer dans les conférences. Donc oui, en fait, à la base, ça peut paraître très solidaire, mais en fait, on a une interaction constante.
- Speaker #0
Ok. Vis-à-vis du management, parce que j'imagine que le management dans le doctorat, hormis lorsque vous gérez le projet, enfin comme aujourd'hui, vous êtes sous tutelle, vous m'aviez dit.
- Speaker #1
C'est le ministère, en fait. On est un établissement sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur.
- Speaker #0
D'accord. Et donc ? Vis-à-vis du management, je trouve qu'il y a vraiment un gap entre mener une recherche et gérer un établissement. Est-ce que vous avez vraiment ressenti ce gap ?
- Speaker #1
Oui, c'est sûr que ce n'est pas du tout pareil. Et même en termes de taille, ce n'est pas du tout pareil. Après, je pense que... Je n'ai pas fait de formation au management, je vais faire paniquer tout le monde en disant ça. C'est quelque chose que j'ai appris. Dans les circonstances aussi, c'est-à-dire que le doctorat c'était une étape, après j'ai fait maître de conférence, professeur, donc là on apprend à gérer une équipe plus petite, c'est une petite taille, donc on a les doctorants qu'on encadre, on a les personnes de son équipe qu'on encadre, donc c'est une mini gestion d'équipe. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec une taille d'université, ce qui est vrai. Et quand je suis arrivée à l'université dans le poste de direction par intérim, administrative provisoire, le terme consacré, on était en pleine crise Covid.
- Speaker #0
Le meilleur moment.
- Speaker #1
Le meilleur moment. Et en fait, déjà, le management en crise Covid, il est totalement d'un management récurrent. Donc, je suis arrivée à ce poste sans avoir une expérience d'un management de cette ampleur. Mais on était dans une configuration particulière où il fallait une connaissance très fine de l'établissement pour savoir entre guillemets ce qu'on pouvait rouvrir, pas rouvrir. Et donc c'était un dialogue très resserré avec les chefs de service, avec les directions de laboratoire, de département, mais aussi avec les étudiants, les élus étudiants, pour savoir ce qui était acceptable pour eux ou pas. Et aussi des fois aller aussi vers des choses qui étaient un peu parfois pas faciles, comme les examens en présentiel, comme les kits. important parce que c'est quelque chose qui a permis d'avoir moins de contestation par les entreprises recruteurs sur la qualité du diplôme donc c'est d'essayer de trouver le bon compromis parmi plusieurs acteurs donc ça a été un management de proximité malgré la taille dans cette période là et puis petit à petit on est revenu à une situation de je vais pas dire de routine parce qu'on n'est jamais en mode routine mais on On s'est structuré en différents conseils, conseils rapprochés, le comité de direction, les instances. Et puis le métier est très vite rentré, la façon d'interagir avec les instances, d'impulser la stratégie. En fait, c'est devenu assez naturellement et de savoir s'adapter aussi aux envies des personnes. C'est-à-dire que si on arrive à les mobiliser sur la stratégie, Parce que si on n'arrive pas, parce qu'on n'a pas de levier en université, c'est un mode de...
- Speaker #0
De levier ?
- Speaker #1
C'est-à-dire que, contrairement à une entreprise, on va pouvoir dire promouvoir quelqu'un, par exemple, ou octroyer une prime d'objectif, etc. À part donner envie en université, parce que les gens, c'est soit des fonctionnaires, donc on ne peut pas jouer sur la carrière, les budgets sont contraints, les clés de salaire sont inférieures. souvent à ce qu'on a en entreprise, je ne veux pas faire rêver mais c'est la réalité. Et puis les étudiants, on n'a pas de pression sur les étudiants. Notre travail c'est de faire que les étudiants réussissent, ce n'est pas une pression particulière. Donc en fait on n'a pas les leviers classiques de management classique on va dire, on mérite etc. Donc le management à l'université c'est donner envie aux gens de le faire. mais donner envie par la conviction ou l'effet d'entraînement. Dire si on y va tous ensemble, on pourra faire ça et ce sera chouette. Ou regardez, on va pouvoir transformer ça, mais ça va être mieux pour tout le monde. Et ça, c'est encore une autre facette, c'est-à-dire qu'il faut entraîner toute une communauté sans de clé magique en fait, juste par la conviction. que ça va nous faire progresser parce que ça correspond à nos valeurs qu'on va s'engager là-dedans.
- Speaker #0
Finalement, vous avez un exemple pour illustrer, parce que même au sein d'une entreprise, réussir à faire en sorte que les salariés s'engagent par conviction, parce que finalement, de mon point de vue, je trouve ça limite mieux. Est-ce que vous avez un exemple pour illustrer comment vous avez réussi à amener les personnes avec qui vous travaillez à... Juste à ce qu'ils soient plus motivés et investis pour que tout se passe bien.
- Speaker #1
C'est-à-dire que notre métier de base, c'est enseigner, chercher, ou quand on est dans les services, c'est gérer les aspects administratifs. Entre guillemets, on est payé pour ça. Dès lors qu'on va aller sur une tâche supplémentaire, c'est-à-dire structurer un schéma directeur, par exemple, ou se projeter dans un... Dans un schéma de transformation, ça demande plus de temps, donc un investissement supplémentaire par rapport à notre mission de base. On a eu plusieurs exemples. On a fait, il y a deux ans maintenant, un peu plus de deux ans, on a fait une consultation pour sortir un plan d'action en transition écologique et en engagement sociétal. C'est la toute première phase. Là, on va dire que ce n'est pas... plus facile mais ça résonne dans les valeurs ancrées des gens. C'est-à-dire, s'ils sont convaincus, ils vont y aller parce que c'est une transformation de la société de toute façon. En fait, la clé, c'est de réussir à trouver dans ce qu'on... On propose en chantier transformant ce qui résonne individuellement en termes de valeur. Le dernier en date, c'était le schéma directeur à l'amélioration de la vie étudiante. Donc là, on a mobilisé quand même beaucoup de personnes, on a fait quand même beaucoup de réunions. Pourquoi les gens y sont allés ? Pourquoi ils se sont impliqués dans les groupes de travail ? Ils ont fait des actions, ils ont proposé des actions qui vont se dérouler dans les cinq prochaines années. Parce que le mot-clé, c'était notre métier, c'est la réussite étudiante Et donc la réussite étudiante passe par une meilleure condition de vie des étudiants sur le campus. Et donc c'est une façon de présenter les choses, c'est-à-dire c'est pas juste bon allez les gars, on va aller faire… On va aller faire ce schéma parce qu'il faut le faire et puis c'est un truc en plus. C'est notre métier, nos valeurs sont ancrées dans ce chantier transformant et on va pouvoir imposer notre marque de fabrique ou en tout cas apporter quelque chose de complémentaire. Et normalement, on va retrouver les gens chez qui ça résonne qui vont venir le faire. On n'embarque pas tout le monde, évidemment.
- Speaker #0
C'est super intéressant. Il y a un autre point, parce qu'on a parlé de l'UTC pour l'instant, de l'école, mais à travers vos responsabilités, je sais aussi que vous êtes liée à d'autres institutions. Il y a le groupe UT, donc l'UTC s'inscrit dans plusieurs écoles. Il y a aussi UTIM, si je ne dis pas de bêtises.
- Speaker #1
Oui, je suis présidente du conseil de surveillance de UTIM. UTIM, c'est la filiale de valorisation. de l'UTC. On est actionnaire à 100%.
- Speaker #0
Et finalement, la question que je me pose, c'est comment réussir à avoir un regard cohérent vis-à-vis de toutes ces activités ? Parce que, alors certes, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. Et comment bien réussir à différencier chaque activité ?
- Speaker #1
En fait, pour moi, c'est vraiment un... C'est une globalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a le groupe UT, je fais partie du comité des membres de l'Alliance Sorbonne Université, j'interagis au niveau du comité stratégique du stresserie, donc comité régional d'enseignement, de recherche et d'innovation, qui donne les orientations stratégiques dans ces axes-là. Donc... Mais quand on est dans l'UTC, je ne le vois pas comme juste l'UTC. Une université, un établissement d'enseignement supérieur, il est là pour s'articuler avec les besoins nationaux, internationaux, transformation sociétale, transformation du territoire. Donc déjà, il faut qu'il soit ouvert aux stratégies externes pour se positionner, qu'il doit définir sa propre stratégie aussi dans tout ça, donc imposer sa patte, s'imposer sa façon de voir les choses, sa vision, et puis savoir articuler ses actions. Une fois qu'on a tout ça, c'est-à-dire quels sont nos bras d'action pour pouvoir faire du contrat partenarial industriel, du coup c'est Utim qui va gérer ça. comment est-ce qu'on va développer les valeurs des universités de technologie, on le travaille dans le cadre du groupe UT. Donc après, c'est une vision globale. Et ensuite, chaque acteur fait partie de la communauté qui va permettre de découpler notre impact. Et donc pour moi, en fait, c'est les pièces d'un puzzle géant. Et quand on réfléchit, on réfléchit sur le puzzle géant. Et après, on va actionner chaque bloc en fonction de ce qu'il va pouvoir apporter.
- Speaker #0
Donc vous avez vraiment une vision d'ensemble à chaque fois que vous prenez des décisions pour chaque institution ? Oui,
- Speaker #1
association. Il faut parce que sinon il n'y a pas de cohérence. Et s'il n'y a pas de cohérence, on n'est pas crédible dans ce qu'on propose parce que ça peut être dissonant. Et puis je pense qu'il y a tellement à faire qu'à l'heure actuelle, il faut qu'on rame tous dans le même sens. Donc c'est mettre en cohérence, mettre sur les mêmes axes ces différents acteurs, ensemble, et c'est pas il y en a un qui prend le lead, mais c'est ensemble pour faire front et y aller ensemble. Et si on n'a pas une vision globale, finalement on va faire un truc dans un coin, et ça va être en si haut par rapport à d'autres actions, et là on perd en énergie de manière incroyable.
- Speaker #0
Ok. Vous m'avez dit que vous aviez une expérience à l'international. L'international, j'ai entendu dire ces derniers temps que... Enfin, j'ai vu que vous avez fait des voyages. Vous avez voyagé pour nouer des nouveaux partenariats, donc pour l'UTC. Dans le cadre international, comment vous trouvez le système des grandes écoles, qui est unique à la France, je dis pas de bêtises. Comment... Finalement, ce système arrive à se démarquer par rapport aux autres pays où on va retrouver des universités avec beaucoup plus d'étudiants, beaucoup plus de domaines d'études. Comment ça se passe au niveau international ?
- Speaker #1
Alors, je n'avais pas forcément une vision très claire. Alors, après, il faut voir selon les pays, parce qu'après, ça se découpe en facultés. Il peut y avoir des facultés d'ingénierie qui, finalement, dans la grosse structure, se rapprochent un peu de ce qu'on est. Mais par contre, il y a un truc qui m'a marquée, il n'y a pas très longtemps je suis allée au Japon pour notamment rencontrer le président de l'Université de Tokyo qui est un partenaire stratégique de l'établissement, donc des meilleures universités au monde. Et en fait, en discutant, et c'est intéressant aussi de voir que l'UTC, malgré notre taille, parce qu'on va dire 4200 étudiants ingénieurs, finalement on est une grosse école d'ingénieurs, mais on est une toute petite université. Et quand on parle à l'international, on parle d'université à université. Donc par rapport à notre taille d'université, on est limite du bruit de fond pour eux. Par rapport à des grandes universités comme Strasbourg, Sorbonne Université, on est limite... insignifiants en termes de taille et pourtant ils nous reçoivent et pourtant on a des partenariats avec eux. Alors je me suis justement dit qu'est ce qu'on a comme carte à jouer parce qu'on peut pas avoir la force de frappe des grandes universités c'est clair que non mais par contre ils vont venir nous chercher, ils vont être intéressés par nous parce qu'en fait on est on est agile on est agile dans le sens où on a une nature de fonctionnement dans l'établissement qui fait qu'il y a un petit esprit famille. Quand je disais qu'on peut avoir un management de proximité, c'est vraiment le cas parce qu'on se connaît tous. Les problèmes remontent très vite. Ça, ça fait des fois des journées où c'est compliqué à la fin de la journée. Et en même temps, on peut les résoudre vite et on peut les résoudre à plusieurs ou en concertation. Et donc, on a un temps de circuit de décision et de changement qui est très court. par rapport à des grosses structures. Et là où je veux en venir, c'est que par rapport à des grandes structures comme ça, on peut être des poissons pilotes, on peut être des preuves de concepts. C'est-à-dire que si un jour on se dit, bon allez, hop, on essaie une formation sur ça, je dis n'importe quoi, parce qu'il faut de la ressource quand même, mais... On se dit, tiens, on fait un truc interdisciplinaire sur ces deux génies, puis on essaie de faire une nouvelle filière. Ça demande un petit peu de travail, mais on peut le faire vite, tandis que sur des grosses structures, ça peut être beaucoup plus long. Et notre agilité fait que si on se trompe, c'est possible, ça peut arriver. Il n'y a pas de... On est dans une confirmation où si on se trompe, on défait, puis on retempe quelque chose. Ça, c'est l'esprit de l'UTC, c'est qu'on est des testeurs. Et dans l'histoire de l'UTC, d'ailleurs, on a été la première école doctorale de France, qui a été reprise ensuite, maintenant, les écoles doctorales, il y en a partout. On a fait deux fois six mois de stage, et puis maintenant, tout le monde le fait. Et on a fait plein de trucs comme ça et des fois même le ministère dans l'histoire nous a demandé de tester des choses. Alors moi je dirais pas crash test parce qu'on sait pas cracher. Mais voilà on a cette faculté, cette agilité, c'est vraiment un esprit que je souhaite cultiver. C'est la culture du on peut tenter et si ça se passe mal c'est pas grave.
- Speaker #0
Ok et donc ces résultats ça va vraiment intéresser des universités à l'international pour voir finalement si eux ils n'ont pas intérêt aussi à le mettre en place ?
- Speaker #1
Bah c'est ça, c'est à dire que par exemple Là, dans les projets, c'est se dire, tiens, si on fait une filière entrepreneuriale à l'international avec l'Université de Tokyo, c'est une des choses qu'on a évoquées en discutant, bah tentons-la. Et puis si ça marche pas ou si ça prend pas aussi bien, bah c'est pas grave. Mais si ça marche, waouh, ça sera chouette quoi. Ça sera chouette. Donc c'est ça et c'est ce qui les intéresse parce que... politiquement, s'ils se disent Oh là là, donc je vais lancer une faculté sur ça, X personnes, sur je ne sais pas combien d'étudiants, et puis ça se passe mal, là il y a vraiment un impact cohorte important ou politique important. Et même par rapport à la présidence, de se dire c'est un gros échec nous ce n'est pas grave, parce que de toute façon, on a cette culture. Donc si on tente un truc, il n'y a pas péril en la demeure, et puis on aura testé, et puis on en récupérera des enseignements intéressants.
- Speaker #0
Ok. Mais il y a un autre point, c'est... Moi, je me suis toujours demandé si dans ces partenariats, le software des pays, voire même des villes, parce que dans le cadre du système grande école, on a énormément d'écoles d'ingénieurs dispatchés partout en France, est-ce que ça va avoir un impact ou pas du tout ? Dans le sens où l'image de la France, que ce soit vis-à-vis du travail ou vis-à-vis des échanges, Est-ce que ça va donner plus ou moins envie à une université de vouloir créer un partenariat avec une école française ?
- Speaker #1
Je pense que la France a une bonne réputation de toute façon dans l'enseignement supérieur. Donc ça, évidemment, on part avec déjà une bonne carte de visite. Mais après, il ne faut pas se leurrer, on a des pays qui sont aussi très... Autres pays qui sont très bons, en Europe, le Canada, les États-Unis. Je pense qu'il ne faut pas y aller en ayant la superbe en disant on est une école française donc on est forcément de l'excellence. Ce temps-là est un peu passé et il faut vraiment pouvoir le démontrer par rapport à des performances ou des formations innovantes ou une approche qui allie recherche et enseignement, parce que ça on sait le faire aussi, et cet aspect très tourné vers la technologie sous toutes les formes. Je parle de la technologie juste. Et responsable, c'est quelque chose sur lequel on est finalement assez en avance en France par rapport à certains autres pays. Mais les grands pays, encore une fois, comme le Canada, etc., ils ont déjà aussi une bonne longueur d'avance. Donc c'est bien trouver les complémentarités, les synergies. C'est une bonne carte de visite, mais ça ne fait pas tout. Plus maintenant, en tout cas.
- Speaker #0
Ce que je me demandais, c'était surtout autre que sur l'aspect académique. Est-ce que le soft power va jouer ? Parce que je trouve que quand un partenariat va se créer entre des universités, on a quand même cet aspect national qui est beaucoup plus puissant qu'avec une entreprise, parce que souvent une entreprise peut être présente à l'international, donc elle a moins d'identité nationale, je trouve. C'est mon avis personnel. Et c'était juste un point, je me demandais, est-ce que du coup cet aspect national en fonction de l'université lorsqu'un partenariat va se créer, ça va avoir un impact ou pas du tout ?
- Speaker #1
Pour les étudiants qui souhaiteraient venir, je pense que oui. Je pense que c'est quelque chose qui est pris en compte. Un pays fait plus ou moins rêver, ou en tout cas ce qui peut être offert avec le réseau du pays, et notamment la présence d'entreprises, c'est quelque chose qui va pouvoir attirer. Je ne sais pas encore si ça a vraiment une influence sur le partenariat.
- Speaker #0
Ok. Parce que moi, du coup, je voyais surtout ça d'un point de vue étudiant, ayant fait un échange, où dans ce cas-là, dans mon cas, oui, clairement, le pays a porté... Oui,
- Speaker #1
mais c'est ça. Je pense que sur les étudiants, c'est un impact. Je pense que du coup, dans le partenariat, les personnes vont se dire, oui, si on envoie des étudiants dans ce pays, c'est une carte en plus. Mais en fait... La France est un pays qui accueille beaucoup d'étudiants en mobilité entrante. Donc même au sein de la France, on est tellement nombreux à proposer une mobilité entrante qu'il faut savoir se démarquer aussi.
- Speaker #0
Ok. Et il y a aussi au niveau international ce système d'alliances qu'on retrouve en France. Donc dans le cadre de l'UTC, elle fait partie de l'alliance Sorbonne. Et finalement... À quoi ça va servir ? Parce que vous m'avez dit au début que les... Enfin, qu'on arrivait... Rester compétitif, c'est pas forcément le mot, mais qu'on arrivait à montrer que les écoles étaient agiles et que ça permettait d'amener des résultats et que ça intéressait des universités. Finalement, le système d'alliance, à quoi il sert ?
- Speaker #1
Alors, les alliances d'universités européennes, si c'est ça...
- Speaker #0
Je pensais... L'alliance Orban, c'est aussi européen ?
- Speaker #1
Non. L'Alliance Sorbonne, c'est une alliance d'acteurs nationaux. C'est une alliance de différentes universités et d'organismes, d'écoles, qui travaillent ensemble sur des sujets communs, qui répondent à des appels à projets ensemble pour récupérer des gros financements et alimenter les projets communs. C'est une association pour être plus fort ensemble. Après, il y a, qui émerge depuis quelques années, les alliances d'universités européennes. Donc là, ce sont des universités qui se mettent en réseau privilégié au sein de l'Europe.
- Speaker #0
L'UTC ne fait pas encore partie d'un de ces réseaux, même si on a quand même, je te rappelle, 230 partenaires internationaux, donc on a quand même un réseau historique puissant. Et on est en train de travailler un projet d'alliance, justement. Alors les alliances d'universités européennes, elles ont différents degrés. Ça peut être des réseaux très puissants en recherche, mais in fine, ça peut être un réseau de mobilité internationale pour les étudiants. Alors nous on a déjà un portefeuille entre guillemets de partenaires et de destinations importants, on a presque 900 places qu'on peut proposer à nos étudiants à l'international, mais par contre ça peut être intéressant pour développer des parcours un peu plus personnalisés, un peu plus hybridés entre deux universités sous une forme de réseau ou plusieurs universités sous une forme de réseau. Par exemple aller chercher des compétences complémentaires et que du coup nos étudiants pourraient chercher. En mobilité, et inversement, les étudiants d'autres universités viennent chercher en mobilité en 30.
- Speaker #1
Moi, cette question, je ne m'attendais pas à cette réponse pour être honnête, elle me vient surtout du fait que quand on est étudiant, on a tendance à regarder des classements. Quand on s'intéresse à l'international, on regarde notamment les classements QS. Et ce classement-là, on ne va pas retrouver des écoles, mais souvent plus loin dans les classements. Et ce que j'avais cru comprendre, c'est que les alliances permettaient... aux écoles françaises de remonter dans les classements et c'est là que je me suis intéressé aux alliances de ce point de vue là.
- Speaker #0
Alors il y a différents niveaux en fait en termes d'alliances. En fait une école apparaît dans un classement en tant qu'entité juridique indépendante. Donc quand on fusionne avec d'autres structures, du coup on agrège les autres structures et du coup on a une masse d'indicateurs on va dire ça comme ça plus important, on est plus visible. dans les classements parce qu'il y a une sorte de taille critique, de taille de production, etc. Donc, infiniment, les grandes structures performantes tendent à être plus présentes. Si on prend le classement de Shanghai, par exemple, on y retrouve les sortes d'universités, on y retrouve les grosses structures parce qu'il y a une force de production, scientifique notamment, qui est conséquente. Après, on y retrouve aussi des écoles. qui tirent leurs épingles du jeu, comme l'INSAN Toulouse, c'est une des rares écoles d'ingénieurs en français qui est au classement de Shanghai. Nous, on n'y est pas encore. Au classement de Shanghai, on ne candidate pas, il faut qu'on soit repéré par le classement de Shanghai, par une collègue d'indicateurs externes. Et ça, ça nécessite un travail spécifique qu'on est en train de faire et qui n'avait pas été suffisamment fait auparavant. Donc on est en train de reprendre... reprendre le taureau par les cornes. Sur ça, peut-être qu'on aura de bonnes surprises, mais il y a une synergie, une inertie de quelques années pour que ça s'effaite. Donc en fait, c'est plusieurs éléments. Un élément de taille critique, donc effectivement quand les universités se regroupent, par exemple en établissements publics expérimentaux, donc du coup il y a un seul pilote pour plusieurs établissements, ils se renforcent en masse critique et donc ils ont plus de chances d'apparaître. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'autres facteurs.
- Speaker #1
Ok. Donc finalement, ces alliances permettent aussi de rentrer dans les classements parce qu'il y a certains facteurs, ce n'est pas forcément le mot, des indicateurs qu'il faut agréger. Oui,
- Speaker #0
tout ça. Mais par exemple, nous, dans l'Alliance Sorbonne Université, on a fait le choix de rester en association et d'avoir... chacun notre personnalité juvédique indépendante. Et donc l'alliance Sorbonne-Université n'apparaîtra pas dans les classements, mais Sorbonne toute seule apparaîtra, l'UTC toute seule apparaîtra. Il y a d'autres établissements qui ont fait le choix de fusionner et de n'avoir qu'un seul chef, entre guillemets.
- Speaker #1
Après avoir parlé de toutes ces alliances, je me demandais ce que vous pensiez du système grande école. Donc ce système, je pense que nos auditeurs le veulent. Ce dont on parle, c'est d'avoir un enseignement sur 5 ans, avec 2 ans qui vont être plutôt généralistes, notamment sur les maths et les sciences, pour les écoles d'ingénieurs. Pour les écoles de commerce, je sais qu'il y a aussi pas mal de mathématiques. Finalement, ce système, après avoir voyagé, après avoir pu rencontrer de nouveaux acteurs, est-ce que vous trouvez qu'il y a des points qui sont plutôt positifs, des points qui sont plutôt négatifs ? C'est quoi votre opinion à ce sujet ?
- Speaker #0
J'ai pas une opinion très formatée sur ça. Parce que justement, moi j'ai un parcours un peu bizarre. J'ai un peu le format classe préparatoire, école d'ingénieur, etc. Mais j'ai beaucoup changé de discipline. Et puis, je vais vous étonner peut-être, mais je n'ai pas suivi une scolarité de Norval parce que je n'ai pas été à l'école. Et j'ai commencé à faire mes premiers cours en présentiel, en prépa. Donc j'ai fait tout parcours par correspondance jusqu'au bac. Donc, moi j'ai une vision qui est qu'il n'y a pas un système roi Même si je pense que, forcément je ne vais pas dire le contraire, je ne vais pas faire un débat sur la classe préparatoire, mais en tout cas une classe intégrée comme on propose à l'UTC est quelque chose qui peut être intéressant et surtout permet de toucher beaucoup de disciplines, beaucoup de modules et pas que une spécialité, même si ce n'est pas toujours très agréable, mais faire des maths, peut-être un peu de management. etc. assez tôt parce que ça fait partie du métier d'ingénieur. Même si souvent, il y en a qui intègrent l'UTC en disant je vais faire de la bio, je vais faire de la bio et que de la bio Donc ça, ça permet d'être agile sur plusieurs disciplines et ça, c'est important. Mais puis parce qu'à l'UTC aussi, on recrute la moitié de notre contingent en Bac plus 2. Donc ça montre aussi qu'on peut avoir différents parcours pour arriver à une spécialité. Donc... La diversité des profils, la diversité d'apprentissage est quelque chose d'important. Donc pour moi, il n'y a pas un format cadré. Et puis je pense que chaque formation doit s'adapter à la façon dont on sait apprendre, où on a envie d'apprendre, au moment où on a envie d'apprendre. Je m'explique, si on prend l'UTC, il y a des étudiants qu'on n'aurait pas recrutés en post-bac parce que ce n'était pas le moment, parce que justement le format... plusieurs modules, plusieurs disciplines, c'est pas ce qu'il leur fallait à ce moment-là, et qui vont être des excellents étudiants en bac plus 2, parce qu'ils auront une phase où ils seront avancés, et feront leur propre maturation par rapport à ce qu'ils ont envie de faire, et par rapport à leur choix. Moi qui n'ai pas été à l'école jusqu'à mon bac, j'ai tout le temps cours par correspondance, donc c'était un peu le bordel, je faisais mes cours le soir, je faisais autre chose la journée. C'est un format qui m'allait très bien parce que rester une journée en cours, je ne devrais pas dire ça, mais à l'époque ça ne m'allait pas. Je pouvais faire d'autres activités et puis parce que je pouvais réviser très rapidement, faire en 4 heures ce que j'aurais pu faire en 8 heures par exemple. Donc en fait tout ça pour dire que c'est un format, la grande école, qui est performant. Je défends quand même le modèle UTC parce qu'il propose beaucoup de choix. Et ce n'est pas un format linéaire cadré, c'est-à-dire tout le monde fait des maths à telle heure et tout le monde fait de la physique à telle heure, etc. Parce que les étudiants peuvent quand même construire leur parcours et choisir leur module. Au moment où ils ont envie de choisir aussi, même s'il y a des contraintes, mais il y a quand même une certaine flexibilité de choix. Et ça, c'est important. Mais c'est surtout trouver la formation qui convient aux envies et au moment où on est prêt à la suivre.
- Speaker #1
Pour résumer, vu que vous êtes étudiante de l'UTC, je comprends totalement ce que veut dire Mme Rossi. Mais à l'UTC, on a vraiment l'opportunité de pouvoir choisir nos cours chaque semestre. Et ce qu'on peut dire, dans un système grande école classique, on n'a pas le choix. Ce qui fait qu'un étudiant à l'UTC n'aura... C'est pratiquement impossible que vous ayez le même parcours que votre ami, parce que vous allez faire votre choix. Donc finalement, votre avis représente bien le format de l'UTC, c'est que le parcours idéal, c'est le parcours qu'un étudiant va pouvoir se former en fonction de ses envies, et le moment où il sera prêt de le faire. Je voulais partir, à plus tard, des formations ouvertes, puisque je trouve que dans l'enseignement, c'est un point qui est important, vu qu'on est dans un monde qui évolue très rapidement. Le premier point que je voulais aborder à ce sujet, c'est dans le cadre de l'UTC, l'UTC, une des valeurs qui est mise en avant, c'est le fait de vouloir former des ingénieurs ouverts, aussi sur les sciences sociales. Par exemple, ce type de valeur, comment, dans un cadre, je vous imagine que vous avez illustré avec l'UTC, mais aussi dans un cadre générique, comment retransmettre une valeur qui est forte à un établissement auprès de ses étudiants ?
- Speaker #0
Alors, si on parle de la composante technologie, société, humanité, de l'enseignement, ou de manière générale...
- Speaker #1
Je parle plus de manière générale, comment...
- Speaker #0
retransmettre une valeur d'un établissement auprès de ses étudiants et j'ai pris l'exemple des sciences sociales en fait je pense que sur l'établissement on a beaucoup de valeur en ce moment je suis en train de co-rédiger la charte des universités de technologie donc je suis en plein dedans qu'on a oublié ou on se rend plus compte que l'on a c'est-à-dire j'en parlais avant de pouvoir offrir un parcours individualisé quasiment sur mesure à chaque étudiant, d'être ouvert à tous les profils parce qu'on est finalement sélectif sur les résultats scolaires évidemment, mais sélectif aussi sur l'envie et l'engagement des étudiants à suivre un cursus dans notre école. Et on va accepter d'intégrer des profils très diversifiés avec des... des étudiants qui ont des parcours un peu atypiques, avec des étudiants qui n'ont pas envie de faire que de l'académie, qui vont faire entrepreneur, sportif, etc. On est ouvert à la diversité des profils. On est aussi, de par notre modèle, qui est le côté agile, adaptable, où finalement vous changez de module et vous changez de promo tout le temps, et de discipline aussi beaucoup, avec une capacité de se requestionner et de travailler en collectif. et un collectif qui peut changer, pas toujours les mêmes personnes, etc. Je ne vais pas faire tout un descriptif de l'UTC, mais les valeurs finalement de l'établissement, les étudiants les expérimentent au cours de leur cursus, ils ne s'en rendent peut-être pas compte. Et quand on a fait les enquêtes de notoriété de nos diplômés dans les entreprises, ce qui ressort, c'est les valeurs d'agilité, d'humilité, de savoir travailler pour le bien commun et s'effacer. son intérêt propre par rapport à une tâche collective, de savoir se remettre en question, etc. Tout un ensemble de valeurs d'être qui caractérisent les étudiants UTC, les diplômés UTC, et même en discutant avec des diplômés qui ont été diplômés une paire d'années avant, ils se retrouvent dans ces mots-clés-là. Donc c'est des valeurs qui sont finalement acquises de par le modèle. Et après, il y a des valeurs d'engagement de l'établissement, en termes de, justement, vous en parliez avec les humanités, de savoir faire dialoguer, d'être un trait d'union entre l'académique, le monde socio-économique, la société, et de toujours penser des développements avec une vision un peu systémique, c'est-à-dire en intégrant les différents paramètres, et de ne pas développer de la technologie pour la technologie, mais de la technologie qui va être juste. et qui va être acceptée par la société en réponse à des réels besoins. Et c'est pour ça qu'on est, à l'heure actuelle, plus de 40% de notre recherche est tournée vers les enjeux du développement, de la transition écologique notamment, parce que c'est ancré, c'est-à-dire qu'on a un modèle d'établissement qui se questionne par rapport aux besoins de la société et on est agile pour pouvoir s'adapter à y répondre. Et ça, ça fait partie de nos valeurs aussi. Après, pour faire adhérer à des valeurs, il y a des chartes de valeurs, ça reste qu'un bout de papier. Moi, je pense que faire adhérer à des valeurs, c'est les vivre et les développer. Quand on est dans l'établissement et quand on est diplômé, on regarde en arrière et on se dit Ah bah oui, finalement, j'ai ces valeurs-là parce que c'est mon parcours qui me les a amenées. Plutôt que de coller une estampille en disant Bon, nous, on a ces valeurs-là. On peut toujours le dire, mais il faut le vivre et l'être pour vraiment défendre des valeurs.
- Speaker #1
C'est vraiment... via le processus, via le parcours que les valeurs vont pouvoir être transmises. C'est vrai que l'adaptabilité, c'est plutôt vrai pour l'UTC. Un autre point que je trouvais intéressant, c'est, comme je l'ai dit, le monde est en constante évolution. On a aussi des outils qui sont en constante évolution. Comment faire dans l'enseignement, finalement, pour... intégrer ces outils. Moi, je trouve que l'exemple parfait en ce moment, c'est ChatGPT. C'est quoi votre avis, du coup, vis-à-vis de comment faire évoluer un enseignement pour qu'il arrive à suivre l'évolution du monde ?
- Speaker #0
Justement, c'est un peu la force de notre école, c'est qu'on est une université, donc on a des laboratoires de recherche de pointe. Et on est une des écoles d'ingénieurs où on a le plus d'enseignants-chercheurs qui enseignent aux étudiants. Ça veut dire que, qui dit enseignant-chercheur, ça veut dire que la moitié du temps, voire plus de la moitié du temps, les personnes qui sont dans les laboratoires travaillent au futur de la science. C'est-à-dire qu'ils anticipent les besoins du monde où ils sont en train de créer les solutions de demain. Vous ne pouvez pas avoir mieux en termes d'anticipation et de coller aux enjeux du monde. Et ça forcément parce que c'est des personnes qui sont passionnées par leur métier, vont l'influencer, le diffuser dans leur enseignement. Et donc chaque année, les enseignants, moi y compris, je refais mes cours et je remets les nouvelles avancées, je requestionne par rapport, je fais de l'alimentation, par rapport justement à l'impact carbone de l'alimentation, etc. les cycles de vie, etc. Donc, c'est toujours en évolution, pour coller. Et ça, là-dessus, c'est quelque chose qui est important parce qu'on a cette capacité d'évolution aussi par notre recherche. Donc ça, c'est une chose. Et du coup, sur les outils, déjà, on a un groupe de recherche, tout un laboratoire qui est très performant en IA, notamment. Ils ont un point de vue aussi sur ça. Ils sont en train aussi de travailler sur des... concepts. Alors moi, c'est mon avis personnel, il y a un groupe de travail qui est en train d'élaborer un avis de l'université sur ça. Moi je pense que dans toutes les évolutions qu'on a pu voir, il y a plusieurs choses qui sont importantes. C'est de se dire, maintenant que c'est là, il ne faut pas forcément tourner le dos, mais il faut savoir l'utiliser. Mais il faut savoir l'utiliser intelligemment. Je l'utilise, un chat GPT aussi, parce que ça m'a forcément intéressée. Je trouve que quand on donne des instructions basiques et bêtes, ils nous donnent un truc basique et bête. De très bon, ou alors je ne sais pas, mais souvent de pas bonne facture par rapport à quelque chose que je pourrais produire moi-même. Après, si on s'en sert, et c'est fait pour ça, comme base de structuration, et qu'après on vient apporter son intelligence en tant qu'individu pour structurer quelque chose de... de beaucoup mieux, etc. Ou qu'on arrive à reconnaître que ce qui nous a sorti, c'est vraiment pas bon, et puis hop, on se dit, finalement, notre cerveau n'est pas si mal et qu'on le produit nous-mêmes. Je pense qu'il faut toujours garder, dans ces outils-là, un recul sur la qualité du rendu. Mais des fois, ça peut être une aide de gain de temps et une performance, parce qu'il peut être taillé pour restructurer des choses, etc. Donc c'est comme tous les outils qu'on a, que ce soit les téléphones portables, les réseaux. C'est un outil nouveau parmi tant d'autres qu'il faut savoir maîtriser, qu'il faut savoir utiliser avec le recul. Et sur les réseaux, on a le même problème.
- Speaker #1
Moi, je suis totalement d'accord avec vous sur l'utilisation de Tchadjépté. Je trouve ça hyper performant pour avoir une très bonne structure de base. Mais après, souvent, il faut l'alimenter avec vos connaissances. Mais il y a aussi un point que je trouvais amusant d'aborder sur Tchadjépté, c'est que je suis presque sûr que ça doit embêter les professeurs. vis-à-vis des rendus que les professeurs peuvent demander. Est-ce que c'est facile de voir qu'un étudiant a pu utiliser le chat GPT, par exemple ?
- Speaker #0
Moi, je fais très peu de rendus sur... Enfin, j'ai des rendus sur rapports, mais des rapports qui ne peuvent pas être générés vraiment par chat GPT ou si ce n'est par structuration de paragraphe, mais le contenu ne peut pas être trouvé sur le chat GPT. Donc, je n'ai pas eu de soucis personnellement. Je sais, par contre, qu'il y a des collègues sur des rapports un peu plus bibliographiques standards. que là, oui, il peut y avoir du tchat GPT, et ça peut être vraiment un problème, parce que du coup, on a du mal des fois à détecter si c'est l'étudiant qui a fait le travail, ou au moins ce qu'il en a retenu lui, parce qu'on n'en a pas un travail pour un travail, même parce qu'après, il faut qu'on le corrige, il ne faut pas l'oublier. Mais il faut que l'étudiant puisse en ressortir quelque chose. On n'est pas des gentils organisateurs qui occupons le temps des étudiants, c'est pour qu'ils en ressortent quelque chose. Donc si c'est juste pour claquer le sujet dans le tchat GPT, nous faire un copier-coller du rapport, et ça existe, là il y a zéro intérêt ni d'un côté ni de l'autre. On le voit, ou alors parce que le rendu n'est pas bon. Après, il y a des gens qui savent très bien se servir de ChatGPT, qui arrivent à construire quelque chose d'un rendu tout à fait correct. Là, ce n'est pas toujours facile de détecter, mais il ne faut pas oublier aussi que ChatGPT ne fait pas l'analyse bibliographique, ne va pas chercher les références bibliographiques, donc ça a aussi ses limites. Mais ça veut dire aussi, et ça c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que ça peut questionner aussi notre façon d'évaluer. Donc ça peut nous entraîner nous-mêmes à évoluer, pour évaluer différemment et trouver des solutions pour montrer vraiment ce que l'étudiant a pu acquérir personnellement de ce qu'on lui a demandé.
- Speaker #1
Mais c'est pas évident, parce que ça fait un an, je pense, que c'est sorti, qu'on a vraiment parlé. En l'espace d'un an, vous avez déjà à peu près des méthodes pour essayer de voir si l'étudiant a réellement compris ce que vous vouliez lui transmettre. en un an ?
- Speaker #0
Là, c'est sur quoi on est en train de travailler en ce moment.
- Speaker #1
Donc ça montre bien que même cette évolution du monde elle force au-delà des nouvelles avancées. Au niveau de la recherche, ça nous permet de les mettre en avant au niveau des cours. Mais il y a aussi un travail perpétuel vis-à-vis des outils pour
- Speaker #0
C'est une révolution en tant que telle, mais ça a toujours existé. C'est loin d'être la généralité à l'UTC. On a déjà eu des cas, moi-même, où je me suis rendue compte que les rapports qu'on me rendait, c'était du plagiat de rapports. Il y a eu les outils de plagiat, après, qui sont sortis. Mais ce n'est pas toujours performant sur des traductions. Donc, après, il y a toujours des possibilités de faire des soutenances en complément, si on a un doute, de se rendre compte qu'il n'y a rien derrière. Donc, on est quand même des personnes qui rédigent des articles scientifiques, donc on n'est pas forcément dupes, on arrive quand même à voir. Mais maintenant, c'est très performant, donc on peut se faire avoir.
- Speaker #1
J'aimerais maintenant avancer un peu plus sur votre expérience personnelle. Notamment, j'ai encore jamais abordé ce type de questions, mais vis-à-vis de votre organisation pour mener à bien tous vos projets. Donc, vous avez... Vous êtes encore professeur, vous êtes... Je vais avoir du mal à tout rééliminer. Mais est-ce que vous avez des méthodes que vous utilisez tous les jours, au jour le jour, pour... avoir un visuel clair sur ce que vous devez faire vis-à-vis des projets sur du court terme ou du long terme. Comment vous vous organisez ?
- Speaker #0
Ce n'est pas facile parce qu'on a la planification de travail, on sait à peu près ce qu'on doit sortir, à quel moment on doit le sortir. On a beaucoup d'urgence, donc beaucoup de choses qui arrivent dans la journée, qu'on doit traiter vite, qu'on n'avait pas prévu et qui peuvent tout chambouler. Donc déjà, mon organisation, c'est de se dire que mon organisation ne va pas tenir. Ce qui me rend beaucoup plus sereine. Ensuite, après j'ai une des techniques très rudimentaires qui vont faire crier tous ceux qui ont l'habitude d'outils plus performants. Je travaille avec des to-do list. Et des to-do list par critère d'urgence. C'est-à-dire ma liste de points à faire dans les journées ou dans les deux jours, avec des rendus très très courts. Une liste de tous les sujets que je dois traiter sur le mois. Des listes de sujets exploratoires, c'est quand j'ai le temps de commencer à me mettre dessus. Donc j'ai priorisé, j'ai un petit classeur où je me fais mes listes. En papier ? J'aime bien barrer, ça me fait du bien.
- Speaker #1
J'ai réussi à le faire.
- Speaker #0
C'est ça. J'ai essayé sur l'ordinateur, mais bizarrement, j'arrive pas, j'ai pas la même relation à quelque chose d'écrit par moi-même qu'une issue ordinateur. Bon, ça c'est personnel. Donc je gère comme ça par liste, après je gère aussi par thématique ou par direction avec lesquelles je travaille, les sujets que je dois avoir avec les directions pour rien oublier parce qu'en fait le gros souci c'est la multitude de sujets et donc toujours me dire ah oui ça je l'ai vu avec un tel, il faut que j'en parle à un tel pour... et c'est plus ça qui prend la bande passante, sur le charge mental même si je ne suis pas une grande fan de ce mot-là et de réussir à... rester serein et concentré tout en se rappelant de tout ce qu'il y a à faire et de le répartir en termes de priorisation. Moi, je fonctionne avec ma petite to-do list à différents niveaux. Jusqu'à présent, ça marche. Ça marche très bien.
- Speaker #1
Ok, c'est intéressant. Mais est-ce que, j'ai une petite question, c'est, vous allez, vous avez des to-do list en fonction du temps. Je m'explique. Si vous aviez un projet sur l'année, vous allez dire je dois réaliser ça sur l'année et donc le déconstruire petit à petit sur des échelles de temps plus... Vous travaillez aussi comme ça ?
- Speaker #0
Oui, quand on a notamment des schémas directeurs à produire ou en tout cas des axes stratégiques à produire, parce qu'en plus on a les conseils, donc ce qu'on propose, il faut qu'on le soumette aux différents conseils qui rendent leurs avis, qu'on ait le temps d'intégrer leurs avis, etc. pour finir par souvent le conseil d'administration. Et donc, il faut se laisser ces temps d'écriture, de consultation, de modification, etc. Donc, en fait, on part de la fin, on regarde les échéances par rapport au conseil et on adapte les temps de production par rapport à ça. Donc oui, sur les grands sujets comme ça. Et en général, c'est là où on se dit Ah, bah bon Dieu, on est en retard !
- Speaker #1
En parlant de retard, j'imagine qu'au long de votre carrière, tout n'a pas été rose, dans le sens où parfois il y a des échecs. Est-ce que vous avez, là, celui-ci, un de vos plus gros échecs ? Et surtout, ce qui est intéressant, c'est comment vous l'avez surmonté ?
- Speaker #0
Alors, je n'ai pas d'échecs qui m'ont marquée. Évidemment, je n'ai pas toujours tout réussi. J'ai fait des tentes à l'ARJPJ, il y a des postes auxquels j'ai postulé quand j'étais plus jeune que je n'ai pas forcément eu, des avancements que je n'ai pas eu au moment où je le voulais. Les projets de recherche, c'est un exemple fabuleux. On écrit des projets de recherche qu'on soumet, qu'on n'a pas. On a passé deux mois à écrire un truc et on n'a pas le financement. Déjà, l'enseignant-chercheur, c'est un échec permanent, dans le sens où on travaille souvent beaucoup en exploratoire. pour récupérer des financements, parce qu'on travaille beaucoup sur modalité maintenant. Et donc, une fois sur deux ou une fois sur dix, ça fonctionne. Donc déjà, on est formaté à l'échec. On y va à fond, mais on sait que dans ce qu'on fait, on le fait déjà pour nous-mêmes. Mais il y a de grandes chances qu'on n'arrive pas à le porter jusqu'au bout parce qu'on n'a pas le financement. Donc ça, c'est déjà un apprentissage.
- Speaker #1
C'est bien un superbe état d'esprit, savoir que... Savoir continuer alors que ça n'a pas marché. Je trouve que la plupart des gens que j'ai pu rencontrer de mon âge, quand ça n'a pas marché, on peut abandonner le projet. Je ne savais pas que... Enfin, si, en soi, c'est logique. Dans la recherche, si vous avancez... Je commence à me perdre là. Mais tout à pour dire que savoir continuer alors qu'on a eu un échec, c'est plutôt...
- Speaker #0
je pense que tous les chercheurs ont ça c'est à dire qu'on est convaincu de quelque chose après il faut se remettre en question si au bout de 20 fois ça marche pas il faut changer un peu de braquet c'est un milieu compétitif en termes d'appel à un projet en termes de financement parce que les financements sont rares donc c'est forcément compétitif parce que des fois aussi on est trop en exploratoire et qu'il faut faire un peu de preuve de concept avant de rétablir financer, etc. Donc, il faut rester, si on croit dans son projet, il faut continuer, il faut y aller. Et c'est pour ça que la notion d'échec, pour moi, en fait, elle est intégrée. Et je visualise difficilement l'échec en tant que tel, parce qu'en fait, c'est plutôt du fil rouge, c'est-à-dire quand on y croit, on y va, ça ne marche pas pour faire ça du premier coup, on continue, on cesserait d'adapter. Parce que voilà, peut-être qu'il y a un truc qu'on n'a pas bien fait et qu'on améliore. C'est plutôt une amélioration continue qu'un échec. Échec, je trouve que dans l'esprit, on ne s'est pas préparé à ne pas réussir. Et que du coup, quand on s'est dit, on essaye, mais ça ne va peut-être pas marcher, mais je pourrais essayer ou je changerais un peu, c'est de se dire qu'on n'est pas parfait tout de suite, tout le temps, et que ce n'est pas un coup d'arrêt.
- Speaker #1
Donc être prêt à rebondir finalement. C'est ça. On va passer à quelques questions de conclusion. Si vous pouviez recommander un ouvrage, donc ça peut être un film, un livre, absolument n'importe quoi, et pas forcément de management ou de chimie, ça peut vraiment être tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous recommanderez ?
- Speaker #0
Alors, elle n'est pas facile cette question. Moi j'ai des lectures très diverses.
- Speaker #1
Un ouvrage qui vous a tenu à cœur ?
- Speaker #0
Je vais vous faire rire. Il y a un ouvrage qui m'a marquée, mais ça ne va pas du tout aller sur ce que vous imaginez. Je reprécise que je suis enseignante et chercheuse maintenant en nutrition et en formulation des aliments. J'ai fait chimie, biologie, etc. et d'arriver à allier... mon aspect passion avec mon domaine de recherche. Et quand j'étais jeune, quand j'avais 10 ans, mon livre de chevet, c'était Faites votre pâtisserie de Gaston Lenotre, qui était un ouvrage de référence à l'époque, parce qu'il n'y avait pas autant de livres de cuisine que maintenant. Ce n'était pas monnaie courante, le livre de cuisine. Et je l'ai appris par cœur. Mais c'était un livre de cuisine classique ? Oui, oui.
- Speaker #1
D'accord. Et j'adorais ce livre, en fait, et je l'ai encore, parce qu'en fait, ça préfigurait, je ne dirais pas de chimie, mais ça préfigurait déjà une envie d'aller vers ce domaine-là, en fait. Alors, je ne veux pas dire que c'est le livre à lire, mais après, j'ai lu des ouvrages, beaucoup, j'étais une passionnée de païontologie, je le suis toujours, passionnée des requins, je le suis toujours. J'aime beaucoup tout ce qui est fantastique. Je n'ai pas un ouvrage qui m'a marquée, mais plutôt plusieurs qui m'ont alimentée. Donc, j'aurais un peu du mal à donner une recommandation.
- Speaker #0
Ok. Après, vous vous êtes essayée à cet exercice. Qui est la personne que vous aimeriez voir faire cet exercice ?
- Speaker #1
Il va m'en vouloir. Je pense que quelqu'un qui serait intéressant à écouter, c'est peut-être le président du conseil d'administration de l'UTC, Jean-Louis Chaussade, qui a aussi, non seulement une carrière fabuleuse, enfin aussi, moi je n'ai pas une carrière fabuleuse, mais il a une carrière fabuleuse, et c'est quelqu'un que je trouve qui a une expérience de management forcément. très importante, mais qui reste toujours en bienveillance et en écoute, quels que soient les interlocuteurs, en tout cas qui sait prendre les avis des personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à faire quand on a une carrière avec des postes à responsabilité, rester ouvert, et comme il est président du conseil d'administration de l'UTC, qui vient de l'industrie, qui travaille aux côtés avec nous sur des problématiques. d'enseignement supérieur. Il faut rester ouvert. Comme je disais, c'est une modalité différente. On n'a pas les mêmes leviers. Il faut travailler sur les convictions. L'enseignant-chercheur est un être un peu capricieux, je peux le dire, j'en suis une. Je pense que rester dans cet état d'esprit ouvert, je pense que ça peut être quelqu'un d'intéressant à interviewer.
- Speaker #0
Pour finir, c'est ma question préférée. Aujourd'hui, vous êtes présidente de l'UTC. Si vous aviez l'occasion de pouvoir discuter avec Claire à la sortie de son PSD, qu'est-ce que vous lui diriez ?
- Speaker #1
Tu sais pas ce qui t'attend ! Qu'est-ce que je lui dirais ? Je pense que je n'aurais jamais imaginé, quand j'étais en thèse, de faire ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai envie de lui dire, éclate-toi, vas-y à fond, et ne change rien en fait. Ça peut paraître présomptueux, mais je n'ai pas eu envie de... Dans mon parcours, je n'ai pas eu un moment où j'ai regretté ce que j'avais fait. Je me suis dit que j'ai pris la mauvaise direction, le mauvais choix. Parce que finalement, j'ai réussi toujours à m'éclater dans ce que je faisais et à prendre du plaisir. Donc, je n'ai pas de regrets dans ce que j'ai fait depuis que je suis en thèse.
- Speaker #0
Donc finalement, continuer à s'amuser tout au long de sa carrière.
- Speaker #1
Voilà, croire en ce qu'on fait, y aller avec les tripes et puis un peu le cœur. et y aller en sincérité. Je pense que quand on y arrive à faire ça, même si des fois, on a des moments pas faciles, on se prend des murs, rester convaincu, je pense que c'est important.
- Speaker #0
Moi, je trouve que c'est plutôt un bon mot de fin. Merci beaucoup pour votre temps. Merci de m'avoir accueilli. Et puis, je vous souhaite bon courage pour la suite.
- Speaker #1
Merci beaucoup à vous aussi.
- Speaker #0
Félicitations, ça fait une heure que tu nous écoutes. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à t'abonner. Ça me ferait vraiment super plaisir. C'est un side project que je mène à côté des études et ça demande vraiment beaucoup de temps. Sur ce, on se retrouve au mois prochain avec un nouveau leader.