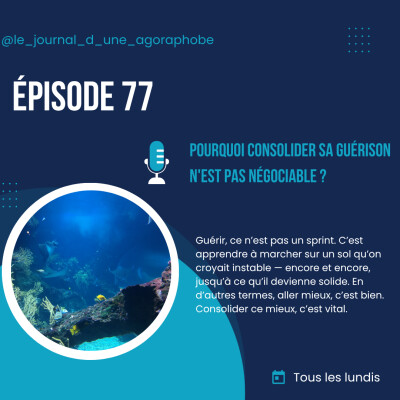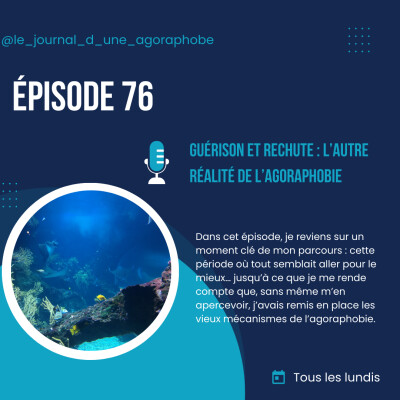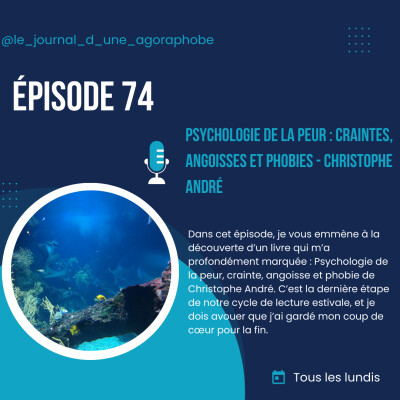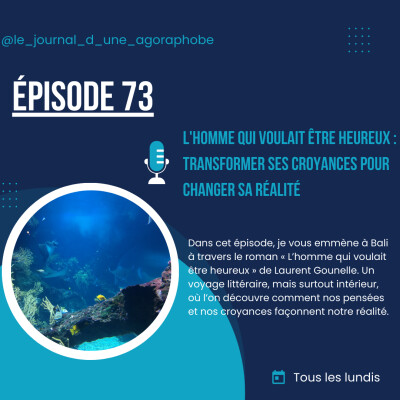- Speaker #0
J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cyrielle Richard, psychologue spécialisée dans la neuropsychologie et dans les thérapies cognitives et comportementales. Au-delà de sa pratique clinique, Cyrielle partage une véritable passion pour la transmission des savoirs. En effet, elle a conçu et animé plusieurs formations sur les TCC et s'est également lancée dans l'écriture avec déjà trois ouvrages publiés. Le premier, savoir pour guérir les troubles du comportement chez les personnes déficientes intellectuelles. Le deuxième, La paranoïa et la schizophrénie paranoïdes, 100 question-réponse. Et le troisième, Histoires insolites de la psychiatrie. Comme il aurait été dommage qu'elle s'arrête là, le quatrième livre n'est pas encore sorti à l'heure où j'enregistre ce podcast. Il sort le 22 août 2025. Il s'intitule Déficience intellectuelle de la compréhension à la prise en charge. Je vous mets toutes ces références ainsi qu'un lien vers le profil LinkedIn de Cyrielle dans les notes de l'épisode. Cyrielle, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour explorer ensemble la psychologie francophone au-delà des frontières françaises et plus particulièrement au Canada, Québec, puisque c'est là que tu résides. Ton parcours universitaire me semble être une porte d'entrée idéale pour aborder le sujet. Tu exerces en tant que psychologue en France depuis 2009, mais j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu as également suivi une formation de troisième cycle en psychologie à l'Université de Montréal dans le cadre d'un processus d'équivalence avec l'Ordre des psychologues du Québec. Cela soulève une question Cyrielle. Un psychologue français doit-il nécessairement passer cette équivalence ?
- Speaker #1
Ok, bon alors déjà, merci beaucoup de me recevoir et puis merci pour cette question qui, je suis sûre, va intéresser beaucoup de monde. Alors, effectivement, pour reprendre un petit peu les différences entre les formations, pour commencer, en France, jusqu'à aujourd'hui, parce que ça peut potentiellement changer, ça fait déjà quelques années qu'on en parle, en fait, la formation de psychologue se fait en cinq ans. Donc, moi, quand j'ai commencé mes études en 2004... on était encore dans le système en fait DEUG, licence, maîtrise. Puis en fait, en cours de route, ça a changé. Donc, on est passé avec la réforme LMD à, licence, master, doctorat. Mais pour exercer en tant que psychologue en France, eh bien, pour le moment, il suffit d'avoir un master 2, donc souvent un master 2 professionnel. Et bien, des psychologues en France choisissent ensuite de poursuivre leur formation avec des diplômes universitaires, certains en s'orientant vers des doctorats, que ce soit pour faire de la recherche ou pas forcément. Mais voilà, globalement, avec le Master 2 professionnel, on peut justement commencer à exercer en tant que psychologue. Au Québec, c'est assez différent puisque, en fait, depuis 2006, il y a eu une réforme qui fait qu'auparavant, les psychologues pouvaient exercer et avoir leur titre à partir de la maîtrise. Et depuis 2006, ça prend un doctorat pour pouvoir avoir le titre de psychologue et exercer. Donc, quand on est psychologue français, et puis qu'on a justement, comme c'était mon cas, simplement un master de professionnel, peu importe le nombre de DU que vous avez fait par la suite, ce qui va être pris en considération, c'est le master de professionnel qui vous a donné le titre. Eh bien, lorsque vous passez au Québec, vous devez justement entreprendre une démarche d'équivalence. Et donc là, c'est l'Ordre des psychologues du Québec qui va étudier votre dossier et qui ensuite va vous faire justement différentes suggestions de cours supplémentaires à suivre. Donc effectivement, comme tu le résumais bien, moi j'ai eu un certain nombre de cours en fait de niveau doctorat à suivre et j'ai notamment eu à faire un projet de recherche. Et donc justement, l'article en lien avec ce projet de recherche est paru là en avril 2025. Et donc, je vous passe le titre en anglais parce que vous allez souffrir avec mon accent, mais en gros, le titre justement en général, c'était pour parler des enjeux de la révélation des troubles de santé mentale au travail. Donc voilà, éventuellement, je pourrais transmettre le lien s'il y a des personnes qui sont intéressées à lire l'article. Donc voilà, pour reprendre un petit peu la question, oui, lorsqu'on est un psychologue français, on est obligé de toute façon, si on veut exercer en tant que psychologue, de soumettre une demande auprès de l'Ordre des psychologues du Québec et qui, par la suite, va demander à ce qu'il y ait un certain nombre de cours à suivre. Dans les cours qui sont demandés de façon obligatoire, il y a le cours justement sur l'éthique et de la déontologie, qui est un cours qui est assez essentiel puisque justement, contrairement à la France où il n'y a pas d'ordre des psychologues en France, il y a un code de déontologie mais, on va dire qu'il y a surtout une valeur symbolique. Au Québec, le code de déontologie des psychologues a force de loi en fait et tout manquement et tout écart par rapport à ces règles d'éthique et de déontologie peut mener à des sanctions, que ce soit des sanctions faites par l'Ordre des psychologues du Québec directement, qui peut justement mener des enquêtes et qui peut retirer justement les autorisations d'exercice, ou que ce soit par la justice, justement, civile, voire pénale en fonction de la gravité des infractions. Donc voilà, il y a un cours obligatoire, c'est celui sur l'éthique et la déontologie. Tout le monde le suit de toute façon. Et puis après, dans les autres cours qui peuvent être régulièrement demandés, il y en a ceux sur les évaluations, ceux sur éventuellement tout ce qui est autour de la supervision. Et puis sinon, moi, ce qu'on m'avait demandé à titre personnel, c'était pas mal de cours autour justement de tout ce qui était les méthodologies de recherche. Et puis également sur les prises en charge groupales et sur les prises en charge plus individuelles. Voilà, donc en quelques mots.
- Speaker #0
Nous avons discuté un petit peu avant de lancer l'épisode. Tu me disais quand même qu'un psychologue qui exerce à Québec ne peut pas exercer dans un autre État. Votre pratique dépend de l'État dans lequel vous vivez.
- Speaker #1
Eh bien, alors exactement. Je vais alors juste pour repréciser par rapport aux auditeurs et auditrices, en fait, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut ne pas forcément connaître lorsqu'on n'est pas sur site, en fait. Alors, le Canada, en fait, est un État fédéral et donc il y a des lois fédérales, mais il y a également des lois spécifiques à chaque État qui compose justement le Canada. Et donc, entre autres, le Québec peut avoir ses propres lois ... Et également, pour les ordres professionnels, il y a des règles spécifiques pour déjà chaque ordre professionnel, mais également chaque ordre professionnel à l'intérieur des différents États du Canada. Et effectivement, l'Ordre des psychologues du Québec a certaines attentes, certaines exigences qui peuvent être différentes de celles éventuellement de l'Ordre des psychologues de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique, et ainsi de suite. Donc effectivement, lorsque par exemple, on va... Imaginons, donc moi je suis membre de l'Ordre des psychologues du Québec, mais si par exemple demain je décidais de déménager à Toronto, donc qui est en Ontario, il faudrait à ce moment-là que je me mette en lien avec l'Ordre des psychologues de l'Ontario, qui très certainement me demanderait à ce moment-là de reprendre un certain nombre de cours. Donc très probablement, j'aurai à nouveau à suivre le cours d'éthique et déontologie de l'Ontario, parce qu'il y a, même si on va dire les grands principes... sont assez similaires, il y a quand même des spécificités à chaque état. Il est peut-être probable également qu'ils me demanderaient de suivre encore d'autres cours universitaires, parce que peut-être que leurs exigences seraient différentes de celles du Québec. Point également important, c'est vrai, auquel je repense la matin que je n'avais pas forcément mentionné quand on discutait auparavant, c'est que, par exemple, imaginons que demain, je revienne en France, mais que je décide de poursuivre mon activité, par exemple, avec des personnes qui vivraient au Québec, en soi, ça pourrait être possible dans la mesure où je suis membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Par contre, si jamais j'arrêtais d'être membre de cet ordre, je ne pourrais plus suivre des personnes qui sont québécoises parce que je ne suis plus membre de cet ordre. Idem, si par exemple, j'avais décidé de suivre des personnes françaises sans être membre de l'Ordre des psychologues du Québec, et que ça aurait pu être possible, puisque, en gros... je suivais des personnes françaises. Mais si, par exemple, en vivant au Québec, je décidais de suivre des personnes qui vivaient au Nouveau-Brunswick, là, ce ne serait pas possible puisque je ne suis pas membre de l'Ordre des psychologues du Nouveau-Brunswick. Voilà, j'espère que je n'ai pas perdu trop de monde avec tout ça. Non, non, non,
- Speaker #0
t'as été super claire. Et alors, une dernière question quand même sur la formation pour toi qui as vu les deux facettes de la pièce. Tu penses... Est-ce que c'est plus efficient en France ou tu vois ça comme plus efficient au Québec ?
- Speaker #1
Alors honnêtement, pour avoir testé les deux systèmes, moi j'ai plutôt la faveur du côté du Québec. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, tout d'abord, il y a une chose qui me semble assez importante à préciser, c'est que j'ai trouvé qu'au Québec, il y avait davantage justement de cours qui étaient axés sur l'aspect scientifique. Chose qu'en France, j'ai trouvé qui était assez limitée. Ensuite, il y a un autre aspect qui me semble assez important, justement, c'est que beaucoup de cours, même des cours des premières années, en fait, étaient assez ouverts aux différentes approches. Honnêtement, moi, dans ma formation initiale en France, j'ai été dans une faculté qui était très psychanalytique. Beaucoup de facs en France sont très psychanalytiques. Ça a bougé un petit peu ces dernières années, mais il y en a encore beaucoup qui sont strictement avec un référentiel psychanalytique. Et donc, j'ai commencé à entendre parler des autres approches. J'étais quasiment à la fin de ma formation. Et encore, c'était essentiellement expliqué pour pouvoir débiner justement l'autre école de pensée. Donc voilà, on va dire que le parti pris était assez marqué. Ici au Québec, c'est différent, dans le sens où... Les différentes approches vont être présentées dès les premières années de formation. Et c'est à partir du doctorat que les étudiants vont être libres à ce moment-là de choisir d'avoir plus de cours selon une certaine approche que selon une autre. Donc par exemple, vous pouvez parfaitement arriver au doctorat en ayant vu un peu à égalité les différentes approches qui existent. Donc la psychodynamique va être présentée, les TCC vont être présentées. Mais également vont être présentés les courants humanistes qui sont beaucoup plus développés au Québec qu'en France, je trouve. Et à partir de là, en fait, donc ça, c'est les trois principaux courants en psychothérapie. Et donc, à partir de là, les étudiants peuvent parfaitement dire si cette approche me parle plus, je prendrai davantage de cours qui sont sur cette approche, tout en gardant des troncs communs qui rassemblent en fait tous les étudiants. Donc, par exemple, dans les différents cours que moi, j'avais eu à prendre, L'Ordre des psychologues du Québec m'a demandé de suivre un cours notamment sur tout ce qui est approche groupale. Moi, de mon côté, j'avais plutôt eu envie de me former à tout ce qui était thérapie de couple. C'était ça que j'avais suivi. C'était un cours de niveau doctorat. On était à peu près une petite dizaine d'élèves. Moi, je suis plutôt d obédience TCC. Mais j'avais dans mes collègues des personnes qui étaient plus d'approche psychodynamique. Donc voilà, ça faisait partie un peu des choses que je trouvais appréciables, c'était le fait qu'on pouvait justement avoir des moments qui étaient rassembleurs, je dirais, des différentes approches, tout comme à côté. Si, par exemple, on souhaitait suivre d'autres cours plus spécifiques d'une approche, on avait cette possibilité-là également. Je reviens un petit peu sur ce que je disais également tantôt quand je parlais d'approche scientifique. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de cours qui sont centrés sur les différentes méthodologies en recherche, justement. Donc, j'ai suivi pas mal de cours. J'ai suivi... Alors, ça a été un peu une... J'allais dire, ça a été un peu compliqué pour moi parce que ça faisait des années que je n'avais pas fait de statistiques, mais j'ai eu des cours à suivre, je dirais. Là-dessus, j'ai eu également pas mal de cours sur tout ce qui était les méthodologies de recherche. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément fait en France. Les statistiques, je les avais vues... Alors, évidemment, je les avais vues au lycée, mais je les avais vues après, en première année de DEUG, et je crois que ça, c'était... arrêté là, globalement. Je vous avoue que j'étais soulagée parce que je n'aime pas spécialement ça, mais voilà. Mais honnêtement, je trouve que justement, ça c'est quelque chose qui manque, je dirais, au niveau de la formation en France. Je trouve qu'on n'est pas assez orienté vers une approche scientifique. Et s'il y a bien une chose, je dirais que la crise du Covid et de la pandémie nous ont appris, c'est à quel point nous avons besoin, justement, d'avoir une base scientifique commune. Ne serait-ce que pour pouvoir savoir lire une étude, pouvoir comprendre aussi la méthodologie des chercheurs, mais aussi pouvoir identifier les éventuels biais de la recherche et pouvoir dire tout de suite, OK, là, ces résultats-là sont valides parce que, justement, il y a une bonne validité interne, externe et tout ça. Ou de dire au contraire, ben voilà, ces résultats, en gros, on ne peut pas vraiment les considérer, en tout cas, on ne peut pas les prendre comme étant pour argent comptant parce que, justement, il y a tel et tel biais qui n'ont pas été pris en compte. Parce que justement, il manque également tels et tels éléments pour garantir la validité et ainsi de suite. Donc vraiment, je trouve que c'est ça. Pour moi, ça a vraiment été ça, les deux grosses différences. Numéro un, la culture qui est beaucoup plus scientifique. Numéro deux, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture justement aux différentes approches avec un tronc commun. Et puis ensuite, une liberté laissée aux étudiants d'aller ensuite vers l'approche qui leur parle le plus, mais tout en gardant ce tronc commun. Voilà.
- Speaker #0
Je ne savais pas que la formation était si radicalement différente ? C'est vrai qu'on aurait pu faire un épisode uniquement sur la formation, mais peut-être qu'on en refera un, un jour uniquement sur la formation.
- Speaker #1
Alors, un autre point aussi qui était très différent, là par contre, au niveau du Québec et au niveau de la France, c'est le temps qui est donné également au stage et comment on reconnaît également le stagiaire pendant justement sa période de formation. Point important. Toutes les facultés en France n'ont pas forcément les mêmes règles, mais moi, dans celle dans laquelle j'étais, nous avions des stages à partir de la licence, donc la licence 3 en l'occurrence. Et ensuite, nous avions différentes exigences à remplir en tant que stagiaire selon qu'on était en licence, en master 1 ou en master 2, et ainsi de suite. Au Québec, les stages arrivent plus tardivement, je dirais, dans la formation. Par contre, il y a... beaucoup plus d'heures qui est donnée au stage. Et pareil, le stagiaire n'est pas considéré et n'est pas accompagné de la même façon selon le moment où il en est dans sa formation. Les premiers stages se font souvent auprès d'équipes qui sont rattachées à l'université, avec une très grande part qui est laissée justement à la supervision des stagiaires, ce qui n'est pas forcément le cas en France, où on laisse beaucoup ça en fait. Alors, il y a quelques cours, je dirais, de supervision à l'université, mais c'est beaucoup après, au lieu de stage, de fournir un peu la supervision ou pas, puisqu'il n'y a pas tant de règles vraiment établies, à ma connaissance en tout cas. Pour ce qui est du Québec, au contraire, voilà, comme je disais, les premiers stages sont beaucoup justement orientés sur des approches plus d'observation, de supervision et ainsi de suite, avec justement, comme je disais, un accompagnement qui est assuré par des personnes qui sont rattachées à l'université et puis plus... l'étudiant progresse dans sa formation, plus il va avoir des heures de pratique qui vont lui être demandées. Et donc finalement, à la fin, l'étudiant, quand il sortira diplômé, il aura fait 1600 heures soit en tant que stagiaire, soit en tant qu'interne, et ainsi de suite. Ce sera le format global, sachant qu'il peut en faire éventuellement plus, parce qu'il y a des passerelles aussi pour pouvoir faire après d'autres types d'activités, mais bon voilà, c'est pour vous dire. En France, globalement, en tout cas dans l'université dans laquelle j'étais, c'était le premier stage, j'étais à 200 heures. Le deuxième, c'était 300 heures. Et le tout dernier, c'était à 500 heures. Donc voilà, ça c'est encore d'autres petites choses, sachant que toutes les universités n'ont pas les mêmes exigences en termes de stage. Certaines vont demander des stages qu'à partir de la maîtrise, du Master 1, je veux dire. D'autres, dès la licence. Je sais que l'école des... Des psychologues praticiens, donc psychoprates, eux, demandent des stages dès la toute première année d'études. Enfin, voilà, vraiment, les règles peuvent être différentes d'un endroit à l'autre. Autre point important, c'est qu'au Québec, comme il y a une grosse pénurie, justement, au niveau des secteurs de la santé, les étudiants, en fait, en psychologie, quand ils arrivent au doctorat, peuvent, en fait, demander une bourse qui va, en fait, les rémunérer le temps qu'ils fassent leur stage. Alors, ils sont évidemment sous condition. Entre autres, il faut qu'ils puissent faire leur stage dans le secteur hospitalier. Pareil, l'accompagnement des étudiants pour trouver le stage est également beaucoup plus encadré au Québec qu'en France. En France, c'était un petit peu débrouillez-vous, quoi, en fait. Tandis qu'au Québec, au contraire, les universités ont un peu un pool d'endroits où elles peuvent envoyer leurs étudiants en stage. Donc, bien souvent, ça va être, comme je disais, dans des services hospitaliers. ça va être également dans d'autres institutions qui vont être... rattachées plus ou moins à l'université. Et également, il y a en fait des temps qui sont dédiés justement pour que les étudiants fassent leurs entrevues de stage et ainsi de suite. Enfin voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux cadré et accompagné pour les étudiants québécois que ce que j'ai vécu moi en France. Bon, après moi, comme j'étais en tant que candidate justement pour l'obtention de mon permis, ce qui fait que j'ai pas fait... Toutes ces démarches-là, moi, ça s'est passé différemment, mais les collègues que j'avais dans certains de mes cours en doctorat m'avaient expliqué comment, pour eux, ça se passait, justement, et donc c'est ça que je vous restitue là.
- Speaker #0
Tu me permets une transition ? Oui.
- Speaker #1
Une transition.
- Speaker #0
En tant qu'ancienne agoraphobe, je me suis rendue compte que ma psy ne communiquait pas avec mon médecin, que mon médecin ne communiquait pas avec ma psy, que mon médecin ne communiquait pas avec mon psychiatre. Ça, c'est compliqué parce que toi, tu es là, tu es au milieu, tu es un peu paumé puisque tu ne connais pas... tout ce qu'ils connaissent, toi, tu ne le connais pas. Et tu es en train de me parler de milieu hospitalier. Est-ce que tu es en train de me dire que la coordination et que la communication entre les différents membres du corps médical est fluide comme ça ?
- Speaker #1
Alors, là-dessus, tu vois, moi, je ne travaille pas en hôpital. Donc, je ne pourrais pas te dire précisément. Par contre, moi, je travaille en libérale. Et là, pour le coup, je peux te parler de comment ça se passe. Parce que justement, je suis un peu en plein dedans pour diverses raisons. En fait, si tu veux. Donc là, par exemple, moi, je travaille en tant que psychologue, donc en libéral. Je reçois... des personnes. Je travaille dans une clinique qui est spécialisée autour des troubles anxieux. Donc voilà, pour le coup, c'est assez bien. Je connais bien le sujet, on va dire. Donc imaginons, par exemple, que je reçois une personne qui, par exemple, peut souffrir d'agoraphobie. Why not ? Cette personne, on va dire qu'elle est suivie par un médecin ou par un infirmier en pratique avancée, puisque c'est une autre spécialité un petit peu. Une autre spécificité, je dirais, du Québec, c'est que les psychologues et même ce qu'on appelle les infirmiers en pratique avancée sont avec également des missions que n'ont pas forcément les psychologues français ni les infirmiers, y compris les infirmiers, justement, les super infirmiers, entre guillemets, qu'on a formés récemment. Et donc, par exemple, on va dire que la personne, pour une raison x ou y, va être, par exemple, en arrêt de travail. D'accord ? Eh bien, imaginons... que, par exemple, son médecin ou l'infirmier veuillent communiquer avec moi. Alors, sur le principe, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que je demanderais en amont, avant de rentrer en contact avec ces personnes-là, c'est que la personne me signe une décharge, en fait, pour dire qu'officiellement, elle m'autorise à entrer en communication avec ces personnes-là. Et pareil, je dois également m'assurer de son consentement par rapport aux informations qu'elle veut bien que je transmette. Donc, bon. généralement les gens disent voilà qu'ils sont ok sur tout alors après je reprends un peu pour dire peut-être sur le principe comme ça mais il y a peut-être des choses que tu n'as peut-être pas envie que j'aborde quand même donc on va refaire un point sur les différentes choses et puis tu me diras si tu es ok que je parle de ça ou pas et ainsi de suite voilà et donc à partir du moment où il y a le consentement je dirais et que justement c'est validé là avec la signature de cette décharge disant qu'elle m'autorise à entrer en communication avec ces personnes, à ce moment-là, on peut justement se programmer une rencontre ou un appel. Là-dessus, c'est ouvert. C'est la même chose, je dirais, avec d'autres par exemple interlocuteurs. Ça peut arriver, par exemple, on reprend le cadre de l'arrêt de travail. Imaginons que la personne est en arrêt de travail. On va dire qu'il y a un arrêt qui doit être assez long. Son assureur, puisque ici, c'est beaucoup un système assuranciel. son assureur prend en charge justement tout ce qui va être certains frais, le temps de son arrêt. L'assureur peut éventuellement faire la demande de rentrer en communication avec moi, par exemple. Eh bien, là-dessus, c'est la même règle. C'est-à-dire que globalement, moi, je peux effectivement échanger avec l'assureur en question, mais c'est seulement si j'ai la validation de la personne, si elle m'a autorisé justement à transmettre les informations en question. Et encore une fois, il faut s'assurer toujours du consentement parce que la personne peut très bien dire « oui, je veux bien que tu communiques avec l'assureur sur tel point, tel point, tel point » parce que c'est cohérent avec, par exemple, l'arrêt de travail, mais pas sur tel point, tel point, tel point, parce que ça, c'est d'ordre privé et que, effectivement, ce n'est pas pertinent par rapport à l'enjeu de l'arrêt de travail. Voilà, c'est globalement le truc.
- Speaker #0
les différences de fonctionnement sont passionnantes Moi, j'ai eu un cas différent. C'est, par exemple, ma psy, un jour, m'a dit, je pense qu'un traitement serait nécessaire. Naïvement, je vais voir mon généraliste. Mon généraliste me regarde, Bon, il me connaît depuis un certain nombre d'années. Et il me dit, mais non, c'est un petit coup de mou. Donc, du coup, il ne m'a pas prescrit ce traitement, qui était nécessaire. Donc, je l'ai eu après. Je n'ai jamais compris pourquoi ma psy n'avait pas appelé. Elle savait, elle savait pertinemment qu'à un moment donné, il fallait que je prenne ce traitement. Et je n'ai jamais compris pourquoi lui n'avait pas contacté. Pourquoi il n'y a pas eu de communication autour de ma psy en fait ?
- Speaker #1
Ça après, je ne pourrais pas dire pour les autres, mais tu vois, quand tu en parlais, ça me rappelle une situation que j'avais vécue en France. Ou un peu pareil, là, c'était pour une question d'hospitalisation où je trouvais que la personne était vraiment très mal et qu'une hospitalisation, justement, serait nécessaire pour son bien. La personne, en gros, j'en avais parlé, elle était ouverte. Bon, j'avais contacté le médecin traitant pour lui en parler, justement, avec l'accord de la personne et tout ça. Le médecin traitant m'avait dit « Ah oui, oui, je vous soutiens » . Et ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là, en gros. Moi, je savais qu'il me soutenait, c'était gentil. En tant que psychologue, je ne peux pas demander l'hospitalisation des gens. En gros, ça s'était conclu que la personne devait elle-même se rendre à l'hôpital pour demander l'hospitalisation. C'est juste que ça aurait été quand même beaucoup plus aidant si on avait pu avoir un prière d'admettre ou un truc comme ça. Mais voilà, en gros, ça s'était... Je reste marquée par le gars, il était très gentil, ce n'est pas le problème. Le médecin était vraiment... Voilà, il était fort... Agréable, au téléphone c'est pas le problème, mais c'est juste qu'ils me disaient « bah oui, Merci pour votre soutien. Il ne s'est pas passé à l'acte, c'est ça ? Non, c'est ça. En fait, il n'y a pas eu de suite. Je suis toujours ravie de savoir que mes arguments étaient frappés au coin du bon sens, visiblement, mais pas assez pour qu'on passe à l'action. La perception,
- Speaker #0
aller chez un psychologue au Québec, et Est-ce qu'il y a des tabous autour de ce sujet ? Parce que j'ai cru comprendre en début d'interview que tu avais fait, alors nous on appelle ça un mémoire en France, mais je ne suis pas sûre que ça s'appelle comme ça au Canada, sur la perception des maladies mentales au travail.
- Speaker #1
Oui, en fait, j'ai envie de dire, est-ce que c'est plus ou moins tabou ? C'est un peu difficile à dire, parce que j'ai envie de dire que ça dépend en fait des maladies, ça dépend également... de l'environnement dans lequel baigne la personne et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment multifactoriel. Point, par contre, pour revenir à une question qui était est-ce que les gens au Québec viennent plus facilement consulter ? Dans un sens, j'ai envie de dire, ils ont plus de facilité à venir en consultation pour plusieurs raisons. Au Québec, je dirais, il y a cette culture assez nord-américaine, je dirais, où tout est basé beaucoup sur un système assurantiel. C'est-à-dire, il y a... évidemment, des aides de l'État, mais qui sont quand même beaucoup moins présentes que ce qu'on a en France. Et donc, beaucoup de... Enfin, beaucoup, là, j'ai l'impression que la majorité des employeurs, en fait, proposent des assurances à leurs employés. Et les personnes qui n'ont pas forcément une assurance par leur employeur prennent des assurances par elles-mêmes. Et c'est assez essentiel, justement, pour pouvoir prendre en charge tous les frais de santé. Et, point important, c'est que... Je ne peux pas dire tous parce que je ne les connais pas tous, mais je dirais que la grosse majorité des assurances propose justement des forfaits autour de tout ce qui est dédié à la psychothérapie et justement à la prise en charge des troubles de santé mentale. Ça, c'est une différence, je dirais, par rapport à la France, où en gros, nous avons un système avec, évidemment, la sécurité sociale et puis à côté des mutuelles. Mais les mutuelles, par exemple, ne vont pas forcément... inclure de forfaits psy ou alors elles vont inclure une espèce de forfait fourre-tout dans lequel certes on peut aller voir un psy, mais alors vraiment c'est pinuts je dirais par rapport à ce que c'est les frais pour pouvoir avoir une psychothérapie je dirais. Et souvent comme je dis c'est un peu fourre-tout dans le sens où vous avez bah vous pouvez consulter un psy mais tout comme vous pourriez consulter un autre professionnel et ce sera la même somme en gros qui vous sera allouée par votre mutuelle pour ça. Les assurances ici par contre ont un vrai forfait dédié justement aux soins en psychologie et en psychothérapie qui est totalement indépendant des frais qu'elles vont allouer pour aller voir un dentiste, pour aller voir un ophtalmo, pour aller voir un autre type de professionnel de la santé ou même un autre type de professionnel qui va vous accompagner sur le plan de la santé psychologique ou même au niveau social. Ça, je dirais que ça peut favoriser justement le fait d'aller consulter. Malheureusement, il y a encore, je dirais, une grosse différence entre le secteur public et le secteur privé. Au niveau du secteur public, il y a quand même des très très longs temps d'attente. Et c'est vrai que si, par exemple, vous êtes une personne qui vit sur ce qu'on appelle le bien social ici au Québec, c'est-à-dire avec les aides sociales et tout ça, vous ne pouvez pas forcément vous permettre d'aller voir une personne en libéral. Et donc, automatiquement, vous devez attendre d'avoir éventuellement une place qui se libère au public et ça peut se chiffrer en années. Malheureusement, pour avoir travaillé dans différentes régions de France, j'ai envie de dire qu'on a un peu ce problème-là aussi, notamment pour le secteur des enfants, où j'ai travaillé justement en centre médico-psycho-pédagogique, donc CMPP, et où... où clairement, le temps d'attente se chiffrait à 18 mois, 2 ans, facilement. Et encore, j'ai entendu dans d'autres régions qu'on pouvait aller encore plus loin en temps d'attente.
- Speaker #0
Je résume. Donc, si on a une assurance maladie, aller voir un psychologue, ce n'est pas un luxe. Ça rentre dans les mœurs, puisqu'il y a une bonne partie des consultations qui sont remboursées. Je sais que c'est quand même beaucoup plus rare en France. Et ensuite, il y a deux systèmes, un système public et un système privé. Le système public... fournit ces séances de thérapie par contre il peut y avoir jusqu'à deux ans d'attente ?
- Speaker #1
J'allais dire en moyenne, oui, parce que ça peut être plus long. Mais oui, je pense que je crois qu'en moyenne, c'est ça, c'est au moins dans les deux ans, voire peut-être plus loin d'attente pour pouvoir accéder. Sachant que, par contre, une fois que vous êtes rentré, justement, imaginons, on vous appelle pour vous dire, oui, vous pouvez avoir une place, à ce moment-là, on peut vous proposer différentes choses en fonction de vos besoins, mais aussi en fonction de la première rencontre, je dirais, de bilan qui aura été faite. Par exemple, on peut tout à fait dire, là, vous allez faire, par exemple, tant de séances, par exemple, en groupe, ou vous allez avoir tant de séances en individuel. Enfin, voilà, là-dessus, c'est… Après, c'est un peu des propositions qui sont faites au cas par cas, et aussi en fonction du besoin de la personne et de ce qui aura déjà été fait auparavant.
- Speaker #0
Et dans le privé, le temps d'attente ?
- Speaker #1
Je dirais là, ça dépend vraiment de plein de facteurs. Alors, entre autres, ça peut dépendre de là où vous habitez. Dans le sens où, par exemple, imaginons qu'une personne habiterait Montréal, par exemple. Bon, à Montréal, on a quand même pas mal, je dirais, de cliniques privées et tout ça. Donc, je pense que la personne peut, globalement, selon les périodes de l'année et ainsi de suite, peut-être qu'elle aura un temps d'attente de quelques semaines, mais ça peut aller relativement vite, je dirais. Ce n'est pas la même chose si, par exemple, vous êtes dans des régions un petit peu plus rurales où là, vous avez potentiellement moins de services ou en tout cas, peut-être moins d'opportunités à proximité. Je pense que les auditeurs, auditrices pourront s'amuser à les regarder sur la carte, si ça les intéresse. Moi, je travaille sur Montréal, mais ça peut m'arriver, par exemple, d'avoir en visio des personnes qui sont en Abitibi, par exemple. Alors, ce n'est clairement pas la porte d'à côté, je dirais. Heureusement que la Visio s'est démocratisée. Mais pourquoi est-ce qu'on en est là ? C'est parce que justement, ces personnes-là en question n'ont pas forcément accès à des professionnels à proximité de chez elles. Il n'y a pas longtemps, j'ai été contactée également par une autre personne qui est plutôt du côté du Saguenay. C'est une très belle région, très touristique, tout ça. Mais c'est clair que c'est un peu un territoire où on manque de personnel et Il y a quelques temps, je regardais à la télé, justement, c'est valable aussi pour le secteur public, je ne me souviens plus précisément du nom du lieu, mais en gros, ils alertaient en disant qu'il y allait avoir justement un centre public qui risquait de fermer, parce qu'en gros, les derniers professionnels étaient tous en fin de carrière et que globalement, ils ne trouvaient plus de personnes qui allaient pouvoir être recrutées comme ça. Donc, ils alertaient en disant, voilà, il faut absolument qu'on se mobilise parce que... ce centre-là, qui est un centre public, justement, risque d'être fermé si on n'agit pas pour faire venir des professionnels. J'allais dire même, malheureusement, ça c'est un autre point dont on n'a pas forcément conscience, parce que c'est vrai que quand on est en France, quand on pense au Québec, on pense beaucoup aux grosses métropoles, mais il faut savoir qu'il y a des territoires au nord du Québec qui sont majoritairement des territoires avec des populations autochtones. Et ces territoires du Nord, en fait, malheureusement, sont un peu coupés du reste, j'ai envie de dire, du Québec, dans le sens où on y accède relativement difficilement. Il faut souvent passer par un avion, tout ça. Et de même, en fait, ces territoires-là ont extrêmement du mal à recruter des professionnels pour le système public. Ce qui fait que, bien souvent, ils vont offrir certains contrats aux professionnels, mais il va y avoir un turnover assez important parce que, bah, et bien... conditions de vie assez compliquées. Plus, c'est du travail aussi avec des populations qui sont souvent laissées pour compte avec des problématiques de santé qui peuvent être complexes et qui peuvent être chroniques. Et plus aussi le fait que malheureusement, c'est des territoires qui sont aussi peu accessibles mais aussi peu développés, ce qui fait que pour les conjoints, par exemple, qui ne sont pas forcément des professionnels de santé ou autre, ça peut être compliqué de trouver aussi un emploi. Et même pour après, pour soi-même, si jamais on a besoin d'avoir accès à certains services, ça peut être compliqué également. Ça crée des disparités aussi qui font que les gens auront peut-être moins facilement accès à certains services, dont des services de santé mentale.
- Speaker #0
Le Québec a également ses déserts médicaux.
- Speaker #1
Voilà, exactement. Et pour le coup, c'est pas... C'est plus dramatique qu'en France, je dirais, en l'occurrence, parce qu'il y a les conditions climatiques qui peuvent aussi aggraver la situation.
- Speaker #0
Alors, j'aimerais, parce que je crois que le temps passe... et que tu as une consultation. Bon, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais une anecdote, j'aimerais une anecdote ou une expérience particulière qui illustre bien cette spécificité entre le Québec, cette spécificité de pratique entre le Québec et la France ?
- Speaker #1
Je vais te donner un exemple. C'est qu'en fait, depuis cette année, c'est vraiment très récent, les psychologues peuvent, au Québec, faire des arrêts maladie et peuvent les renouveler également. Et ça, c'est vrai. Alors, c'est une nouveauté de cette année, mais j'ai envie de parler de cela. Pourquoi ? Parce que justement, ça montre aussi la différence de statut et de reconnaissance des psychologues au Québec par rapport à la France.
- Speaker #0
Alors,
- Speaker #1
certes, ça arrive aussi dans un contexte où on a une grosse pénurie de médecins. J'ai envie de dire, là, la pénurie de médecins, elle est mondiale. Mais, je dirais, contrairement à la France, où parfois la logique de nos gouvernants m'échappe un petit peu, j'avoue, au Québec, ils se sont posés la question de « Ok, comment est-ce qu'on peut justement pallier à cette pénurie de médecins ? » Et en gros, ça a été justement en reconnaissant davantage l'expertise des professionnels des autres spécificités. Donc, comme je disais, par exemple, pour ce qui est des arrêts maladie, les psychologues sont habilités à les faire, mais également les infirmières en pratique avancée peuvent le faire également. Enfin, voilà, ça n'arrange pas la pénurie de médecins, j'ai envie de dire, mais au moins, ça permet de ne pas laisser sur le carreau indéfiniment des personnes qui seraient justement en souffrance et qui auraient besoin qu'on leur apporte des réponses ou qu'on puisse justement leur apporter des opportunités. également de se distancier peut-être d'un environnement de travail qui contribue au fait qu'elle soit peut-être pas très bien psychologiquement. Donc voilà, j'ai envie d'utiliser un peu ce texte comme ça.
- Speaker #0
Cette reconnaissance, donc si vous êtes habilité à effectuer des arrêts maladie, cette reconnaissance, donc effectivement, c'est une vraie reconnaissance du statut de psychologue, et en fait cette reconnaissance, j'allais te dire, de l'œuf ou de la poule, est-ce que c'est votre formation ? qui vous permet au Canada, au Québec, d'avoir cette reconnaissance. Chez nous, là, tu es en train de me dire un truc. En France, ça me paraît impensable. C'est toujours les mêmes antidépresseurs qui sont prescrits, mais même s'ils sont légers, un psychologue ne peut pas les prescrire. Et là, c'est vraiment… Ça paraît, vu de France, ça paraît hallucinant, en fait, qu'un psychologue fasse un arrêt maladie.
- Speaker #1
En fait, justement, c'est parce qu'ici… les psychologues sont habilités à poser un diagnostic. Pareil, je reviens un petit peu aux distinctions, c'est-à-dire qu'en France, on est parfaitement formé, justement, pour pouvoir identifier les troubles. On est parfaitement formé également pour pouvoir les identifier, mais on pourrait aussi poser un diagnostic pour tout ce qui est troubles de santé mentale. Le fait est que cela ne nous est pas reconnu, ce qui fait que, par exemple, même si... En France, par exemple, je rencontrais une personne et que je faisais mon bilan et que je voyais effectivement que tous les signaux, on va dire, pour, par exemple, je vais dire un trouble panique, par exemple, était là ou un épisode dépressif était là. En soi, je ne pourrais pas lui dire, ben voilà, vous avez un trouble dépressif là. Je serais obligée de dire, voilà, les signes sont évocateurs de, je vous encourage à voir votre médecin. Je suis liée, par contre, à l'impossibilité de donner justement le diagnostic et ainsi de suite. Ici, au Québec, c'est différent dans le sens où justement on nous reconnaît cette expertise officiellement et que donc, nous avons la possibilité de poser le diagnostic. Nous, nous pouvons dire, voilà, je rencontre monsieur, madame, un tel, voici tous les éléments, ta-ta-ta-ta-ta-ta, voici les différentes évaluations que j'ai pu faire, ta-ta-ta-ta-ta, et donc, eh bien, à la lumière de ces différents éléments, nous pouvons dire qu'elle a, voilà, tel trouble, éventuellement. Et donc, effectivement, si par exemple, la personne, dans le cadre du suivi, il s'avère qu'elle a telle ou telle difficulté et qu'un arrêt de travail pourrait être bénéfique pour elle, oui, nous avons la capacité au Québec de justement le proposer, en fait. Chose qui n'est pas effectivement dans les mœurs en France. Et comme je disais, là, ça s'inscrit aussi dans une logique, ça s'inscrit aussi parce qu'il y a un ordre des psychologues du Québec qui est reconnu comme étant un interlocuteur par le gouvernement. Chose également que nous n'avons pas en France. Je pense notamment lorsqu'il y a eu justement les rencontres par rapport au dispositif MonPsy, il n'y a pas eu, à ma connaissance, de rencontres préalables avec des organisations ou des syndicats de psychologues. C'est quand même assez questionnant que le gouvernement français veuille faire des lois autour de la santé mentale, veuille monter des dispositifs dans lesquels le psychologue est censé être on va dire l'acteur principal, sans rencontrer aucune organisation qui regroupe des psychologues. Voilà. Mais rencontre des tas d'autres organisations professionnelles pour parler justement du travail des psychologues, de comment les psychologues interviendraient dans tel ou tel dispositif. Je trouve que c'est vraiment deux mentalités différentes.
- Speaker #0
Oui, c'est vrai qu'effectivement, nous, on n'a pas eu de concertation, mais ça a été pareil pour tout. Je crois que ça a été pareil pour les professeurs. Après le Covid, ils n'ont pas été consululté sur comment les enfants allaient passer le bac. Il y a eu une annonce à l'époque, c'était Blanquer, une annonce de la manière dont le bac allait se dérouler, sans que les profs soient au courant.
- Speaker #1
Oui, je me souviens de ça. En fait, les gens l'avaient découvert dans la presse, effectivement. Enfin, voilà. C'est ça. C'est ça.
- Speaker #0
Les professeurs ont découvert dans la presse comment les enfants allaient passer le bac. Donc, en fait, on est accoutumés du fait, finalement. Donc, je sais, Cyrielle, je sais que tu as une consultation. C'est passionnant. C'est vrai que c'est vraiment... Je vois que... Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de différences, en fait. Mais je dois te laisser, parce que je sais que tu as une consultation. En tout cas, je te remercie énormément de nous avoir apporté tous ces éclairages. Je rappelle qu'il y a une sortie d'un livre le 22 août. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre ?
- Speaker #1
Oui, bien sûr. Donc, ce sera chez Deboeck Supérieur. Et donc, c'est Déficience intellectuelle, de la compréhension à la prise en charge. Voilà, vous ne laissez pas rebuter par le titre, entre guillemets. On parle beaucoup justement de tout ce qui va être compréhension et des handicaps rares, comme par exemple certains syndromes qui ne sont pas forcément très bien connus du grand public. Je pense notamment au syndrome de Dravet ou de Cornelia Delange. Mais je vais également parler de tout ce qui va être trouble du neurodéveloppement. Et puis, ce sera aussi l'occasion d'aborder tout ce qui va être justement les programmes de remédiation cognitive, mais également tout ce qui va être autour des prises en charge en psychothérapie, parce que c'est important d'avoir en tête que les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement, un handicap rare, quel qu'il soit, peuvent également être vulnérables face aux troubles psychologiques tels que les troubles anxieux, la dépression et bien d'autres également. Et que oui, nous pouvons assurer des prises en charge en psychothérapie, c'est juste qu'il faut avoir conscience de certaines adaptations qui sont cohérentes aussi avec leurs besoins particuliers. Donc voilà, ce sera tout ça qui sera abordé dans le livre.
- Speaker #0
Moi, je souhaite vraiment un beau succès à cet ouvrage, un magnifique succès à cet ouvrage. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis encore merci beaucoup de ta présence et je souhaite également une excellente journée à nos auditeurs.
- Speaker #1
Merci beaucoup.
- Speaker #0
Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du journal d'une agoraphobe.
- Speaker #1
Merci beaucoup. Bonne journée.